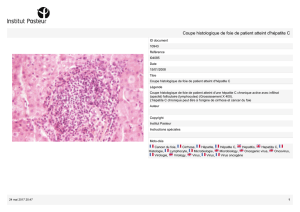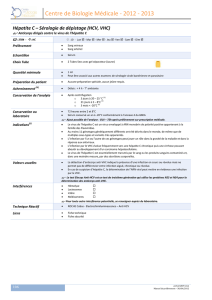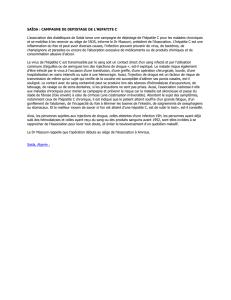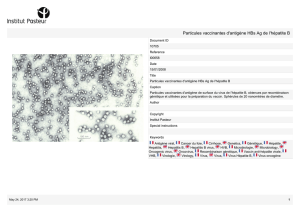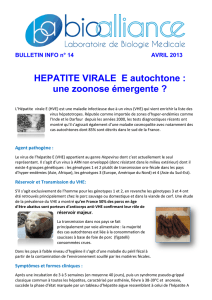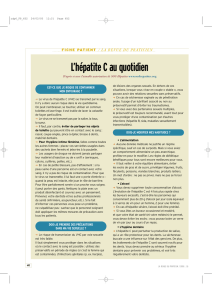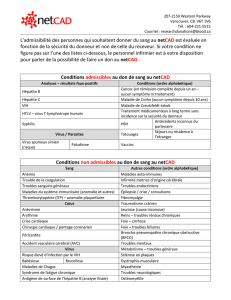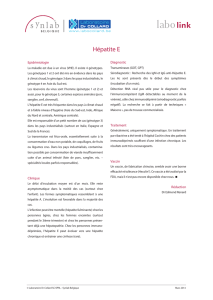Hépatite E autochtone, une pathologie émergente : à propos d`un cas

Journal Identification = ABC Article Identification = 0822 Date: May 31, 2013 Time: 12:15 pm
doi:10.1684/abc.2013.0822
349
Pour citer cet article : Mais L, Gerome P, Tesse S, Vincent E. Hépatite E autochtone, une pathologie émergente : à propos d’un cas. Ann Biol Clin 2013 ; 71(3) : 349-51
doi:10.1684/abc.2013.0822
Biologie au quotidien
Ann Biol Clin 2013 ; 71 (3) : 349-51
Hépatite E autochtone, une pathologie émergente :
à propos d’un cas
Autochtonous hepatitis E, an emerging infection: case report
Laetitia Mais1
Patrick Gerome2
Sylvie Tesse3
Edmond Vincent1
1Service d’hépato gastroentérologie,
HIA Desgenettes, Lyon, France
2Fédération de biologie clinique, HIA
Desgenettes, Lyon, France
3CNR Hépatite E Hôpital du Val de
Grâce, Paris, France
Article rec¸u le 19 juillet 2012,
accept´
e le 15 octobre 2012
Résumé. L’hépatite E est une infection rare en France mais sa fréquence crois-
sante en fait une infection émergente. Les formes autochtones prédominent,
concernent essentiellement l’adulte de plus de 40 ans et sont dues majoritaire-
ment au génotype 3f. Face à une hépatite aiguë, ce diagnostic doit être évoqué,
y compris en l’absence de voyage récent en pays endémique. Il repose sur
l’association de la sérologie (IgM et IgG anti-VHE, et dans certains cas l’index
d’avidité des IgG) et de la RT-PCR (sur selles ou sérum) devant être pratiquée
précocement et probablement en première intention sur un terrain à risque.
Mots clés : hépatite E, sérologie
Abstract. Hepatitis E is rare in France but its increasing frequency makes it
an emerging infection. Autochtonous hepatitis E is prevalent, largely confined
to older men and currently caused by gentotype 3f. Patients with unexplained
hepatitis should be tested by hepatitis E, even in the absence of travel from
endemic areas. The diagnosis is based on serological testing (including detection
of specific antibodies IgM and IgG, and sometimes by determination of antibody
avidity) and nucleic acid amplification techniques which might used first.
Key words: hepatitis, serology
Dans les pays industrialisés, devant un tableau d’hépatite
aiguë, l’hypothèse d’hépatite E devrait être systéma-
tiquement évoquée devant la négativité d’un bilan
sérologique initial bien conduit (principaux virus respon-
sables d’hépatite aiguë), y compris en l’absence de facteurs
favorisant cette infection. L’observation rapportée en est
une illustration.
L’observation
Nous rapportons le cas d’un homme de 82 ans, cauca-
sien, militaire à la retraite, hospitalisé dans notre service
pour ictère. Le patient avait pour antécédent une car-
diopathie ischémique, une hypertension artérielle, une
dyslipidémie, une bronchite chronique post-tabagique, une
insuffisance rénale et un carcinome urothélial non infiltrant
non traité. Il n’avait pas d’habitudes toxiques, notamment
pas d’alcoolisme chronique, et n’avait pas introduit de nou-
veaux médicaments. Le vaccin anti-hépatite B était à jour.
Le patient n’a rapporté aucun voyage récent à l’étranger, ne
rapporte pas de modification des habitudes alimentaires, ne
vit pas en présence d’animaux domestiques et ne pratique
pas la chasse. Il n’a pas bénéficié de transfusion sanguine
dans les trois mois précédant l’apparition des symptômes.
Il a présenté un ictère cutanéo-muqueux apparu quelques
jours avant l’hospitalisation, sans signes associés notam-
ment en l’absence de fièvre. L’examen clinique n’a pas
retrouvé de signes d’hépatopathie chronique. Le bilan bio-
logique a mis en évidence une cytolyse hépatique (ASAT :
5 N et ALAT : 6 N), un ictère cholestatique à bilirubine
conjuguée à 230 mol/L sans syndrome inflammatoire et
sans insuffisance hépatique (TP à 88 %). L’échographie
hépatique normale orientait vers une hépatite aiguë. Les
hépatites alcoolique et médicamenteuse ont été éliminées
par l’interrogatoire fiable du patient. Le bilan complé-
mentaire a permis d’écarter une étiologie virale commune
(absence d’argument biologique en faveur d’une infection
par les virus des hépatites A, B, C, par le virus d’Epstein
Barr et le cytomégalovirus) et auto-immune. La recherche
d’une infection par le virus de l’hépatite E en deuxième
intention révélait la présence d’IgM et d’IgG anti-VHE ;
la recherche d’ARN du VHE sur plasma confirmait le
diagnostic et permettait d’identifier un virus de génotype
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = ABC Article Identification = 0822 Date: May 31, 2013 Time: 12:15 pm
350 Ann Biol Clin, vol. 71, n◦3, mai-juin 2013
Biologie au quotidien
3f. Le patient a bénéficié d’un traitement symptoma-
tique excluant les traitements hépatotoxiques et d’une
surveillance biologique des paramètres hépatiques jusqu’à
normalisation de ceux-ci. L’évolution a été spontanément
favorable ; le patient a quitté le service au trentième jour
après normalisation du bilan hépatique. Le patient n’a pas
été revu en consultation, celui-ci vivant à présent en insti-
tution médicalisée.
La reprise de l’interrogatoire a posteriori révélait une
consommation de figatelles crues et de produits à base
de porc apparaissant comme le vecteur de contamination
le plus probable. Cependant, en l’absence d’échantillons
alimentaires, cette hypothèse ne peut être confirmée.
Discussion
Le virus de l’hépatite E (VHE) est connu depuis 1978. Il
s’agit d’un virus du genre Hepevirus, de la famille des Hepe-
viridae. Il existe cinq génotypes dont un génotype aviaire
[1].
Il sévit selon deux modes épidémiologiques. L’expression
sur un mode épidémique concerne les pays émergents où
l’hépatite E est avant tout une maladie du péril oro-fécal.
Cette contamination est responsable de cas sporadiques
d’importation dans les pays industrialisés. Les génotypes
principalement retrouvés sont les génotypes 1 (Asie et
Afrique), 2 (Mexique) et 4 (Chine, Taïwan au Japon,
Vietnam) qui sont responsables de formes graves, principa-
lement chez les femmes enceintes. Les génotypes 1 et 2 sont
retrouvés exclusivement chez l’homme contrairement aux
génotypes 3 et 4 qui ont une prévalence humaine et animale.
L’expression sur un mode endémo-sporadique concerne les
pays industrialisés (Europe, Japon, Amérique du Nord).
Le génotype 3 est en général impliqué dans ces formes
autochtones (principalement le génotype 3f en Europe) qui
représentent la majorité des cas décrits dans ces zones (plus
de 85 %). La transmission est indirecte, le plus souvent par
voie orofécale. Les vecteurs de contamination sont soit la
consommation d’eau, soit l’exposition au réservoir animal
via les suidés par consommation de viandes crues ou insuf-
fisamment cuites (salaisons, jambon, saucisses crues type
figatelles) [2]. De rares cas de transmission par transfusion
sanguine ont été rapportés dans ces zones endémiques [3].
L’origine de la contamination demeure cependant inconnue
dans un tiers des cas d’hépatites E autochtones.
Les cas autochtones d’hépatite E aiguë sont de plus en
plus rencontrés dans les pays comme la France où leur
incidence est en augmentation (19 cas rapportés en 2005,
145 en 2008, 200 cas en 2010) [4]. La séroprévalence des
anticorps anti-VHE de type IgG dans les pays non endé-
miques est hétérogène selon les zones géographiques et les
populations étudiées (13,5 % chez les transplantés) [5]. En
France, un gradient nord-sud de cette prévalence est décrit,
il passe de 3,2 % en région parisienne à 16,6 % en région
toulousaine. Ces résultats sont en accord avec la réparti-
tion des cas autochtones qui sont majoritairement décrits en
région Paca, Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées (plus
de 50 % des cas). La région Rhône-Alpes en a recensé 3,5 %
de cas en 2008 [1].
L’âge moyen des patients est supérieur à 55 ans. La plupart
du temps, l’infection est asymptomatique ou pauci symp-
tomatique (environ 50 % des cas). Lorsque l’infection se
manifeste, le tableau clinique est celui d’une hépatite aiguë
virale classique associant une phase pré-ictérique d’une
durée d’un à dix jours avec des symptômes digestifs de
type nausées, vomissements et douleurs abdominales suivie
d’une phase ictérique inconstante. La guérison est obtenue
le plus souvent en 1 mois sans séquelles.
Des formes chroniques susceptibles d’évoluer vers une
cirrhose et ses complications sont rapportées. Elles ne sur-
viennent que chez les patients à risques : patients porteurs
d’hépatopathie chronique, immunodéprimés et patients
transplantés pour lesquels la mortalité atteint8à12%.
Par contre, les formes d’hépatite fulminante paraissent
exceptionnelles dans les pays industrialisés. Ceci est à
opposer aux formes graves décrites chez la femme enceinte
dans les pays à haut niveau d’endémicité (20 % de décès
au 3etrimestre de grossesse). Cette différence pourrait
s’expliquer par le génotype en cause ou par l’âge de
l’infection.
Le diagnostic de certitude de l’infection par le virus de
l’hépatite E est biologique. Il repose sur la détection du
virus par RT-PCR dans le sang et/ou dans les selles et sur
les analyses sérologiques. Le prélèvement est contributif
s’il est fait dans les 5 jours précédant l’ictère ou dans les
28 jours qui suivent son apparition. La RT-PCR est plus
sensible que la sérologie pour le diagnostic d’infection à
VHE chez les patients immunodéprimés. L’analyse du frag-
ment du génome viral mis en évidence permet de déterminer
le génotype de la souche impliquée. Cette information est
importante pour la recherche du vecteur de contamination et
les études épidémiologiques [4]. La détection des anticorps
spécifiques du VHE (IgG et IgM) a des limites. La détection
des IgM spécifiques est en faveur d’une infection récente,
avec une spécificité supérieure à 95 % et une sensibilité de
85 % qui diminue chez les immunodéprimés [6]. Les IgG
spécifiques du VHE sont produits précocement et persistent
plus de 10 ans après l’infection. Le taux protecteur d’IgG
n’a pas encore été établi [7]. Un test d’avidité des IgG peut
être utilisé, notamment lorsque la RT-PCR est négative, afin
de distinguer une infection récente d’une infection ancienne
selon la force de liaison des antigènes-anticorps mais n’est
disponible qu’en laboratoire spécialisé.
En cas d’hépatite chez un patient à risque, et particu-
lièrement chez les immunodéprimés, la recherche d’une
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = ABC Article Identification = 0822 Date: May 31, 2013 Time: 12:15 pm
Ann Biol Clin, vol. 71, n◦3, mai-juin 2013 351
Un cas d’hépatite E autochtone
infection par le VHE pourrait être évoquée d’emblée devant
le risque de complication. La RT-PCR sera l’examen indi-
qué. Une recherche d’anticorps anti-VHE chez ces sujets
pourrait diminuer la mortalité induite par le virus. Chez
le patient autochtone immunocompétent avec un tableau
clinique et biologique d’hépatite aiguë, compte tenu des
données épidémiologiques actuelles, cette hypothèse relève
par contre d’une deuxième intention.
Le traitement de l’hépatite E autochtone est symptoma-
tique chez les patients sans signe de gravité. Dans les
formes chroniques, un traitement par ribavirine de 3 mois
en monothérapie est à l’essai chez des patients transplan-
tés rénaux. De même, l’introduction de ribavirine sur une
courte période (10 jours) chez deux patients immunocom-
pétents a permis une régression rapide de la charge virale.
Chez les patients avec une hépatopathie chronique pré-
existante développant une défaillance hépatique sévère, la
transplantation hépatique doit être évoquée [7].
Devant la recrudescence des cas, un vaccin recombinant
est en cours d’étude de phase 3 en Asie [8]. Un réseau de
surveillance a été mis en place en 2009 par l’Institut de veille
sanitaire et le CNR aux vues des données épidémiologiques
du virus de l’hépatite E. La déclaration n’est pas obligatoire
mais les laboratoires font des démarches volontaires auprès
des Centres nationaux de référence [9].
Ce cas clinique permet de rappeler un certain nombre
de points. L’hépatite E est une infection rare en France,
mais sa fréquence croissante pose le problème de son
caractère émergent. Les formes autochtones prédominent
et concernent essentiellement l’adulte de plus de 40 ans.
Le diagnostic repose sur des analyses sérologiques et la
recherche de l’ARN viral dans le sang et les selles devant
être réalisées précocement. Le diagnostic de l’hépatite E
doit être évoqué dans le cas d’un voyage en zone endé-
mique pour les cas importés. Il doit également être évoqué
en l’absence de voyage si le patient déclare avoir été en
contact avec des animaux ou avoir consommé de la viande
de suidé crue ou peu cuite. En effet, le tropisme du virus de
l’hépatite E n’est pas limité à l’espèce humaine, l’hépatite E
étant classée parmi les zoonoses. Tous les vecteurs de conta-
mination ne sont pas clairement identifiés, le diagnostic
doit donc être évoqué après exclusion des autres hépatites
virales.
Liens d’intérêts : aucun.
Références
1. Couturier E. L’hépatite E : synthèse de l’épidémiologie humaine. BEH
2010 ; Hors-série, septembre : 18-9.
2. Colson P, Borentain P, Queyriaux B, Kaba M, Moal V, Gallian P, et al.
Pig liver sausage as a source of hepatitis E virus transmission to humans.
J Infect Dis 2010 ; 202 : 825-34.
3. Khuroo MS. Discovery of hepatitis E : the epidemic non A, non B
hepatitis 30 years down the memory lane. Virus Res 2011 ; 161 : 3-14.
4. Renou C, Nicand E, Pariente A, Cadranel JF, Pavio N. How to detect
and diagnose an autochthonous hepatitis E ? Gastroenterol Clin Biol 2009 ;
33 (Suppl.) : F27-35.
5. Coton T, Delpy R, Hance P, Carre D, Guisset M. Autochthonous
hepatitis E virus in Southeastern France. 2 cases. Presse Med 2005;34:
651-4.
6. Peron JM. Hépatite aiguë E autochtone : une maladie émergente. Post’U
2011 : 225-30.
7. Dalton HR, Bendall R, Ijaz S, Banks M. HepatitisE:anemerging
infection in developed countries. Lancet Infect Dis 2008;8:698-709.
8. Zhu FC, Zhang J, Zhang XF, Zhou C, Wang ZZ, Huang SJ, et al.Effi-
cacy and safety of a recombinant hepatitis E vaccine in healthy adults :
a large-scale, randomised, double-blind placebo-controlled, phase 3 trial.
Lancet 2010 ; 376 : 895-902.
9. Nicand E, Bigaillon C, Tesse S. Hépatite E en France : données de
surveillance des cas humains, 2006-2008. BEH 2009 ; 31-32 : 337-41.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
1
/
3
100%