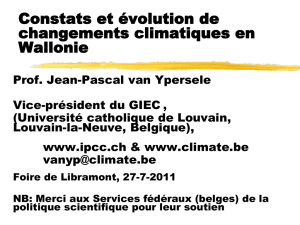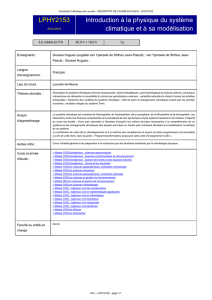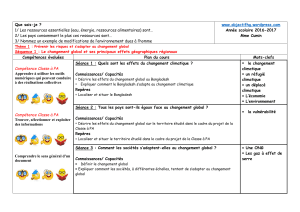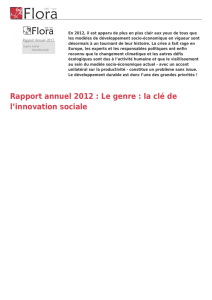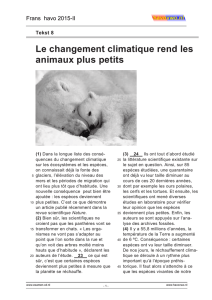écueils à l`horizon

D
’après les observations satel-
lites, le niveau de la mer
s’est élevé annuellement de
quelque 3 millimètres ces
10 dernières années. Si ce rythme devait
se maintenir, l’élévation sera de 30 cm en
moyenne d’ici 2100. De plus en plus de
scientifi ques estiment néanmoins que le
rythme s’accélère. Le risque est bien réel
de connaître une élévation de 50 cm d’ici
2100, avec d’énormes répercussions pour
une multitude de régions”, prévient Jean-
Pascal van Ypersele, vice-président du
GIEC et professeur de climatologie et de
sciences de l’environnement à l’Université
catholique de Louvain (UCL).
Impact humain
Selon M. van Ypersele, la montée du niveau
de la mer qui nous attend probablement
ne fait que commencer. Du point de vue
scientifi que, la prudence s’impose dès lors
quant à identifi er l’origine des problèmes
qui peuvent la provoquer. “Les courants
océaniques et le vent, entre autres, jouent
un rôle, tout comme le puisage d’eau sou-
terraine, qui provoque l’affaissement du
sol. Dans le cas de certaines îles, ce sont
les mouvements des plaques tectoniques
qui sont le déclencheur. Quoi qu’il en soit,
le niveau de la mer s’élève et continuera à
le faire. Les conséquences seront loin d’être
négligeables. Pour le Bangladesh, une élé-
vation de 50 cm mettra sous eau 5 à 10 %
du territoire, ce qui est énorme pour un
pays avec une telle densité de population !
Autre exemple : l’Égypte. Selon les chiffres
enregistrés il y a une décennie, 10 millions
d’Égyptiens vivent à moins d’un mètre au-
dessus du niveau de la Méditerranée, peut-
être plus encore aujourd’hui…”
Et les communautés
côtières pauvres ?
Matthew MacKinnon est rédacteur en chef
du Climate Vulnerability Monitor, lancé par
le Climate Vulnerable Forum (groupement
de pays se sentant déjà concrètement
menacés par le changement climatique)
et l’ONG DARA, qui examine l’impact de
l’aide humanitaire. Il énumère des consé-
quences de la montée du niveau de la mer :
“Tout d’abord, elle est responsable de la
salinisation de l’eau à proximité de la côte,
qui affecte également les terres et entraîne
la baisse des rendements agricoles. De plus,
en raison de l’érosion, la dégradation, la dis-
parition ou de la mise sous eau de ces terres,
la superfi cie des terres où l’homme peut
travailler ou habiter est réduite. La biodiver-
sité faiblit aussi en raison de l’altération des
caractéristiques environnementales. Il existe
d’autres conséquences encore, comme le
risque d’inondation, des problèmes pour les
pêcheurs, avec la salinisation de l’eau des
rivières, etc. C’est essentiellement le secteur
primaire – agriculture, pêche… – qui est
durement touché alors que ce secteur est
bien plus important dans les pays en déve-
loppement que dans les pays riches. Les
communautés côtières à très faibles revenus
seront les premières à affronter de graves
Des centaines de millions de personnes risquent de perdre leur habitation, leur terre et par-
fois même leur pays en raison de la montée du niveau de la mer, l’une des conséquences du
changement climatique. Nous en discutons avec le professeur Jean-Pascal van Ypersele,
vice-président du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), et
avec Matthew MacKinnon, rédacteur en chef du Climate Vulnerability Monitor.
“
Le gouvernement des Maldives a tenu une
réunion ministérielle sous l’eau afi n d’attirer
l’attention sur les effets du réchauffement
climatique.
Le Sud envisage des solutions écologiques comme la protection ou la plantation de mangroves
La montée du
niveau de la
mer touchera
plus durement
les pays en
développement.
UNE VULNÉRABILITÉ CROISSANTE
ÉCUEILS
À L’HORIZON
© Photo_Anatmavada
© AP
18 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013 I dimension 3

diffi cultés : baisse des revenus, réduction des
vivres, utilisation de plus en plus fréquente
de l’eau saumâtre… Les pays aux moyens
financiers supérieurs comme les nations
occidentales seront confrontés à ces pro-
blèmes dans une moindre mesure ; ils opte-
ront pour la dessalinisation de l’eau, l’ache-
minement d’eau en provenance de l’intérieur
des terres, la protection de la qualité du sol
au moyen d’engrais et de l’irrigation… et la
protection de leurs côtes.”
Coûts énormes
Les mesures requises pour se préparer
à la montée du niveau de la mer néces-
sitent beaucoup d’argent. M. van Ypersele
cite le plan que la ville de
New York a récemment
proposé. “Un plan de 20
milliards de dollars. Pour
la protection d’une seule
ville. Imaginez la situation
dans laquelle se trouve
un pays entier comme le
Bangladesh.”
La Belgique est une
autre région occidentale
en pleine préparation,
avec le projet “Baies
flamandes 2100”, qui
entend protéger notre zone côtière d’ici
2100 contre une tempête qui survient en
moyenne une fois tous les 1.000 ans, par
l’accumulation de sédiments (principale-
ment du sable), la construction de rete-
nues d’eau le long des quais portuaires,
la rénovation des digues, barrages et
écluses et l’érection d’un barrage anti-
tempête à Nieuwpoort. Le coût d’une telle
opération est diffi cile à chiffrer, car les tra-
vaux s’étendent sur un siècle. Le plan de
base pour la défense de la zone côtière,
élément crucial du dispositif, est déjà éva-
lué à 300 millions d’euros.
M. MacKinnon avance un autre exemple,
le Viêt Nam. “Une province du delta du
Mékong a établi un plan triennal pour l’amé-
nagement d’une infrastructure de protection
contre une élévation moyenne du niveau de
la mer d’ici 2050, autrement dit selon un scé-
nario ni pessimiste, ni optimiste. Il requiert
plus de 100 millions de dollars. Quand on
sait que le delta du Mékong comprend
seulement six provinces,
on entrevoit l’énormité du
défi qui attend les pays en
développement.”
Réponse protéiforme
M. MacKinnon explique
que la plupart des pays
en développement voient
davantage leur salut dans
une approche qui ne serait
pas axée sur l’infrastruc-
ture : “Ils envisagent par
exemple des solutions
écologiques, comme la protection ou la
plantation de mangroves, ou la limitation du
puisage d’eaux souterraines afi n de contrer
l’affaissement des sols. Autre option : réduire
l’infrastructure fl uviale, comme les digues,
qui restreint malheureusement la sédimen-
tation des deltas. On constate néanmoins
que le fi nancement, surtout celui issu de
l’aide au développement, est bien plus rapi-
dement octroyé aux travaux d’infrastructure
qu’à de telles mesures écologiques et stra-
tégiques. Pour cette raison, de nombreuses
régions doivent choisir les zones qu’elles
protégeront et celles qu’elles laisseront de
côté, étant donné qu’elles ne disposent pas
de moyens fi nanciers suffi sants pour la pro-
tection de toutes les régions en danger. Les
constructions entraînent dès lors la dégra-
dation plus rapide encore des zones non
protégées, entraînant des tensions entre
groupes de population et le renforcement
des inégalités.”
Il constate par ailleurs que les pays riches
auraient aussi tout intérêt à mettre en place
un plus large éventail de réponses à la mon-
tée du niveau de la mer via des mesures tant
stratégiques et infrastructurelles qu’écolo-
giques, comme la dépoldérisation.
Réfugiés
M. van Ypersele indique aussi qu’une
solution adaptée à une région précise
ne conviendra pas nécessairement à une
autre région : “Les spécificités géogra-
phiques locales sont essentielles. Il sera ainsi
impossible de protéger le Bangladesh par
des mesures identiques à celles prises aux
Pays-Bas. La situation est complexe aussi
pour les États insulaires menacés. Cela tient
d’une part au fait que leurs moyens fi nan-
ciers sont moindres et d’autre part à des
raisons techniques. Ces États prônent prin-
cipalement une réduction plus rapide des
émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs
tentent d’organiser le déplacement de leur
population vers d’autres contrées. Les popu-
lations menacées acceptent cependant avec
diffi culté d’abandonner leur terre, leur île.
Sans oublier que peu de nations semblent
enclines à les accueillir.”
Des décennies d’efforts… en vain ?
Le 19 juin, la Banque mondiale a publié
le rapport Turn Down The Heat, indiquant
que l’impact du changement climatique
se traduira par de graves problèmes dans
les régions qui sont déjà pauvres ou qui
étaient actuellement en train de sortir de
la pauvreté. Pour le président de la BM,
Jim Yong Kim, le plus préoccupant est le
fait qu’une augmentation de deux degrés
– que nous pourrions déjà atteindre d’ici
2030 ou 2040 – empêcherait de réaliser
l’objectif d’éradication de la pauvreté
dans le monde et que des décennies
d’aboutissements dans des projets de
développement n’auraient dans ce cas
servi à rien. Une perspective qui n’en-
chante personne…
KOEN VANDEPOPULIERE
Les Sundarbans sont gravement touchés par le changement climatique. Cette région située à
l'embouchure du Gange au Bangladesh et au Bengale occidental en Inde fait partie du plus grand
delta du monde.
© Agence européenne pour l’environnement
New York
consacrera
20 milliards
de dollars aux
préparatifs visant
à faire face à
l'élévation du
niveau de la mer.
dimension 3 I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013 19
EAUEAU
1
/
2
100%