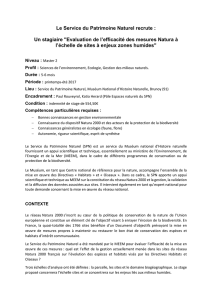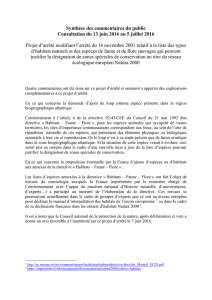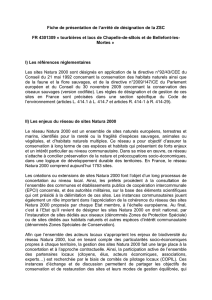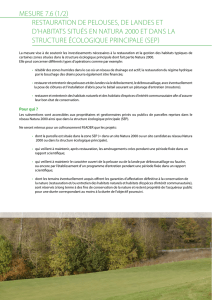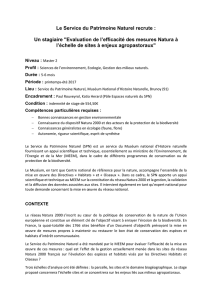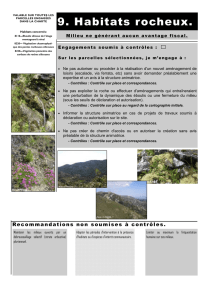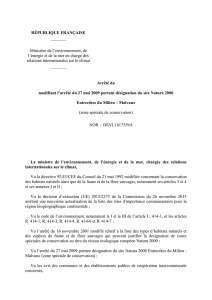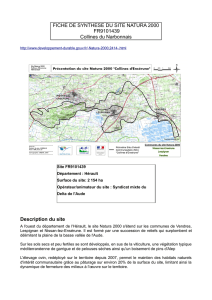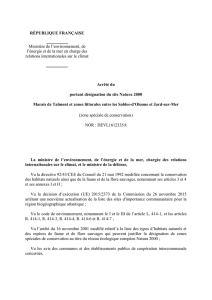PLATEAU DE L`AUBRAC

PLATEAU DE
L’AUBRAC
Conception : CCAL / Crédits photographiques : L. Andrieu, F. Puech, CCAL.
Charte Natura 2000
Site Natura 2000 FR 910 1352
Novembre 2012

1.1 Ses objectifs
La Charte Natura 2000 est un oul contractuel de
mise en œuvre du document d’objecfs en applica-
on des arcles R.414-11, R.412-12 et R.414-12.1 du
Code de l’Environnement et de l’arcle 143 de la loi
DTR du 23/02/2005.
L’objecf de cee Charte est de concilier le mainen
des habitats et espèces d’intérêt communautaire
dans un bon état de conservaon avec le dévelop-
pement économique, culturel et social du territoire.
Elle permet aux propriétaires (et leurs ayants droits)
de terrains inclus dans le site Natura 2000 « Plateau
de l’Aubrac » de s’engager durablement dans la pré-
servaon de ces habitats et espèces, et de souligner
la contribuon de leurs praques de geson à la réa-
lisaon des objecfs dénis dans le document d’ob-
jecfs (DOCOB) du site.
La présente Charte Natura 2000 ne se substue pas
à la réglementaon en vigueur sur les sites qui s’ap-
plique indiéremment en ou hors site Natura 2000.
Les engagements qu’elle porte relèvent d’une vo-
lonté propre aux signataires d’aller au-delà des exi-
gences réglementaires.
1.2 Son application
La Charte s’applique à l’ensemble du site Natura
2000 « Plateau de l’Aubrac ». Elle concerne tous les
milieux naturels ou semi-naturels, pour une durée
de 5 ans.
La charte s’adresse à toute personne physique ou
morale, publique ou privée, désireuse de parciper
à la préservaon de ce site, de ses milieux et de ses
espèces, et tulaire de droits réels ou personnels sur
des terrains inclus dans le site.
Le signataire est, selon les cas, soit le propriétaire,
soit la personne disposant d’un mandat la qualiant
juridiquement pour intervenir et pour prendre les
engagements menonnés dans la charte (si le man-
dat couvre au moins la durée d’adhésion à la Charte).
Il s’agit d’un engagement volontaire : c’est le pro-
priétaire, ou ses ayants droits, qui choisit de signer
la charte dans sa totalité, ou sur certaines parcelles
cadastrales seulement :
le propriétaire, en signant, adhère à tous les
engagements de portée générale ainsi que ceux spé-
ciques aux types de milieux naturels présents sur
ses parcelles engagées ;
le mandataire peut uniquement souscrire aux
engagements de la Charte qui correspondent aux
droits dont il dispose ;
tout autre signataire peut s’engager « mora-
lement » au respect de la Charte sans bénécier
d’avantage scal pour cee adhésion.
Contrats Natura 2000 et Charte sont deux ouls in-
dépendants et pourront être engagés sur les mêmes
propriétés.
I. La Charte Natura 2000 1.2 Ses avantages :
Contrairement aux contrats Natura 2000 et aux me-
sures agri-environnementales, l’adhésion à la charte
ne donne pas droit à une rémunéraon directe de
compensaon, puisque les engagements qui y -
gurent ne doivent pas entraîner de surcoûts de ges-
on pour l’adhérent.
Par contre, la Charte constue une garane de ges-
on durable pour ses adhérents, et elle leur permet
ainsi de bénécier de diérentes exonéraons s-
cales sur les parcelles engagées, et d’accéder à dié-
rentes aides publiques :
Exonéraon de la taxe foncière sur les proprié-
tés non bâes (TNPNB) : L’exonéraon concerne
les parts communales et intercommunales, mais pas
la part perçue par la Chambre d’Agriculture.
Exonéraon des ¾ des droits de mutaon à
tre gratuit pour certaines successions et dona-
ons : Les parcelles concernées doivent être enga-
gées dans une geson conforme aux objecfs de
conservaon des milieux naturels.
Déducon du revenu net imposable des
charges de propriétés rurales (travaux de restau-
raon et de gros entreen eectués en vue du main-
en du site en bon état écologique et paysager).
Garane de geson durable des forêts : L’ad-
hésion à la charte est un des moyens d’accéder aux
garanes de geson durable lorsque le propriétaire
dispose d’un document de geson arrêté, agréé ou
approuvé. Cee garane de geson durable permet
de bénécier sous certaines condions (art. 793 du
Code Général des Impôts) :
- De réducons scales au tre de l’Impôt Solidarité
sur la Fortune (ISF) ou de mutaons à tre gratuit,
- D’une réducon d’impôts sur le revenu au tre de
certaines acquisions de parcelles ou de certains tra-
vaux foresers,
- D’aides publiques à l’invesssement foreser si la
propriété fait plus de 10 hectares.
Le bénéce des contrepares d’adhésion à la Charte
est cependant condionné au respect de toute régle-
mentaon (codes de l’environnement, foreser, rural
et de l’urbanisme), concourrant à la préservaon des
habitats, des habitats d’espèces et des espèces d’in-
térêt communautaire idenés sur le site. Le constat
d’un procès verbal d’infracon à ces réglementaons
entraïnera la suspension de l’adhésion à la Charte.
1.3 Son contenu :
La charte s’appuie sur des mesures générales appli-
cables à l’ensemble du site, et des mesures spéci-
ques à diérents milieux naturels (landes, forêts, …)
et acvités. Ces mesures, qu’elles soient générales
ou spéciques, sont de deux types :
des engagements, qui feront l’objet de contrôles
et qui, s’ils ne sont pas respectés par l’adhérent,
pourront entraîner une suspension, voire une rési-
liaon de l’adhésion à la Charte par le préfet et par
conséquent, des avantages qui y sont liés.
des recommandaons, qui ont pour objecf de
sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservaon du
site et ses espèces et donc à favoriser toute acon
dans ce sens. Il s’agit d’une liste de bonnes praques
qui ne sont soumis à aucun contrôle.
1.4 Les modalités
Le candidat qui souhaite adhérer à la Charte
prend contact avec la structure animatrice du site
Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac » pour être ac-
compagné dans ses démarches.
Il envoie à la DDT (Direcon Départementale des
Territoires) une copie de son dossier comprenant :
- le formulaire d’adhésion à la charte complé-
té, daté et signé ;
- la Charte signée et ses annexes, pour la-
quelle il aura préalablement séleconné les enga-
gements qui concernent les parcelles qu’il souhaite
engager ;
- un plan de situaon des parcelles cadas-
trales (échelle : 1/25 000 ème ou plus précise), un re-
levé de propriété, et un plan cadastral des parcelles
engagées.
L’adhérent transmet la copie de son dossier et
de l’accusé de récepon envoyé par la DDT auprès
des services scaux de son département.
1.
2.
3.
12
administratives :

L’Aubrac Lozérien est caractérisé par une richesse
paysagère, faunisque et orisque importante,
issue de son passé volcanique, glaciaire mais aussi
agricole.
En eet, l’Aubrac est un vaste plateau caractérisé par
une couche épaisse de basalte (coulée magmaque
issue des mouvements orogéniques du Cénozoïque),
et quelques aeurements de granite (qui constue
le socle ancien de tout le Massif Central). Le passé
glaciaire du plateau a également laissé des traces en-
core visibles aujourd’hui, comme les lacs d’altude,
les moraines roulées par le glacier ou les graviers et
sables encore exploités. Le réseau hydrographique,
dius, est caractérisé par tout un chevelus de ruis-
seaux dont le principal, le Bès, draine presque tout
le plateau du Sud vers le Nord.
Sur le haut plateau, au-dessus de 1100 mètres d’al-
tude, la hêtraie a laissé place aux esves et prai-
ries d’altudes et il ne reste que très peu de forêts.
En eet, l’Aubrac est une région dédiée avant tout à
l’élevage et apparaît comme une terre d’esves : les
troupeaux sont mis en pâturages extérieurs chaque
année de mai à octobre. Si l’essenel des surfaces
est occupé par les pâtures, prairies naturelles, de-
vèzes, ou « montagnes », le plateau compte aussi de
nombreuses prairies naturelles de fauche qui par-
cipent à la constuon de tout ou pare des stocks
de fourrage qui doit être important vu la longueur
des hivers.
Enn, situé sur le tracé du chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, l’Aubrac are grand nombre de
randonneurs, et ore un grand choix d’héberge-
ments. En plus de son arait patrimonial et cultu-
rel (monuments historiques, églises romanes, sites
naturels classés…), le plateau propose des acvités
de pleine nature : randonnées (pédestres, équestres,
en raquees à neige, ...), chasse, pêche, loisirs moto-
risés, ski, …
Le site Natura 2000 FR 910 1352 « Plateau de
l’Aubrac » a pour ambion la préservaon et la valo-
risaon de ces habitats naturels et espèces remar-
quables, grâce à diérents ouls comme la Charte
Natura 2000.
2.1 Descriptif et enjeux
II. Le site Natura 2000 Plateau de l’Aubrac
34
Les espèces et habitats d’intérêt communautaire
Deux inventaires successifs ont permis d’idener et cartographier les diérents habitats et es-
pèces d’intérêt communautaire sur le site « Plateau de l’Aubrac » en vue de la rédacon du DOCOB.
Le site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac » inventorie 4 espèces animales d’intérêt communautaire (cf tableau
1), toutes aquaques : la loutre, la moule perlière, l’écrevisse à paes blanches, et le chabot. Deux espèces
végétales d’intérêt communautaire ont également été recensées : la ligulaire de Sibérie, le uteau nageant.
Code Natura
2000
Nom de l’espèce Type de milieu
1758 Ligulaire de Sibérie (Ligularia siberica) Zones humides
1831 Fluteau nageant (Luronium natans)
Habitats de rivières et plans d’eau
1163 Chabot (Cottus gobio)
1029 Moule perlière (Margaretifera margaretifera)
1092 Ecrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes)
1355 Loutre (Lutra lutra)
1324 Grand murin (Myotis myotis) R: Habitats anciens / C: milieux ouverts
1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) R: Habitats anciens / C: vallées alluviales
et massifs forestiers (feuillus)
1308 Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) R: habitats ou ssures / C: massifs fores-
tiers (feuillus)
Tableau 01 : Correspondance entre les espèces d’intérêt communautaire et les grands types de milieux iden-
és dans la Charte (pour les chiroptères: R= habitat de reproducon/ C: habitat d’alimentaon)

Les zones humides :
L’arcle 2 de la Loi sur l’Eau du 3.01.1992 dénit comme
zone humide «les terrains, exploités ou non, habituelle-
ment inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire ; la végétaon,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygro-
philes pendant au moins une pare de l’année».
Le caractère patrimonial des zones humides du Plateau
de l’Aubrac n’est plus à démontrer : la mosaïque de tour-
bières, prairies humides, et autres mares abritent de nom-
breuses espèces végétales (frillaires, orchidées, carex…),
et sont le lieu de refuge, alimentaon ou nidicaon de
nombreuses espèces animales (Bécassine des marais,
Vanneaux huppés, Loutres, Chauves-souris, Libellules, ...).
Situées en tête de bassin, elles jouent un rôle important
de stockage de l’eau lors des périodes humides (eau qui
sera restuée progressivement en période sèche), mais
aussi un rôle auto-épurateur non négligeable pour la qua-
lité des cours d’eau et les espèces qui y sont sensibles
(chabot, écrevisses,…).
Ces milieux et les espèces qui leur sont inféodées sont
sensibles aux perturbaons du fonconnement hydrolo-
gique.
Les ruisseaux et plans d’eau :
Le réseau hydrographique est très développé sur le pla-
teau : tout un chevelus de pets ruisseaux constue des
zones refuges et de reproducon pour de nombreuses es-
pèces végétales et animales (moules, écrevisses, chabots,
mais aussi odonates, …). Le sous-sol tantôt granique tan-
tôt volcanique du plateau constue des réservoirs d’eau
qui ne sont pourtant pas susants pour éviter des pé-
riodes d’éage* de ce pet chevelu. Sur l’Aubrac, les eaux
sont globalement peu minéralisées, acides et de bonne
qualité bactériologiques, mais restent sensibles aux pollu-
ons, qu’elles soient accidentelles ou chroniques.
Les ruisseaux du plateau présentent à de nombreux en-
droits un eondrement des berges, dû d’une part à l’ab-
sence de véritable végétaon riveraine ou ripisylve (aux
systèmes racinaires stabilisateurs des sols), et d’autre part
au piénement du bétail venant s’abreuver ou traversant
régulièrement le cours d’eau. Ces instabilités et dégrada-
ons des berges ont plusieurs conséquences sur le fonc-
onnement du cours d’eau et sur les espèces aquaques :
colmatage des frayères à truites, stérilisaon des milieux,
ralenssement et réchauement de l’eau, ...
L’Aubrac présente également plusieurs lacs d’altude,
d’origine glaciaire, et fréquentés par les pêcheurs. Seul
l’un d’entre eux est empoissonné pour cee acvité.
Le site est encore préservé de l’envahissement par des
espèces exogènes, qu’elles soient végétales ou animales
(Ecrevisse californienne, Renouée du Japon, ...), mais leur
présence à proximité du site rend aujourd’hui essenel
la surveillance de ces espèces et de leur propagaon. En
eet, leur colonisaon pourrait avoir des conséquences
sur le mainen des habitats et espèces d’intérêt commu-
nautaire du site.
* éage : stasquement, période de l’année où le débit du cours
d’eau aeind son point le plus bas
56
Concernant les habitats naturels, dix-neuf ont été recensés, parmi lesquels cinq sont considérés comme prio-
ritaires
Code Natura
2000
Nom de l’habitat Type de milieu
6410-11 Prés humides subatlantiques à précontinentaux, montagnards du
Massif Central et des Pyrénées
Zones humides
7140
Tourbières de transition
Bourbiers tremblants à Carex rostrata
Radeaux à Menyanthe trifoliata et Potentilla palustris
7110
*Tourbières hautes actives
Tapis et buttes de sphaignes avec éventuellement des chaméphytes et
nanophanérophytes
Buttes à buissons nains d’éricacées
Communautés de tourbières à Trichophorum cespitosum
Chenaux, cuvettes profondes
Tourbières à Narthecium
Pré-bois tourbeux
7210 *Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex davalliana
7120 Tourbières hautes, dégradées, susceptibles de
régénération
91D0
Tourbières boisées
* Bois de bouleaux à Sphaignes et linaigrettes
* Bois tourbeux de Pins sylvestres
* Bois tourbeux à Pinus Rotundata
6430-8 Megaphorbaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des
Vosges, et du Massif Central
3160 Mares dystrophes naturelles
Habitats de rivières et plans
d’eau
3130-1
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique
montagnardes à subalpines des régions alpines, des
Littorelletea
uniorae
6230-4 * Pelouses acidiclines montagnardes du MC
Milieux prairiaux
6510-7 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles,
eutrophiques relevant de l’Arrhenatherion elatioris
6520-1 Prairies fauchées montagnardes et subalpines du Massif Central
relevant du Polygono-trisetion
8230-2 Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses
du Massif Central
8220-14 Falaises siliceuse des Cévennes relevant de l’Anthirrhinion asarinae
Habitats rocheux
8150-1 Eboulis siliceux, collinéens à montagnards des régions atlantiques et
subcontinentales relevant du Galeopsion segetum
9120-4 Hêtraie–sapinière acidiphile à houx et Luzule des neiges relevant du
Lozulo-fagion Milieux forestiers
91E0-6 * Forêts alluviales à Alnus glutineux et Fraxinus excelsior
relevant de l’Alnion incanae
4030-13 Landes acidiphiles montagnardes du Massif Central Milieux de landes
5120-1 Landes à Genêt purgatif du Massif Central
Tableau 02 : Correspondance entre les habitats d’intérêt communautaire et les grands types de milieux iden-
és dans la charte (* : habitats prioritaires).

78
D’une manière générale, la Charte Natura 2000 ne se
substue pas aux réglementaons en vigueur sur le site
(loi sur l’eau, réglementaon agricole, cynégéque, ha-
lieuque, ...).
Voici une liste non exhausve de points de la réglemen-
taon considérés comme importants à détailler au regard
des enjeux du site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac ».
Pour toute queson complémentaire, il est conseillé de
prendre contact avec l’animateur du site Natura 2000 ou
la DDT de la Lozère.
Espèces et milieux naturels :
« La protecon des espaces naturels et des paysages, la
préservaon des espèces animales et végétales, le main-
en des équilibres biologiques auxquels ils parcipent et
la protecon des ressources naturelles contre toutes les
causes de dégradaon qui les menacent sont «déclarés»
d’intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la
sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les
acvités publiques ou privées d’aménagement, d’équipe-
ment et de producon doivent se conformer aux mêmes
exigences.» (Loi relave à la protecon de la nature de
1976)
La Direcve européenne 2004/35/CE du 21 avril 2004,
et la Loi sur la Responsabilité Environnementale qui en
découle, xent un cadre commun de responsabilité pour
les aeintes graves causées aux espèces et habitats natu-
rels protégés par des textes communautaires (direcves
«Habitats» et «Oiseaux»), aux eaux et aux sols. Cee loi
intègre également la noon de «services écologiques»
assurés par les sols, les eaux et les espèces et habitats. La
personne qui exploite l’acvité à l’origine d’un dommage
environnemental doit prévenir le dommage en meant
en place les mesures nécessaires, puis réparer le milieu
endommagé.
> Les espèces protégées :
Les espèces protégées en droit français sont les espèces
animales et végétales dont les listes sont xées par arrê-
tés ministériels en applicaon du Code de l’environne-
ment (L411-1 et suivants).
Pour les espèces végétales protégées : il est interdit de
détruire, de colporter, de vendre, d’acheter ou d’uliser
les spécimens de ore sauvage dont la liste est xée par
arrêté (sauf cultures). Plusieurs espèces présentes sur le
plateau sont protégées au niveau naonal et/ou régional,
avec par exemple 16 plantes protégées au niveau naonal
(d’après la base de données du Conservatoire Botanique
Naonal de Porquerolles).
Pour certaines espèces animales, dont les listes sont
xées par arrêtés, la destrucon ou l’enlèvement des
œufs ou des nids, la destrucon, la mulaon, la capture
et la naturalisaon des spécimens peuvent être interdits.
T
extes de références : textes internaonaux (Convenons CITES, de
Bonn, de Berne, et sur la diversité biologique), communautaires (Di-
recves Oiseaux et Habitats), et naonaux (arrêtés ministériels xant
les espèces protégées).
> Les espèces exoques :
«…Est interdite l’introducon dans le milieu naturel,
volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout
spécimen d’une espèce animale ou végétale à la fois non
indigène au territoire d’introducon et non domesque
ou non culvée, dont la liste est xée par arrêté conjoint»
des autorités administraves compétentes (Code de l’en-
vironnement, L.411-3).
> La protecon des monuments :
La Loi du 2 mai 1930 relave à la protecon des monu-
ments naturels et des sites de caractère arsque, histo-
rique, scienque, légendaire ou pioresque, a permis de
désigner des sites classés et des sites inscrits sur le terri-
toire français. Le site Natura 2000 «Plateau de l’Aubrac»
présente trois sites inscrits depuis le 2/11/1942 : le Lac
de St Andéol, le Lac de Salhiens, et la Cascade du Déroc.
> La geson des forêts :
Le Code foreser dénit le terme de forêt, puis organise
et réglemente la geson de ce milieu, que leur proprié-
taire soit une personne publique ou privée. Entre autres,
les points suivants sont régit par le Code Foreser : dé-
nion des forêts nécessitant un plan de geson, contenu
de ces documents, modalités de vente et d’exploitaon
des produits de la forêt (bois, pâturage, chasse, cueillee
etc.), droits d’usage, défense et lue contre les incendies,
défrichements, amélioraon des essences foresères,
délits et contravenons...
2.2 Réglementations et mesures de protection
Les milieux prairiaux et landes :
Le plateau de l’Aubrac est une terre d’élevages, et le pâtu-
rage extensif tradionnel qui y est appliqué depuis des
siècles a parcipé au mainen de zones ouvertes comme
les prairies et les landes. Des praques pastorales inadap-
tées pourraient conduire à une évoluon de ces milieux
et une diminuon de leur richesse orisque (surpâtu-
rage, sous-pâturage, ferlisaon, ...). La modernisaon de
l’agriculture a souvent induit la disparion des haies sur le
plateau, comme sur l’ensemble du territoire français, des
alignements d’arbres qui ont pourtant de nombreuses
foncons d’un point de vue agronomique (protecon du
bétail, mainen d’espèces) et écologique (habitat, corri-
dor, ltre naturel de certains polluants, ...).
Sur le site, les zones facilement mécanisables et au sol
riche sont souvent ulisées comme prairies de fauche.
Ces milieux sont riches en espèces et leur mainen dé-
pend de praques agricoles tradionnelles : faible ferli-
saon, fauche tardive, ...
Les milieux foresers :
Le plateau de l’Aubrac est caractérisé par deux types de
boisements naturels : les forêts à Pins sylvestres et les Hê-
traies. Aussi, certains boisements de conifères (épicéas,
sapins, mélèzes, ...) ont été plantés à des ns d’exploita-
on, ou encore an de stabiliser les pentes ou protéger
certains axes et parcelles des intempéries (lois de restau-
raon des terrains de montagne, créaon du Fond Fores-
er Naonal). Les forêts aubracoises de petes tailles
sont souvent incluses dans des parcs et donc pâturées en
sous-bois.
Quelles soient communales ou seconales, ces forêts
sont toutes soumises au régime foreser et possèdent un
Plan d’Aménagement Foreser rédigé. Il s’agit d’un plan
de geson de la forêt d’une durée de 15 à 20 ans qui xe
les objecfs, les modes et le calendrier des intervenons
sylvicoles. Concernant les forêts privées du site, certaines
possèdent des documents de geson durable comme le
PSG (Plan Simple de Geson), le RTG (Règlement Type
de Geson) ou le CBPS (Codes de Bonnes Praques Syl-
vicoles).
Dans les boisements exploités, le mainen d’une impor-
tante biodiversité et l’assurance d’un bon fonconnement
de l’écosystème foreser (et notamment de la régénéra-
on naturelle des arbres) passent par le mainen d’une
mosaïque de milieux diérents comme les clairières, les
zones humides, ou des îlots d’arbres morts ou sénescents.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%