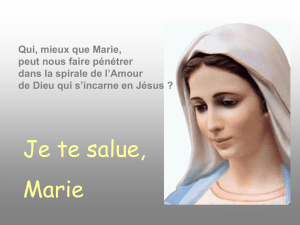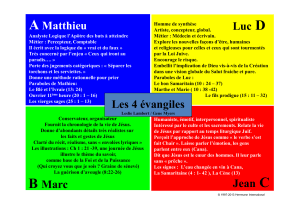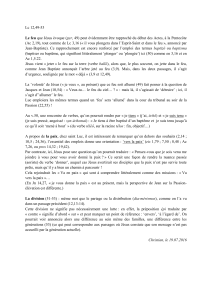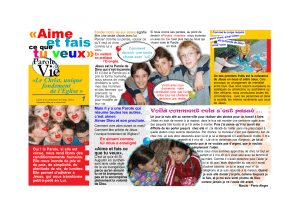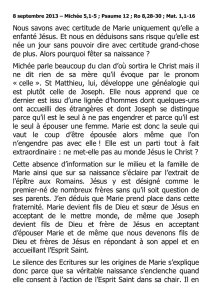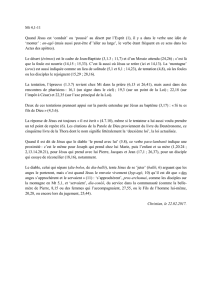Cahier n°2 - Chrétiens et Juifs, des amis

Les Cahiers de YERUSHALAIM
N°2
Qui est Jésus ?
« Pour vous, qui suis-je ? »
Joël Putois
avec la participation de Henri LEFEBVRE
Anastasis pio christiano
Représentation symbolique de la Résurrection. Sarcophage romain, datant de l'an 350 environ.
Musée du Vatican - Photo chargée du site internet wikipedia
Edité par l’association CŒUR
C
omité
Œ
cuménique d’
U
nité chrétienne pour la
R
epentance
envers le peuple juif

L e s C a h i e r s d e Y E R U S H A L A I M n u m é r o 2 « Q u i e s t J é s u s ? »
2
SOMMAIRE
Avant-propos
Introduction
Chapitre 1 S’affranchir du poids des erreurs historiques 5
Chapitre 2 Jésus , un personnage hors norme 8
Chapitre 3 Le Jésus des Évangiles 10
Chapitre 4 Les premiers témoins de Jésus ressuscité 12
1
ère
Partie : Jésus, Fils de l’Homme et Fils de Dieu
Chapitre 5 La construction de la doctrine chrétienne dans un milieu difficile 14
Chapitre 6 Une inculturation décisive 17
Chapitre 7 Logos ou Shekhina ? 19
Chapitre 8 Philon : une philosophie récupérée par l’Église 21
Chapitre 9 La dérive doctrinale 23
Chapitre 10 L‘incarnation selon le Nouveau Testament 25
2
e
Partie : Jésus Messie
Chapitre 11 Messie et Fils de l’Homme 27
Chapitre 12 Premier Adam et dernier Adam 30
Chapitre 13 Une re-création de l’Adam … ( et Marie, nouvelle Eve ?) 32
Chapitre 14 L’ère messianique : changement et continuité 34
Chapitre 15 La transgression d’Adam, source d’un ébranlement cosmique 36
Chapitre 16 La résurrection : pourquoi ? 39
Chapitre 17 La résurrection : pour quoi ? 43
Chapitre 18 Le Messie vient pour restaurer. 45
Chapitre 19 Identité et vocation du Messie 48
Chapitre 20 L’ère messianique : phase ultime de la Restauration-Rédemption 50
3
e
Partie : Jésus Sauveur-Rédempteur
Chapitre 21 Jésus Sauveur Rédempteur 52
Chapitre 22 Conception traditionnelle du Salut : le Messie triomphant 55
Chapitre 23 Le Messie sauveur accidentel - homme de douleurs 58
Chapitre 24 La Parousie, « accomplissement » ultime de l’ère messianique 62
Chapitre 25 Le Messie rédempteur : étendue de sa mission 65
Chapitre 26 L’itinéraire-bis évite des erreurs de traduction 68
4
e
Partie : Essai de Synthèse
Chapitre 27 Le ré-enseignement : un défi ! 72
Chapitre 28 Un nouveau regard sur « Jésus Dieu » ? 77
Chapitre 29 Quel accomplissement ? 83
Chapitre 30 Changer le monde : comment ? 86
Chapitre 31 Les dix paroles des Temps de la fin 88
Chapitre 32 Identité et vocation respectives des Juifs et des Chrétiens 90
Chapitre 33 La réparation : rétablir les identité et vocation respectives 93
Chapitre 34 Identités et vocations juives et chrétiennes distinctes mais convergentes
96
Postface
99

L e s C a h i e r s d e Y E R U S H A L A I M n u m é r o 2 « Q u i e s t J é s u s ? »
3
Avant-propos
Nous sommes heureux de vous présenter ici le deuxième « CAHIER DE
YERUSHALAIM ».
Nos lecteurs de l’association ont parfois été surpris par le sujet que nous avions choisi
pour le premier Cahier.
Le sujet de ce Cahier n°2 est beaucoup plus compréhensible compte tenu de notre longue
quête initiée dans les 50 numéros de notre REVUE YERUSHALAIM.
Il n’en est pas moins périlleux, car si les différends entre nos églises s’estompent quand
nous voulons parler au monde de notre foi commune, ils se ravivent dès que nous
essayons de donner un corps uni à nos différents points de vue sur la question que nous
nous posons ici.
Il y eut certes un certain nombre de « conciles œcuméniques » qui ont tenté de définir une
doctrine commune. Nous aborderons ce sujet pour en rappeler les circonstances. Mais le
consensus obtenu est loin de donner une réponse globale claire à notre question.
Nous avons donc bien conscience que la question est immense, vertigineuse même, que
nous ne pourrons au mieux que l’effleurer, mais qu’elle risque de bousculer un certain
nombre de sensibilités. Car si la foi en Jésus est bien ce qui amène les hommes sur le seuil
du Christianisme, on constate vite, dès qu’on y pénètre, de nombreuses convictions et des
pratiques dissemblables qui peuvent surprendre ! Et à ce moment-là notre question peut
devenir presque dérangeante…
Dans la continuité de nos revues YERUSHALAIM, nous nous efforcerons de dégager les
réponses que nous trouvons si nous en tenons obstinément à une lecture attentive des
Ecritures, Nous voulons ainsi fournir au lecteur des éléments objectifs de discernement.
Il en est de cette question comme de l'observation d'un grand tableau: à force de le
contempler, on en arrive à le connaître si bien que, insensiblement, on s'en approche pour
distinguer les détails. Et, ce faisant, on commence peu à peu à perdre de vue l'ensemble. Il
est bon, de temps en temps , de prendre un recul suffisant pour assimiler à nouveau dans
sa globalité, ce qui redonne en même temps toute son importance aux détails qui avaient
focalisé notre attention.
C’est cette méthode que le père Roger Telle décrit en introduction à une étude qu’il a
rédigée sur le baptême :
Mettons-nous d'abord à l'écoute des textes de la Bible en cherchant à voir ce qu'ils
nous disent du baptême, sans a priori, sans chercher à justifier ou critiquer nos
théologies ou pratiques actuelles, mais en cherchant autant que possible à
comprendre le baptême dans sa fraîcheur première comme les premières
générations chrétienne le comprenaient. Nous chercherons aussi à lire ces textes
pour eux-mêmes, avec un regard neuf. Cela n'est pas facile et demande un effort de
désappropriation de notre vision habituelle du baptême, un effort d'objectivité.
Nous avons tous vu des peintures du Moyen-Âge, représentant par exemple la

L e s C a h i e r s d e Y E R U S H A L A I M n u m é r o 2 « Q u i e s t J é s u s ? »
4
nativité de Jésus, où les lieux, les habitations, les personnages, les attitudes, les
costumes, sont ceux de l'époque du peintre. Ces peintures nous renseignent mieux
sur leurs auteurs et leur époque moyenâgeuse que sur la nativité elle-même. Nous
risquons de faire de même en lisant les textes bibliques avec nos images, nos
conceptions, nos habitudes à propos du baptême, et de ne pas sortir de notre vision
préconçue. Essayons donc de regarder les textes pour eux-mêmes, le plus
objectivement possible.
C'est donc à une telle démarche que nous invitons le lecteur. C'est à une enquête que nous
le convions, Bible en main, en l'invitant à s'y avancer en acceptant de jeter un regard
nouveau
Au pire, cette enquête emmènera peut-être l’un ou l’autre à une remise en question de
conceptions qui lui paraissaient solides, et cela ne peut que l’inviter à retravailler pour lui-
même les questions posées.
Au mieux, il pourra en résulter un affermissement de la foi de celui qui l'aura suivi. C'est
en tous cas le voeu que nous formulons.
* * *

L e s C a h i e r s d e Y E R U S H A L A I M n u m é r o 2 « Q u i e s t J é s u s ? »
5
Introduction
------------------------------------------
Chapitre 1
S’affranchir du poids
des erreurs historiques
Il est bien clair, et il faut fortement insister à ce sujet, que le Christianisme a pris naissance au sein
du Judaïsme. Jésus, ses disciples et la première église étaient juifs ! La séparation s’est rapidement
opérée et ce, pour des motifs multiples et avec des torts partagés : les causes en sont innombrables
et ont donné lieu à de nombreuses études. Après seulement trois ou quatre siècles, le
Christianisme s’était largement répandu au sein de l’empire romain et était passé du statut de
petite secte persécutée à celui de courant majeur participant au pouvoir politique, alors que le
judaïsme qui était depuis longtemps implanté glissa peu à peu, avec l’assentiment des chrétiens,
dans le camp des « persécutables » !
Les disciples de Jésus, ceux qui ont cru en Lui et fait confiance à ses enseignements, se sont
dépêchés d'oublier le noyau de son enseignement, noyau pour lequel il est pourtant réputé dans le
monde entier, celui de l'Amour ! Ils se sont conduits beaucoup trop souvent de façon opposée, se
transformant dès qu'ils pouvaient accéder au pouvoir temporel, comme des adversaires, puis des
persécuteurs, des oppresseurs de ceux qui ne les suivaient pas dans leurs convictions religieuses:
l'histoire du christianisme est constellée d'épisodes de «conversions forcées» , sous menace,
parfois même de mort ! A l’intérieur du Christianisme, les conflits de formulation de la foi
dégénérèrent vite en conflits féroces : il ne faisait pas bon, pendant longtemps, de se trouver en
désaccord avec la pensée officielle ; les sectaires étaient vite appelés infidèles, puis ennemis, et
ennemis de l'église car « ennemis de Dieu » !
L’histoire de l’église est ponctuée de massacres et de violences que l’on a tort actuellement
d’attribuer simplement à la violence des mœurs de ce temps-là: le Maître avait formellement exclu
le recours à la force, même pour le défendre lui-même :
« Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui prennent l’épée disparaîtront par l’épée ! »
(Matthieu 26 :52)
La violence des chrétiens (ce devrait être une expression antinomique !) s’exerça même hélas sur
ceux que pourtant l'apôtre Paul recommandait tout particulièrement à l’amour des disciples, ceux
dont nous avons hérité la foi et les Ecritures, C’est ainsi qu’ils devinrent par une détestable
inversion, le modèle même de l'infidélité : pendant des siècles, les Juifs furent considérés par
l’Eglise comme les ennemis de Dieu ! On peut même dire que les Juifs constituèrent la cible la plus
permanente des persécutions « chrétiennes » de sorte que, s’il y a un objet qui mérite le plus la
repentance chrétienne, c’est bien ce cycle millénaire de violence de « l’église » contre les Juifs !
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
1
/
99
100%