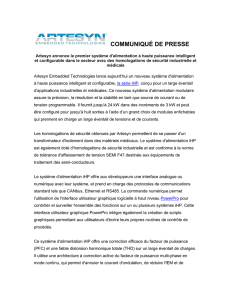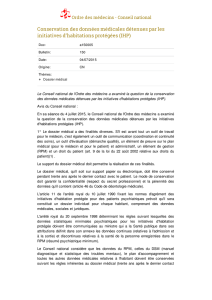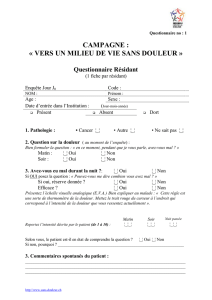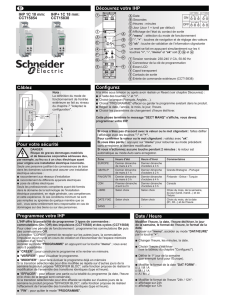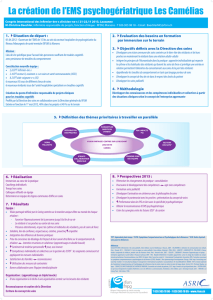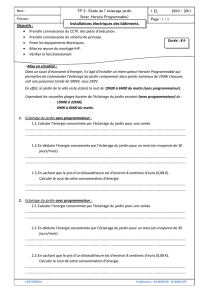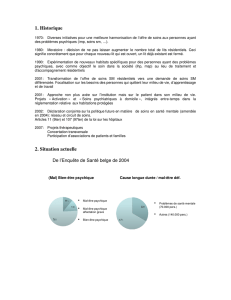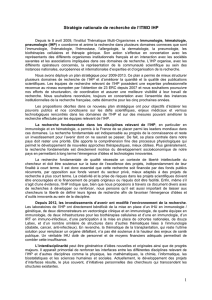L`autonomie en question

Les Cahiers de la Santé
de la Commission
Communautaire Française
L’autonomie en question
Lien social et santé mentale
Sous la direction de Thierry Van de Wijngaert & François de Coninck
Fédération Francophone des Initiatives d’Habitations protégées
25


Les Cahiers de la Santé
de la Commission
Communautaire Française
L’autonomie en question 25
Lien social et santé mentale

Photo de couverture© : Pol Pierart
Pour Pol Pierart, les jeux de mots, omniprésents dans ses travaux, ne constituent pas une n en soi. Il considère
que le but essentiel de l’art est d’entrer en relation: «C’est la photographie qui crée la relation du fait même que le
regardeur, pour appréhender le travail, est amené à comprendre quelque chose. Ce faisant, même s’il ne s’en rend
pas compte, il fait le travail… Voilà le nœud de la relation. Le côté ludique et l’humour sont autant de moyens de
renforcer le propos.»
Extrait d’un texte de présentation de l’artiste sur www.contretype.org

TABLE DES MATIERES
Introduction - Thierry Van de Wijngaert 8
1 Présentation des Initiatives d’Habitations Protégées 11
1.1 LES IHP dans le paysage des institutions de soins en santé mentale et d’aide sociale
Claude Petit 13
1.2 La variété des pratiques
Virginie Delarue, Pascale Bourgeois et Patrick Vandergraessen 18
1.2.1 La diversité de l’offre et des modalités de prise en charge 18
1.2.2 Trois étapes importantes d’un parcours en IHP 19
2 Abords de l’autonomie 23
2.1 L’autonomie : des prescrits légaux à la réalité clinique - Thierry Van de Wijngaert 24
2.1.1 Les coordonnées de l’Arrêté Royal
2.1.2 L’autonomie
2.1.3 L’aptitude
2.1.4 L’accompagnement
2.2 L’autonomie, un abord sociologique - Jean De Munck 30
2.2.1 L’aptitude
2.2.2 Le rapport au Politique
2.2.3 Le concept d’autonomie
2.3 L’autonomie : un abord clinique - Philippe Fouchet 34
2.4 Contributions des représentants du monde politique 36
2.4.1 Des pratiques singulières et innovantes, au plus près des usagers
2.4.2 Les tensions entre le monde vécu et le système conçu
2.4.3 Les enjeux cliniques et politiques de la réorganisation des soins de santé mentale
3 Dix thématiques concrètes en rapport avec l’automonie 41
3.1 Difcultés d’autonomie : Symptôme psychique ou carence éducative ? 43
3.1.1 Savoir se séparer de l’institution et vouloir s’en séparer
3.1.2 Quand les troubles psychiques limitent les capacités d’apprentissage
3.1.3 Pas de perspective éducative sans construction du cas
3.1.4 Prendre la mesure de la fonction du symptôme :
l’accueil de la psychose au Club André Baillon - Manuelle Krings 47
3.2 Les activités : En faut-il ? Qu’en attend le résidant ? Qu’en espère l’équipe ? 51
3.2.1 S’approprier de nouvelles expériences
3.2.2 Le plan de services intégré, au rythme de chacun.
3.2.3 Les activités, satisfaction subjective et production de lien social
3.2.4 L’emploi et le travail pour les résidants en IHP - Fondation Julie Ranson 58
3.3 Le rapport au contrat : fonction structurante du cadre et nécessité de souplesse ? 59
3.3.1 La revendication de liberté pour éloigner l’envahissement de l’Autre
3.3.2 Le cadre au service de l’opération thérapeutique.
3.3.3 Inventer le lien social au-delà de la transgression
3.3.4 Les « mensonges » et les non-dits - Fondation Julie Ranson 65
3.4 Les vertus de l’accompagnement minimaliste : quand les exigences ne sont pas de mise. 67
3.4.1 Chercher la juste mesure
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
1
/
132
100%