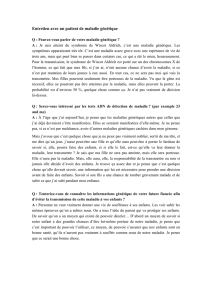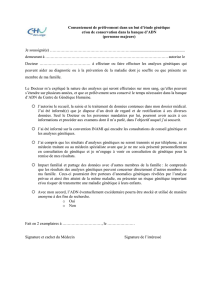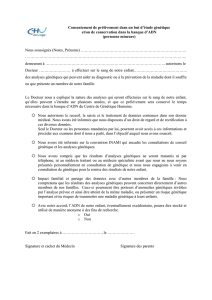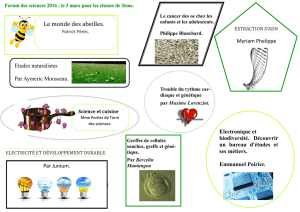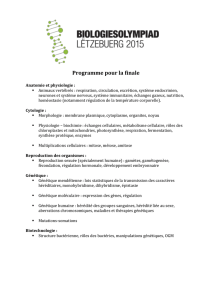Addictions n° 10, juin 2005

Vulnérabilité génétique et conduites d’addiction
Dossier
’hétérogénéité
des manifesta-
tions de l’alcoo-
lo-dépendance
constitue à la fois
un obstacle et une richesse
dans la recherche de ses
déterminants. L'épidémiolo-
gie génétique, comme la bio-
logie moléculaire, offrent des
chances de repérer des fac-
teurs susceptibles d'expliquer
en partie cette pathologie
complexe.
Epidémiologie
génétique
de l’alcoolisme
Les études familiales ont
permis de repérer l’existence
d’une composante génétique
dans l’alcoolisme : si la pré-
valence de l'alcoolisme
est évaluée dans une
fourchette de 2% à 5 %
en population générale,
dans la fratrie d'un
malade alcoolique elle
atteint des niveaux
situés entre 10% et 50 %.
Cette implication fami-
liale est d’autant plus
forte que le degré de
proximité familiale est
important, et concerne
essentiellement les
sujets masculins.
Les études de jumeaux, qui
comparent les "vrais"
jumeaux (monozygotes, dis-
posant du même patrimoine
génétique) et les "faux" (dizy-
gotes, n’ayant en commun
que la moitié de leurs gènes)
mettent aussi en évidence une
influence des gènes, significa-
tive mais partielle, dans les
modalités de consommation
d’alcool. Une dizaine de ces
études montrent un taux
moyen de concordance pour
l’alcoolisme de 50% chez les
jumeaux monozygotes et de
35% chez les dizygotes.
Quant aux études d'adoption
(enfants d’alcooliques adoptés
par des parents en principe
non alcooliques), elles complè-
tent et confirment ces données
et concluent à la priorité des
facteurs génétiques par rapport
aux facteurs d’éducation.
Tous ces arguments plaident
en faveur d’une transmission
au moins partiellement géné-
tique de la vulnérabilité à l’al-
C’est de famille,
entend-on souvent à
propos d’un cas
d’alcoolisme réputé
inéluctable. La fatalité
serait-elle inscrite dans
les gènes ?
Encore faut-il préciser
la nature des éléments
transmis.
L
10 - Juin 2005 - N°10
Addictions
coolo-dépendance, mais ne
permettent qu’une estimation
indirecte du poids des facteurs
génétiques impliqués (entre
30% et 60%).
Type 1, type 2
Est-il possible, dans une
population porteuse d’un
marqueur d’alcoolodépen-
dance, ou présentant des
traits cliniques caractéris-
tiques, de repérer des sujets
plus "génétiquement déter-
minés", chez lesquels les fac-
teurs génétiques seraient plus
importants (ou plus simples à
révéler) ? Encore faut-il préci-
ser la nature des éléments
transmis : incapacité à résister
à l’envie de boire, traits de
caractère particuliers, résis-
tance exceptionnelle aux
effets de l’alcool…
Certaines manifestations cli-
niques laissent supposer une
composante génétique de la
maladie alcoolique. Ainsi,
l’héritabilité génétique appa-
raît plus élevée dans les cas
de conduites alcooliques
ayant commencé précoce-
ment (avant 20 ans ou 25 ans),
Par Mathias Wohl (*, **), DES, Philip Gorwood (*, **), PU-PH.
LL’’aallccooooll eesstt--iill iinnssccrr
* C.H.U Louis Mourier, service
de psychiatrie du Professeur
Adès, 178 rue des Renouillers,
92701 Colombes Cedex.
** INSERM U675, 16 rue Henri
Huchard 75018 Paris.
LL’’aallccooooll eesstt--iill iinnssccrr
Addic10_010 A 014 7/06/05 3:27 Page 2

Lors de vos recherches,
vous situez-vous plutôt
comme généticien ou
comme alcoologue ?
La recherche en
psychiatrie génétique est
clairement à l'interface
de la clinique (quel est le
trouble considéré, c'est-
à-dire le phénotype) et
de la génétique (qu'est-ce
qui est transmis, c'est-à-
dire le génotype). C'est
d'ailleurs ce qui fait
toute la richesse de cette
approche qui se nourrit
de la diversité de la
clinique (chaque patient
venant mettre à mal
toute classification
globaliste) et se
confronte à la rigueur de
la génétique (chaque
polymorphisme devant
être analysé dans son
implication sur un trait
et un seul).
La recherche en
génétique peut-elle
avoir un impact sur la
clinique en alcoologie ?
Les deux approches sont
effectivement très
intriquées. Du fait de
mes recherches en
génétique, j'ai été
sollicité à plusieurs
reprises par des patients.
L’un d’eux par exemple
m’a expliqué qu'il était
alcoolo-dépendant et
que son père, son frère et
son grand-père paternel
étaient ou avaient été
aussi dépendants. Sa
demande portait sur le
risque qui pesait sur ses
enfants à venir. Fallait-il
le rassurer à tout prix en
lui disant : "C'est vous
qui faites votre vie", "rien
n'est inéluctable", "les
connaissances en
recherche sont trop
insuffisantes pour
pouvoir faire un
pronostic". .. ? Toutes ces
réponses sont exactes,
mais on passe à côté de
l'essentiel. A partir du
moment on l'on décide
de consulter, cela vaut
largement le coup (je
trouve) de parler
vraiment de génétique.
Oui, il existe bien une
vulnérabilité génétique,
oui ses enfants seront
plus à risque que
d'autres, oui la
concentration familiale
témoigne d'une
vulnérabilité plus
importante. Bien sûr, ces
réalités risquent de
réveiller des fantasmes et
de susciter l'angoisse du
sujet, il reste donc à faire
l'essentiel, reprendre
différents concepts clés
avec le patient : (1) la
vulnérabilité génétique
(être vulnérable n'est pas
être malade), (2) la
génétique des
pathologies
polyfactorielles (la
génétique n'explique
qu'une part de ce qui est
en jeu, l'éducation, la vie
menée font grandement
varier ce risque), (3) la
pénétrance incomplète
(même les vrais jumeaux
de sujets malades ne
sont pas tous atteints),
(4) l'augmentation du
risque familial (avoir
trois fois plus de risque
que la population
générale [3 x 5%] laisse
une majorité de chances
de ne rien avoir [15%
<50%], …Avec ce type
d’explications, la
relation avec le patient
devient ainsi plus
partenaire, moins
infantilisante.
Philip Gorwood
C.H.U. Louis Mourier, service de psychiatrie (Pr Adès), INSERM U 675
11 - Juin 2005 - N°10
Addictions
et quand les modalités de
consommation restent stables
au cours du temps. Pour Clo-
ninger, un psychiatre améri-
cain, ce n'est pas l'alcoolisme
en tant que tel qui est trans-
mis, mais plutôt un type parti-
culier de consommation
(début précoce et abus sévè-
re), auquel certains facteurs
(sexe masculin, conduite anti-
sociale) sont associés. Il dis-
tingue ainsi deux sous-types
d'alcoolisme.
●
●
Le type I, ou abus "dépen-
dant du milieu", qui existe
chez l'homme et chez la
Interview
ccrriitt ddaannss lleess ggèènneess??
Etudes
familiales,
études de
jumeaux et
études
d’adoption
révèlent
certaines
transmissions
génétiques
ccrriitt ddaannss lleess ggèènneess??
Addic10_010 A 014 7/06/05 3:28 Page 3

Dossier
hyperactivité de l'enfance -
trouble des conduites - com-
portements délictueux - per-
sonnalité psychopathique -
développement d'une dépen-
dance, s’il n’est pas inéluc-
table, est suffisamment obser-
vé pour offrir des pistes de
recherche intéressantes dans
la compréhension des méca-
nismes impliqués dans la
dépendance.
Les études de jumeaux ont
également permis d’identifier
des facteurs génétiques com-
muns entre hyperactivité et
trouble des conduites (87%),
et entre trouble des conduites
et dépendance à l’alcool (71 à
76%). Certaines caractéris-
tiques cognitives spécifiques à
ces troubles prémorbides,
elles-mêmes probablement
génétiques, pourraient sous-
tendre cette vulnérabilité
commune.
Alcoolisme
et toxicomanie
Il existe par ailleurs une
convergence d’éléments lais-
sant supposer un déterminis-
me génétique des dépen-
dances, indépendamment de
la nature de la substance
consommée, que confirme la
forte comorbidité alcoolisme-
toxicomanie, révélée tant par
les études familiales sur la
toxicomanie que les études
d’adoption, qui ont montré
que les parents biologiques
d’enfants toxicomanes sont
plus souvent dépendants que
les parents adoptifs, et ce quel
que soit le toxique.
Les recherches sur les lignées
de rat et de souris confortent
ces données. Par croisement
de lignées, on peut obtenir
des souris et des rats " préfé-
rant l'alcool " (contrairement
à la plupart de leurs congé-
nères), capables d’absorber en
alcool jusqu'à 30 % de leur
consommation hydrique quo-
tidienne. Or la préférence
pour l'alcool d’une lignée est
fréquemment corrélée à une
forte consommation de déri-
vés opiacés et de cocaïne,
révélant une préférence croi-
sée des rongeurs aux diffé-
rents psychotropes.
Des gènes
de vulnérabilité à
l’alcoolo-dépendance
De nombreux marqueurs
génétiques ont été testés dans
la maladie alcoolique. Ils
concernent principalement
les gènes correspondant aux
récepteurs de certains neuro-
médiateurs (voir encadré) :
sérotonine, dopamine, GABA en
particulier, impliqués dans les
phénomènes d’appétence, de
dépendance et de tolérance.
➜
➜Dopamine
Les récepteurs qui ont fait
l’objet du plus grand nombre
de recherches dans le domai-
ne de l’alcoolisme sont ceux
de la dopamine, en particulier
son récepteur D2. La dopami-
ne est le neuromodulateur qui
ancre la sensation de récom-
12 - Juin 2005 - N°10
Addictions
Vulnérabilité génétique et conduites d’addiction
femme, et se caractérise par
un abus peu sévère, un début
à l’âge adulte, sans histoire de
criminalité chez les parents
biologiques.
●
●
Le type II, ou abus "dépen-
dant du sexe", qui à l’inverse
se caractérise par un début
dans l'enfance, un abus sévè-
re, un fort taux de criminalité
chez les parents biologiques et
une forte composante géné-
tique, les facteurs postnataux
jouant un rôle minime.
Pour Cloninger , ces sous-
groupes ont hérité de méca-
nismes neuroadaptatifs qui se
reflètent dans leur comporte-
ments. Ainsi, le type II se dis-
tingue par une forte recherche
de nouveauté, peu d'évite-
ment de la douleur, et une
faible dépendance à la récom-
pense. Par exemple, ces sujets
sont peu capables de différer
un comportement (prise de
boisson) lors d'une situation
de stress, personnelle, familia-
le ou sociale.
Le coefficient d'héritabilité de
la conduite alcoolique, situé
entre 21 et 88%, varierait ainsi
en fonction du type, I ou II,
auquel le malade se rattache.
Hyperactivité,
troubles de conduite
Les facteurs héréditaires pour-
raient aussi se manifester
dans les liens existant entre
l'alcoolo-dépendance et
d'autres pathologies psychia-
triques. Une comorbidité spé-
cifique est souvent repérée
chez les alcooliques adultes,
en l’occurrence le déficit
attentionnel avec hyperactivi-
té, trouble particulier du com-
portement apparaissant dès
l’enfance. Une étude récente
s’est intéressée à 220 sujets
suivis pendant une vingtaine
d'années. Elle a permis de
montrer que l'hyperactivité
augmentait de 8 fois le risque
de trouble de conduite. La
présence d'un trouble de
conduite amène très souvent,
quant à elle, à l'accomplisse-
ment d'actes illégaux (vols,
fugues ou brutalités) (risque
multiplié par 12). Actes illé-
gaux apparaissant précoce-
ment qui sont à leur tour asso-
ciés à un risque accru (13 fois
plus élevé) de personnalité
psychopathique à l'âge adulte.
Enfin, la personnalité psycho-
pathique est chez l'adulte le
trouble le plus fortement
associé à un risque de dépen-
dance, qu’elle augmente de 21
fois. Cet enchaînement :
Une forte comorbidité alcoolisme-toxicomanie.
Le déficit
attentionnel
avec
hyperactivité,
un trouble qui
apparaît dès
l’enfance.
❝
❝
Addic10_010 A 014 7/06/05 3:29 Page 4

13 - Juin 2005 - N°10
Addictions
guments plaident en faveur
du rôle significatif de la séro-
tonine, son recaptage et son
transport, dans la préférence
pour l’alcool. Son gène pour-
rait être plus spécifiquement
associé à certains sous-types
de l’alcoolo-dépendance , un
de ses allèles étant lié à la
sévérité et au nombre de ten-
tatives de suicide dans des
populations d’alcooliques.
➜
➜GABA
L'anxiété, et parfois les
convulsions, observées au
cours du sevrage pourraient
être expliquées quant à elles par
l'action de l'éthanol sur le
récepteur GABAA. L’alcool facili-
te en effet la fixation du GABA
sur son récepteur, empêchant
la propagation normale des
informations dans le réseau
neuronal. En recherche anima-
le, on a montré que l’aversion à
l’éthanol, comme l’impact de
l’alcool sur la coordination
motrice et l’induction de som-
meil variait d’une lignée de rats
à l’autre en fonction de leur
génotype pour une sous-unité
du récepteur GABAA. Cette
sous-unité a particulièrement
retenu l’attention depuis
qu'une étude réalisée chez des
Indiens d’Amérique (très tou-
chés par l’alcoolo-dépendance)
a montré qu’une des régions du
génome transmise en même
temps que l’alcoolo-dépendan-
ce comportait ce gène.
➜
➜Enzymes
Enfin, les enzymes hépatiques
impliqués dans le métabolis-
me de l'alcool intéressent éga-
lement les chercheurs, dans la
mesure où la plus ou moins
grande capacité d’un individu
à métaboliser l’éthanol va
avoir un impact sur ses moda-
lités de consommation, et par
conséquence sur le risque
d’alcoolisme qui le menace.
L’alcool est dégradé au niveau
du foie par l’action d’un enzy-
me, l’ALDH, qui le transforme
en acétaldéhyde, toxique pour
l’organisme. L’acétaldéhyde
est dégradé à son tour en acé-
tate, jusqu’à élimination totale
de l’alcool dans l’organisme.
On a montré l’existence d’une
pense potentielle pour les sti-
muli environnementaux (tels
l'alimentation, les rapports
sexuels…). On l'a souvent inti-
tulée (à tort) la molécule du
plaisir, alors qu'en fait elle ne
fait que signaler (au sens
propre) de manière anticipa-
toire l'arrivée d'une récom-
pense à venir. L'alcool a la
particularité de faire se libérer
directement de la dopamine.
L'ensemble des études cas-
témoins portant sur plus de
1300 malades et 1 300 témoins
montrent une association
significative entre l'allèle A1 du
récepteur D2 et l'alcoolisme.
Le risque relatif d'alcoolisme
est trois fois plus élevé pour les
porteurs de cet allèle A1. Il est
vraisemblable que l'allèle A1
joue un rôle dans plusieurs
pathologies évoquant l’alcoo-
lo-dépendance, dans la mesu-
re où il est retrouvé dans les
toxicomanies comorbides.
De nombreuses données sug-
gèrent par ailleurs l’implica-
tion du gène du récepteur D2
de la dopamine dans les sys-
tèmes de récompense et la
vulnérabilité aux addictions. A
petites doses, l'éthanol a un
effet excitant sur les neurones
dopaminergiques de l'aire teg-
mentale ventrale (région du
cerveau associée au plaisir),
générant ainsi une "récom-
pense pharmacologique" qui
renforce à son tour un com-
portement de recherche d'al-
cool. Noble et al. (1991) a
montré que l’allèle A1 est
fortement associé à une hypo-
sensibilité (baisse de l’affinité)
des récepteurs D2 à la dopami-
ne. Les sujets souffrant d’al-
coolo-dépendance seraient
donc particulièrement peu
sensibles aux effets de récom-
pense liés à la dopamine, en
partie du fait de leur consom-
mation d’alcool, et en partie du
fait de l’existence dans leur
génome de l’allèle A1 du D2.
Ces données sont compa-
tibles avec une étude de
cohorte portant sur des
enfants à haut risque d’alcoo-
lisme qui montre que le fac-
teur le plus prédisposant est
leur tolérance initiale à l’al-
cool, aptitude qui, en termes
biologiques, se traduit par
une hyposensibilité des
récepteurs D2.
Par ailleurs, des données
convergentes suggèrent le rôle
d’un gène de la dopamine
dans les accidents de sevrage
d’alcool (crises convulsives de
sevrage et de delirium tre-
mens). Ce qui tendrait à mon-
trer que indépendamment du
phénomène de la dépendance
à l’alcool, certains facteurs
génétiques peuvent aussi aug-
menter les complications liées à
la maladie.
➜
➜Sérotonine
Autre neuromédiateur clef
dans la régulation des com-
portements, la sérotonine,
impliquée dans l’impulsivité
et les passages à l’acte vio-
lents. Un grand nombre d’ar-
De nombreux marqueurs génétiques ont été testés dans la
maladie alcoolique.
Vin et musique...chez les Beethoven
Chez les Beethoven, l'alcool fut à la fois source de
revenus et de pathologie. L'arrière-arrière grand-père,
puis le grand-père, excellent musicien, de Beethoven
tenaient un commerce de vins dont ils étaient
eux-mêmes consommateurs intempérants. Sa grand-
mère paternelle mourut d'alcoolisme. Quant à son père,
ténor réputé, il était plus connu encore pour ses excès
de boisson. Ludwig lui-même mourut à 57 ans d'une
cirrhose du foie.
Addic10_010 A 014 7/06/05 3:29 Page 5

Dossier
variante de l'enzyme ALDH
chez certains Orientaux, inca-
pables de ce fait de métaboli-
ser l'acétaldéhyde. L'ingestion
d'alcool chez ces sujets pro-
voque un phénomène de
“flush” (1) . Une telle configura-
tion d’intolérance génétique à
l’éthanol, qui entraîne une bais-
se significative de la consom-
mation individuelle, semble
donc correspondre à un “gène
de protection” par rapport à l’al-
coolo-dépendance.
Interactions entre
les gènes
et l’environnement
Il est clair que les facteurs
génétiques impliqués dans la
dépendance ne sont pas de
type "déterminants", mais
qu’ils opèrent en abaissant le
"seuil de vulnérabilité"
(comme pour l'essentiel des
pathologies polyfactorielles).
Ainsi le risque de dépendance
chez les enfants adoptés
dépend à la fois de l’environne-
ment (abus d’alcool chez les
parents adoptifs), pour une
part modérée, et de l’hérédité
(alcoolo-dépendance chez les
parents biologiques), pour une
plus large part. Les facteurs
familiaux non génétiques ne
participeraient qu’à 37% dans
la transmission. Différents tra-
vaux laissent supposer que cer-
taines dispositions comme
l’agressivité durant l’enfance,
ou un comportement d’oppo-
sition à l’entourage, ou certains
traits psychopathologiques
peuvent jouer comme des
"facteurs intermédiaires" entre
la vulnérabilité génétique, l’en-
vironnement prédisposant et
l’émergence de la dépendance
(alcool ou drogue).
Les études de jumeaux ont
elles aussi montré une vulné-
rabilité génétique commune à
l’alcoolisme, à d’autres abus
de substances, et à certains
troubles du comportement de
l’enfant . Cette vulnérabilité
commune implique encore
une fois un rôle partagé des
facteurs génétiques et envi-
ronnementaux, la rencontre
au produit constituant un cas
particulier de cette vulnérabili-
té. Ainsi certains traits de tem-
pérament, comme la
recherche de sensation (le
sujet se montre toujours avide
de nouveauté, se lassant très
vite d’une activité ou d’une
situation) augmentent les
risques d’exposition au pro-
duit. De son côté, un environ-
nement peut favoriser ou
réprimer une vulnérabilité
génétique sous-jacente. Il est
clair par exemple que les
règles morales et religieuses
familiales protègent en partie
l’individu d’un usage inappro-
prié de l’alcool. Alors qu’à l’in-
verse, un climat familial per-
turbé ou le manque d’atten-
tion des parents vis-à-vis de
leurs enfants agissent en sens
inverse.
Toutes ces données suggèrent
que, au-delà de la simple addi-
tion des facteurs de risque,
l’environnement, en interagis-
sant avec les tendances héri-
tées de l’individu, pourrait
modifier l’activité transcrip-
tionnelle de certains gènes
tout au long des processus de
neurodéveloppement, confé-
rant ensuite, de manière
stable, une vulnérabilité à cer-
taines pathologies liées à l’al-
coolo-dépendance, ou à l’al-
coolo-dépendance elle-même.
Que peut attendre
le thérapeute
de la génétique ?
La composante génétique de
l’alcoolo-dépendance est sur-
tout évidente quand elle a
commencé avant 20 ans, et
qu’apparaissent des antécé-
dents familiaux d’alcoolisme
(type II de Cloninger). Il est
vraisemblable que des fac-
teurs de vulnérabilité prédis-
posent à un comportement
général d’addiction et de
conduites impulsives,
incluant l’alcoolodépendance.
Les données génétiques peu-
vent être utiles au clinicien,
dans la mesure où elles vont
l’aider à évaluer un risque
individuel en fonction d’anté-
cédents familiaux de patholo-
gie directement ou indirecte-
ment liés à l’alcool (autres
dépendances, hyperactivité,
personnalité antisociale).
Cette aide peut être particuliè-
rement utile face à un adoles-
cent cumulant consomma-
tion excessive, conduite aso-
ciale et antécédents fami-
liaux. La notion de vulnérabi-
lité croisée pour les autres
substances addictives peut
également alerter le thérapeu-
te sur le risque d’émergence
d’autres dépendances dans le
parcours du sujet.
(1) manifestation de l’intolérance
à l’alcool se traduisant par des
rougeurs au visage et des nausées.
14 - Juin 2005 - N°10
Addictions
Vulnérabilité génétique et conduites d’addiction
L’environnement peut favoriser ou réprimer une vulnérabilité sous-jacente.
Quelques mots sur les neurotransmetteurs
Le cerveau est le siège de stimulations internes
véhiculées par les neuromédiateurs, substances
chimiques assurant la transmission de l’information
d’un neurone à l’autre, grâce à un récepteur spécifique.
L’alcool perturbe l’action des neuromédiateurs par
différents mécanismes : stimulation de la production,
ou inhibition de la recapture des produits en excès ou
modification de l’action de ces médiateurs sur leurs
récepteurs.
Dopamine : joue un rôle clé dans l’harmonisation des
mouvements et attribue une valeur plus ou moins
prioritaire aux événements externes.
Sérotonine : c’est un régulateur du cycle veille-
sommeil impliqué dans la régulation de l'humeur
Gaba : joue comme un frein pour les neurones sur
lesquels il est localisé
Addic10_010 A 014 7/06/05 3:30 Page 6
 6
6
1
/
6
100%