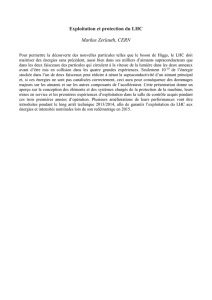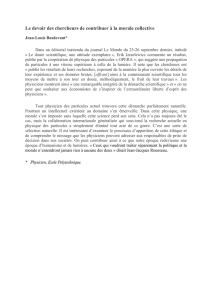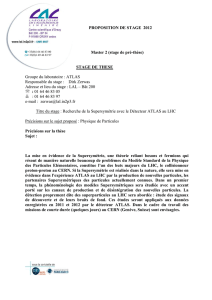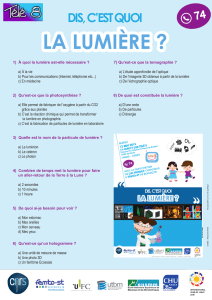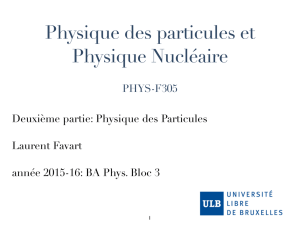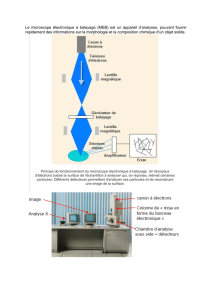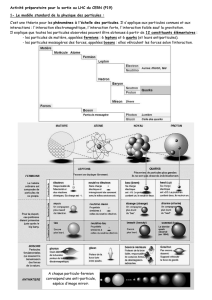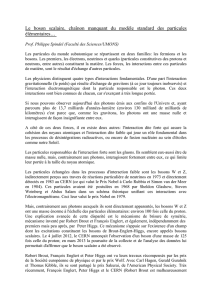Le Modèle Standard - International Particle Physics Outreach Group

É
LÉMENTAÍRE
De l’infiniment petit à l’infiniment grand
Équinoxe de printemps 2008
Revue d’information scientifique
Le Modèle
Numéro 6
Standard

Revue d’information paraissant deux fois par an, publiée par : Élémentaire, LAL, Bât. 200, BP 34, 91898 Orsay Cedex
Tél. : 01 64 46 85 22 - Fax : 01 69 07 15 26. Directeur de la publication : Sébastien Descotes-Genon
Rédaction : N. Arnaud, M.-A. Bizouard, S. Descotes-Genon, F. Fulda-Quenzer, M.-P. Gacoin, L. Iconomidou-Fayard, H. Kérec, G. Le Meur,
P. Roudeau, J.-A. Scarpaci, M.-H. Schune, J. Serreau, A. Stocchi.
Illustrations graphiques : S. Castelli, B. Mazoyer, J. Serreau. Maquette : H. Kérec.
Ont participé à ce numéro : N. Alamanos, F. Couchot, J. Haissinski, J.-L. Puget, P. Royole-Degieux.
Remerciements : nos nombreux relecteurs.
Site internet : C. Bourge, N. Lhermitte-Guillemet, http://elementaire.web.lal.in2p3.fr/
Prix de l’abonnement : 6 euros pour 2 numéros (par site internet ou par courrier)
Imprimeur : Imprimerie Nouvelle de Viarmes. Numéro ISSN : 1774-4563
É
LÉMENTAÍRE
De l’infiniment petit à l’infiniment grand
À l’occasion de ce numéro d’Élémentaire, nous vous in-
vitons à découvrir le « Modèle Standard ». Un curieux
nom qui s’est imposé au fil des années, même s’il évoque
plus les défilés de mode parisiens que la physique des
particules. Un modèle de quoi ? Et en quoi serait-il plus
standard que les autres ? C’est ce que nous allons essayer
d’expliquer à travers les rubriques de ce numéro.
En fait, pour concocter l’« Apéritif », mélangez des consti-
tuants élémentaires de matière (des quarks, des neutrinos,
des électrons...) avec des interactions bien choisies (élec-
tromagnétique, forte, faible), secouez bien fort et vous ob-
tiendrez la description la plus aboutie de nos connaissan-
ces sur la structure intime de la matière... rien que ça !
Comme jadis à la Samaritaine, on trouve donc de tout dans
le Modèle Standard. Cette théorie est née progressivement
dans les années 60 et 70 afin de réunir les trois interac-
tions qui interviennent en physique des hautes énergies :
l’électromagnétisme, l’interaction forte et l’interaction fai-
ble. C’est cette petite dernière qui donnera le plus de fil
à retordre aux théoriciens, ce que nous verrons dans la
rubrique « Théorie ». Elle sera aussi l’objet d’une atten-
tion toute particulière au CERN (« Centre ») pour identifier
les particules qui la transportent, les bosons W+, W- et Z0.
Cette saga commence dans les années 80 avec les expé-
riences UA1 et UA2 (« Découverte ») pour se conclure en
beauté avec les mesures de précision effectuées au LEP
dans les années 90 (« Expérience »).
Nous en profiterons pour décrire certains outils qui se
sont avérés fort utiles dans cette chasse aux bosons de
l’interaction faible. « Détection » s’intéressera à des dispo-
sitifs appelés détecteurs de vertex, particulièrement utiles
pour identifier certaines particules issues d’une collision.
« Analyse » vous initiera à différentes méthodes inventées
par les physiciens pour repérer parmi ces collisions les
événements les plus intéressants, tout en vous offrant quel-
ques détours botaniques, biologiques et informatiques.
Pour l’ « Interview », nous donnerons la parole à Jean Ilio-
poulos, un théoricien qui a participé à l’élaboration du
fameux Modèle Standard.
Vous retrouverez également nos autres rubriques habi-
tuelles. « LHC » s’intéressera aux éléments accélérateurs
qui fourniront en faisceaux de protons les expériences du
LHC, et « Icpackoi » fera le point sur les coupes sombres
dans le budget fédéral des États-Unis et leur impact sur nos
disciplines.
Nous profitons de cet éditorial pour remercier chaleureu-
sement les parrains qui nous accompagnent dans l’aven-
ture « Élémentaire », en particulier l’IN2P3, ainsi que P2I
qui nous rejoint à l’occasion de ce numéro.
Au fil de ces pages, vous sentirez peut-être les émotions
contradictoires, tantôt admiratives, tantôt agacées, que sus-
citent le Modèle Standard. Au cours de sa brève existence,
il a déjà affronté de nombreux tests tout en expliquant un
vaste éventail de phénomènes. Et pourtant, nous savons
qu’il est incomplet, avec ses nombreux paramètres arbitrai-
res, son ignorance de la gravitation, et son boson de Higgs
qui manque toujours à l’appel. De quoi justifier l’enthou-
siasme des physiciens pour les prochaines expériences du
LHC : si l’on s’attend à y confirmer de nombreux aspects
du Modèle Standard, on espère bien le mettre enfin en
défaut... Ce sera d’ailleurs le thème d’un prochain numéro
d’Élémentaire. Mais d’ici là, bonne lecture !

Analyse p. 33
Discriminant de Fisher et
réseaux de neurones
Interview p. 10
Jean Iliopoulos
Détection p. 26
Les détecteurs de vertex en
silicium
Accélérateurs p. 38
Les collisionneurs : révolution
dans les accélérateurs
de particules
Histoire p. 7
Quelques dates marquantes
É
LÉMENTAÍRE
De l’infiniment petit à l’infiniment grand
Retombées p. 29
Le rayonnement synchrotron
Et le web fut !
La question qui tue
p. 68
Peut-on (doit-on) tout unifier ?
ICPACKOI p. 65
La feuille de déroute des États-Unis
Physique des deux infinis
Le LHC p. 59
Le LHC : un accélérateur sans égal
Apéritif p. 4
Un modèle tout en
séduction
Centre de
recherche p. 14
Le CERN
Théorie p. 52
De la force faible à l’interaction
électrofaible
Expérience p. 20
Le LEP
Découvertes p. 46
À la chasse aux bosons W et Z
Abonnement : faites votre demande d’abonnement sur le
serveur : http://elementaire.web.lal.in2p3.fr/ ou à l’adresse : Groupe
Élémentaire LAL, Bât 200, BP 34, 91898 Orsay cedex. Prix pour
deux numéros (port inclus) : 6 euros au total, chèque libellé à l’ordre
de «AGENT COMPTABLE SECONDAIRE DU CNRS». Pour les
administrations les bons de commande sont bienvenus.
Contact : elemen[email protected]

page 4
É
LÉMENTAÍRE
Apéritif
Le « Modèle Standard » de la physique des particules, élaboré dans
les années 60 et 70, est le cadre théorique permettant de décrire les
particules élémentaires connues actuellement ainsi que leurs interactions.
Il donne une description cohérente et unifiée des phénomènes aux
échelles subatomiques (c’est-à-dire à des distances inférieures à 10-15 m
et supérieures à 10-18 m). Comme nous l’avons vu dans les
numéros précédents d’Élémentaire, qui dit petites échelles
dit grandes énergies. C’est pourquoi le Modèle Standard
s’appuie d’une part sur la physique quantique (petites
échelles) et d’autre part sur la relativité restreinte d’Einstein
(grandes énergies).
Moyennant l’introduction d’un certain nombre de
paramètres qui ont été déterminés par des expériences,
le Modèle Standard rend compte de tous les phénomènes
microscopiques qui se manifestent lorsque l’on sonde la
matière jusqu’à des distances correspondant au centième
de la taille d’un proton. De telles distances peuvent être
explorées lors de collisions à haute énergie (de l’ordre de
100 GeV).
Pour des raisons historiques, il est d’usage de distinguer
les particules de matière et les particules d’interaction
(voir le tableau ci-contre). Les premières sont les quarks
et les leptons que nous avons déjà rencontrés dans les
précédents numéros d’Élémentaire. Elles interagissent en
« échangeant » des particules d’interaction, le photon, les
bosons W± et Z0 ainsi que les gluons.
Trois familles, égales en noblesse...
Le Modèle Standard regroupe les quarks et les leptons en trois familles
structurées de façon identique. Chacune d’elles est composée de deux
quarks et de deux leptons. On distingue les leptons des quarks par les
interactions auxquelles ils sont sensibles : les leptons, à la différence des
quarks, ne sont pas sensibles à l’interaction forte. En fait, une seule famille
(la première, composée de l’électron, de son neutrino, et des deux quarks u
et d) est suffisante pour rendre compte de la matière ordinaire. Les atomes,
par exemple, sont constitués d’électrons s’agitant autour d’un noyau, lui-
même composé de protons et de neutrons, c’est-à-dire in fine de quarks u
et d. Comme nous l’avons vu dans les précédents numéros d’Élémentaire,
les quarks et leptons des autres familles ont été découverts en étudiant les
rayons cosmiques et dans des expériences réalisées auprès d’accélérateurs
de très haute énergie. Il existe ainsi six types de leptons et six types de
quarks.
À cet ensemble, il faut en ajouter un autre, de structure identique, dans
lequel chaque particule est remplacée par son antiparticule, ayant la
Un modèle tout en séduction

page 5
É
LÉMENTAÍRE
Un modèle tout en séduction
Quelques questions que vous vous posez
sur le Modèle Standard et toujours
sans réponse à l’heure actuelle !
même masse mais dont la charge électrique a une valeur opposée. À
l’électron est ainsi associé le positron, au quark u l’anti-quark noté u, etc...
La première antiparticule, l’anti-électron ou positron fut découverte en
1932 (Élémentaire N° 3).
Que les forces soient avec vous
Dès les années 1930, les physiciens postulent que l’interaction entre deux
particules de matière est due à l’échange d’une troisième dont la masse
est directement reliée à la portée de l’interaction. Ce modèle permet une
interaction à distance entre deux particules. Plus la masse de la particule
échangée est petite plus la portée de l’interaction est grande. On appelle
particules d’interaction celles qui transmettent les forces fondamentales.
Elles font en quelque sorte office d’agents de liaison.
Des quatre interactions fondamentales, deux nous sont connues par
l’expérience quotidienne et ont été étudiées en physique « classique » : la
gravitation et la force électromagnétique. Les forces correspondantes ont
en commun d’être de portée infinie et d’avoir une intensité qui décroît
comme le carré de la distance séparant les deux objets en interaction.
En théorie quantique, cela implique que les vecteurs de ces interactions
(leurs « messagers ») sont de masse nulle. Il s’agit du photon pour
l’électromagnétisme, et du graviton pour la gravitation. Il faut toutefois
noter que si l’existence du photon n’est plus à démontrer, on n’a pas
encore observé de graviton de manière directe. Cependant, la gravitation
joue un rôle mineur du fait de sa très faible intensité aux énergies atteintes
actuellement lors des collisions entre particules. Elle est donc tout
simplement négligée au niveau subatomique et n’est pas incluse dans le
« Modèle Standard ».
Nous avons exploré les multiples facettes de l’interaction forte dans le N°4
d’Élémentaire. Nous avons en particulier noté que les gluons, messagers
de cette interaction, sont de masse nulle. Cependant, pour de subtiles
raisons d’écrantage, l’interaction forte reste de portée très petite, ce qui
explique qu’elle est cantonnée au sein des noyaux atomiques.
La quatrième interaction est l’interaction faible qui est responsable, entre
autres, de la désintégration bêta de certaines particules élémentaires et
de noyaux (Élémentaire N°2). Elle est aussi une force de portée inférieure
à la taille de l’atome à cause des masses élevées des messagers qui la
véhiculent, les bosons intermédiaires W± et Z0, plus de 80 fois plus massifs
qu’un proton !
Un des grands succès de la physique du XXe siècle a été d’unifier dans
une même description l’interaction faible et l’électromagnétisme qui
apparaissent comme deux aspects d’une même force. Ce succès théorique
a été couronné expérimentalement par la découverte en 1984 au CERN
des particules W± et Z0 (« Histoire ») et par l’étude de leurs propriétés.
_
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
1
/
72
100%