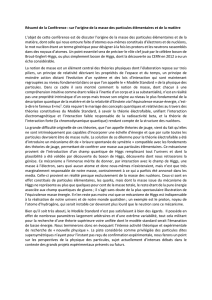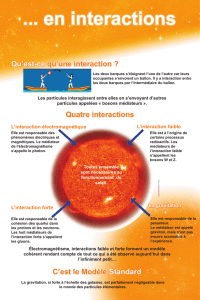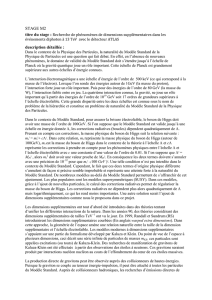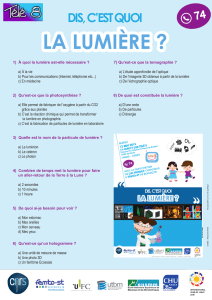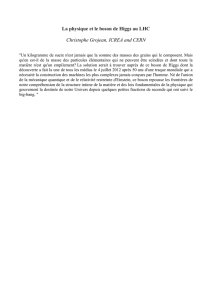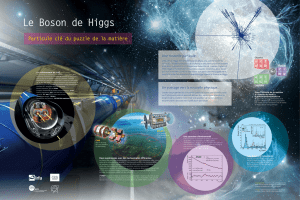via ce lien

Le boson scalaire, chaînon manquant du modèle standard des particules
élémentaires…
Prof. Philippe Spindel (Faculté des Sciences/UMONS)
Les particules du monde subatomique se répartissent en deux familles: les fermions et les
bosons. Les premiers, les électrons, neutrinos et quarks (particules constitutives des protons et
neutrons, entre autres) constituent la matière. Les forces, les interactions entre ces particules
de matière, sont le résultat d'échange d'autres particules.
Les physiciens distinguent quatre types d'interactions fondamentales. D'une part l'interaction
gravitationnelle (le poids) qui résulte d'échange de gravitons (à ce jour toujours inobservés) et
l'interaction électromagnétique dont la particule responsable est le photon. Ces deux
interactions sont bien connues de chacun, car s'exerçant à très longue portée.
Si nous pouvons observer aujourd'hui des photons émis aux confins de l'Univers et, ayant
parcouru plus de 13,7 milliards d'années-lumière (environ 130 milliard de milliards de
kilomètres) c'est parce que, comme les gravitons, les photons ont une masse nulle et
interagissent de façon insignifiante entre eux.
A côté de ces deux forces, il en existe deux autres: l'interaction dite forte qui assure la
cohésion des noyaux atomiques et l'interaction dite faible qui joue un rôle fondamental dans
les processus de désintégrations radioactives, ou encore de fusion nucléaire au sein d'étoiles
comme notre Soleil.
Les particules responsables de l'interaction forte sont les gluons. Ils semblent eux-aussi être de
masse nulle, mais, contrairement aux photons, interagissent fortement entre eux, ce qui limite
leur portée à la taille du noyau atomique.
Les particules échangées dans les processus d'interaction faible sont les bosons W et Z,
indirectement perçus aux travers de réactions particulière de neutrinos en 1973 et directement
détectés en 1983 au CERN (ce qui valut le Prix Nobel à Carlo Rubbia et Simon van der Meer
en 1984). Ces particules avaient été postulées en 1968 par Sheldon Glashow, Steven
Weinberg et Abdus Salam dans un schéma théorique unifiant ces interactions avec
l'électromagnétisme. Ceci leur valut le prix Nobel en 1979.
Mais, contrairement aux photons auxquels ils sont directement apparentés, les bosons W et Z
ont une masse énorme à l'échelle des particules élémentaires: environ 100 fois celle du proton.
Une explication avancée de cette disparité est le mécanisme de brisure de symétrie,
mécanisme inventé par Robert Brout et François Englert, et également, indépendamment des
premiers mais peu après, par Peter Higgs. Ce mécanisme s'appuie sur l'existence d'un champ
dont les excitations constituent les bosons de Brout-Englert-Higgs, encore appelés bosons
scalaires. Le 4 juillet 2012, le CERN annonçait l'observation d'un boson d'une masse de 125
fois celle du proton; en mars 2013 la poursuite de la collecte et de l'analyse des données lui
permettait d'affirmer que le boson scalaire a été observé.
Robert Brout, François Englert et Peter Higgs ont vu leurs travaux récompensés par les prix
de la Société européenne de physique et par le prix Wolf. Avec Carl Hagen, Gerald Guralnik
et Thomas Kibble, ils se sont partagé le prix Sakurai, de l'American Physical Society. Très
récemment, François Englert, Peter Higgs et le CERN (Robert Brout est malheureusement

décédé en mai 2011) ont obtenu, pour leurs travaux en la matière, le prix Prince des Asturies
de Recherche Scientifique et Technique. Très récemment, c'est le Prix Nobel qui a couronné
les travaux de François Englert et Peter Higgs « pour la découverte théorique d'un mécanisme
qui contribue à notre compréhension de l'origine de la masse de particules subatomiques, et
qui fut récemment confirmé, aux expériences ATLAS et CMS au LHC du CERN, par la
découverte de la particule fondamentale prédite ».
Ainsi après le prix Abel décerné cette année au mathématicien belge Pierre Deligne, la
Belgique peut s'enorgueillir de voir un autre des siens recevoir un prix tout aussi prestigieux.
Pour en savoir plus, visitez le site:
http://www.ulb.ac.be/sciences/physth/brout_englert_higgs.html
1
/
2
100%