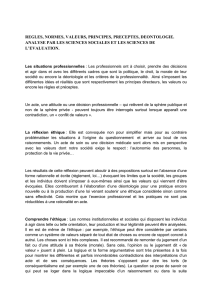ETHIQUE ET RESPONSABILITE « De l`éthique des

1
ETHIQUE ET RESPONSABILITE
« De l’éthique des dirigeants d’association »
!Intervention de Jacques LE GOFF, Professeur de Droit Social à la Faculté de Droit de Brest
dans le cadre des Journées d’Etude du G.N.D.A. des 6 et 7 Mars 2002 à Paris
L’énoncé du beau thème de cette matinée : « De l’éthique des dirigeants
d’association », m’a séduit. Et pour une double raison :
• de forme tout d’abord. Elle tient à l’intitulé très classique dans la manière
latine, qui rappelle les XVIIe – XIXe siècles : De la recherche de la vérité, De
l’épouse parfaite, De la capacité politique des classes ouvrières… des titres
qui annonçaient des développements en forme de conversation, de variation
libre sur un thème.
• de fond ensuite par l’invitation qui m’était faite d’affronter à la fois un concept
très à la mode et pour cette raison des plus incertains : celui d’éthique, et un
couple non moins problématique : celui que forment l’éthique et la
responsabilité des dirigeants d’association. Il y avait là une stimulante
provocation à la réflexion que je placerai ce matin sous le patronage d’Ethique
et responsabilité.
Dans ce libellé, chacun des mots fait, en effet, difficulté. Ethique, responsabilité : de
quoi parle-t-on au juste ?
Partons de l’éthique. Qu’est-ce qui la spécifie par rapport à des termes aussi voisins
que ceux de morale, déontologie et droit ( la déontologie 1 se situant souvent à mi-
chemin de la morale et du droit ) ? Qu’est-ce que ce mot apporte comme valeur
ajoutée à l’intelligence de l’agir humain ? On confond souvent les termes de morale
et d’éthique : quel profit intellectuel y a-t-il à les dissocier ? Mon propos consistera
précisément à tenter de faire ressortir le spécifique de la démarche éthique en tant
qu’irréductible à celle guidée par la morale et par le droit. Qu’est-ce donc qu’une
décision placée sous l’horizon de l’éthique ?
La responsabilité ? La représentation dominante influencée par le droit en fait le
mécanisme d’imputation d’un acte à une personne physique ou morale. Le droit
comme la morale assignent des statuts de responsables. Au regard de la morale, il
ne fait pas de doute que les parents sont responsables de leurs enfants, les enfants
de leurs vieux parents, les auteurs d’un dommage de ses conséquences… Au regard
du droit on est déclaré responsable de, par décision de la loi ou du juge :
responsable des proches dont on a la charge au double sens, dans le cas des
enfants, de responsabilité vis à vis de et responsabilité de, des choses dont on a la
garde, des salariés placés sous son autorité, des dommages à l’environnement….
Dans tous ces cas, être responsable c’est répondre à une injonction de la société
selon ses attentes, à raison de certaines catégories de risques, et s’acquitter du
minimum qu’on lui doit faute de quoi on sera déclaré responsable le plus souvent
d’un défaut de responsabilité. Paradoxalement, on est le plus souvent responsable
en droit d’une irresponsabilité de fait. On est responsable de ne pas l’avoir été
1 La déontologie ( du grec!: to deon!: «!ce qu’il convient de faire!», dein!: lier, «!attacher!», et logos!: «!discours!» ) s’analyse
comme une morale particulière, propre à certaines professions.

2
suffisamment. On répond de ne pas avoir répondu, de ne pas avoir tenu notre rôle.
Et ce rôle est d’autant plus exigeant que la fonction est aussi éminente que celle de
directeurs d’association pour qui elle représente « un élément de dignité de la
fonction 2 ».
Il me semble que la responsabilité éthique est d’un autre ordre. Elle ne répond pas
d’abord à la question du qui ? du qui doit répondre ? mais à la question : « que dois-
je faire ? » étant entendu que cette fois la réponse n’est pas prescrite ; elle est
ouverte. Et je la définirai non comme injonction d’agir mais comme la convocation à
agir, à répondre imposée par une situation, par un événement qui placent soit dans
une situation de vide juridique, soit face à un conflit de principes et de normes qui
peuvent être juridiques mais entre lesquels il faut arbitrer sans autre secours que
celui de la conscience livrée à elle-même dans un espace sans garde-fou où le « ce
que l’on doit faire » n’est pas énoncé par avance. C’est justement parce qu’il y a
défaut de prescriptions certaines ou au contraire trop-plein d’obligations mais de
signe contraire, qui par conséquent tendent à s’annuler, que l’on se retrouve dans un
no man’s land où il faut décider mais sans autre guide pour la décision que le souci
du bien faire ou, bien souvent, de faire du moins mal possible. On se trouve
autrement dit confronté à des cas de conscience, à ce que les juristes américains
nomment des « hard cases », des cas difficiles qui obligent à trancher sans complète
certitude. Et ce n’est évidemment pas un hasard si le regain d’intérêt pour l’éthique
date des années 1970 c’est à dire de l’essor de la bioéthique comme effort de
réponse à des situations qui mettent en présence des exigences contraires mais de
statut équivalent : faut-il admettre la revendication des transsexuels qui souffrent
dans leur chair et dans leur esprit, faut-il admettre l’euthanasie, peut-on faire un
enfant pour sauver grâce à certaines de ses cellules un enfant gravement
malade… ? La décision éthique est en ce sens une décision sans filet, une décision
élaborée dans le clair-obscur du doute parce qu’il y a autant de raisons de faire ceci
que choisir son contraire, d’agir que de s’abstenir.
En ce sens on pourrait dire qu’alors que la responsabilité éthique a en commun avec
la responsabilité morale et juridique de répondre certes à une situation de risque à
juguler, mais en plus, et c’est sa particularité, elle suscite un risque pour celui qui
l’assume, le risque de l’incertitude. Ce qui me conduit à penser que la responsabilité
éthique relève de la responsabilité pure en tant qu’elle est indissociable du courage
du choix. Ici on pourrait risquer un rapprochement avec la réflexion d’Hans Jonas sur
notre responsabilité vis à vis des générations futures. Elle est essentiellement d’ordre
éthique la question étant de déterminer la conduite à adopter dans les situations de
risques pour l’avenir de l’espèce humaine. C’est l’objet du Principe responsabilité 3.
Partant du constat des « transformations de l'essence de l'agir humain », Jonas en
vient à définir un nouvel impératif catégorique dont l'une des formulations est la
suivante : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ». Et pour en éclairer la
mise en œuvre, Jonas propose ce qu'il nomme une « heuristique de la peur » c'est à
dire une règle de conduite incluant toujours la perspective du pire, celle d'une
menace contre l'image de l'homme. A l'opposé de l'optimisme scientiste fondé sur la
conviction que la science trouve toujours une solution aux problèmes qu'elle génère,
2 L. Engel, A. Garapon, «!La fonction publique saisie par le droit!», Esprit, octobre 1997, p. 109.
3 Le Cerf, 1990.

3
le philosophe allemand conseille d'examiner avec gravité toutes les conséquences
futures de la décision « en prêtant davantage l'oreille à la prophétie du malheur qu'à
celle du bonheur ». Mais il ne s'agit pas de se faire peur comme des enfants avec
d'horribles scénarios de science-fiction. Une telle attitude conduirait à la complète
paralysie de l'action. Il s'agit plutôt de se mettre dans cette disposition « spirituelle »
d'exploration méthodique et sans préjugés de tous les possibles et d'en tirer les
conclusions qui s'imposent. En sorte que la simple possibilité qu'une technique
menace l'existence ou l'essence de l'humanité ( manipulation du génome humain )
doit suffire à la prohiber inconditionnellement.
Par conséquent, en première analyse, il y aurait un régime propre de la
responsabilité éthique que je voudrais tenter de cerner de plus près, dans un premier
temps, en m’intéressant à la décision éthique que je comparerai, dans un second
temps, avec celle inspirée par la morale et le droit. Et c’est ce qui me conduira à
souligner, par-delà la dissymétrie de démarche, de nombreuses similitudes entre ces
deux volets.
I – La décision éthique
Pour cerner de plus près le propre de l’éthique, je vais m’appuyer sur la réflexion
d’un auteur que je tiens comme nombre d’entre vous en très haute estime : Paul
Ricoeur dont le Soi-même comme un autre m’a puissamment aidé dans cette
réflexion.
Ricoeur dit de l’éthique, de la visée éthique qu’elle est la visée d’une vie accomplie,
on pourrait aussi dire d’une vie juste, dans la conformité à l’estime de soi. C’est en ce
sens que l’on dit d’une personne animée d’un intense souci éthique qu’elle est un ou
une « juste » ( cf Le dernier des justes de Schwartz-Bart ou l’essai de Marek Halter
La force du bien ). Le juste n’est pas celui dont la conduite est simplement morale.
Cela en ferait une personne convenable. C’est celui qui sait prendre des risques, et
donc se renoncer à lui-même, dans l’intérêt d’autrui et pour se conformer à l’idéal de
son statut d’homme ou de sa fonction. On pourrait dire que le juste est celui qui ne
s’est pas déjugé, c’est à dire dont le comportement a toujours été en accord avec
l’estime de soi, qui a donc fait ce qu’il estimait devoir faire. Il se peut qu’il ait manqué
à la morale mais dans l’intérêt d’autrui qui constitue son Nord. Sans l’exclure, au
contraire, l’éthique mène au-delà de la morale, elle l’excède. Pour l’illustrer, je
reprendrai le débat classique entre Kant et Benjamin Constant autour du droit de
mentir : « A-t-on le droit de mentir ? ». Kant qui adopte une posture déontologique
très rigoureuse ne cédant rien des principes moraux répond par la négative et dans
tous les cas. Peut-on mentir au SS ou à l’agent du NKVD qui recherche un résistant
ou un dissident ? Non, dit Kant. L’idée qu’il se fait de l’estime de soi le lui interdit.
Constant n’est pas de cet avis et adopte une posture au contraire aristotélicienne qui
fait passer le bien de l’autre avant la norme somme doute sécurisante. Son point de
vue téléologique le conduit a prendre le risque du mensonge au mépris de sa
quiétude et dans l’intérêt d’autrui. En sorte que dans cette affaire c’est celui qui
respecte la morale sans concession qui apparaît comme un salaud et celui qui la
viole comme un juste. Ce qui ne signifie pas que morale et éthique soit
nécessairement en conflit, bien entendu. Mais il y a entre elles la différence entre la
conformité et l’excès mais toujours un excès justifié par l’intérêt d’autrui. Et du même
coup surgit un problème lié au subjectivisme ou à l’impressionnisme de la décision

4
éthique : n’est-elle pas de nature à ouvrir la voie à l’arbitraire de l’appréciation
relative de l’estime de soi et de l’intérêt d’autrui ? Pour prendre un exemple qui a fait
un peu de bruit ces derniers temps : la pédophilie que certains libertaires justifiaient
en mai 1968 par l’intérêt des enfants et qu’ils tenaient pour parfaitement compatible
avec leur propre estime de soi, était-elle de ce fait recevable ? La réponse va de soi.
C’est pourquoi Ricoeur, définit l’éthique comme « la visée de la vie bonne ( « souhait
d’une vie accomplie 4 » ) avec et pour autrui dans des institutions justes 5».
Autrement dit, même l’éthique n’échappe pas à une régulation par des institutions
reconnues justes et appelées à réguler la décision éthique, éventuellement
moralement et juridiquement hautement discutable, au regard des circonstances qui
l’ont justifiées. C’est d’ailleurs ce qui explique que la décision éthique soit de moins
en moins un exercice solitaire : cas de l’euthanasie, de l’expérimentation de
nouveaux traitements….
L’exercice éthique se définit par l’horizon du « bien », du « vivre bien », de la « vraie
vie 6 » ( Aristote ) dans une perspective de désintéressement.
Je voudrais reprendre les éléments de définition proposés par Ricoeur :
1 ) la vie bonne qui constitue la fin et le but de la démarche éthique se déploie
sur plusieurs plans d’existence. Au point de vue le plus général, on peut
considérer le plan le plus global, le plus englobant qui est celui de l’existence
même qu’il revient à chacun de mener à son plus haut niveau
d’accomplissement. Ce qui peut s’opérer par les voies les plus diverses, selon
les talents, le charisme de chacun, le critère de cet accomplissement n’étant
pas substantiel c’est à dire identifiable à la réalisation de telle ou telle valeur (
solidarité, courage, volonté, service…) mais existentiel à savoir l’estime de soi,
c’est à dire une forme de plénitude proprement morale faite du sentiment
d’avoir fait ce qu’il fallait, ce que je devais faire. Comme l’écrit Ricoeur, « la vie
bonne est pour chacun, la nébuleuse d’idéaux et de rêves d’accomplissement
au regard de laquelle une vie est tenue pour plus ou moins accomplie ou
inaccomplie […]. C’est le " ce en vue de quoi " tendent les actions 7 ». Et cette
estime de soi n’est pas le contentement de soi, car « le soi-même que l’on aime
c’est le meilleur de soi […] ce qui en soi-même est le plus durable, le plus
stable, le moins vulnérable au changement des humeurs et des désirs 8 ».
Mais cette visée se déploie également à des niveaux de portée plus limitée où
elle se spécifie sur un mode particulier. Ce peut être le plan de la citoyenneté,
de la parenté ou la vie professionnelle, tous niveaux également tendus vers la
réalisation de cette « vie bonne ».
En sorte que c’est dans un « travail incessant d’interprétation de l’action et de
soi-même que se poursuit la recherche d’adéquation entre ce qui nous paraît le
4 «!Approches de la personne!» ( Esprit, mars 1990, p. 116 ).
5 Soi-même comme un autre, Seuil, Points, 1996, p. 202.
6 Autant d’expressions d’Aristote empruntées à L’éthique à Nicomaque!:!«!Tout art et toute recherche, de même que toute
action et toute délibération réfléchie, tendent, semble-t-il, vers quelque bien Aussi a-t-on eu raison de définir le bien!: ce à
quoi on tend en toutes circonstances!».
7 Op.cit., p. 210.
8 Op.cit p. 216.

5
meilleur pour l’ensemble de notre vie et les choix préférentiels qui gouvernent
nos pratiques 9 ». Tout cela s’exprimant dans le cadre d’une existence qui n’est
pas la succession d’instants séparés les uns des autres, de présents sans
attaches, presque intemporels mais au contraire dans le déroulement de cette
existence qui constitue un récit, le récit de notre propre histoire. C’est pourquoi
Ricoeur insiste sur l’« unité narrative » de l’existence qui lui donne sa
cohérence. Je parlerai volontiers de l’héliotropisme de l’éthique c’est à dire de
ce travail de longue haleine qui consiste à disposer l’existence de la meilleure
manière pour être en mesure de percevoir certains types de problèmes et y
faire face.
2 ) « avec et pour les autres » : ce qui signifie que la visée éthique est
indissociable d’une pratique de mutuellisme, de réciprocité, d’échanges, de
sympathie, d’amitié, de sollicitude et de bienveillance. L’éthique se déploie donc
dans l’espace de la relation à l’autre qui me convoque, comme dit Lévinas, à la
responsabilité à son égard, qui me tient et me retient. Lévinas va très loin dans
le privilège accordé à autrui puisqu’il lui accorde la première place, il vient
d’abord : « pas de soi sans un autre qui le convoque à la responsabilité ». Il
ajoute : « L’expérience irréductible et ultime de la relation me paraît être […] le
face à face des humains 10 ». Or ce « face à face » est par lui traduit comme un
« visage à visage » dans une distance proche et pourtant infinie. Une citation
parmi beaucoup d’autres : « Autrui demeure infiniment transcendant, infiniment
étranger [ et ] son visage où se produit son épiphanie […] en appelle à moi 11 ».
Il en « appelle à moi » pour signifier au minimum « ne me tue pas » et au plus
fort « aimes moi ». Et non seulement il en appelle à moi mais il a l’antécédence,
il vient en premier au sens où la relation éthique part de l’autre et de son
mouvement vers moi, de la convocation qu’il m’adresse. Ce que Lévinas
résume en deux expressions qui portent loin : le « après vous » du passage à
une porte et : « Avant le cogito, il y a le bonjour ».
Une position radicale qui laisse entendre que la dynamique de la relation tire
son énergie de l’autre dans un rapport de pure gratuité. Elle se discute et
d’ailleurs Ricoeur suggère de faire sa place au mouvement qui vient de moi en
termes de bienveillance, sollicitude et compassion 12.
Et Ricoeur en tire la conséquence que « je ne puis m’estimer moi-même sans
estimer autrui comme moi-même. Comme moi-même signifie : toi aussi tu es
capable de commencer quelque chose dans le monde, d’agir pour des raisons,
de hiérarchiser tes préférences, d’estimer les buts de ton action et, ce faisant,
de t’estimer toi-même comme je m’estime moi-même 13 ». Ce qui conduit à la
conviction exprimée par J. Rawls selon laquelle la justice requiert de tout faire
9 Op.cit, p. 210.
10 Ethique et infini, Livre de poche,1984, p. 71.
11 Totalité et infini, Livre de poche, 1990, p. 211.
12!«!Il nous importe de donner à la sollicitude un statut plus fondamental que l’obéissance au devoir. Ce statut est celui de la
spontanéité bienveillante intimement liée à l’estime de soi au sein de la visée de la vie bonne!». Se situer entre les deux
extrêmes «!de l’assignation à responsabilité où l’initiative procède de l’autre, et de la sympathie pour l’autre souffrant, où
l’initiative procède du soi aimant, l’amitié paraissant comme un milieu où le soi et l’autre partagent à égalité le même souhait
de vivre-ensemble!» ( p. 222 et 224 ).
13 p. 226.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%