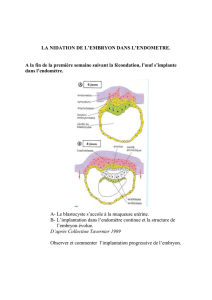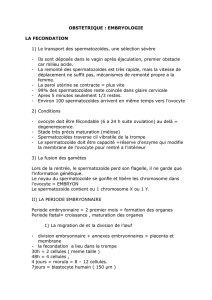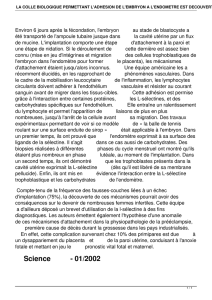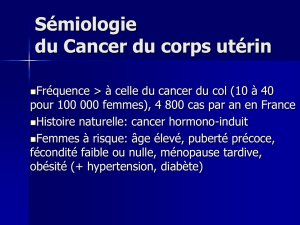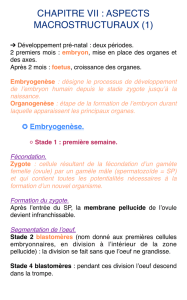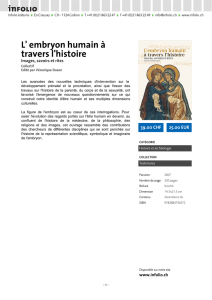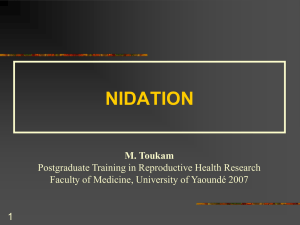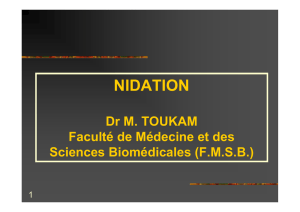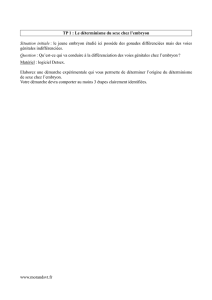Interactions endomètre-embryon au cours de lPimplantation : du

Interactions endomètre-embryon
au cours de l’implantation : du follicule
au remodelage vasculaire de l’utérus
Interactions endometrium-embryo in implantation.
From follicle to uterine vascular remodelling
Nathalie Lédée
1
Jean-Claude Challier
2
Françoise Ferré
3
1
Inserm U782,
Université Paris-Sud,
UMR-S0782,
Implantation et dialogue maternofœtal,
92140 Clamart,
France
2
UMPC-Site Saint-Antoine,
Inserm UMRS938,
Cellules souches fœtales,
75571 Paris cedex 12,
France
3
Inserm U1016,
Institut Cochin,
Génomique, épigénétique
et physiopathologie de la reproduction,
75014 Paris,
France
Résumé. L’implantation embryonnaire a été examinée dans des aspects cliniques et
fondamentaux récents. La question de l’environnement pré- et périconceptionnel interpelle
aujourd’hui dans sa valeur prédictive du succès de la grossesse. L’approche biochimique
des liquides folliculaire, séminal et endoluminal constitue une source d’informations dans
l’exploration des marqueurs préconceptionnels. Des résultats intéressants ont été obtenus en
utilisant le G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor) folliculaire pour documenter la
compétence ovocytaire ou/et l’expression des interleukines endométriales (IL-15 et IL-18
ARNm) dans l’établissement de biomarqueurs de réceptivité utérine. L’implantation requiert
un environnement endométrial équilibré en cytokines, chémokines et sécrétions diverses
constituant ainsi une véritable niche implantatoire. Les microarrays ont permis d’identifier
les principaux gènes régulés en phase de réceptivité. Pour étudier l’implantation humaine,
des modèles in vitro ont été développés, en particulier l’effet hatching de la zone pellucide,
les conditions d’adhérence de l’embryon à l’épithélium endométrial et la clairance de la
mucine 1. La décidualisation a aussi été abordée dans des modèles in vitro, suggérant
un mécanisme AMPc-dépendant. Dans la phase d’établissement de la placentation, le
trophoblaste extravillositaire adopte un phénotype invasif et migre dans la décidue jusqu’au
myomètre selon un processus bien orchestré et des mécanismes partiellement apparentés à
ceux observés avec des cellules cancéreuses conduisant à d’importantes modifications de la
vascularisation utérine. Des approches épigénétiques pourraient permettre prochainement
d’en décrypter les dysfonctionnements afin de mieux comprendre les principales pathologies
de la grossesse. Les interactions cellulaires entre trophoblaste extravillositaire, cellules
épithéliales, stromales et vasculaires endométriales et cellules immunitaires sont le pivot de
la consolidation de cette niche implantatoire. Elles sont au centre de l’acceptation immuno-
logique de l’embryon. Ce dialogue semble essentiel à l’adaptation de la vascularisation
utéroplacentaire ainsi qu’à la croissance et le développement approprié du conceptus.
Mots clés : implantation, follicule, endomètre, décidue, trophoblaste
Abstract. Mechanisms related to the embryo implantation have been examined under new
clinical and basic aspects. Analysis of pre- and peri-conceptional environments highly
suggest a possible predictive value for successful pregnancy. Biochemical investigation of
preconceptional fluids (follicular, seminal or endoluminal fluids) are raising clue informations
and suggest the possibility of preconceptional biomarkers. Interesting results were obtained
using either follicular granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) concentration as biomar-
ker of oocyte competence or IL-15 and IL-18 endometrial mRNA expression as biomarker of
uterine receptivity. Implantation requires an environment equilibrated in endometrial cytoki-
nes, chemokines and various secretions to constitute a true implantation niche. Microarrays
have identified key genes regulated specifically at the phase of uterine receptivity thus during
the implantation window. For human implantation, in vitro models have been developed to
investigate effects of embryo hatching from the zona pellucida, the mucin 1 clearance linked
to the process of embryo adhesion to the endometrial epithelium. Decidualization has been
also addressed by in vitro models showing a cAMP-dependent mechanism. During placenta-
tion, the extravillous trophoblast shows an invasive phenotype and migrates into decidua up
to the myometrium.by implementing a well programmed mechanism with some similarities
with invasive cancer cells leading to noticeable changes in the vascular uterine bed. Epige-
netic studies may give us clue to decipher some placental dysfunctions implicated in the
main pathologies of human pregnancy. Cellular interactions between extravillous tropho-
blast, epithelial, stromal, vascular and immune uterine cells are central to allow the construc-
tion of this implantation niche. They are crucial to let mechanisms of local immune tolerance
to the embryo to take place, allowing the development of an adequate uteroplacental vascu-
lature with an appropriate fetal growth and development.
Key words: implantation, follicle, endometrium, decidua, trophoblaste
doi: 10.1684/mte.2010.0304
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2010 ; 12 (4) : 285-94
médecine thérapeutique
Médecine
de la Reproduction
Gynécologie
Endocrinolo
g
ie
Tirés à part : N. Lédée
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010
Mini-revue
285
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

«L’implantation de l’embryon est-elle la dernière
frontière de la procréation médicalement assis-
tée ? ». Venant de Robert Edwards, « père » il y a 30 ans
du premier bébé-éprouvette, la question interpelle [1].
C’est un fait, le taux moyen d’implantation des embryons
conçus par FIV/ICSI reste faible, 20 % environ. Cela ne
facilite pas la mise en place de la seule mesure suscep-
tible de réduire les grossesses multiples post-FIV : le trans-
fert d’un seul embryon dans l’utérus et non de plusieurs
pour potentialiser les chances de succès. Dès lors, la
compréhension clinique de la réceptivité utérine et, plus
largement, du dialogue précoce de l’embryon avec l’endo-
mètre devient un des enjeux majeurs de la reproduction.
L’objectif de la médecine de la reproduction n’est pas
uniquement la grossesse, mais la naissance d’enfants bien
portants. Il faut pour cela prendre en compte l’hôte, la mère
et son aptitude à recevoir l’embryon et à construire autour
de lui sa matrice nourricière [2].
La décidualisation de l’endomètre en phase sécrétrice
moyenne, au sens large où nous l’entendons, est ce phé-
nomène postovulatoire de remodelage endométrial qui
inclut la transformation sécrétoire des glandes, l’arrivée
de cellules utérines natural killer (uNK) spécialisées et un
remodelage de la paroi des artères spiralées. Au prix de
cette différenciation sous contrôle de la progestérone (P4)
et de l’AMP cyclique (AMPc), les fibroblastes du stroma
endométrial (FSE) décidualisé acquièrent la propriété
unique de réguler l’invasion trophoblastique, de résister
aux agressions du stress oxydatif et, enfin, de développer
un environnement de tolérance immunitaire local et pro-
grammé. Chez l’homme, la décidualisation du comparti-
ment stromal survenant en phase lutéale moyenne se
déroule indépendamment de l’embryon et ne nécessite
pas sa présence, contrairement à la plupart des espèces
animales. Cela permet d’envisager la possibilité que
l’analyse de marqueurs biochimiques, à partir de biopsies
d’endomètre prélevées au cours de cycles non concep-
tionnels, soit informative pour le déroulement d’une
grossesse ultérieure [3].
L’interprétation de la complexité des phénomènes
implantatoires par des techniques mettant en œuvre
des modèles ex vivo/in vitro humains ainsi que la
génomique et la transcriptomique nous ouvrent de
nouveaux horizons. Le but est d’approcher les
interactions cellulaires dynamiques entre les cellules
épithéliales, stromales, endothéliales et immuno-
compétentes présentes dans l’endomètre au cours de la
fenêtre de réceptivité pour reconstituer ainsi de façon
satisfaisante le processus implantatoire. Dans une
première partie, nous développerons une approche
clinique avant d’aborder les perspectives d’avenir que
nous offrent les progrès de la recherche. La deuxième
partie est consacrée à l’expression des gènes lors du
cycle menstruel et aux modèles in vitro d’implantation
et de décidualisation, la troisième à l’invasion du
trophoblaste extravillostaire et à l’angiogenèse vascu-
laire qui permettent l’implantation durable et le déve-
loppement des produits de conception.
Implantation embryonnaire humaine :
d’aujourd’hui à demain
Les concepts de fenêtre implantatoire
et de réceptivité utérine impliquent
d’explorer précisément l’endomètre
en phase lutéale moyenne
En dehors de cette fenêtre précise, l’endomètre est
réfractaire à toute implantation et a pour simple mission
de se défendre de toute infection et/ou agression exté-
rieure. Néanmoins, malgré la connaissance théorique
accumulée depuis les études de Psychoyos [4], aucune
approche clinique de routine n’est apparue satisfaisante,
principalement du fait des variations d’un cycle à l’autre.
Par exemple, l’histologie-datation avec marquage des
récepteurs hormonaux se révélera insatisfaisante, et
l’apparition des pinopodes non valable, du fait de la
variation d’un cycle à l’autre chez un même individu.
L’analyse de la prometteuse protéine antiadhésive, la
mucine-1 (MUC1), nécessite la présence de l’embryon
pour être régulée négativement. Le screening à base
d’intégrines est spécifique à certaines pathologies, inflam-
matoire principalement.
La quasi-totalité de la littérature traitant des anomalies
vasculaires et de la placentation a établi un consensus sur
la haute valeur prédictive négative en termes de grossesse
évolutive en cas d’anomalies vasculaires (mauvaise
perfusion) en phase lutéale moyenne ou de trouble de la
prolifération endométriale (endomètre trop mince).
Néanmoins, l’ensemble des données échographiques a
une très faible spécificité et est peu utile en clinique, car
on n’identifie pas qui doit être traité et qui ne doit pas
l’être, et surtout aucun paramètre n’apparaît prédictif du
succès d’une tentative de traitement. En revanche, cette
méthode a le mérite de dépister les mauvais pronostics.
L’exploration échographique utilisant les technologies
de troisième dimension associée à une angiographie
avec analyse digitale permet une exploration précise et
quantifiée de la vascularisation utérine et améliore ainsi
la sensibilité du dépistage.
Cette observation consensuelle entre cliniciens invite
néanmoins à rechercher un rationnel moléculaire entre
les anomalies vasculaires (artères spiralées) et l’échec
d’implantation.
Les travaux de Loke [5] ont permis de montrer que
l’influx dans l’endomètre en phase lutéale des uNK était
un élément constructif, essentiel au processus implanta-
toire, contrairement à ce que l’on pensait précédemment.
C’est cette mobilisation cellulaire qui instaurerait le
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010
Mini-revue
286
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

dialogue immunotrophique à l’origine de la croissance du
fœtus et l’établissement d’un réseau vasculaire adapté.
Ces présomptions ont été confirmées puis admises par le
monde scientifique [6].
Ces uNK sont particulières dans leur phénotype et
dans leur fonction et se distinguent des cellules NK san-
guines. Très sommairement, les cellules NK sanguines
sont la première ligne de défense de l’organisme. Tout
ce qui n’est pas soi est tué immédiatement (cellules
infectées ou cancéreuses). Leur particularité est liée à
leur cytotoxicité aboutissant à la production de cytokines
pro-inflammatoires Th-1. Les uNK sont différentes et se
caractérisent dans une situation normale par une
sécrétion de cytokines Th-2 dominante à l’origine de
l’immunotrophisme (base de la croissance fœtale) et de
l’angiogenèse (développement vasculaire adapté du
placenta). Cela est à l’origine du concept selon lequel la
grossesse est un phénomène Th-2. Ce concept, bien que
révisé, souligne l’importance de l’équilibre environne-
mental utérin dans le processus d’implantation.
Des données récentes suggèrent que le dialogue
visant à favoriser l’implantation est bien plus précoce,
pré- et périconceptionnel, et concerne aussi l’environne-
ment gamétique (liquides folliculaire, séminal) et
embryonnaire (fluide endoluminal et liquide tubaire).
Environnement pré- et périconceptionnel
gamétique et embryonnaire
Le liquide folliculaire participe aux étapes finales de
maturation de l’ovocyte dans la trompe. Il contrôle,
avant l’ovulation les dernières modifications transcrip-
tionnelles et post-transcriptionnelles qui permettront à
l’embryon d’effectuer ses synthèses protéiques au cours
des premières étapes de segmentation. Son rôle réel est
finalement peu connu. De nombreux facteurs de crois-
sance et cytokines sont présents dans les follicules prêts
à ovuler. Néanmoins, des données récentes permettent de
suspecter un rôle majeur de celui-ci dans la physiologie
normale. Le réseau européen Embryo Implantation
Control (EMBIC) a étudié des liquides folliculaires indivi-
duels tout en établissant une traçabilité de chaque prélè-
vement pour sélectionner les prélèvements correspondant
à un embryon qui parviendra à naître. On peut donc par
cette méthode établir un lien entre l’expression au sein de
l’environnement ovocytaire et le futur potentiel de vie et
d’implantation de cet ovocyte après fécondation. L’étude
en immuno-essai sur microbilles en multiplex a permis
d’identifier un biomarqueur significativement prédictif
du potentiel implantatoire, le granulocyte colony-
stimulating factor (G-CSF) en cycle aussi bien stimulé
que naturel [7, 8]. Alors que certains ovocytes ont un
potentiel de naissance dépassant les 40 %, d’autres ont
un potentiel de moins de 10 %, alors que rien morpho-
logiquement ne permet de les distinguer. Le G-CSF est
produit par certaines cellules du tractus reproductif
comme les cellules de la granulosa [9], endométriales,
stromales, déciduales et placentaires. Il est intéressant de
voir que ce biomarqueur du potentiel implantatoire de
l’ovocyte avant l’ovulation est décrit dix jours plus tard,
donc au moment de l’implantation proprement dite,
comme augmentant dans le sérum en cas de grossesse
en cycle naturel [10] et stimulé après FIV/ICSI [9].
Quel est le sens de ce message, où sont les rationnels
des mécanismes ? Est-ce l’ovocyte lui-même ou une
action à distance du liquide folliculaire ? Très vraisembla-
blement les deux, de manière non exclusive et complé-
mentaire. Nous n’en sommes qu’àl’étape d’élaboration
d’hypothèses, mais leur énoncé propre ouvre de nou-
veaux horizons à la recherche. On peut spéculer que le
niveau de G-CSF folliculaire nous donne une information
essentielle sur l’ovocyte : son habilité au dialogue pré-
coce avec son environnement. Ce dialogue permettra la
préparation d’un utérus réceptif, et cela avant même que
l’embryon soit généré. L’hypothèse est que la qualité
d’un ovocyte semble bien être sa capacité intrinsèque à
préparer l’utérus et à influer sur l’ensemble de son envi-
ronnement vers une voie de tolérance immunitaire.
L’utérus est un lieu de rencontre,
de dialogue et d’achèvement
Dans sa globalité, cet organe est remarquable par son
organisation cyclique et sa plasticité. Des études récentes
ont ainsi étudié la composition du fluide endoluminal au
moment de la ponction en phase périovulatoire, grâce à
des techniques de lavage endoluminal ou flushing utérin
[11]. C’est une procédure indolore qui permet d’étudier le
milieu endoluminal. La cellule épithéliale endométriale
apparaît comme polarisée, avec une sécrétion apicale
en direction de la lumière différente de celle en direction
du stroma et des vaisseaux [12]. Cette polarisation sug-
gère un rôle spécifique des messages envoyés. Dans
cet esprit nous avons en outre mis en évidence que des
sécrétions d’IL-18 et de mannose-binding lectin (MBL, un
régulateur du complément) étaient significativement
augmentées en cas d’infertilités dites inexpliquées dès le
moment de la ponction [13, 14]. Une étude plus récente
utilisant la technique d’immuno-essai sur billes en multi-
plex a permis de mettre en évidence l’expression luminale
chez des patientes enceintes au décours de la FIV de
chémoattractants et certaines cytokines de l’immunité
innée : l’IL-1RA, RANTES, MCP-1, l’IP-10, MIP-Iβet
MIP-α, G-CSF et IL-15. En termes finalistes, la mission uté-
rine à ce stade serait très clairement d’attirer l’embryon et
de préparer sa matrice en conséquence. En utilisant la
même méthode, mais une semaine plus tard en fenêtre
implantatoire, des expressions anormales ont été obser-
vées pour des cytokines clés comme le leukemia inhibi-
tory factor (LIF) en cas d’échecs d’implantation [15].
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010 287
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Enfin, l’endomètre lui-même peut être analysé au cours
de cycle non conceptionnel afin de documenter le futur
environnement embryonnaire auquel sera confronté
l’embryon transféré.
Les cellules uNK sont le pivot du processus implanta-
toire, leur mobilisation théorique a lieu au moment de
la fenêtre implantatoire. Chez les patientes en échec
d’implantation, on peut très facilement faire un comptage
par immunohistochimie de ces cellules CD56+ en fenêtre
implantatoire. Il est fréquent de constater soit un excès,
soit une déplétion dans des contextes pathologiques.
Ainsi, nous retrouvons, comme pour l’embryon, une
notion essentielle de stabilité. Embryon et endomètre
semblent obéir à la « loi du milieu ».
L’environnement cytokinique dans lequel évolueront
ces uNK au contact du trophoblaste est probablement
essentiel. Ainsi, dans ces contextes d’échecs implantatoires
inexpliqués, nous avons étudié le tripode IL-18/IL-12/IL-15
censé représenter l’équilibre cytokinique nécessaire ou
adapté à l’immunotrophisme. L’interleukine-18 est une
cytokine bivalente. Elle sera Th-1 en présence d’excès
d’IL-12 et -15 ou Th-2 si les IL-12 et -15 sont exprimées à
taux moindre, mais nécessaire. L’échec d’implantation
peut aussi bien résulter d’un défaut d’expression et/ou de
sécrétion Th-2 que d’un excès de sécrétion Th-1 [16, 17].
Un excès cytotoxique et une activation des cellules uNK
en véritables cellules cytotoxiques (lymphokine activated
killers [LAK]) peuvent constituer une limite à l’invasion
trophoblastique et être nocifs pour l’embryon. À l’inverse,
l’absence de ces sécrétions au niveau de l’endomètre sug-
gère une absence de réactivité de la muqueuse utérine,
réactivité pourtant nécessaire au phénomène d’apposition
entre les épithéliums embryonnaire et utérin.
L’échographie avec angiographie digitalisée, nouvelle
méthode non invasive, est la méthode la plus adaptée
pour étudier l’angiogenèse endométriale [18]. Une angio-
genèse inadaptée est corrélée très significativement avec
ces anomalies d’expressions cytokiniques. Une telle appro-
che peut ainsi servir de base pour une évaluation molécu-
laire et prévenir l’échec d’implantation et de gestation.
L’expression génique
au cours du cycle menstruel
prépare l’implantation
Parmi les techniques d’investigation nouvelles, la
génomique fonctionnelle a permis ces dernières années
des avancées importantes dans le décryptage des méca-
nismes de préparation à l’implantation au cours du cycle
menstruel, notamment lors de la phase de réceptivité uté-
rine. La technique des puces à ADN (DNA-microarrays)a
été appliquée à des échantillons d’endomètre de différen-
tes phases du cycle utérin. Les résultats ont été analysés
par Giudice en 2006 [19] et interprétés par la technique
d’analyse en composante principale (PCA) et celle du
clustering hiérarchique.
La PCA montre que le profil d’expression génique
d’échantillons de tissus dont la provenance est connue
correspond aux phases du cycle menstruel : proliférative
(P), sécrétoire précoce (SP), moyenne (SM) et tardive (ST)
enfin menstruelle (M). Des échantillons atypiques sont
cependant observés dans chaque phase. Bien que la plu-
part des études soient convergentes, des disparités ont été
observées quant aux gènes régulés en raison de l’échan-
tillonnage des tissus, de variables techniques dans l’hybri-
dation, des critères utilisés pour l’analyse des résultats.
Le clustering hiérarchique met en évidence deux bran-
ches principales, l’une formée par les phases proliférative
précoce et SP, l’autre par les phases SM et ST. La dépen-
dance hormonale a été stigmatisée dans chaque phase
afin d’interpréter les modifications du profil d’expression
des gènes. Les échantillons de la phase P ou les explants
endométriaux traités par l’estradiol (E2) sont caractérisés
par des taux d’E2 élevés. Ils peuvent être comparés à ceux
de la phase M dans laquelle E2 circulant est trop
faible pour mettre en évidence les gènes E2-régulés.
Les molécules dont l’expression génique est stimulée
sont la glycoprotéine-1 de l’oviducte, la connexine-37,
l’olfactomédine-1 (une glycoprotéine sécrétée dont
l’expression est réduite dans une autre étude), SFRP4
(secreted frizzled related protein 4). Les molécules dont
l’expression est réduite sont des métalloprotéinases
MMP-1, 3 et 10, des interleukines IL-1β, IL-8, IL-11, l’inhi-
bine βA et SOX4 (facteur de transcription, Sry-related
HMG-bOX 4).
La phase SM sous la dominance de P4 avec de faibles
taux d’E2 peut être comparée à la phase P ou aux explants
d’endomètre traités par P4 pour détecter les gènes P4-
régulés. Mais c’est surtout lors du passage P à SP que
s’expriment de tels gènes. Ainsi, l’expression de la
MUC1, de Dkk1 (Dickkopf-related protein 1, inhibiteur
de la voie Wnt) ainsi que celle d’IL15 s’accroît. De P à
SP, l’expression de la N-cadhérine est abaissée et celle
de FOXA1 est augmentée. Chez la souris et l’humain, en
comparant oestrus-dioestrus et SP versus P respective-
ment, l’hydroxystéroïde déshydrogénase (HSD) 17β2 est
augmentée via les récepteurs de P4 (PR) dans le stroma
et par voie paracrine dans l’épithélium. Cette transition
annonce la fin de la dominance d’E2 dont les récepteurs
ER seront diminués dans le stroma et disparaîtront de
l’épithélium en phase SM.
Lorsqu’on passe de la phase SP (16 jours du cycle ou
LH + 2) à SM, c’est-à-dire en phase de réceptivité (20 à
24 jours du cycle ou LH + 6 à LH + 10), les gènes cxcl4 ou
pf4, une chémokine, et LIF sont transcrits en abondance.
IL-15 est aussi plus transcrit et pourrait contribuer avec
CXCL4 au recrutement des leucocytes. Des gènes de
protéines sécrétées sont aussi activés : CRISP3 (cystein-
rich secretory protein 3), impliqué dans le remodelage
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010
Mini-revue
288
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

de la matrice extracellulaire (MEC), et SCGB2a2, dont la
protéine, la sécrétoglobine 2A-2, aux fonctions immuni-
taires de chimiotactisme et probablement de transporteur
de stéroïdes, est utilisée dans la détection de certains
cancers du sein. D’autres gènes sont plus transcrits, en
particulier ceux d’antioxydants comme la glutathione pero-
xydase 3 (GPX3) ou la métallothionéine (isoformes 1G, 1H,
1E, 1F, 1L, 1X et 2A) captant aussi des métaux lourds
(cuivre, zinc ou cadmium, mercure, etc.) en protection de
l’endomètre préimplantatoire. Une réduction de la tran-
scription est observée pour la SFRP, l’olfactomédine-1, PR
et PR membranaire, ER-α, MUC1, HSD17β2 et MMP11 qui
signaient l’arrivée en phase sécrétoire.
En phase ST, on assiste à une réduction de P4 entraî-
nant l’expression de gènes impliqués dans la constitution
de la MEC (métalloprotéinases, activateurs du plasmino-
gène, facteur de saignement endométrial), dans l’inflam-
mation (IL-1β, IL-8, CCL2, MCP1), dans la vasoconstriction
et dans la contraction (prostaglandines induites par la
cyclo-oxygénase COX2).
Ces observations concernent l’évolution de l’endomè-
tre en l’absence d’embryon. L’endomètre, jusque-là
réfractaire à toute implantation, est prêt à recevoir
l’embryon. Ce dernier a acquis dès avant la conception
une aptitude à s’implanter qui se consolide au fur et à
mesure de sa progression dans le tractus génital. Il doit
être compétent pour sa fixation dans un utérus réceptif.
Lors de son arrivée dans la lumière utérine au moment
de la phase de réceptivité, il s’instaure un dialogue pro-
pice à sa fixation et à sa nidation par l’intermédiaire du
liquide intra-utérin ou par contact cellulaire et grâce à la
décidualisation du stroma endométrial. Pour des raisons
éthiques, ces dernières étapes ne peuvent être explorées
que dans des modèles animaux ou dans des modèles
humains in vitro.
Qu’apportent les modèles in vitro
au décryptage de l’implantation ?
Blastocystes animaux et endomètre humain
Les étapes de l’implantation dans les modèles ani-
maux ont été analysées récemment [20]. Pour les modèles
in vitro, peu de laboratoires disposent aujourd’hui de
blastocystes humains affectés à la recherche, alors que les
curetages permettent de préparer des tissus endométriaux
susceptibles de décidualiser en culture. Des modèles in
vitro ont donc été développés qui utilisent principalement
des cellules de lignées néoplasiques d’endomètre et de
trophoblaste. Ces modèles devraient permettre de définir
les conditions optimales de fixation des blastocystes
àl’endomètre.
Le choix des cellules endométriales est guidé par leur
capacité à mimer les cellules in vivo. Les cellules
Ishikawa (ISH) dérivent d’adénocarcinomes. Elles sont
adhérentes, à phénotype mixte, épithélial et glandulaire,
et modérément polarisées [21]. Elles expriment des
molécules de surface et d’adhérence telles que MUC1,
l’ostéopontine, CD44, des récepteurs ER, PR, AR et à la
lutéotropine, des cytokines telles que LIF, IL1β, 6 et 11,
LIFR, IL1Rα, des chémokines comme IL8, des hormones
morphogènes comme l’activine et son récepteur. Le point
fort de ces cellules réside dans leur phénotype mixte, leur
polarisation modérée, leur sensibilité aux stéroïdes et leur
fonction sécrétoire, comparé à celui d’autres lignées
comme HES sans récepteurs à P4, peu adhérentes et à
phénotype uniquement épithélial. Autant de caractéris-
tiques qui ont justifié leur utilisation comme modèle
d’endomètre in vitro.
Des blastocystes de souris prélevés par lavage après
quatre jours de gestation adhèrent au plastique des boîtes
de culture et aux cellules ISH cultivées sur plastique, mais
non sur verre [22]. Le pourcentage d’attachement I, après
48 heures d’incubation, est compris entre 90 et 100 %.
À la suite d’une fixation légère au paraformaldéhyde, un
attachement II irréversible est mis en évidence dans envi-
ron 40 % des cas. Le retrait de la zone pellucide par
courte immersion dans du liquide tyrode acide augmente
la proportion d’attachement II de 33 à 53 % et l’emploi
d’anticorps anti-MUC1 n’a pas d’effet sur ces résultats.
Le traitement par P4 réduit bien le taux des récepteurs
ERα. Lors de la préincubation des cellules ISH avec E2,
puis par E2 plus la médroxyprogestérone (MPA), l’attache-
ment II atteint 70 % et augmente l’immunoréactivité de
MUC1, du kératane sulfate et des glycanes reconnues par
la lectine-DBA. Ce traitement affecterait les cellules ISH et
le blastocyste. La disparition de MUC1 au niveau du site de
fixation du blastocyste alors qu’autour MUC1 persiste en
mosaïque sur l’épithélium, est observée dans 70 % des
cas ; elle a été estimée par immunofluorescence à 17 %.
En revanche, on n’observe pas de modifications de la loca-
lisation apicale de la sialomucine CD164 (ou endolyne)
dans les cellules épithéliales au niveau des sites de fixation.
Ces résultats montrent que la fixation du blastocyste
dépend du mode d’ancrage de l’épithélium sur la MEC
en relation avec sa dépolarisation plus une redistribution
des molécules d’adhérence et/ou l’ouverture de l’espace
intercellulaire pour l’infiltration du blastocyste. Le départ
de la zone pellucide favorise modérément le taux d’atta-
chements, confirmant l’utilité de l’éclosion artificielle en
procréation médicalement assistée, même si cette opéra-
tion ne modifie pas significativement la disparition de
MUC1. Une imprégnation des ISH par E2, puis par E2
plus un dérivé de P4, favorise l’adhérence. Cela confirme
des résultats antérieurs observés chez la souris selon les-
quels elle serait responsable de l’entrée en phase de
réceptivité de l’endomètre qui permettrait au blastocyste
d’acquérir sa compétence à l’attachement, lui-même agis-
sant ensuite sur la durée de la fenêtre de réceptivité, la
décidualisation et la poursuite de l’implantation [20].
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 12, n° 4, octobre-novembre-décembre 2010 289
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%