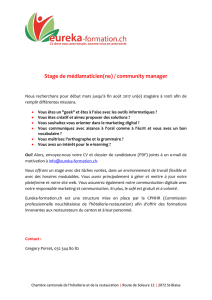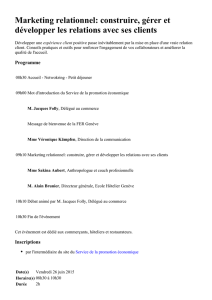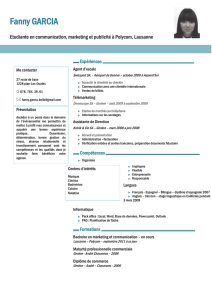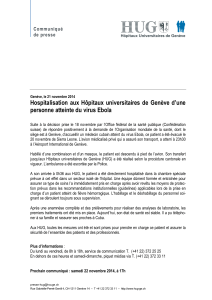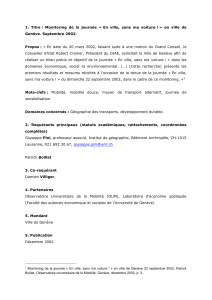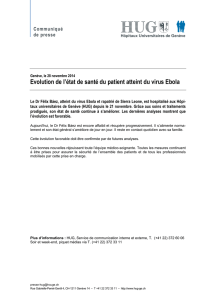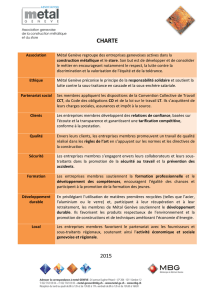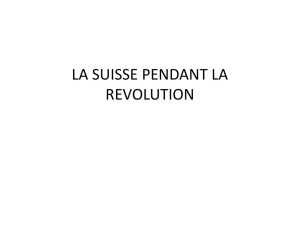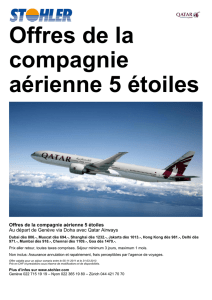Entre Genève et Soleure, il y a la France comme puissance, comme

Entre Genève et Soleure, il y a la France comme
puissance, comme protectrice, comme médiatrice,
et l’Empire romain germanique. Son ambassadeur
malgré sa proximité avec Berne et le succès populaire des
prédicateurs réformés. Elle est bien située pour être le
centre du jeu diplomatique entre le roi et les Confédérés,
liés par la «paix perpétuelle» de 1516 et l’alliance de 1521.
L’ambassadeur de France, le «bassidor» comme disent
les Soleurois, devient le personnage important de la ville,
pourvoyeur d’emplois, organisateur de fêtes, dispensateur
quelle que soit leur religion: peu importe leur Dieu, pourvu
qu’ils soient unis, le plus unis possible. C’est la tâche de
l’ambassadeur de maximaliser la cohérence de l’ensemble
helvétique.
Genève, devenu protestante en 1536, est alors dans une
proximité périlleuse avec la Savoie, qui ambitionne de s’en
emparer. La cité de Calvin n’a de traité de combourgeoi-
sie qu’avec Berne, protection qu’elle souhaite renforcer
en demandant formellement en 1571 à être admise dans
l’alliance confédérale. La France appuie de tout son poids
cette revendication. Les cinq cantons catholiques de Suisse
centrale, Uri, Schwytz, Unterwald, Lucerne et Zoug, s’y
opposent farouchement. Ils envoient des délégations à
Soleure et Fribourg, plutôt favorables, pour les dissua-
der d’accueillir l’hérétique Genève, «peuple infâme et
sans Dieu».
Le massacre des huguenots français, à la Saint-Barthé-
peuvent plus espérer s’entendre avec les catholiques, et
d’autant moins que des catholiques suisses ont participé
aux crimes de Paris.
De leur côté, les cantons catholiques s’activent avec la
Savoie, à laquelle ils promettent leur aide si elle prend
Genève, ou Vaud, ou les deux. Une alliance est même jurée
à Turin en 1578, après qu’une pluie de cadeaux et magni-
de Suisse centrale.
Soleure n’est pas de cette partie. Peut-être parce qu’une
opinion protestante y subsiste, ou parce le «bassidor» se
montre convaincant. Celui-ci s’inquiète en effet de l’al-
liance de Turin: elle est une menace de guerre sur l’espace
helvétique. Berne, pour sa part, la juge déloyale puisque
les cantons catholiques renoncent à la reconnaissance de
ses nouvelles possessions vaudoises.
Après la tentative de Jacques de Savoie de mettre la main
sur Genève, en 1578, l’alarme est au plus haut. Soleure
se joint alors à Berne et à la France de Henri III pour
signer, le 8 mai 1579, un traité «perpétuel» pour la pro-
tection de Genève.
C’est un texte majeur dans l’histoire des deux villes.
Genève est intégrée avec Vaud dans la paix perpétuelle qui
avait été conclue en 1516 entre François 1er et les cantons
suisses; les citoyens genevois sont placés sur le même pied
que les sujets du roi en France; Henri III s’engage à mettre à
disposition un contingent de 1500 hommes aussi souvent
que Berne et Soleure se verraient obligées d’envoyer des
troupes protéger Genève. Mais l’ambassadeur a son mot à
dire sur la situation. Il se trouve donc placé en position de
décideur sur les affaires genevoises et suisses.
Soleure, quant à elle, acquiert dans la Confédération un
rôle politique auquel son catholicisme ne la prédestinait
pas. Elle se met à même de porter des jugements et
d’entreprendre des actions qui transcendent les adhésions
religieuses, rôle qui conforte celui que la France prétend
jouer.
Le traité de Soleure est renforcé en 1584 par l’apport
de Zurich, qui signe un accord de combourgeoisie avec
Genève, forte pour deux siècles de la protection des deux
plus puissants cantons suisses.
La France d’après 1789 n’a pas de visées différentes pour
la Suisse que la France d’avant: la paix confédérale avant
tout. Seule la méthode change: Genève est annexée et
Soleure occupée, avec le reste du pays. Les deux villes ne
pourront plus rien l’une pour l’autre.
ENTRE GENÈVE
ET SOLEURE
L’agent français
Par Joëlle Kuntz
1
/
1
100%