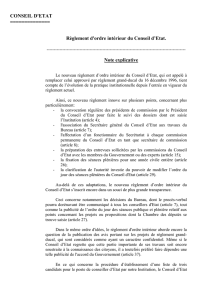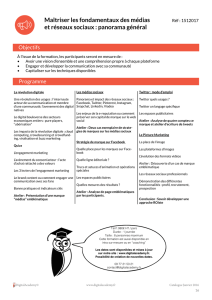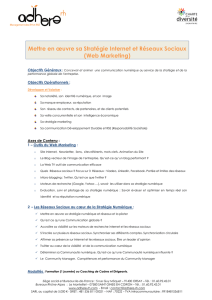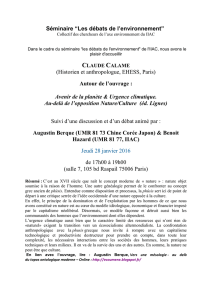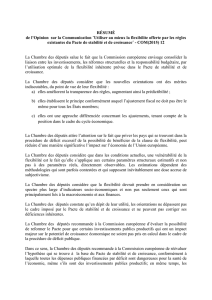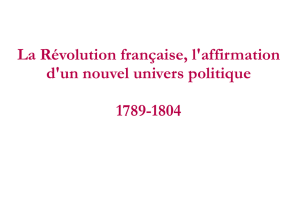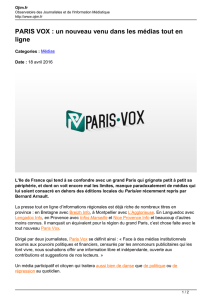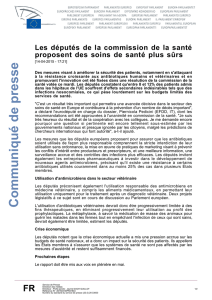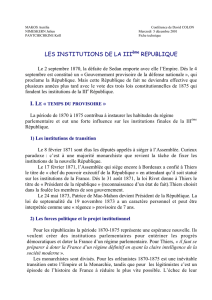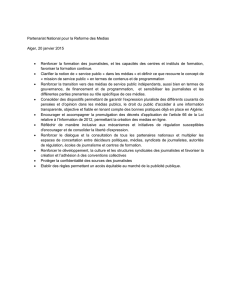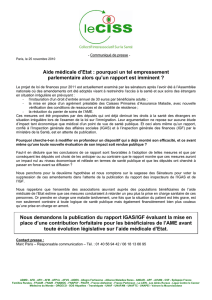Approche ethnographique des systèmes d - ADESS

1
Jonathan Chibois
chibois@ehess.fr
Pierre Amiel Giraud
Pierre-amiel.giraud@u-bordeaux-montaigne.fr
Contacts GRANIT :
matthieu.noucher@cnrs.fr,
olivier.pissoat@cnrs.fr
Approche ethnographique des systèmes d'information
à l'Assemblée nationale. Le cas Twitter.
En 2015, le GRANIT poursuit son cycle de séminaires sur le thème « Internet comme terrain »
1
afin
d’aborder sous un angle interdisciplinaire le potentiel, la technicité et l’opacité des analyses des
données du Web. Dans ce cadre, Jonathan Chibois, doctorant à l'EHESS (laboratoire IIAC, équipe
LAIOS), présentera le 20 mars une partie de ses travaux ethnographiques concernant le
phénomène technico-politique à l'Assemblée nationale. Son projet de thèse s'appuyait sur l'idée
que les systèmes d'information et Internet constituaient des objets dont il devait observer
l'appropriation par les acteurs de son terrain, l'Assemblée nationale. Cependant, cette approche a
montré ses limites. Durant l'enquête, ces technologies se sont avérées moins des objets que des
espaces sociaux, qui ont donc dû être investis, notamment parce que se sont avérés de précieux
modes d'accès au terrain.
Cette présentation vise à montrer comment et pourquoi, dans le cadre d'une démarche
ethnographique sur l'Assemblée nationale, un chercheur peut se sentir méthodologiquement
obligé de repenser la substance même de son terrain, voire de l'évacuer au profit d'une définition
purement relationnelle. L'enjeu du terrain devient alors moins de parcourir et de quadriller un
1
http://www.ades.cnrs.fr/spip.php?article1225

2
territoire que de trouver sa place dans un univers social aux règles spécifiques. Après être revenu
sur le travail réflexif ayant conduit à ce recadrage, il montrera comment il explore ce terrain, à
l'aide de méthodes qualitatives et quantitatives, en travaillant à se rendre légitime auprès de ces
interlocuteurs : son activité sur son compte Twitter et sur son carnet de recherche en ligne font
ainsi pleinement partie de son travail de terrain, ce qui n'est pas sans lui poser quelques problèmes
de posture. Enfin, il replacera ces considérations dans le cadre plus large de son travail de thèse, en
montrant comment cette approche permet de comprendre et de rendre compte de la place
spécifique, parce qu'ambiguë, de la technique à l'Assemblée. En venant remettre régulièrement (et
de plus en fréquemment) en cause le fonctionnement institutionnel par le rythme des innovations,
elle offre à l’institution d'actualiser à chaque fois un certain nombre de principes de
fonctionnement, et d'assurer par là une certaine stabilité et continuité dans le temps.
Jonathan Chibois est doctorant en anthropologie à l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales sous la direction de Marc Abeles.
Il est actuellement rattaché à l'équipe LAIOS (Laboratoire d'anthropologie des institutions et des
organisations sociales) de l’Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain(IIAC).
IACC : le contemporain comme objet
http://www.iiac.cnrs.fr/
Le IIAC se donne pour objet l’anthropologie des sociétés contemporaines. Il faut entendre par ce dernier terme
non seulement une co-présence du chercheur et des sociétés qu’il étudie mais aussi la problématisation de
la contemporanéité comme espace de relations et aussi de dissonances. On peut vivre dans une même époque
sans être contemporain et, inversement, telle situation historique, telle dimension du passé peuvent devenir
contemporaines en projetant leur ombre portée sur le présent. C’est dans cette perspective que l’histoire entre
pleinement dans le projet du IIAC aux côtés de l’ethnologie et de la sociologie, formant le trio des disciplines
principales qui collaborent à une approche anthropologique générale et justifiant la mention de
l’interdisciplinarité dans la dénomination de l’Institut.
Outre ce traitement problématisé du temps, le IIAC pratique un déploiement dans l’espace qui se distingue de
l’approche classique en termes d’aires culturelles. La construction de ses objets théoriques peut nécessiter une
approche comparative mais, par ailleurs, les phénomènes de mondialisation et de globalisation font l’objet de
recherches spécifiques tout en constituant des dimensions de la contemporanéité quel que soit le lieu de
l’enquête. Au triangle disciplinaire central peuvent s’adjoindre en tant que de besoin des disciplines, ou quasi
disciplines, complémentaires : sciences politiques, psychologie, psychologie sociale, linguistique, musicologie...
Cette ouverture justifie une pratique intensive de la réflexivité qui se donne pour objet le champ de
l’anthropologie dans une perspective d’épistémologie historique.
LAIOS : une anthropologie des institutions et des organisations sociales
http://www.iiac.cnrs.fr/laios/
Au temps de la globalisation, le politique se
recompose autour d’enjeux économiques et
environnementaux, de crises vécues à différentes
échelles, du transnational au national et au local,
dans les lieux (apparemment) plus visibles que sont
les grandes organisations internationales, comme
dans les marges où se recréent des espaces
politiques. Les chercheurs de ce sous-axe analysent
plusieurs thèmes, à travers deux grandes
thématiques, soutenues par l’organisation d’ateliers
rapprochant les chercheurs du IIAC sur les
problématiques proposées.
Sa formation pré-doctorale a pour partie été effectuée à l’Université de Bordeaux, au sein de la
licence Ethnologie. Son master, effectué à l'EHESS sous la direction de Philippe Descola, portait sur
la question des politiques de la nature urbanisée dans un arrondissement parisien. Dans l'idée de
prolonger la question des politiques de la matérialité, du territoire et du corps, il s'est engagé dans
un projet de recherche autour de la question informatique à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, il
s'est rapproché de Marc Abélès pour diriger sa thèse, lui qui a fait du lieu du politique sa spécialité

3
et qui a effectué la première ethnographie de l'institution à la fin des années 1990. Les premiers
mois d'enquête, en 2008, ont été effectués en qualité de collaborateur parlementaire au Palais-
Bourbon. En 2010-2011, il était ATER à l'Université de Bordeaux 3, rattaché à l'ISIC.
Sa thèse a pour projet de mettre en évidence la manière dont les technologies informatiques et
numériques ont été mobilisées pour façonner un nouveau visage à l’institution parlementaire, en
association aux autres réformes réglementaires et institutionnelles entreprises. En posant la
question du « virage numérique de l’Assemblée », ou de l’« entrée de l’Assemblée dans la société
de l’information », ce travail s’appuie sur l’hypothèse que la technique, à l’instar du droit, constitue
une des ressources principales dans laquelle l’institution puise pour assurer la continuité historique
de son existence. D’une part, la technique forme le squelette nécessaire au maintien de la forme
institutionnelle sur le temps long par-delà la vie politique qu’elle accueille (bureaucratie,
architecture). D’autre part, la technique constitue une source de remise en question de cet ordre
parlementaire, en venant régulièrement questionner les fondements du travail législatif (médias
audiovisuels, dématérialisation des procédures) mais permet ainsi à l’institution de faire siens un
certain nombre d’enjeux sociaux contemporains.
De fait, ce travail avance que les dispositifs techniques mis en œuvre à l’Assemblée, aussi variés
soient-ils au premier abord, peuvent être abordés comme un seul objet. L’organisation
architecturale de l’hémicycle, les règles de restrictions d’accès au Palais Bourbon, les postes de
travail informatiques à disposition des collaborateurs de députés, le site internet de l’Assemblée,
sont autant de facettes d’une même préoccupation qui sont étudiés comme autant d'études de
cas. Ce sont des dispositifs qui, tous à leur niveau, participent de la cohésion et de la cohérence
générale de l’institution parlementaire, c'est-à-dire en définitive d'une culture technique propre à
l’Assemblée. La technique est alors ici moins envisagée comme objet dont s’approprieraient les
acteurs de l’institution (par exemple le micro-ordinateur), que comme geste, c’est-à-dire comme
moyen d’agir.
La liste de ses publications et communications est disponible sur son site internet
http://www.laspic.eu/
Il tient également un carnet de recherche sur la plateforme Hypothèses, sur lequel il publie
régulièrement des remarques, observations et analyses relatives à ses expériences de terrain ainsi
qu'à l'actualité de l'Assemblée nationale.
http://laspic.hypotheses.org/

4
Morceaux choisis par l'invité
Textes sur lesquels s'appuiera la présentation
Le récent ouvrage de Delphine Gardey (2015) offre une très belle description des enjeux
techniques et des enjeux de pouvoir à l'Assemblée nationale. L'approche socio-historique de
l'auteur (1789-1970) explique l'absence d'Internet, mais les réseaux y sont très présents :
téléphone, télégraphie, poste, pneumatique.
La perspective ethnographique de Jonathan Chibois actualise la démarche en montrant que les
blogs et les plates-formes comme Twitter viennent enrichir les terrains des ethnographes.
L’articulation entre l’approche de Delphine Gardey et le travail de Jonathan Chibois est encore plus manifeste à la
lecture du chapitre 3 de l’ouvrage. Voir les extraits reproduits à la fin du dossier. En effet, Gardey y montre que les
technologies, dans leur mise en œuvre au sein de l'institution, imposent à chaque fois une redéfinition des règles de
circulation et de communication. Or, ce travail de restructuration vise à délimiter clairement l'intérieur de l'extérieur
afin de permettre la souveraineté et l'activité de l'Assemblée. L'irruption de Twitter dans la vie parlementaire pose cette
question de manière extrêmement aiguë.
Gardey Delphine, 2015, Le Linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité et genre du politique à l'ère
démocratique, Paris : éditions du Bord de l'eau, coll. Objets d'histoire.
http://www.editionsbdl.com/fr/books/le-linge-du-palais-bourbon.-corps-matrialit-et-genre-du-politique-lre-dmocratique/466/
« Que faut-il pour faire vivre une assemblée délibérative et souveraine ?
Un toit, des murs, un palais, une salle, des œuvres d’art. Des lingères,
des hommes de peine, des commis, des gardes Suisses. Mais encore ?
Un territoire sanctuarisé, une force militaire, des prérogatives, une
police intérieure, des règlements, un personnel dédié, des procédures
rituelles et codifiées. Et surtout, le désir et la possibilité de durer.
Loin des visions désincarnées de la philosophie politique, ce livre
propose un voyage historique et anthropologique inédit dans les
soubassements de l’Assemblée Nationale. Lecture au ras de l’archive,
cette plongée dans le quotidien du Palais-Bourbon s’intéresse à la façon
dont les Assemblées législatives se sont organisées pour exister depuis
la Révolution française jusqu’à nos jours.
Comment produire un corps autonome et souverain qui ne soit pas l’Etat
? Comment le rendre capable de survivre aux aléas de la rue et de
l’exécutif ? Comment faire vivre ce lieu inédit, ce contre-emplacement,
cette hétérotopie ?
Le linge, métaphore et réalité, est le moyen de questionner la tessiture
des institutions démocratiques occidentales contemporaines réputées
neutres et universelles. L’enquête rend compte de la fabrique matérielle
et sociale d’une institution dont les traits aristocratiques et domestiques
se poursuivent dans le cadre républicain. Elle s’interroge alors sur la
culture masculine qui règne durablement à l’Assemblée et les rapports
de genre qui y ont cours.
Que penser, finalement, de l’anatomie politique du parlementarisme
républicain ? ».
Chibois Jonathan, 2014, « Twitter et les relations de séduction entre députés et journalistes » La
salle des Quatre Colonnes à l'ère des sociabilités numériques, Réseaux, 2014/6 n° 188, p. 201-228.
Résumé : Ce texte entend décrire la manière dont Twitter s’insère, aujourd’hui en France, au centre du jeu d’influence
qui réunit les députés et les journalistes dans la production de l’actualité politique. L’analyse montre comment les
nouveaux usages médiatiques que permet ce support sont l’occasion pour les députés de s’émanciper d’une institution
parlementaire historiquement soucieuse de contrôler au plus près la visibilité médiatique des activités qu’elle
accueille. Néanmoins, si cette dynamique participe d’un désenclavement dans les relations entre la presse et
l’Assemblée, les modes d’interaction entre députés et journalistes dans cet espace ne se distinguent pas
significativement de ceux en vigueur en salle des Quatre Colonnes.

5
Extraits : « L’entrée de Twitter à l’Assemblée nationale française ne s’est pas faite sans remous . Au cours du premier
semestre de l’année 2010, à plusieurs reprises et pour leur propre bénéfice médiatique, des députés ont utilisé les
courts messages à forte audience que sont les tweets pour lever le voile sur quelques nouvelles faisant l’événement au
Palais Bourbon, à la grande satisfaction du monde journalistique. Ces épisodes ont amené en juillet 2010 le Bureau de
l’Assemblée à réfléchir à la meilleure manière d’encadrer l’usage du tweet dans l’enceinte du Palais Bourbon, ainsi que
Bernard Accoyer, alors président de l’Assemblée, à déclarer que « les nouvelles technologies sont là, il faut s’en féliciter,
elles font circuler l’information de manière de plus en plus rapide. Mais elles ne peuvent remettre en cause le respect
du huis clos lorsque l’Assemblée ou une commission décide de siéger à huis clos » . Ces mots sont représentatifs du
désarroi d’un grand nombre de parlementaires face à ce qui est apparu comme une remise en cause de certains
principes de fonctionnement de l’institution par des usages médiatiques émergents. La question du régime de visibilité
entourant les affaires publiques traitées à l’Assemblée a fait l’objet de discussions, et la question du huis clos n’en était
qu’un aspect. D’une manière plus large, c’est le vieux débat sur la publicisation des activités parlementaires qui
ressurgit ici, et avec lui l’épineuse question de la relation des députés et de l’Assemblée avec la presse.
[…]
Ainsi, l’usage de Twitter sera ici envisagé dans un contexte historique et politique particulier, comme une réponse de
députés en quête de visibilité à des logiques médiatiques et institutionnelles jugées contraignantes. La prééminence,
dans la couverture médiatique de l’actualité parlementaire, que se réservent les quelques députés occupant une
position forte dans l’appareil politique ou dans l’institution, est un exemple de ces contraintes. La préférence des
journalistes pour l’événement politique plutôt que pour les travaux délibératifs et législatifs ordinaires en est un autre
exemple. La finalité visée est pour eux de rééquilibrer un rapport de force qu’ils considèrent comme insuffisamment
avantageux. Le journaliste serait-il ainsi en position privilégiée vis-à-vis du député ? Les faits ne semblent pas l’indiquer,
mais donnent plutôt à voir le maintien d’un certain équilibre dans la mesure où « chacun essaie d’exercer une influence
sur le comportement de l’autre et, finalement, tente d’acquérir et de maintenir, à l’encontre de l’autre, une maîtrise sur
le mécanisme de construction de l’actualité politique » (Charron, 1994, p. 11). Leur relation mutuelle doit plutôt être
comprise comme l’expression d’une tension permanente. De manière contradictoire, la production de l’actualité
politique suppose à la fois qu’ils collaborent étroitement et qu’ils jouent leur rôle en maintenant une distance. Ce
rapport basé autant sur la coopération que sur le conflit a amené Jean Charron à concevoir les échanges entre députés
et journalistes à l’aune du principe de négociation, les fenêtres d’exposition médiatique se marchandant contre des
informations évaluées selon leur valeur dans l’espace médiatique. Dans cette idée, la notion de séduction, ensuite, sera
ici utile pour éclairer la manière dont les sphères privées et publiques des députés et des journalistes s’entremêlent
dans des stratégies individuelles, où chacun tente à son niveau de résoudre cette tension. Ainsi, ce texte a pour
première finalité la description de ces stratégies menées au quotidien par les députés envers les journalistes. En second
lieu, ce texte a pour objet de montrer en quoi les nouveaux usages médiatiques, portés par Twitter notamment, ne
viennent pas remettre en question ce jeu d’influence, mais le renouvellent et le recomposent dans de nouveaux
espaces. La matière première de ce travail s’appuie sur une enquête ethnographique à l’Assemblée, menée notamment
en tant que collaborateur parlementaire. Huit témoignages de députés, journalistes et collaborateurs ont été
sélectionnés ici, conduits principalement durant les six premiers mois de l’année 2014.
[…]
Quelle place en définitive pour Twitter dans l’histoire des modalités de visibilité médiatisée des activités et des acteurs
parlementaires ? Du point de vue des journalistes, l’usage de Twitter a entériné, en même temps qu’il a contribué à le
rendre possible, un mouvement en faveur d’une plus grande ouverture de l’espace médiatique. Pour ceux d’entre eux
qui ne sont ni spécialisés sur un thème ni détachés au Parlement, l’entretien d’un réseau de relations pour accéder à
l’information n’est plus une nécessité fondamentale, puisque la coprésence nécessaire aux relations privilégiées n’est
plus dépendante d’un ici et maintenant (Thompson, 2005). Du point de vue des députés, l’usage de Twitter apparaît
comme une opportunité dans une lutte pour la visibilité, en offrant de contourner une logique médiatique sélective par
laquelle seule une élite des députés bénéficie de l’essentiel de la couverture médiatique. Par la prise en main, en
amateur (Cardon, 2010, p. 36), de la publicisation de leurs activités et positionnements, l’espace médiatique jusqu’ici
matérialisé par la salle des Quatre Colonnes s’ouvre, en permettant une plus grande égalité d’accès de chacun à une
visibilité publique médiatisée. L’espace de sociabilité que constitue Twitter offre aux députés une capacité renouvelée à
initier des interactions avec les journalistes. Toutefois, si les positions ont été amenées à évoluer, les relations entre
députés et journalistes, elles, n’évoluent pas à proprement parler, et il s’avère au final que peu d’éléments distinguent
Twitter de la salle des Quatre Colonnes. En participant à désenclaver les relations entre la presse et l’Assemblée ainsi
qu’à redéfinir certaines positions de pouvoir au sein de la vie parlementaire, on voit se prolonger une tendance initiée à
la moitié du siècle dernier par laquelle la publicisation parlementaire s’éloigne encore un peu plus de l’hémicycle et des
débats en séance ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%