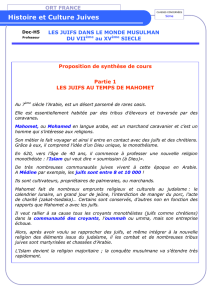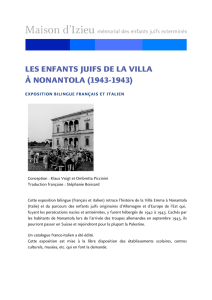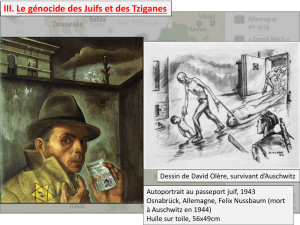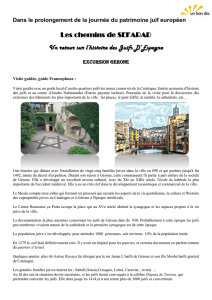Les usuriers juifs aux XVIe et XVIIe siècles

Les usuriers juifs aux XVIe et XVIIe siècles
par Jean-Bernard LANG, membre correspondant
L'installation, ou plutôt la réinstallation de communautés juives dans l'es-
pace lorrain au XVIe siècle, est l'aboutissement à la fois de diverses évolutions,
mais aussi d'une profonde transformation de la société, à la suite du choc éco-
nomique que constitua pour la vieille Europe la découverte du Nouveau Monde,
et l'afflux de métaux précieux qui en résulta. Il n'est pas inintéressant d'en
entreprendre une brève étude et d'en souligner les principales lignes de force,
dans les domaines politiques, économiques et financiers.
A. Les grandes évolutions politiques
Aux premières années du XVIe siècle, les juifs avaient pratiquement été
exclus des différents états d'Europe occidentale. Leur installation dans ces
régions était pourtant ancienne, datant probablement du Bas-Empire pour cer-
taines villes rhénanes, Cologne ou Trêves en particulier (1). Plus tard, sous la
souveraineté des Carolingiens, leur présence est attestée par de nombreux docu-
ments, à Metz notamment, mais aussi ailleurs dans cette région que les écrivains
rabbiniques du XIe siècle, Rashi particulièrement, appelaient « Lotar », c'est-à-
dire Lotharingie (2). Remarquons d'ailleurs en passant que cette « Lotar »
regroupait les Lotharingies historiques (Haute et Basse) et incluait donc la
Rhénanie.
Ces communautés n'avaient jamais dû être très nombreuses ni particuliè-
rement très peuplées, bien que nous n'ayons guère de chiffres fiables pour ali-
menter une statistique sérieuse. On pense cependant, pour fixer un ordre de
grandeur, qu'à l'époque de la première croisade, en 1096, il ne devait pas y avoir
plus de vingt mille individus dans l'espace germanique (3), à peu près autant
dans celui du royaume de France, Tsarfat en hébreu. Elles se développèrent et
1.
Code théodosien XVI 8,3 et VII 8,2.
2.
NAHON Gérard, les Sages de France et de Lotharingie, dans Mille Ans de cultures
ashkénazes, éditions Liana Levi, Paris, 1994.
3.
Mille Ans de cultures, op. cit., p. 11.

prospérèrent encore au XIIe siècle, mais ensuite, la conjoncture se retourna
contre elles. Sans entrer dans les détails qui nous feraient sortir du sujet, on se
bornera à rappeler qu'elles furent à la fois victimes des tentatives de l'Église de
créer une « Chrétienté » homogène (4), et des réussites de certains princes
créant des états centralisés où l'impôt finissait par être perçu à l'aide d'une
administration dévouée (5).
Le mouvement migratoire des juifs européens de l'ouest vers
l'est
com-
mença donc au début du XIVe siècle. Il s'accentua avec la Peste Noire de 1348-
1350 qui ravagea le continent et déclencha des émeutes anti-juives de toutes
sortes, allant souvent jusqu'aux massacres. Bien que la conjoncture connût des
moments de répit, où la course du balancier s'inversait et où, en certains
endroits, les autorités acceptaient le retour sous certaines conditions, la condi-
tion juive resta marquée tout au long des XIVe et XVe siècles, par la précarité et
les violences.
Dans notre région, les principales puissances territoriales étaient le duché
de Lorraine, la ville de Metz et les évêchés de Metz, Toul et Verdun, le plus
important étant le premier. À Metz, la communauté juive, si renommée au
Moyen Age, avait disparu dans des conditions obscures au début du XIIIe siè-
cle (6). Il ne semble pas que des juifs aient continué à habiter l'évêché de
Verdun après la période carolingienne où on les signalait organisant des convois
d'esclaves en direction de l'Espagne musulmane. Il n'en existe nulle trace à
Toul. Par contre, nous savons qu'à plusieurs reprises, les évêques de Metz, qui
ne gouvernaient plus que leur temporel dont la capitale était Vie, en acceptaient
certains sur leurs terres. En tout cas, lorsqu'en 1564, trois familles furent auto-
risées par l'autorité militaire française à venir résider dans la ville de Metz,
l'une d'elles était originaire de Marsal, terre évêchoise (7).
Quant à la Lorraine, c'était en bien des cas un état bicéphale puisque com-
posé de l'union personnelle de deux duchés, celui de Bar et celui de Lorraine.
Concernant le premier, qui était depuis longtemps sous influence française, les
juifs y avaient afflué en grand nombre, venant de France en 1306, mais les ducs
de Bar s'étaient rapidement alignés sur la politique de leur suzerain en la
matière, puisqu'ils avaient prononcé l'expulsion dès 1323. La Lorraine avait
pour sa part tenté à plusieurs reprises d'en installer le long de ses routes com-
merciales les plus importantes, notamment celle qui reliait Saint-Dié à Pont-à-
4.
Ainsi apparaît en effet l'Église dirigée par la Papauté au fameux Concile de Latran IV,
en
1215.
5.
Ce n'est pas pure coïncidence si Philippe IV le Bel, qui ordonna en 1306 la première
expulsion
des juifs de France, est aussi le premier des Capétiens ayant réussi à ébau-
cher,
avec l'aide des fameux légistes, un embryon d'état moderne.
6.
Voir les hypothèses à ce sujet dans LANG Jean-Bernard, ROSENFELD Claude,
Histoire
des Juifs en Moselle, Metz, 2001,
p.21-38.
7.
FAUSTINI Pascal, « Les
Juifs
de Metz », actes du XXIIIe colloque de la Société d'his-
toire
des Israélites d'Alsace et de Lorraine, Strasbourg,
2003,
p.47.

Mousson via Lunéville et Nancy (8). Mais la victoire de René II sur Charles le
Téméraire mit fin à ces efforts, d'ailleurs inégalement suivis d'effets. En 1477,
dès le succès décisif de Nancy, le duc prit contre eux un décret d'expul-
sion (9).
Au début donc des années de la Renaissance, les juifs étaient interdits de
résidence dans les duchés de Lorraine et Bar ainsi que dans la ville libre de
Metz. On n'en connaît pas dans les temporels des évêques de Toul et de Verdun,
seules quelques familles devaient subsister sur les terres administrées par l'évê-
que de Metz, essentiellement dans le Saulnois, mais aussi peut-être à Saint-
Avold. Mais d'autres étaient toujours installées à proximité. Ainsi à
Sarreguemines, ville placée sous la souveraineté des ducs de Lorraine. La
mesure d'expulsion de 1477 y fut appliquée, mais les juifs purent se réfugier à
Welferding, village situé à proximité, mais sous la souveraineté des comtes de
Sarrebruck Nassau. Plus loin vers l'est, leur situation était particulièrement
mouvante. En Alsace où n'existait aucune autorité centrale, chaque prince, cha-
que ville, chaque seigneur, laïc ou ecclésiastique, faisait ce qu'il jugeait le plus
conforme à ses intérêts. Les principaux adversaires des juifs, en cette longue fin
du Moyen Age étaient d'abord les commerçants chrétiens, boutiquiers et arti-
sans regroupés dans leurs corporations, et qui craignaient la confrontation avec
des concurrents se contentant de bénéfices moindres. Ils furent donc tout natu-
rellement à l'origine des mesures d'éloignement qui se prirent d'abord dans les
villes principales, Strasbourg en tout premier lieu, puis s'étendirent peu à peu
aux villes moyennes. C'est ainsi que se constitua alors ce judaïsme rural si
caractéristique de l'Allemagne rhénane alors que celui de l'Allemagne médié-
vale avait été plutôt urbain (10). Ce fut le prélude à un véritable bouleversement
économique et social.
En effet, cette mutation, essentielle dans l'histoire des juifs de nos régions,
se produisait au moment où de profondes transformations sociales et économi-
ques affectaient le monde rural. Ce sont ces mutations, que nous allons à présent
étudier, qui expliquent le surprenant renversement de la tendance, en ce qui les
concerne, tant en 1564 de la part des autorités françaises ayant la charge de la
place forte de Metz, qu'en 1597 du duc de Lorraine Charles III (11). Tendance
qui s'accentuera encore lorsque à partir de 1634, les armées françaises occupè-
8. Pour plus de détails, on se rapportera à FRAY (J.-L.), « La présence juive au Moyen
Age », dans Archives juives №27/2, 1994, p. 25-38.
9. On les accusa, mais bien plus tard, de ne pas avoir été loyaux envers le duc René, ayant
paraît-il vendu des chevaux autant aux Lorrains qu'aux Bourguignons. LEMALET
Martine, Maggino Gabrielli, dans Archives juives op. cit. p. 41.
10.
On estime que vers 1550, ne vivent en Alsace guère plus de cent à cent vingt familles
juives, dont la moitié dans le comté de Hanau Lichtenberg. WEIL (G.), « l'Alsace »,
dans Histoire des Juifs en France, BLUMENKRANZ (B.)( dir.) Privas, 197.
11.
Charles III avait décidé en 1597 d'autoriser un certain Maggino Gabrielli, « consul
général de la nation hébraïque et levantine », de s'installer à Nancy pour y ouvrir 2
banques et un Mont de Piété. L'affaire avorta. Cf. LEMALET Martine supra.

rent les duchés, et particulièrement leur partie nord est, appelé le bailliage d'Al-
lemagne. On les chassait jadis, on cherchait à les attirer à présent. L'explication
tient en un mot : on pensait désormais avoir besoin d'usuriers juifs, personnages
à la fois détestés et indispensables. Pourquoi ? C'est à quoi je vais tenter de
répondre.
B.
L'évolution économique et sociale, les difficultés du monde rural
Le monde rural connaît à l'époque de nombreuses difficultés. Certaines
étaient anciennes, comme la faiblesse des rendements, d'ailleurs en voie d'amé-
lioration, mais d'autres étaient nouvelles, et restaient incompréhensibles aux
contemporains.
Les rendements
Toute la vie économique et sociale d'une région dépendait du résultat de
la récolte vivrière, déjà à la limite des besoins en période normale. Deux mau-
vaises récoltes successives pouvaient signifier une catastrophe se traduisant par
une disette, et comme le dit le proverbe, la faim est mauvaise conseillère. De
toute façon, on constate souvent un parallélisme entre une augmentation du prix
du blé et celle des décès, cette dernière étant décalée d'environ un an par rapport
à la première. Le nombre des naissances décroît lui aussi, ce qui introduit sur
plusieurs années un déficit démographique. Les rendements traditionnels étaient
faibles : avant le XIIIe siècle, pour les quatre grandes céréales, (blé, seigle, orge,
avoine), il était en France de 3,7 pour 1 unité semée, pour arriver à 4,3 à la
Renaissance, et 6,3 plus tard, mais ces rendements étaient surtout observés dans
les grandes plaines à blé comme la Beauce. En Allemagne, et dans notre région,
il n'était que de 4,2 jusqu'à la fin du XVIIe siècle (12). L'auto-alimentation et
la part réservée au réensemencement limitaient donc la part commercialisable
de la production agricole. Il en allait de même des aléas climatiques. Les études
relativement récentes sur l'histoire du climat (13) ont mis en évidence le « petit
âge glaciaire ». La deuxième moitié du XVIe siècle a été marquée par un net
refroidissement de la température et une grande humidité : l'hiver glacial et
neigeux, l'été pourri ont alors été très fréquents, ce qui était grandement préju-
diciable aux rendements, même si d'autre part, ces derniers se redressaient un
peu grâce à l'utilisation plus importante de la fumure, liée au développement de
l'élevage. Mais d'autres éléments entraient en compte.
12.
SLICHER VAN BATH (B.H) De agraris geschiednis van West Europa, 500-1850,
Utrecht, 1960, trad anglaise 1963, cité par MAURO Frédéric, le
XVIe
siècle européen,
aspects économiques, PUF, 1970.
13.
Ces études utilisent des sources nombreuses et variées : chroniques, analyse des
Rogations pour la pluie, dendrologie, glaciologie etc..LE ROY LADURIE (E.),
Histoire du climat depuis Van Mil, Paris, 1967.

Les modifications techniques
Le développement de l'élevage, que l'on perçoit nettement dès la fin du
Moyen Age, est caractéristique du début de la période moderne. Il était lié à
l'augmentation du niveau de vie des citadins, bourgeois enrichis dans le com-
merce ou artisans pourvoyeurs de ce même commerce qui reposait surtout sur
le tissage. Il s'agissait bel et bien d'une nouvelle classe sociale, enrichie, qui
certes n'avait pas encore les moyens économiques de la noblesse et du haut
clergé, mais qui souhaitait mieux se nourrir, et plus particulièrement en produits
carnés. Ces nouveaux riches imitent tout naturellement les anciens seigneurs et
investissent leurs bénéfices à la campagne, rachetant à des petits paysans leurs
lopins de terre qui ne les nourrissent plus, et aussi des parcelles des grands
domaines à des propriétaires nobles ruinés par renchérissement de la vie et la
stagnation de la valeur des cens féodaux. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls,
certains paysans favorisés en font de même. Beaucoup de ces champs sont trans-
formés en pacages pour les troupeaux, mais pour éviter qu'on leur porte attein-
te,
on a tendance à les enclore. C'est particulièrement vrai pour les « enclosu-
res » en Angleterre ou le bocage en Normandie, mais on peut observer le phé-
nomène un peu partout en Europe. La forêt, du coup, change aussi de visage.
Autrefois, elle était le principal lieu où se nourrissaient les troupeaux de porcs
à la glandée, où l'on allait cueillir des baies, des fruits et des champignons. La
forêt médiévale était un bien commun à tous les villageois, bien qu'elle appar-
tienne légalement au seigneur. Au XVIe siècle, celui-ci la réserve à son profit
personnel. Les défrichements sont désormais interdits, malgré l'augmentation
de la population, particulièrement nette après la fin de la guerre de Cent Ans et
qui se poursuit jusqu'aux guerres de Religion. Les seigneurs exploitent désor-
mais leurs forêts pour la vente des arbres, car la consommation de bois flambe
tant à cause de la construction, des chantiers navals ou de la métallurgie qui
utilise le charbon de bois, qu'en raison des besoins militaires (guerres de siège
nécessitant fascines, palissades et machines diverses). On remplace souvent les
chênes par des conifères à croissance rapide (sapins, mélèzes, pins) dont les
fruits sont vénéneux et dont les aiguilles tombées au sol stérilisent le sous-bois.
La chasse dans ces futaies devient un privilège du noble et le vilain n'y peut plus
venir pour améliorer d'un coup de fusil l'ordinaire de sa famille (14). Ces nou-
velles formes d'exploitation des ressources rurales entraînent alors des modifi-
cations de la société paysanne.
Les modifications sociales
Le monde rural se divise peu à peu en trois catégories. Tout en haut de la
pyramide, les paysans aisés, gros fermiers ou propriétaires de superficies non
négligeables, laboureurs à bœufs car possédant généralement du bétail. Ceux-là
sont à peu près à l'abri d'un retournement de la conjoncture, et si vraiment les
aléas de la vie les mettaient dans l'embarras, ils pourraient s'en sortir plus ou
14.
FOSSIER (R.), Le Moyen Age, tome III, Paris, Armand Colin, 1983, p. 395-400.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%