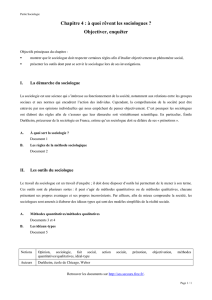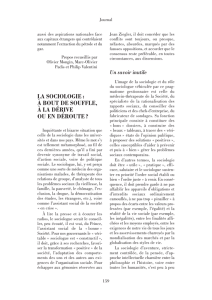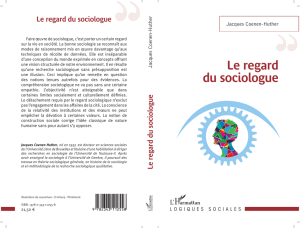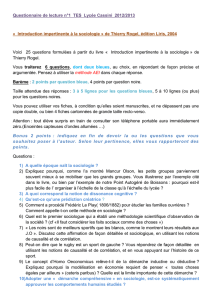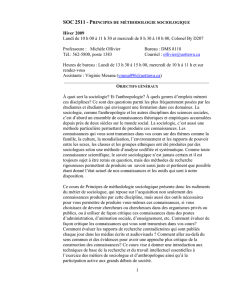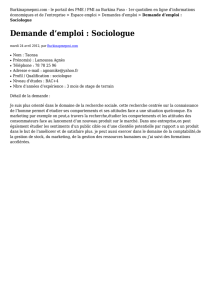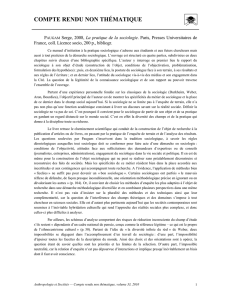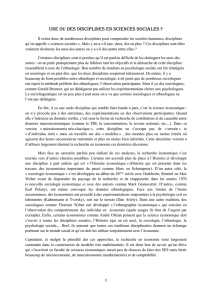Compte rendu de colloque. Le sociologue dans la Cité

S’est déroulé le 15 avril 2010 à l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS) un collo-
que accompagnant la parution du premier numéro
de la revue SSoocciioollooggiiee, éditée aux Presses univer-
sitaires de France. Serge Paugam (Centre national
de la recherche scientifique – EHESS, Centre Maurice
Halbwachs), directeur de la publication, définit ce
«nouvel espace d’exposition des recherches
contemporaines » comme « généraliste, ouvert aux
différents courants théoriques et méthodologiques,
sensible aux enjeux de société, ancré dans la
conviction que la sociologie doit être ”utile” (…) »
(éditorial de S. Paugam, p. 1-2 du n° 1 de SSoocciioo--
llooggiiee). En quoi consiste cette utilité de la sociologie
et du sociologue et à quelles conditions engage-
ment et scientificité peuvent-ils être combinés ?
Les quatre tables rondes de la journée n’auront pas
épuisé la question, récurrente depuis la naissance
de la discipline. Les points de vue contrastés
défendus par les un-e-s et les autres ont stimulé les
échanges au sein d’une discipline qui s’est, à cette
occasion, donnée à voir comme réflexive, vivante
et ambitieuse.
Pour S. Paugam, introduisant le colloque, la ques-
tion cruciale à approfondir aujourd’hui est celle
de l’engagement du sociologue qui, pour être,
selon lui, impératif, n’en comporte pas moins des
risques. Émile Durkheim, un des pères fondateurs
de la discipline, écrivait en 1893 dans la préface
à la première édition de son ouvrage DDeellaaddiivvii--
ssiioonndduuttrraavvaaiillssoocciiaall:«Nous estimerions que nos
recherches ne méritent pas une heure de peine si
elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si
nous séparons avec soin les problèmes théoriques
des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger
ces derniers : c’est, au contraire, pour nous mettre
en état de les mieux résoudre ». Autrement dit,
étudier la réalité n’est pas renoncer à l’améliorer :
au contraire, les aspects théoriques ne valent
qu’en tant qu’ils permettent la résolution de pro-
blèmes pratiques. Le processus de dévoilement
auquel se livrent les sociologues – qui doivent
être, pour É. Durkheim, des « conseilleurs », des
«éducateurs »(
LL’’éélliitteeiinntteelllleeccttuueelllleeeettllaaddéémmoo--
ccrraattiiee, 1904) – permet à la société de prendre
conscience d’elle-même, voire ensuite de changer.
Pour ce faire, le sociologue doit diffuser ses résul-
tats et s’adresser à des publics et des types de
lecteurs divers, en faisant preuve de clarté et de
pédagogie sans sacrifier à la rigueur scientifique.
Cette dernière a d’autant plus de chances d’être
préservée que le chercheur visera d’abord à pro-
duire pour être lu par la communauté de ses
pairs, que le sociologue Raymond Boudon dési-
gnait comme « le marché I de la production intel-
lectuelle »(1). Les marchés II – public plus large
de non-sociologues concernés par les thémati-
ques traitées – et III – public plus diffus de l’en-
semble des citoyens – ne sauraient dominer la
production sociologique si la confrontation pre-
mière du sociologue est celle de sa communauté
d’origine. Il s’agit donc de partir des exigences du
premier marché (rigueur scientifique) puis, dans
un second temps seulement, de voir comment se
faire comprendre des publics hors communauté
scientifique. Cette règle d’or doit permettre au
sociologue d’éviter de tomber dans les travers du
métier, parmi lesquels figure notamment celui
d’être instrumentalisé en tant qu’expert pour les
besoins de l’Administration, de la « technocratie ».
Et S. Paugam de citer l’injonction à produire des
chiffres dans le domaine de la pauvreté, par
exemple, comme si ces derniers avaient en eux-
mêmes le pouvoir de résoudre ce qu’ils mesurent.
Les attentes de l’Administration et des entreprises
sont, par nature, décalées par rapport à l’esprit
dans lequel les travaux scientifiques sont conduits.
Politiques sociales et familiales n° 103 - mars 2011
109 Synthèses et statistiques
Compte rendu de colloque
Le sociologue dans la Cité
Éthique et utilité sociale
Clémence Helfter CNAF – Direction des Statistiques, des Études
et de la Recherche.
Pôle Recherche et Prospective.
Mots clés : Sociologie – Éthique – Épistémologie.
(1) Boudon R., 1981, L’intellectuel et ses publics : les singularités françaises, in,FFrraannççaaiiss,,qquuiiêêtteess--vvoouuss??(sous la dir. de
Grafmeyer Y. et Padioleau J.-G.), Paris, La Documentation française.

Pierre Bourdieu avançait ainsi : « Une bonne partie
de ceux qui se désignent comme sociologues ou
économistes sont des ingénieurs sociaux qui ont
pour fonction de fournir des recettes aux diri-
geants des entreprises privées et des administra-
tions. Ils offrent une rationalisation de la connais-
sance pratique ou demi-savante que les membres
de la classe dominante ont du monde social. Les
gouvernants ont aujourd’hui besoin d’une science
capable de rationaliser, au double sens, la domi-
nation, capable à la fois de renforcer les méca-
nismes qui l’assurent et de la légitimer »(2).
S. Paugam soutient donc que le sociologue qui se
laisserait happer par les « concepts vulgaires »
que sont, d’après lui, ceux de « l’évaluation des
politiques publiques » ne pourrait plus prétendre
exercer le métier de sociologue, indissociable de
la capacité dont il doit pouvoir jouir d’exercer sans
entrave une réelle force critique.
L’engagement sociologique : évolutions
et ruptures
Cette première table ronde questionne le postulat
de S. Paugam selon lequel les sociologues peuvent
et doivent s’engager dans la Cité. Qu’en est-il
alors du rapport du chercheur engagé au principe
de neutralité axiologique de Max Weber ? Comment
donner des frontières personnelles à l’engage-
ment ? Y a-t-il place pour différents types et degrés
d’engagement ?
Dominique Schnapper témoigne de l’expérience
de « participation observante » (plutôt que d’ob-
servation participante) qui a été la sienne au sein
de la Commission sur la réforme de la nationalité
(1986-1987) puis du Conseil constitutionnel
(2001-2010) : « comment intervenir sans perdre
son âme de sociologue ? ». Celle qui s’est livrée à
un exercice d’ethnographie de l’institution juri-
dique dont elle a été indigène pendant neuf ans
(UUnneessoocciioolloogguueeaauuCCoonnsseeiillccoonnssttiittuuttiioonnnneell, 2010,
Gallimard) – et avec intérêt – porte néanmoins un
regard désabusé sur les hommes et les femmes
politiques comme sur les hauts fonctionnaires, que
les sciences sociales dont la sociologie « n’inté-
ressent pas ». Ce qui l’amène à déplorer que la
plus-value spécifique que la participation d’une
sociologue aurait pu apporter à l’activité du
Conseil ait été purement et simplement ignorée.
Pour François Dubet (Bordeaux II et EHESS), la
question de l’engagement du sociologue est large-
ment rhétorique, lui qui considère être « engagé
de fait » comme tous ceux qui pourraient pourtant
tenter de s’en défendre. Pour preuve, par exemple :
«les outils statistiques sont des théories en actes ».
Répondant aux propos introductifs de S. Paugam
sur les experts, F. Dubet estime qu’il n’y a pas à
leur opposer mécaniquement la figure de l’intel-
lectuel : la position d’expert, difficile à tenir
certes, n’a selon lui rien de déshonorant ni d’infâ-
mant a priori. En effet, il invite à raisonner en
termes de possibilités d’action : une position forte
dans une institution peut permettre d’être critique
à l’endroit de cette dernière et donc de concilier
loyauté et liberté, plus encore si l’expert peut
s’appuyer par ailleurs sur un « milieu professionnel
consistant ». Où l’on retrouve le contrôle par les
pairs et le premier marché, instance de critique et
de débat qui, seule, peut conférer une légitimité
scientifique. Cela ne signifie pas pour autant que
tout risque d’appropriation soit écarté : « le jeu
politique est plus fascinant que le jeu scientifique »,
en particulier parce que le premier se caractérise
par une réactivité immédiate qui contraste avec
la lenteur du second. Ce « piège d’attraction poli-
tique » se double d’un « piège d’appropriation »,
qu’illustre par exemple le passage de F. Dubet par
la Commission des programmes de sciences écono-
miques et sociales (pour en modifier les enseigne-
ments en classe de seconde), puis sa démission
motivée par l’instrumentalisation dont les préco-
nisations faisaient l’objet de la part du ministère
commanditaire. D’où la position nuancée qu’il
défend : l’engagement est incontournable mais
l’impact des interventions du sociologue sur la
société peut être assez limité. Il s’agirait ainsi de
ne pas surestimer cet impact tout en postulant la
capacité des sociologues à peser dans le débat et
donc à influer sur la société à condition qu’ils
travaillent à la constitution d’un milieu profes-
sionnel suffisamment robuste, à l’instar de celui des
économistes, qui « se saisissent de plus en plus des
objets sociaux ».
L’idée de la prétention hégémonique de la science
économique est ici brièvement introduite et sera
reprise ensuite, pour être confirmée, nuancée ou
infirmée, par l’ensemble des intervenants de la
journée. Ainsi, Stéphane Beaud (EHESS, École
normale supérieure de Paris) souligne que l’éco-
nomie mobilise un stock méthodologique impor-
tant sur les problèmes sociaux, dont la force
démonstrative est frappante. La sociologie risque
par contraste de devenir une microsociologie
de description du vécu et donc une science rési-
duelle. Éviter cet écueil passe, pour S. Beaud,
par la formation des étudiants en sociologie aux
outils statistiques. La guerre est déclarée : il s’agit
de « contrer les points de vue dominants des
économistes », de « réagir » face aux statisticiens
et autres économètres et « d’avoir les mêmes capa-
cités qu’eux pour les challenger ». L’enjeu principal
Politiques sociales et familiales n° 103 - mars 2011
110 Synthèses et statistiques
(2) Bourdieu P., 1984, Une science qui dérange,QQuueessttiioonnssddeessoocciioollooggiiee, Paris, éditions de Minuit.

est avant tout interne à la discipline pour
S. Beaud. L’engagement est illusoire : la socio-
logie se borne à esquisser des scénarios et,
puisque « les dés sont pipés », le sociologue ne
doit pas « participer aux mascarades de consul-
tations organisées par un pouvoir qui n’est pas à
l’écoute » mais plutôt « rester sagement dans sa
tour d’ivoire ». À défaut de quoi le risque est de
se décrédibiliser et la discipline avec. Ce qui
n’empêche pas le sociologue d’avoir possible-
ment une influence sur la société par la diffusion
des résultats des recherches qu’il a choisi de
mener (le choix de l’objet de recherche est fonda-
mental en sociologie). Ainsi, en améliorant la
connaissance des milieux sociaux et en repérant
l’existence d’une élite scolaire, il peut peser sur
la représentation que la société se fait d’elle-
même et donc contribuer à la faire ouvrir plus
largement.
Le sociologue dans le champ
médiatique : diffuser et déformer ?
La confrontation aux médias, devenue perma-
nente, fait évoluer les pratiques et le métier de
sociologue. Nombreux sont les acteurs de la
discipline qui le déplorent et considèrent que
les journalistes dénaturent et appauvrissent le
savoir sociologique. Ce n’est pas le point de
vue défendu par Cécile Van de Velde (EHESS,
Centre Maurice Halbwachs), qui constate que la
demande médiatique de sociologie va croissante
et qu’elle est de plus en plus crédible. Les experts
sociologues s’apparentent à des « prêtres laïcs » :
ils sont convoqués pour donner du sens à un
monde qui paraît très complexe, et ils sont de
plus en plus enclins à accepter les sollicitations,
voire à les devancer. De sorte que la sociologie
fait l’objet d’une diffusion croissante qui réactive
du même coup des questionnements qui traver-
sent la discipline depuis ses origines. L’érosion
des frontières entre le monde académique et le
monde médiatique amène les sociologues à
repenser leur place au sein de la société en s’in-
terrogeant sur l’utilité sociale potentielle de leur
discipline versus ses enjeux strictement cognitifs.
On peut se demander aujourd’hui s’il est néces-
saire de simplifier – voire de déformer – les résul-
tats des travaux sociologiques pour les diffuser
largement. Pour C. Van de Velde, la vulgarisa-
tion est une valorisation positive et nécessaire.
Erik Neveu (Sciences-Po Rennes) abonde dans le
même sens : le sociologue a un devoir de diffu-
sion des scénarios qu’il définit : son apport en
terme de problématisation de la société est irrem-
plaçable, pour les politiques notamment. Ne pas
répondre aux sollicitations, c’est prendre le risque
que d’autres aient moins de scrupules, même
s’ils sont moins compétents sur le sujet. L’idée est
de garder toutefois un maximum de contrôle sur
le produit fini, ce qui passe notamment, pour
E. Neveu, par l’intervention en direct et par le
refus des formats trop courts. Il invite ses collè-
gues à proposer à la presse des articles sans
attendre passivement les sollicitations des jour-
nalistes.
Cyril Lemieux (Institut Marcel Mauss EHESS-CNRS)
rappelle que, depuis le début des années 1980,
les contraintes économiques se sont accrues dans
le champ des médias : extension du capitalisme,
normes de productivité et de rentabilité, intensi-
fication du rythme de l’action, externalisation des
coûts, droit d’ingérence croissant des services non
rédactionnels, formats de diffusion plus courts,
« mentalité audimat » avec des luttes concurren-
tielles et le recours à des instruments de mesure
des écarts entre concurrents, etc. Ces transfor-
mations du champ médiatique se traduisent par
un journalisme davantage caractérisé par la
superficialité, le suivisme et le formatage. Selon
C. Lemieux, ces évolutions affectent également le
champ de la recherche et des études statistiques :
ainsi, l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) serait enclin à
lancer des enquêtes sur des sujets susceptibles de
recevoir un écho médiatique de façon à en faire la
promotion et à obtenir des financements dans le
cadre du mécénat public voire privé. Ce spécia-
liste des médias en tire deux conclusions princi-
pales. La première : la sociologie doit être ensei-
gnée au lycée, de façon à permettre que soient
décodés les messages diffusés par les médias et à
contourner le maintien des écarts sociaux dans
l’accès à la diffusion vulgarisée. La seconde : les
sociologues pourraient envisager une façon diffé-
rente de travailler avec les journalistes, dans l’idée
de s’impliquer plus en amont dans la construc-
tion de la réflexion et de la problématisation de
l’actualité et de la société. Une agence de presse
sociologique pourrait même être créée pour diffu-
ser des contre-discours ou des discours alternatifs
sur l’actualité et mener des enquêtes conjointe-
ment avec des journalistes. Reste, là encore, un
appel à produire d’abord et avant tout en direction
de ses pairs et la revendication de C. Lemieux
relative au ”droit du sociologue à rester dans
sa tour d’ivoire” : la valorisation des travaux en
direction des marchés II et III ne doit pas être
imposée. Sylvain Bourmeau (journaliste) se situe
dans la même perspective : sociologues et journa-
listes pourraient collaborer au sein de plates-
formes de dialogues et d’échanges avec les rédac-
tions, pour permettre de rendre visibles et intelli-
gibles certains phénomènes sociaux. Ce qui néces-
site du temps, un temps plus long et lent que celui
des médias, et constitue en lui-même un acte poli-
tique, déplaçant ainsi la question de la neutralité
axiologique.
Politiques sociales et familiales n° 103 - mars 2011
111 Synthèses et statistiques

Le sociologue dans le champ
de l’expertise : contester et servir ?
Agnès Van Zanten (CNRS, Observatoire sociologi-
que du changement) note que les travaux socio-
logiques imprègnent le corps social avec un effet
retard : le cheminement des idées est long dans
le monde social comme dans celui de la décision,
de sorte que l’impact potentiel des sociologues sur
les institutions et la société se mesure à long
terme. Nicolas Duvoux (Université Paris 5, Centre
de recherche sur les liens sociaux), dont on sait
par ailleurs qu’il participe au Comité national
d’évaluation du revenu de solidarité active, fait
remarquer que très peu de sociologues ont un « posi-
tionnement » dans l’Administration ou la haute
Fonction publique. Or, les acteurs de l’Adminis-
tration sont pluriels et abritent en leur sein des
tensions qui peuvent représenter des marges de
manœuvre et permettre ainsi au sociologue de
faire entendre sa voix propre sans se trahir. Robert
Castel (EHESS) revient sur le « mandat » de la socio-
logie : établir des diagnostics et les donner à
discuter. Certes l’univers de la politique et de la
décision administrative obéit à des contraintes
différentes de celles de la recherche académique ;
cependant, dialoguer avec les représentants des
institutions est nécessaire. Le rôle social du socio-
logue est de produire des analyses aussi « objec-
tives » que possible et de discuter avec les déci-
deurs et les responsables politiques de la façon
dont ce qui en découle pourrait être mis en œuvre.
Revenant sur l’opposition entre sociologie et éco-
nomie, Louis Chauvel (Sciences-Po Paris) estime
que la première vit un moment particulier du fait
du terrain qu’elle a laissé à la seconde dans la
société et le débat public. Il note que les politi-
ques et les fonctionnaires ont une mauvaise image
des sociologues, qui seraient ennuyeux si ce
n’est inexistants. De fait, les sociologues appor-
tent davantage de problèmes que de solutions,
tandis que c’est, d’après lui, l’inverse avec les
économistes, de mieux en mieux armés. Fort de
son expérience d’expert scientifique auprès de
la Haute Autorité de santé (Commission d’éva-
luation économique et de santé publique), Daniel
Benamouzig (CNRS, Sciences-Po Paris, Centre de
sociologie des organisations) fait observer que la
nature de la bureaucratie a évolué : de nouvelles
formes hybrides sont apparues, qui cherchent à
incorporer un niveau élevé de connaissance. Un
sociologue peut travailler dans ce cadre de façon
plus praticable, sans être assimilé au « conseiller
du Prince » ni avoir mauvaise conscience. Les
enjeux posés en termes économiques méritent de
l’être en termes politiques et sociaux plus géné-
raux. Les économistes sont alors démunis pour le
faire et se tournent vers d’autres formes de savoirs.
Des rapports d’alliance entre économistes et socio-
logues peuvent ainsi se nouer dans des domaines
et des lieux aussi discrets que la santé et la Haute
Autorité de santé. Il existe des convergences pos-
sibles. La sociologie est attendue : ses méthodes et
savoir-faire sont robustes et utiles. Ce qui suppose
d’en apporter la preuve et de rendre accessible
quelques types de savoirs sociologiques. L’idée est
d’expliciter les enjeux et de reformuler les ques-
tions, d’exposer les connaissances sur lesquelles
se fonde le sociologue. Celui-ci est réinterrogé par
les pouvoirs publics quand la boîte à outils écono-
miques qui sert à construire les réponses ne suffit
plus. La demande des politiques et des administra-
tions est donc décalée : les sociologues sont solli-
cités a posteriori, pour reprendre du champ. Si
l’économie renvoie une image de scientificité, ses
outils ne sont pourtant pas toujours aussi solides
que cela. La sociologie doit donc interroger ces
méthodes et leurs faiblesses, comme par exemple
l’expérimentation par rapport à la vie réelle. L’asy-
métrie entre l’économie et la sociologie est une
réalité mais elle représente, selon D. Benamouzig,
une opportunité si elle est assumée de façon
décomplexée. C’est la stratégie du faible contre le
fort : connaître le langage des économistes pour
pouvoir traduire les concepts, les résultats, les
méthodes en termes sociologiques.
Laurent Muchielli intervient à l’issue de cette table
ronde pour faire remarquer que si les économistes
sont moins réflexifs que les sociologues à l’endroit
de leur propre discipline, ils n’en sont pas moins
en attente de sens et de problématique par rapport
aux enjeux de société, ce que les analyses socio-
logiques peuvent contribuer à apporter. C. Van de
Velde insiste avec fermeté et conviction : elle
s’inscrit en faux contre le diagnostic d’affaiblisse-
ment de la sociologie par rapport à l’économie ;
son constat est plutôt celui d’une montée en force
de la sociologie. Les économistes sont très visi-
bles mais tendanciellement, le crédit porté à la
démarche sociologique s’accroît. La tension entre
ingénieur social et sociologue existe mais il n’y a
pas d’opposition entre les deux, avec l’un qui
serait plus légitime que l’autre. La question à se
poser peut être formulée en ces termes : avec
quels moyens mobilisables être utile ? Les socio-
logues communiquent insuffisamment autour de
la découverte de phénomènes sociaux émergents :
or, cette anticipation serait particulièrement utile à
l’action.
Quelle éthique pour la sociologie
demain ?
L’affaire Tessier (astrologue devenue docteure en
sociologie en 2001 sous la direction de Michel
Maffesoli), le débat sur l’introduction de caté-
gories ethniques dans la statistique publique, les
Politiques sociales et familiales n° 103 - mars 2011
112 Synthèses et statistiques

pressions exercées parfois sur les chercheurs par
les commanditaires institutionnels d’une étude
qui souhaitent en édulcorer le contenu et en
restreindre la diffusion [voir, par exemple, l’expé-
rience d’Elisabeth Gudé et Guillaume Malochet
avec leur rapport sur la fonction de directeur à la
Protection judiciaire de la jeunesse (3)], le projet
de l’Association française de sociologie, depuis
2006, d’une charte déontologique pour les socio-
logues : autant d’éléments qui illustrent un
contexte que l’on peut penser en terme de
méthode sous un angle épistémologique, ou bien
dans une perspective de rapports de force ou
encore en ayant recours à l’éthique. Pierre
Mercklé (École normale supérieure – Lettres et
sciences humaines) se demande s’il faut néces-
sairement que la sociologie serve à quelque
chose : il s’agirait, au contraire, de protéger le
droit qu’elle ne serve à rien. Reste à interroger les
relations entre chercheurs et acteurs du monde
social, dont les politiques et les journalistes :
quels moyens mobiliser pour être audible ?
L’éthique pourrait-elle en être un ? Comment alors
cette éthique pourrait-elle s’incorporer en actes
de recherche ?
Dominique Méda (Centre d’étude de l’emploi)
pose un diagnostic sans appel : l’état de la disci-
pline est dévasté. Et de s’interroger : quel type de
sociologie pour demain ? Ayant dirigé la mission
Animation de la recherche de la Direction de
l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (DARES – service statistique ministériel
rattaché au ministère du Travail, de la Solidarité et
de la Fonction publique), D. Méda témoigne de la
domination du paradigme économique au sein de
la DARES et, plus largement, du ministère : les
directeurs des administrations centrales ne tiennent
pas en haute estime les travaux sociologiques,
menés sur de trop petits échantillons par des
«gauchistes qui pleurent », l’économie est privi-
légiée parce que ses diagnostics sont assortis,
eux, de propositions formulées sur la foi d’énor-
mes bases de données et de modèles complexes.
Conclusion : les sociologues doivent imiter les éco-
nomistes en développant des méthodes « rando-
misées » comme, par exemple, avec le revenu de
solidarité active et les expérimentations jeunes.
Sauf qu’un problème éthique ne manquera pas
alors de se poser pour le sociologue confronté
aux attentes du commanditaire en terme de
démonstration de la causalité. Même si le Comité
d’éthique du CNRS a produit un guide méthodo-
logique des expérimentations qui définit le cher-
cheur comme coexpérimentateur, la position de
coconstructeur des politiques publiques reste dans
les faits problématique.
Nicolas Mariot (CNRS) évoque l’épineuse question
de l’anonymisation des enquêtés. Elle se posera
d’autant plus qu’avec la mise en ligne sur Internet
des revues et de leurs articles de recherche, le
lectorat peut potentiellement augmenter et les
travaux sortir du cercle relativement confidentiel
des spécialistes. Lorsque l’objet d’une recherche
est une personne publique, les chercheurs ont ten-
dance à ne pas anonymiser leurs articles. Même
anonymisée, toute personne enquêtée est suscep-
tible d’être bousculée par la posture sociologique
objectivante et la règle classique de l’anonymat ne
ne résout pas cette question. Or, le chercheur ne
peut se borner à être le simple « ventriloque » de
la parole des enquêtés : c’est un portrait sociolo-
gique que le chercheur construit et qui l’expose à
des réactions potentiellement brutales des enquêtés.
Daniel Cefaï (EHESS, CNRS) estime que les pro-
tocoles d’enquêtes et autres codes déontologiques
sont insuffisants pour encadrer les pratiques d’en-
quêtes sur le terrain. Au-delà des bases que sont le
respect des convenances et civilités ordinaires, la
véritable difficulté à résoudre pour le chercheur
est de s’être engagé à décrire sans fards tout en
anticipant sur les réactions des enquêtés qui lui
ont fait confiance : concrètement, il s’agit pour
le chercheur de parvenir à concilier autonomie cri-
tique et ménagement des enquêtés à la lecture
des résultats de l’étude. La question de l’anonymi-
sation est encore plus compliquée quand le terrain
est un petit milieu, où tous les enquêtés sont facile-
ment reconnaissables. L’idée est alors de construire
des parcours typiques semi-fictifs pour éviter que
les enquêtés puissent être identifiés. Penser résou-
dre les difficultés éthiques que pose toute enquête
de terrain par la création d’un comité déonto-
logique est illusoire. Pire, aux États-Unis et au
Canada, cela s’est traduit par des entraves aux
enquêtes telles qu’il existe des universités aux
États-Unis où plus aucun travail de terrain ethno-
graphique n’est mené. C’est donc à une pragma-
tique de l’éthique que le chercheur aura plus sûre-
ment recours qu’à des règles fondamentales
édictées a priori. Il existe des règles transversales à
un grand nombre de terrains quand d’autres se
règlent au cas par cas. Les chercheurs ne sont pas
démunis : un savoir pratique est accumulé au fur et
à mesure, une véritable casuistique est produite,
qui doit leur permettre d’exercer leur droit démo-
cratique à enquêter.
Les quatre séquences du colloque regroupaient
chacune cinq sociologues, d’où un temps de
parole relativement limité pour chacun d’entre
eux, le risque concomitant de « caricaturer » ses
propres idées, de vider l’argumentation de sa
substance faute de pouvoir la déployer dans le
Politiques sociales et familiales n° 103 - mars 2011
113 Synthèses et statistiques
(3) Laurens L. et Neyrat F. (dir.), 2010, EEnnqquuêêtteerr::ddeeqquueellddrrooiitt??, éditions du Croquant.
 6
6
1
/
6
100%