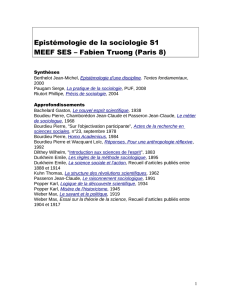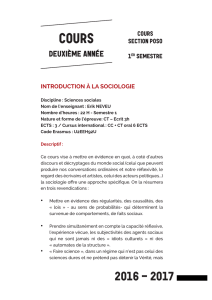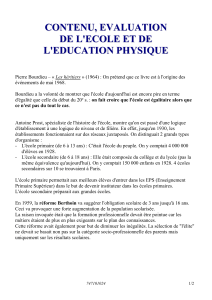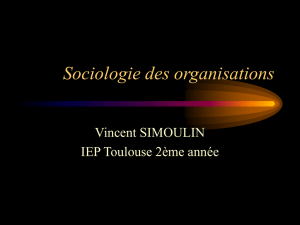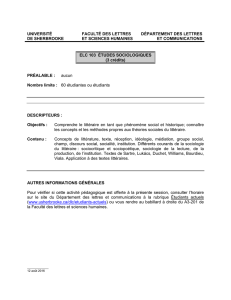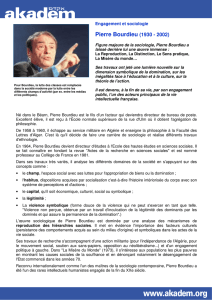Sociologie , Comptes rendus | 2010

Sociologie
2010
Pierre Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1. Cours au Collège de France
1981-1983 (Seuil, 2015)
Arnaud Esquerre
Electronic version
URL: http://sociologie.revues.org/2933
ISSN: 2108-6915
Publisher
Presses universitaires de France
ELECTRONIC REFERENCE
Arnaud Esquerre, « Pierre Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1. Cours au
Collège de France 1981-1983 (Seuil, 2015) », Sociologie [Online], Comptes
rendus, 2016, Online since 08 September 2016, connection on 02 February
2017. URL : http://sociologie.revues.org/2933
This text was automatically generated on 2 February 2017.
© tous droits réservés

Pierre Bourdieu, Sociologie générale.
Volume 1. Cours au Collège de France
1981-1983 (Seuil, 2015)
Arnaud Esquerre
REFERENCES
Pierre Bourdieu (2015), Sociologie générale. Volume 1. Cours au Collège de France 1981-1983,
Paris, Seuil, 740 p.
Pierre Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1. Cours au Collège de France 19...
Sociologie , Comptes rendus | 2010
1

1 « Qu’est-ce que la sociologie ? » et « qu’est-
ce que c’est que d’être un sociologue ? ».
Les deux premières années de cours que
donna Pierre Bourdieu au Collège de
France, entre le 28 avril 1982 et le
25 janvier 1983, sont organisées par ces
deux questions, qu’il posa lui-même ainsi
(respectivement p. 209 et p. 427)1.
Toutefois, la « théorie générale du monde
social » qui fut alors enseignée est « la
vision de la sociologie » de P. Bourdieu,
« vision qu’[il vivait] comme universelle »
(p. 200). Il faut donc comprendre le titre de
Sociologie générale, à laquelle le professeur
consacre les cinq premières années de son
enseignement, comme renvoyant à sa seule
théorie sociologique conçue comme
pouvant s’appliquer et être reprise au
niveau général. Si les cours déjà publiés de
manière posthume traitant de l’État
(1989-1992) et de Manet (1998-2000)
pouvaient parfois donner l’impression de tirer en longueur, ceux-là sont, en revanche,
d’une grande densité, les idées et les exemples s’enchaînant sans répit, leçon après leçon,
chacune formant un chapitre. Car, en vingt-et-une leçons, P. Bourdieu fait référence non
seulement à l’ensemble de ses travaux passés, de l’Algérie à la haute couture en passant
par le Béarn, l’enseignement, les musées, la photographie, mais aussi à la quasi-totalité de
ceux à venir, évoquant le système universitaire que l’on retrouvera dans Homo Academicus
(1984), les grandes écoles, traitées dans La Noblesse d’État (1989), Flaubert et le champ
littéraire qui seront au cœur des Régles de l’art (1992), les rapports entre le masculin et le
féminin développés dans La Domination masculine (1998) et annonçant même la Misère du
monde (1993), en déclarant que « la sociologie n’empêche pas de souffrir, elle permet de
comprendre pourquoi on souffre » (p. 435). Il n’y a guère que le marché des maisons
individuelles des Structures sociales de l’économie (2000) qui ne semble pas déjà en germe.
Rendre compte d’une telle somme oblige donc nécessairement à opérer des choix, qui
insisteront notamment sur le rapport à la philosophie et à la sociologie, et qui n’en
restitueront pas toute la richesse (en particulier en ce qui concerne les longues analyses
de l’injure et du champ littéraire), l’ouvrage étant heureusement doté d’un double index,
de nombreuses notes éclairantes et d’une présentation par Patrick Champagne et Julien
Duval, autant d’éléments précieux d’une édition soignée.
2 Remontant à l’un des auteurs fondateurs de la discipline, Émile Durkheim, qui définissait
celle-ci comme « la science des institutions2 » P. Bourdieu débute donc sa théorie
générale, la première année, principalement par un travail sur l’« institution »
[« “L’institution”, ce mot qui est aussi vieux que la sociologie et que les durkheimiens ont
beaucoup utilisé, m’a paru mériter une nouvelle réflexion » (p. 175)], prenant comme
exemples l’État et l’Église, et, conjointement, sur les opérations de nomination et de
classement. L’institution, revue par P. Bourdieu, se caractérise tout d’abord en ce qu’elle
attribue et retire des places, par des actes « positifs », d’« institution », qui consistent à
Pierre Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1. Cours au Collège de France 19...
Sociologie , Comptes rendus | 2010
2

désigner quelqu’un comme digne d’occuper une position, et des actes « négatifs », de
« destitution », qui consistent à enlever à quelqu’un la dignité qui lui a été accordée
(p. 34). Ensuite, elle tient et impose un discours de présentation d’elle-même, qui vise à ce
qu’on n’apprenne pas sur elle-même ce qu’elle ne veut pas dire (p. 56). Troisièmement,
l’institution transforme un fait en droit, qui prend alors la forme d’une prévision, mais le
faire suppose qu’il existe des différences, jamais complètement constituées, sur un fond
d’incertitude irréductible (car « il y a toujours une incertitude sur ce qui va advenir »,
pp. 124-125). En plus d’avoir des actions qui se divisent en positives et négatives, elle
s’envisage, en outre, par degrés (p. 145) si bien que se repèrent des couples d’opposés : la
nomination officielle est à la fois un acte positif et fortement institutionnalisé, tandis qu’à
l’opposé, l’injure est un acte négatif et faiblement institutionnalisé. Complétant ce
tableau, la flatterie est positive et faiblement institutionnalisée, tandis que la
condamnation à perpétuité est négative et fortement institutionnalisée. L’institution est
constituée par la rencontre de choses matérielles qui sont une forme de son incarnation,
et de corps socialisés pour reconnaître ces choses, c’est-à-dire des habitus, ce qui lui
permet d’assurer à ces corps constitués en un groupe une permanence que ce dernier n’a
pas par lui-même (p. 181). Ce groupe doit cependant être doté d’un porte-parole, qui agit
et parle « en son nom » et qui, dès lors, peut aussi détourner le pouvoir conféré par cette
délégation à son seul profit.
3 C’est à expliquer deux concepts fondamentaux de sa théorie que P. Bourdieu consacre la
deuxième année de son enseignement, l’habitus et le champ, et à essayer d’en proposer
des « définitions rigoureuses dans un effort d’axiomatisation », bien qu’il mette en garde
contre les définitions qui « masquent, sous la fausse rigidité des concepts, le flou, la
stérilité » (p. 232) et qui « font croire que le problème est résolu » (p. 224), alors qu’il ne
l’est pas. Comme le remarque Jean-Louis Fabiani, « c’est dans la réitération obsessionnelle
d’un vocabulaire qu’une personnalité conceptuelle se construit3 ».
4 L’habitus, « c’est l’inertie de toutes les expériences passées qu’il y a dans le corps
biologique de chacun de nous » (p. 226). Quant au champ, qui aurait dû faire l’objet d’un
ouvrage resté inachevé (Microcosmes), P. Bourdieu distingue le champ de forces, en tant
qu’« espace de positions déterminant des conduites », et le champ de luttes, « destinées à
transformer ou à conserver le champ de forces » (p. 568). Expliquant la manière dont il a
forgé son concept de « champ », le sociologue avoue qu’il en avait fait un emploi
« erroné » pour la première fois, en 1964-19654, comme espace d’interactions, et raconte
comment il est arrivé au champ comme espace structuré, à partir d’une confrontation
entre la traduction anglaise par Talcott Parsons du texte sur la « Sociologie de la
religion » de Max Weber et la version originale (pp. 541-542). Pourtant, il inscrit
finalement sa conception du « champ » dans une filiation avec Karl Marx (« je voudrais ici
citer un texte de Marx à qui je pourrais attribuer la paternité de l’usage scientifique de la
notion de champ », pp. 548-549).
5 Dès lors, le problème central de la sociologie est l’articulation entre l’habitus et le champ,
entre l’agent, doté d’un corps, d’une volonté, de dispositions, et la structure dans laquelle
il est positionné. Et ce problème n’est pas seulement théorique mais aussi pratique,
puisqu’il s’agit d’agencer « d’une part, des matériaux statistiques sur les grands nombres
et, d’autre part, des données associées aux individus », P. Bourdieu citant, comme
exemple de ce type de travail à l’échelle individuelle, « le travail de Boltanski sur le
journal d’Amiel5 qui, à [ses] yeux, est typiquement sociologique mais qui n’entre pas dans
la définition ordinaire de la sociologie » (p. 211).
Pierre Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1. Cours au Collège de France 19...
Sociologie , Comptes rendus | 2010
3

6 La seconde question – qu’est-ce qu’être un sociologue ? – parcourt l’ensemble du cours,
jusqu’à faire même l’objet d’une séance complète, le 23 janvier 1982 (pp. 415-449), au
cours de laquelle le sociologue se livre à une sociologie de la sociologie, « la moins
littéraire des disciplines littéraires et la moins scientifique des disciplines scientifiques »
(pp. 433).
7 Être sociologue, c’est tout d’abord, étudier avec une même théorie, à la fois élaborée au
fur et à mesure, mise à l’épreuve et confirmée, une grande variété de domaines, allant de
la haute couture à l’Église catholique, en passant par l’enseignement, l’art ou le droit.
Ensuite, P. Bourdieu interroge constamment la sociologie en s’appuyant sur d’autres
disciplines, au premier rang desquelles la philosophie, ainsi que la linguistique, l’histoire
et dans une moindre mesure, l’économie. Les dix auteurs les plus cités par p. Bourdieu
pendant son cours sont tous européens, dont seulement quatre français (Durkheim,
Sartre, Flaubert, Lévi-Strauss), et ne comporte que trois sociologues (Weber, Marx,
Durkheim), et un anthropologue (Lévi-Strauss, donc)6, mais cinq philosophes : Hegel,
Husserl, Sartre, Heidegger et Leibniz.
8 C’est dire que P. Bourdieu donne, dans sa pratique de la sociologie, une grande
importance à la philosophie, principalement celle de langue allemande (Hegel, Husserl,
Heidegger et Leibniz), et dans une moindre mesure aux philosophes du langage
(Wittgenstein et Austin), la philosophie française, à travers la figure de Jean-Paul Sartre,
étant d’ailleurs moquée (notamment à propos de son analyse du garçon de café dans L’Être
et le Néant7 : « Sartre est tout à fait exemplaire, et admirable en même temps, parce qu’il a
une sorte de puissance logique qui fait qu’il pousse, à mes yeux, des erreurs jusqu’au bout
de leur logique », p. 267).
9 On a pu considérer qu’il existait trois sortes de rapports entre la philosophie et la
sociologie, soit que les disciplines étaient distinctes et sans relation, soit qu’elles auraient
des objets communs et des discours unifiés, soit que la sociologie devrait être conçue
comme un dépassement de la philosophie. Toutefois, une telle conception apparaît
simpliste au regard des rapports complexes que P. Bourdieu propose de nouer entre les
deux disciplines. Tout d’abord, il considère qu’il faut reprendre le mode de
questionnement philosophique pour en faire un questionnement sociologique : « pour
penser adéquatement le monde social, il faut lui appliquer ces modes de pensée que l’on
réserve aux plus hauts objets de pensée, ceux de la métaphysique. […] En termes simples,
il faudrait […] penser le monde social avec Heidegger, poser à propos du monde social des
questions du type : qu’est-ce que penser ? Qu’est-ce qu’exister pour une chose sociale ? »
(p. 217). Cependant, met en garde P. Bourdieu, il ne faut pas reprendre ce mode de
questionnement philosophique en l’appliquant à la sociologie comme discipline, ce qui ne
peut qu’être stérile (p. 264)8. Il faut donc utiliser la philosophie comme une aide, afin
d’assister la sociologie (« dans le travail de réflexion qu’il faut faire pour essayer de
comprendre la logique de la connaissance pratique, la principale assistance théorique est
fournie évidemment par la phénoménologie, par la tradition de Husserl, de Merleau-
Ponty et d’Alfred Schütz […] », p. 286). Toutefois, ce faisant, le sociologue ne doit pas
tomber non plus dans les erreurs que commet la philosophie, et en particulier l’erreur
intellectualiste, qui constitue le rapport entre le philosophe et le monde social comme
vérité du « rapport pratique entre les agents sociaux et le monde social » (p. 267), comme
s’y livre J.-P. Sartre à propos de son analyse, déjà mentionnée, du garçon de café. Si un
sociologue doit éviter ce genre d’erreur, c’est parce qu’« une propriété d’une position est
qu’on ne peut pas être où l’on est et être ailleurs […]. Je ne peux pas “me mettre à la
Pierre Bourdieu, Sociologie générale. Volume 1. Cours au Collège de France 19...
Sociologie , Comptes rendus | 2010
4
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%