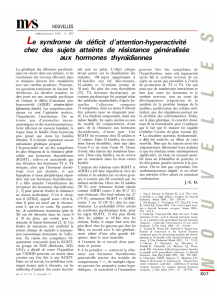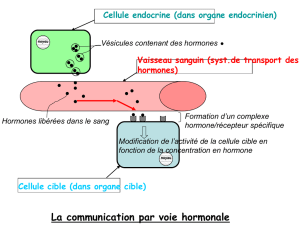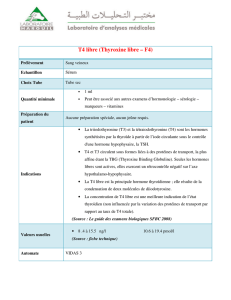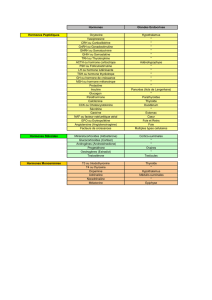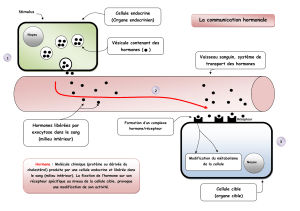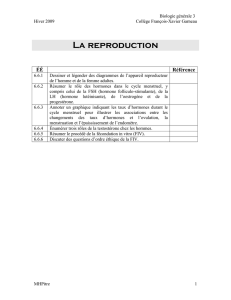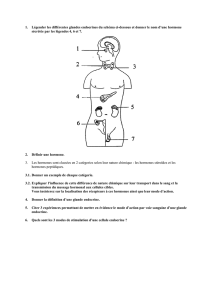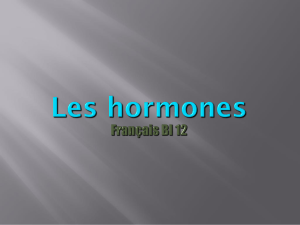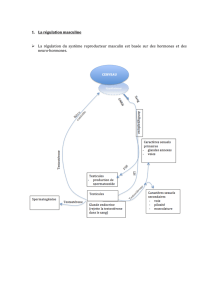Les récepteurs des hormones thyroïdiennes : implications

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002
L
a découverte des récepteurs des hormones
thyroïdiennes (TR) sous la forme de sites
de liaison spécifiques des hormones thyroï-
diennes (HT) dans le foie et le rein date de
1972 (1). Leurs gènes ont été identifiés en
1986 (2, 3). Depuis, les TR ont été impliqués
comme des acteurs essentiels de la voie
d’action des HT, médiateurs obligatoires du
contrôle qu’elles exercent sur la transcrip-
tion de leurs gènes cibles. En 1989, la carac-
térisation d’anomalies dans la séquence de
l’un des gènes codant les TR dans le syndrome
de résistance aux HT (4) a encore renforcé
l’intérêt que l’on pouvait leur porter. Les
avancées techniques permises par la mise au
point de modèles murins d’inactivation
(knock-out) ou de surexpression génique
(transgenèse) ont rendu ensuite possible
l’identification des spécificités fonctionnelles
des différentes isoformes de TR (5). Les
études actuelles affinent l’ensemble de ces
données et explorent un nouveau champ
d’application des TR en pathologie : la car-
cinogenèse humaine. Le but de cette revue
est d’exposer les notions actualisées sur le
rôle des TR en physiologie et pathologie thy-
roïdiennes.
Les récepteurs des hormones
thyroïdiennes : des facteurs
transcriptionnels inductibles
par la triiodothyronine (T3)
Les gènes des récepteurs
des hormones thyroïdiennes
Il existe deux types de récepteurs des hor-
mones thyroïdiennes codés par des gènes
distincts mais de grande homologie : les
gènes TR
α
(ou c-erbA
α
) et TR
β
(c-erbA
β
).
Localisés respectivement sur les chromo-
somes 17 et 3, ils produisent plusieurs
variants par épissage alternatif et/ou utilisa-
tion alternative de promoteurs (figure 1).
Au moins trois d’entre eux, TR
α
1,TR
β
1et
TR
β
2, sont des récepteurs fonctionnels de la
T3. Différent du TR
α
1par son extrémité C-
terminale (impliquée dans la liaison de la
T3), TR
α
2est incapable de fixer l’hormone
(6), mais conserve la capacité d’occuper les
101
Dossier : réceptologie
✎L’action des hormones thyroïdiennes est véhi-
culée par des récepteurs nucléaires spécifiques,
les récepteurs thyroïdiens (TR). Deux gènes
codent plusieurs isoformes de TR, dont certaines
ne sont pas des récepteurs fonctionnels et sont
considérées comme des agents modulateurs de
l’action des véritables TR.
✎Les TR se comportent comme des facteurs
transcriptionnels inductibles par le ligand : ils
contrôlent, positivement ou négativement, l’ex-
pression de leurs gènes cibles en présence ou
en l’absence de la triiodothyronine (T3). Pour
exercer cette activité transcriptionnelle, comme
les autres récepteurs nucléaires, les TR inter-
agissent avec de multiples cofacteurs nucléaires :
les corépresseurs, qui inhibent leur action en
l’absence de T3, et les coactivateurs, qui la
stimulent en sa présence.
✎Les hormones thyroïdiennes exercent des
actions en dehors du noyau. La T3 influence la
biologie mitochondriale en partie par l’inter-
médiaire d’un récepteur spécifique, la protéine
p43, présente dans la matrice mitochondriale
et correspondant à une forme tronquée codée
par le gène TRα. La protéine p43 se comporte
comme un facteur transcriptionnel inductible
par la T3 et contrôle ainsi l’expression de gènes
du génome mitochondrial. La T4 influence cer-
taines voies de transduction intracellulaire des
signaux en favorisant la phosphorylation
d’une kinase. Cette action serait relayée spéci-
fiquement par un récepteur membranaire qui
pourrait appartenir à la famille des récepteurs
couplés aux protéines G.
✎Les modèles murins d’inactivation génique
suggèrent que le rétrocontrôle exercé par les
hormones thyroïdiennes sur le complexe hypo-
thalamo-hypophysaire et leur action positive sur la
maturation auditive et rétinienne sont principa-
lement véhiculés par les produits du gène TRβ.
Les isoformes TRαsont plutôt impliquées dans le
maintien de la température corporelle, la matu-
ration intestinale, la maturation osseuse et le fonc-
tionnement musculaire (muscle strié et myocarde).
✎La résistance aux hormones thyroïdiennes
(RHT) est une affection héréditaire autosomique
dominante, spécifiquement liée à une anomalie
du gène TRβ. Elle est caractérisée par la présence
d’un goitre, de stigmates plus ou moins intenses
d’hypo- et d’hyperthyroïdie et par l’association
d’une hyperhormonémie thyroïdienne et de
taux normaux ou élevés de TSH.
✎Le métabolite actif de l’amiodarone, la
deséthylamiodarone, lie les TR et antagonise
l’action nucléaire de la T3 en inhibant la forma-
tion du complexe T3/TR ainsi que l’interaction
entre les TR et certains coactivateurs.
✎Plusieurs études ont impliqué des anomalies
d’expression ou de séquence des TR dans certains
cancers (sein, estomac, foie, thyroïde). On ne sait
pas, pour l’instant, si ces anomalies en constituent
une cause ou une conséquence et si elles s’ac-
compagnent d’une signification pronostique.
Plus déterminante semble la description de muta-
tions des récepteurs thyroïdiens, en particulier
de l’isoforme TRβ2, dans les adénomes hypo-
physaires thyréotropes, rendus de ce fait
insensibles à l’hyperhormonémie thyroïdienne.
* Clinique Marc-Linquette, service de médecine
interne et d’endocrinologie, CHRU de Lille.
Les récepteurs des hormones
thyroïdiennes : implications
en physiologie et pathologie
V. Vlaeminck-Guillem*, J.L. Wémeau*

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002
sites nucléotidiques en amont des gènes
cibles. Il se comporte ainsi comme un inhi-
biteur compétitif de l’activité transcription-
nelle de la T3. D’autres variants issus du
gène TR
α
ont été identifiés chez la souris :
TR
∆α
1et TR
∆α
2. Ils sont issus de l’utilisa-
tion d’un promoteur accessoire situé dans
l’intron 7 du gène. Ils correspondent respec-
tivement à des formes tronquées et non
fonctionnelles des isoformes TR
α
1et TR
α
2
(7). Les récepteurs TR
β
1, TR
β
2et TR
β
3
– cette dernière isoforme récemment identifiée
chez le rat (8) – diffèrent par leur extrémité
N-terminale. Le gène TR
β
code aussi une
isoforme tronquée de TR
β
3, TR
∆β
3,qui
n’est pas fonctionnelle et se comporterait
comme un antagoniste des véritables récep-
teurs des hormones thyroïdiennes (8).
Mode d’action des récepteurs
des hormones thyroïdiennes
Les récepteurs des hormones thyroïdiennes
appartiennent à la superfamille des récep-
teurs nucléaires, qui comprend également
les récepteurs des stéroïdes, de la vitamine
D ou encore de l’acide rétinoïque. Ces
récepteurs sont fonctionnels dans le noyau,
où ils lient leur ligand spécifique et contrô-
lent, ainsi liés, l’expression de gènes cibles.
Les récepteurs nucléaires ont en commun
une organisation en plusieurs domaines plus
ou moins conservés, notés, de l’extrémité
N-terminale vers l’extrémité C-terminale,
de A à F (figure 1). Ces domaines corres-
pondent à des propriétés fonctionnelles spé-
cifiques, comme la reconnaissance du
ligand portée par le domaine E/F C-terminal.
Ce domaine permet également aux récep-
teurs nucléaires de constituer des dimères,
forme habituelle de liaison à l’ADN. La
liaison à l’ADN est assurée par le domaine
C central, que les isoformes tronquées non
fonctionnelles, TR
∆α
1,TR
∆α
2et TR
∆β
3,
ne possèdent pas. Par le domaine de liaison
à l’ADN, les récepteurs nucléaires recon-
naissent des séquences nucléotidiques
spécifiques situées en amont des gènes : les
éléments de réponse à l’hormone. Le
domaine D constitue une charnière entre les
domaines C et E/F ; il participe à la fois à la
liaison du ligand et de l’ADN. Le domaine
A/B, quant à lui, module l’activité transcrip-
tionnelle du récepteur.
Les TR agissent habituellement sous la
forme de dimères TR/RXR, où les RXR
sont les récepteurs de l’acide rétinoïque
(figure 2). En l’absence de ligand, l’activité
transcriptionnelle intrinsèque des hétéro-
dimères TR/RXR est réprimée par le recru-
tement de cofacteurs nucléaires inhibiteurs :
les corépresseurs. La fixation des coré-
presseurs inhibe la transcription par l’asso-
ciation à un complexe enzymatique multi-
protéique dont le rôle principal est de
maintenir la chromatine de l’ADN dans une
conformation fermée et inadaptée à la fixa-
tion des composants de la machinerie trans-
criptionnelle de base (figure 2). La liaison
du ligand se fait dans une poche ménagée
à l’intérieur du domaine de liaison de
l’hormone. Elle induit un changement
conformationnel dans ce domaine, libérant
le corépresseur et permettant la fixation de
cofacteurs nucléaires activateurs : les
coactivateurs. Un nouveau complexe multi-
protéique fait alors le pont, par l’intermé-
diaire des coactivateurs, entre le dimère de
récepteurs et la machinerie transcriptionnelle
de base.
Les récepteurs thyroïdiens
extranucléaires
Quelques travaux ont montré que les hor-
mones thyroïdiennes pouvaient exercer de
nombreuses activités en dehors du noyau
(9). Il faut insister, par opposition aux effets
nucléaires, sur le fait que la T3 ne constitue
pas la seule hormone thyroïdienne active :
la T4 et même les autres métabolites iodés
produits par la glande thyroïde, comme les
formes reverses (rT3, rT4) ou acétiques
(acides triiodo- ou tetraiodo-acétiques :
Triac et Tetrac), sont actifs. La plupart de ces
activités résultent d’une action directe des
hormones thyroïdiennes sur des cibles pro-
téiques situées sur la membrane cellulaire
ou sur l’une des organelles intracellulaires
102
Dossier : réceptologie
Figure 1. Structure des isoformes protéiques issues des gènes TRααet TRββ.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002
(protéines du cytosquelette, canaux ioniques,
enzymes de la membrane cellulaire ou de la
membrane du réticulum endoplasmique,
etc.). Certaines de ces activités semblent
toutefois véhiculées par des récepteurs thyroï-
diens spécifiques. C’est le cas de certaines
actions des hormones thyroïdiennes sur la
mitochondrie ou sur les voies intracellu-
laires de transduction des signaux.
La transduction intracellulaire des signaux
véhiculés par les récepteurs membranaires
utilise des voies multiples caractérisées par
une cascade de phosphorylation : lorsqu’un
signal est intercepté par un récepteur mem-
branaire, des kinases sont activées et acti-
vent, successivement, par phosphorylation,
d’autres enzymes, qui à leur tour se com-
portent comme des kinases activatrices. À la
fin de la chaîne, un facteur transcriptionnel
nucléaire est activé et contrôle l’expression
de gènes cibles. Les hormones thyroïdiennes
influencent des voies de transduction intra-
cellulaire des signaux reçus par certains
récepteurs membranaires. Dans des cellules
en culture, la T4 mais aussi la rT3 potentia-
lisent ainsi la cascade de phosphorylation
qui accompagne la fixation de l’interféron γ
(IFNγ) sur son récepteur membranaire (10).
Cette action passe par l’activation, par phos-
phorylation, d’une kinase impliquée dans la
voie de transduction du signal IFNγ:la
MAPK (mitogen-activated protein kinase)
(11). L’action de la T4 est inhibée par le
traitement conjoint des cellules par la toxine
cholérique, qui interfère avec le fonctionne-
ment des récepteurs membranaires couplés
aux protéines G. Dans le modèle proposé, la
T4 reconnaîtrait un récepteur thyroïdien
membranaire spécifique, couplé à une pro-
téine G, et dont l’activation aboutirait à la
phosphorylation activatrice de la MAPK
(11). La voie IFNγn’est pas la seule
influencée par les hormones thyroïdiennes :
selon le même mécanisme, la T4 modulerait
d’autres voies de signalisation comme celles
qui aboutissent à la phosphorylation de la
protéine p53 (12) ou du récepteur TR
β
1(13).
La phosphorylation des récepteurs thyroï-
diens, en complément de la fixation de la T3,
est en effet nécessaire à leur pleine activité
transcriptionnelle et participerait au change-
ment conformationnel qui permet aux TR
de libérer le corépresseur et de lier le coacti-
vateur (14). La T4, en activant la MAPK,
favorise la phosphorylation de l’isoforme
TR
β
1et sa dissociation d’un corépresseur,
la protéine SMRT (13).
L’intervention des hormones thyroïdiennes
dans la biologie de la mitochondrie est bien
connue (15). Certaines actions sont extrê-
mement rapides et sous-entendent une
action directe des hormones thyroïdiennes
sur des cibles protéiques enzymatiques de la
membrane et de la matrice mitochondriales.
D’autres sont très lentes et impliquent la sti-
mulation, dans le noyau, de l’expression de
gènes codant des protéines qui seront finale-
ment et lentement acheminées vers la mito-
chondrie. Il existe aussi des actions intermé-
diaires qui consistent en la stimulation, par
les hormones thyroïdiennes, de l’expression
du génome mitochondrial. Ce type d’action
est véhiculé par au moins un récepteur thy-
roïdien spécifique de la mitochondrie, une
protéine de 43 kDa appelée la p43 (16). Cette
protéine est issue du gène TR
α
et correspond
à une forme tronquée de l’isoforme TR
α
1,
dépourvue du domaine A/B N-terminal. Sa
séquence exacte n’est pas connue. De même,
on ignore quels sont les mécanismes qui
permettent son expression à partir du gène
TR
α
(promoteur spécifique ?) et quelles
sont ses relations éventuelles avec les autres
isoformes, fonctionnelles ou non, produites
par ce gène. On sait toutefois qu’elle est
exprimée dans la matrice mitochondriale (et
103
Dossier : réceptologie
Figure 2. Mode d’action des récepteurs thyroïdiens. Les récepteurs thyroïdiens se lient sur l’ADN sous la forme
de dimères, leur partenaire de dimérisation habituel étant le récepteur RXR de l’acide rétinoïque. En l’absence
de ligand (A),le récepteur nucléaire recrute des corépresseurs (exemple : NcoR) et un complexe de protéines à
activité histone désacétylase (exemples : Sin3, HDAC) qui maintiennent la chromatine de l’ADN en conformation
fermée et inhibent la transcription des gènes cibles. En présence du ligand (B),le récepteur nucléaire recrute des
coactivateurs (exemples : SRC-1, CBP/p300, pCAF), dont certains possèdent une activité histone acétylase.
L’acétylation des histones (Ac) ouvre la chromatine et favorise la liaison des multiples facteurs de la machinerie
transcriptionnelle de base (exemples : TBP ou TATA binding protein,TAF ou TBP associated factors, RNA
polymérase II).

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002
accessoirement dans la membrane interne
de la mitochondrie) et que les isoformes
fonctionnelles des TR
α
et
β
n’y sont pas
présentes (17). Dans la matrice mitochon-
driale, la p43, capable de lier la T3, contrôle
spécifiquement l’expression de gènes mito-
chondriaux en liant, dans leurs séquences
régulatrices, des séquences d’ADN simi-
laires aux éléments de réponse à la T3 des
gènes du génome nucléaire (16, 17). Le rôle
propre de la p43 in vivo n’a pas été abordé
dans les différents modèles murins qui ont
étudié les spécificités fonctionnelles des iso-
formes de TR nucléaires.
Spécificités fonctionnelles
des isoformes de TR : l’apport
des modèles murins
Expression des isoformes de TR
Les trois isoformes fonctionnelles des TR,
TR
α
1, TR
β
1et TR
β
2, présentent de nom-
breuses homologies structurales, et les études
réalisées in vitro n’ont pas montré de diffé-
rences marquantes entre elles. Leur conser-
vation phylogénétique suggère cependant
que chacune exerce un rôle qui ne peut être
tenu avec la même efficacité ou spécificité
par les autres. Le premier élément de dis-
tinction (tableau I) concerne les spécificités
d’expression tissulaire (18, 19). L’isoforme
TR
α
1est exprimée de façon ubiquitaire,
comme l’isoforme non fonctionnelle TR
α
2,
et paraît prédominante dans le cerveau fœtal
et adulte, le foie fœtal, le muscle strié, le
myocarde et l’intestin. Les isoformes tron-
quées TR
∆α
1et TR
∆α
2ont une expression
restreinte au cerveau, aux poumons et à l’in-
testin (7). L’isoforme TR
β
1est ubiquitaire,
d’expression plus modérée dans le cerveau
fœtal et adulte, le muscle strié, le myocarde
et l’intestin, et prédominante dans le foie
adulte et l’os. Chez le rat, l’expression de
TR
β
2est restreinte au cerveau : hypophyse,
neurorétine et noyaux de substance grise
impliqués dans l’audition. De même, le
récepteur TR
β
3de rat est exprimé majoritai-
rement dans le rein, le foie et le poumon (8).
Son isoforme tronquée, TR
∆β
3,a été clonée
dans le poumon et la rate (8).
Les modèles murins
d’inactivation des TR
En fait, ce sont surtout les modèles murins
d’inactivation génique qui ont apporté des
renseignements précieux sur la spécificité
fonctionnelle des isoformes de TR (5). Plu-
sieurs équipes ont en effet réalisé chez la
souris l’inactivation par recombinaison
homologue d’un ou de plusieurs des gènes
codant les récepteurs thyroïdiens. Chacune
des actions des hormones thyroïdiennes a
ainsi fait l’objet d’études spécifiques
(tableau II). Par exemple, le rétrocontrôle
qu’elles exercent sur le complexe hypotha-
lamo-hypophysaire est maintenant bien
expliqué. Les souris dépourvues de récep-
teurs TR
β
présentent des taux élevés de
TSH (20). Cette anomalie persiste lorsque
le seul récepteur TR
β
2a été inactivé (21),
suggérant que l’inhibition de la TSH par
les hormones thyroïdiennes utilise essen-
tiellement les produits du gène TR
ββ
,et en
particulier l’isoforme TR
ββ
2.Les produits
du gène TR
α
,surtout l’isoforme TR
α
2, pour-
raient également intervenir, en contrecarrant
l’action répressive véhiculée par le couple
T3/TR
β
2. La sécrétion accrue de TRH chez
les souris dépourvues du récepteur TR
β
2
suggère que le rétrocontrôle exercé par
les hormones thyroïdiennes sur l’hypo-
thalamus utilise également cette isoforme
(22).
Les autres actions des hormones thyroï-
diennes sur le cerveau sont moins claire-
ment définies, puisque les souris dépourvues
des récepteurs TR
α
et/ou TR
β
n’ont pas de
malformation évidente du système nerveux
central ni même d’anomalie du comporte-
ment. Elles présentent, par contre, des déficits
sensoriels. Si les souris dépourvues de
104
Dossier : réceptologie
Isoformes Expression tissulaire
TRαα1Expression ubiquitaire et similaire des deux isoformes. En particulier :
et – expression diffuse et intense dans le cerveau fœtal et adulte
TRαα2– expression cochléaire et vestibulaire dans l’oreille interne
– prédominance dans le foie fœtal
– prédominance dans le muscle strié, le myocarde et l’intestin
– expression moindre dans le tissu osseux
TR∆∆αα1Expression restreinte :
et – poumon
TR∆∆αα2– intestin
– cerveau
TRββ1Expression ubiquitaire. En particulier :
– expression diffuse et modérée dans le cerveau fœtal et adulte
– expression restreinte à la cochlée dans l’oreille interne
– prédominance dans le foie adulte et l’os
– expression moindre dans le muscle strié, le myocarde et l’intestin
TRββ2Expression restreinte :
– expression dans le cerveau adulte restreinte à l’hypophyse
et aux noyaux impliqués dans l’audition
– prédominance dans la neurorétine
– expression moindre dans le muscle strié, le myocarde et l’intestin
TRββ3Expression majoritaire dans :
– le rein
– le foie
– les poumons
TR∆∆ββ3Identification dans :
– la rate
– les poumons
Tableau I. Expression tissulaire des isoformes des récepteurs thyroïdiens chez les rongeurs.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 3, mai-juin 2002
récepteurs TR
α
n’ont pas d’anomalie auditive,
les souris sans récepteurs TR
β
présentent
une surdité (23). Les souris dépourvues du
seul récepteur TR
β
2n’ont pas cette anomalie
(21),suggérant que l’isoforme TR
ββ
1 joue
un rôle primordial dans la maturation
auditive. Les souris sans récepteur TR
β
2 pré-
sentent des dysfonctionnements de la vision
des couleurs, en rapport avec une anomalie
de différenciation de certains cônes réti-
niens (24).L’isoforme TR
ββ
2intervient
plutôt dans la maturation rétinienne.
Les produits du gène TR
α
,quant à eux,
semblent plutôt impliqués dans le main-
tien de la température corporelle, la
maturation intestinale, la maturation
osseuse et le fonctionnement musculaire
(muscle strié et myocarde) (tableau II).
Dans tous ces processus, le récepteur TR
α
1
joue un rôle primordial, mais les isoformes
non fonctionnelles TR
α
2, TR
∆α
1et TR
∆α
2
semblent également intervenir en modulant
l’action de TR
α
1dans un sens positif ou, le
plus souvent, négatif (25). Le modèle de la
maturation intestinale paraît le plus perti-
nent pour montrer ces interactions (25, 26).
Les souris sans récepteur TR
β
2ne présen-
tent pas d’anomalie digestive (20),alors que
les souris qui n’expriment pas les isoformes
TR
α
1et TR
α
2, mais qui expriment encore
leurs isoformes tronquées (TR
∆α
1et TR
∆α
2),
ont un retard de maturation intestinale (27).
Cette anomalie disparaît si l’on supprime
l’expression des isoformes tronquées TR
∆α
1
et TR
∆α
2(26). Ces isoformes antagonisent
donc l’effet positif de TR
α
1sur la matura-
tion intestinale. Cet effet antagoniste est
confirmé in vitro (28) et s’étend à d’autres
facteurs transcriptionnels que le TR
α
1:
TR
∆α
1 et TR
∆α
2inhibent aussi des voies
de différenciation intestinale indépendantes
des hormones thyroïdiennes (26). Si elle
n’est pas prouvée à l’heure actuelle, l’inter-
vention des isoformes non fonctionnelles
produites par le gène TR
α
dans d’autres
voies d’action des hormones thyroïdiennes
est fortement suspectée (29),par exemple
dans la maturation osseuse (25).
Les anomalies innées des récep-
teurs thyroïdiens : la résistance
aux hormones thyroïdiennes
Définition et classification
des états de résistance
aux hormones thyroïdiennes
De telles approches expérimentales sont
bien sûr impossibles chez l’homme.
L’importance des récepteurs thyroïdiens en
physiologie humaine est cependant souli-
gnée par un modèle pathologique particuliè-
rement pertinent : la résistance aux hor-
mones thyroïdiennes (RHT). Familiale, de
transmission habituellement autosomique
dominante, la RHT est en effet liée à une
anomalie du gène TR
β
. Elle est relativement
rare, avec environ 700 cas décrits dans la
littérature internationale. Sa fréquence est
cependant probablement sous-estimée,
puisque la RHT peut être pauci- ou asymp-
tomatique et découverte de façon fortuite
sur un bilan biologique. Sa prévalence réelle
est évaluée à 1 pour 50 000 naissances
vivantes (30).
Classiquement, on distingue trois types de
RHT selon la présentation clinique et le
mécanisme physiopathologique sous-jacent
(tableau III) (31) :la résistance généralisée,
qui correspond à une insensibilité partielle
de l’ensemble des tissus périphériques, y
compris hypophysaire, à l’action de la T3 ;
la résistance hypophysaire, où seul le tissu
hypophysaire paraît résistant aux hormones
thyroïdiennes ; et la résistance périphé-
rique, où l’insensibilité hormonale est
restreinte aux tissus cibles périphériques,
l’hypophyse étant normalement régulée.
Cette classification tend toutefois à disparaître.
La résistance périphérique reste discutée :
un seul cas a été rapporté (32),l’étude de la
sensibilité tissulaire aux hormones thyroï-
105
Dossier : réceptologie
Situation Résistance Résistance Résistance
normale généralisée à prédominance périphérique
hypophysaire
Thyroïde normale goitre goitre normale
État métabolique euthyroïdie euthyroïdie hypermétabolisme hypométabolisme
Hormonémie thyroïdienne normale augmentée augmentée normale
TSH normale normale ou augmentée normale ou augmentée normale
Tableau III. Classification des états de résistance aux hormones thyroïdiennes.
Action des hormones thyroïdiennes Isoforme(s) majoritairement impliquée(s)
Rétrocontrôle sur la sécrétion hypophysaire de TSH TRβ2 (rôle de TRα2?)
Rétrocontrôle sur la sécrétion hypothalamique de TRH TRβ2
Maturation auditive TRβ1
Maturation rétinienne TRβ2
Température corporelle TRα1 (rôle de TRα2?)
Maturation intestinale TRα1 (rôle positif)
TR∆α1 et TR∆α2 (rôle négatif)
TRβ(rôle positif dans l’iléon)
Maturation osseuse TRα1
(rôle des isoformes non fonctionnelles de TRα?)
Muscle cardiaque et strié TRα1
Tableau II. Rôle des isoformes des récepteurs des hormones thyroïdiennes dans la médiation des actions
de ces hormones chez la souris.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%