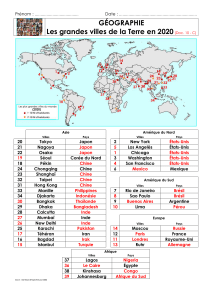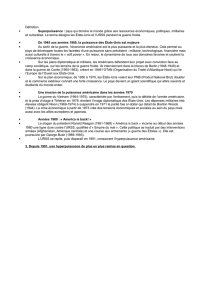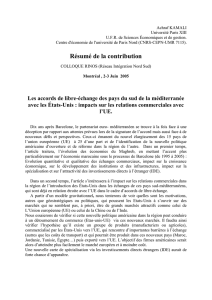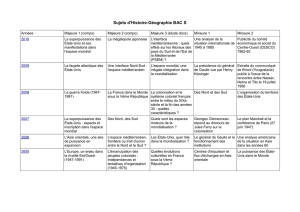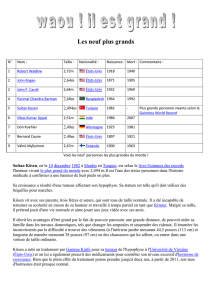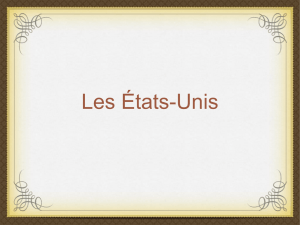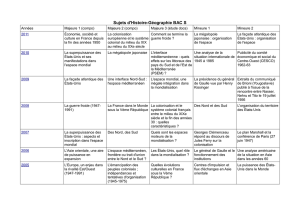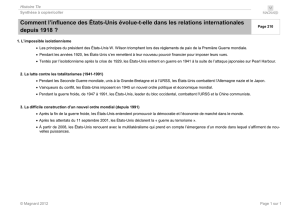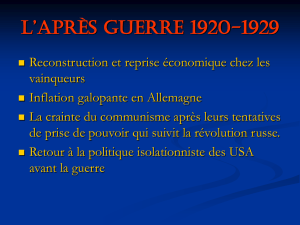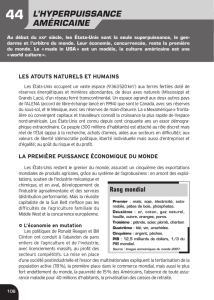cours - les etats-unis et le monde depuis les 14 points du president

1
En 1823, le président Monroe définit sa doctrine, « l’Amérique aux Américains » : les États-
Unis orientent leur politique étrangère sur les États latino-américains, délaissant le reste de la
planète. Cette diplomatie dure jusqu’au milieu du XX
ème
siècle, à l’exception des deux
guerres mondiales, auxquelles les États-Unis sont contraints de participer. La Première Guerre
mondiale consacre les États-Unis au rang de première puissance mondiale et le président
Wilson, en janvier 1918, propose un programme en « Quatorze points » destiné à préparer la
paix : il cherche à faire jouer un rôle international aux États-Unis mais son projet échoue.
Avec la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sortent à nouveau de leur repli puis,
pendant la Guerre froide, ils deviennent une des deux superpuissances en concurrence pour
dominer le monde… Ce qu’ils parviennent à faire. En 1991, lorsque l’URSS disparaît, ils
s’ont plus de concurrent sérieux. Mais les contestations et les concurrences vis-à-vis du rôle
mondial des États-Unis ressurgissent à partir du début des années 2000.
Problématique : Comment les États-Unis, qui se coupent du monde entre 1920 et 1941,
parviennent-ils à devenir et à rester la première puissance mondiale jusqu’à nos jours ?
I. !"#$%&#'''('')!*''' *+,-,.,-,
/'#!## ! '0*!1''' & !'*! !2
Fidèles à leur tradition d’isolationnisme (politique étrangère promouvant une
intervention minimale dans les affaires du monde), les États-Unis restent en dehors de la
Première Guerre mondiale jusqu’en avril 1917. Wilson parvient à convaincre le
Congrès de voter l’entrée en guerre aux côtés de la Triple Entente (France, Royaume-
Uni, Russie), du fait de la « guerre sous-marine à outrance » (torpillage des navires par
l’Allemagne dans l’océan Atlantique) et d’une tentative allemande de convaincre le
Mexique d’entrer en guerre contre les États-Unis. Deux millions de soldats états-unien
sont envoyés pour se battre sur le sol français. L’entrée en guerre des États-Unis soulage
donc les alliés (car elle apporte des hommes et des armes en nombre) et permet
d’accélérer la victoire sur l’Allemagne en novembre 1918.
Doc. 1 page 194 : « Les Quatorze points du président Wilson »
Consigne : Identifiez le document puis analysez-le afin de montrer que les « Quatorze
points » du président Wilson contribuent à l’ouverture internationale des États-Unis.
Le 8 janvier 1918, le président démocrate Wilson présente un plan en « Quatorze
points » qui définit les grands principes de la paix à venir :
- les points 1 à 5 rappellent les grandes valeurs auxquels les États-Unis sont
attachés : une paix négociée publiquement, la liberté de navigation, la
réduction des armements et la fin des revendications coloniales européennes ;
- les points 8 à 13 dessinent la nouvelle carte de l’Europe après le conflit : la
libération de la France ; le rétablissement des frontières italiennes, l’autonomie
pour les minorités austro-hongroises, la création d’un État polonais ;
- le point 14 propose la création d’une organisation internationale chargée de
garantir l’intégrité territoriale de toutes les nations, donc de maintenir la paix :
il s’agira de la Société des Nations, créée en janvier 1920.
Wilson cherche donc à faire peser les États-Unis sur les affaires du monde (il a pour
objectif de protéger les intérêts des États-Unis). Mais il pratique le multilatéralisme
(relations internationales fondées sur la négociation, la coopération et le respect des
interlocuteurs) : en 1919, il est présent en France pour la négociation du traité de
Versailles, qu’il signe pour le compte des États-Unis.

2
3/!#*'#!&'#,-456'''7')'' *)!$'8
Doc. 3 page 195 : « Un pèlerin aborde l’Amérique »
Doc. 4 page 195 : « Les effets des lois des quotas »
Consigne : Confrontez les documents afin de montrer que les États-Unis se replient sur
eux-mêmes à partir du début des années 1920.
En 1920, les républicains, majoritaires au Congrès, refusent de ratifier le traité de
Versailles (ce qu’on voit sur la caricature avec les flèches que les « Republican
hostiles » tirent sur Wilson qui rentre d’Europe dans sa barque). Par conséquent, les
États-Unis n’adhèrent pas à la Société des nations qui vient juste d’être créée et les
élections présidentielles de 1920 mènent un républicain – Harding – au pouvoir. Il
rompt totalement avec la politique wilsonienne et revient à l’isolationnisme.
Le pays durcit les conditions d’entrée pour les immigrés : en 1920 et 1924, sont votées
les « lois des quotas » (lois fixant des plafonds à l’entrée des immigrés aux États-Unis).
Le nombre d’immigrés entrant aux États-Unis passe de 1,2 millions en 1913 à 400 000
en 1920 puis à 200 000 en 1930. Les quotas sont définis en fonction de la nationalité
d’origine, proportionnellement au nombre d’immigrés déjà présents sur le sol des États-
Unis en 1890. Ces quotas privilégient les WASP (pour « white anglo-saxon
protestants », c’est-à-dire les immigrés britanniques, allemands et scandinaves).
Cependant, les États-Unis ne se coupent pas totalement des relations internationales.
La « diplomatie du dollar » est mise en place par le président républicain Coolidge entre
1924 et 1929 : les États-Unis accordent des prêts publics et privés à l’Allemagne, qui
peut ainsi rembourser les réparations de guerre à la France, au Royaume-Uni et à la
Belgique. En contrepartie, ces trois États peuvent rembourser les dettes contractées aux
États-Unis pendant la guerre. Ceci permet d’apaiser les tensions internationales.
9/!#*'#!&'#,-:56'''7')''&)$'8
En octobre 1929, lorsqu’intervient le krach boursier à Wall Street et la crise
économique mondiale qui s’en suit, les États-Unis entrent dans une nouvelle phase de
repli, économique cette fois-ci. Les États-Unis rapatrient les capitaux qu’ils avaient
placés en Europe donc les Européens stoppent le remboursement des dettes de guerre.
D’autre part, le États-Unis renforcent leur protectionnisme (politique économique
menée par un État consistant à protéger ses producteurs contre la concurrence des
producteurs étrangers) en relevant leurs taxes douanières : en 1930, est votée la loi
Hawley-Smoot qui impose des taxes de 59% sur plus de 3200 biens susceptibles
d’entrer aux États-Unis ! En 1934, le président Roosevelt décide une dévaluation
(politique consistant à abaisser la valeur d’une monnaie par rapport à une monnaie de
référence) du dollar de 40% par rapport à l’or. Toutes ces mesures visent bien à protéger
l’économie nationale contre la concurrence étrangère et à stimuler les exportations.
Roosevelt ne peut empêcher le Congrès de voter les « lois de neutralité » (lois
interdisant aux banques et aux firmes états-uniennes la vente de tout produit ou de tout
prêt à des pays en guerre) en 1935, 1936 et 1937. Il ne parvient pas à convaincre son
opinion publique de sanctionner le Japon pour l’agression de la Chine en 1937 et il
refuse d’aider Paris et Londres face aux menaces hitlériennes. Après l’attaque de la
Pologne, en septembre 1939, il obtient du Congrès l’ajout de la clause « cash and
carry » (clause votée en novembre 1939 permettant à un État en guerre de se fournit
auprès des États-Unis à condition de payer la marchandise comptant et de la transporter
sur ses propres navires. Quand la Seconde Guerre mondiale débute en Asie et en
Europe, les États-Unis n’y prennent pas part, comme ils l’avaient fait en 1914.
⇒
⇒⇒
⇒ En 1918, Wilson espérait imposer une politique interventionniste mais
l’opposition et l’opinion publique s’y sont opposées. Les années 1920 et 1930 sont
celles de l’isolationnisme, largement renforcé par la crise économique.

3
II. !"#$!##)''7#;*''!!*+,-,,--,
/('*!''<'')!*'6*!7'*=#*!#)'
En mars 1941, le Congrès vote la loi prêt-bail, permettant aux États-Unis de vendre
des armes à des États sans entrer en guerre à leurs côtés. En août 1941, Roosevelt et
Churchill rédigent la « Charte de l’Atlantique », qui rappelle les principes du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, du renoncement aux conquêtes, de la collaboration
économique internationale… Ce texte s’inscrit donc dans l’héritage des « Quatorze
points » de Wilson. En décembre 1941, l’attaque de la base de Pearl Harbor par le Japon
contraint les États-Unis à entrer en guerre contre le Japon et ses alliés. Les États-Unis
deviennent l’« arsenal des démocraties » (expression désignant le fait que les États-Unis
fournissent des armes à tous les États en guerre contre l’Axe) et engagent 12 millions de
soldats (c’est l’État qui mobilise le plus grand nombre de soldats pendant la guerre).
Les États-Unis contribuent à la victoire sur l’Italie, sur l’Allemagne et sur le Japon. En
Europe de l’ouest, les soldats états-uniens sont accueillis comme des héros lorsqu’ils
libèrent les villes et les villages. Les États-Unis sont présents lors de la signature de la
capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945 et du Japon le 2 septembre 1945.
Au sortir de la guerre, les États-Unis reconstruisent le monde, conformément aux
principes de la « Charte de l’Atlantique ». La conférence de Bretton Woods (juillet
1944) refonde le système économique et financier international en faisant du dollar la
monnaie de référence (les États-Unis détiennent deux tiers des réserves mondiales
d’or) et en créant deux organisations internationales, la Banque mondiale et le Fond
monétaire international, deux basées à Washington. Les conférences de Yalta (février
1945) et de Potsdam (juillet-août 1945) définissent les principes de la reconstruction de
l’Europe. En juin 1945, la conférence de San Francisco crée l’ONU, basée à New York.
Face aux États européens dévastés, les États-Unis constituent une superpuissance (pays
capable d’exercer une suprématie mondiale grâce à son rayonnement dans tous les
domaines) capable d’imposer ses vues à presque tous les États de la planète.
3/'#!##6''#'2# ' ##!'#'*!<''7'
Doc. 2 page 201 : « Les alliés des États-Unis dans une monde divisé »
Doc. 1 page 223 : « La doctrine Truman, 1947 »
Consigne : Confrontez les documents afin de tracer un schéma cartographique montrant
par quels moyens les États-Unis soudent leur bloc afin de lutter contre le communisme.
Point méthode : Construire et intégrer un schéma cartographique dans une
composition d’histoire, c’est :
- analyser la consigne pour comprendre ce qu’on attend de vous : ici, mettre en
évidence les moyens par lesquels les États-Unis dominent leur bloc afin de
lutter contre le communisme (il faudra donc cartographier le communisme) ;
- lire les documents afin de lister les moyens mis en place par les États-Unis
afin de lutter contre le communisme : des alliances diplomatiques et militaires ;
des aides financières ; la diffusion de leur modèle auprès de leurs alliés ;
- affecter un figuré et une couleur pour chaque élément à cartographier ;
- rédiger une phrase annonçant le contenu du schéma qui suivra ;
- schématiser les continents avec des formes géométriques simples ;
- dessiner le schéma en suivant cet ordre : d’abord, les figurés zonaux puis, les
figurés ponctuels et enfin, les figurés linéaires
- achever le schéma avec la nomenclature (en respectant bien les règles déjà
vues en cours : minuscules/majuscules ; bleu/noir) ;
- tracer la légende sous le schéma et lui donner un titre explicite (veillez à ce
que la légende, le schéma et le titre soient sur la même page).

4
Les États-Unis soudent leur bloc pour lutter contre le communisme
ÉTATS-UNIS
URSS
URSS
CUBA
VIETNAM
AUSTRALIE
CHINE
1
JAPON
1 CORÉE
OCÉAN
PACIFIQUE
OCÉAN
ATLANTIQUE
OCÉAN
INDIEN
OCÉAN
INDIEN
CANADA
Un modèle états-unien à diffuser contre le modèle soviétique
Les États-Unis : démocratie, capitalisme et société de consommation
Diffusion du modèle états-unien notamment par le cinéma hollywoodien
L’URSS : totalitarisme communiste, économie collectivisée et planifiée
États communistes alliés à l’URSS
« Containment » : politique d’endiguement de l’extension communiste
Principales interventions militaires états-uniennes pendant la Guerre froide
Des alliances pour souder le bloc et lutter contre le communisme
Organisation des États américains (1948)
Organisation du traité de l’Atlantique nord (1949)
ANZUS (1951)
Organisation du traité de l’Asie du sud-est (1954)
Pacte de Bagdad (1955)
Autres États ayant conclu une alliance avec les États-Unis
Des aides économiques pour reconstruire certains États après la guerre
Plan Marshall (1947) pour la reconstruction des États d’Europe de l’ouest
Plan Dodge (1949) pour la reconstruction du Japon
9/' ##!''#&'$#(!$''*!<''7'
Dans les années 1970, les États-Unis voient leur superpuissance affaiblie :
- le prestige international des États-Unis est écorné par leur défaite contre les
communistes au Vietnam en 1973, par le soutien qu’ils apportent aux dictatures
militaires en Amérique latine (au Chili, en 1973, la CIA soutient le coup d’état
du général Pinochet pour renverser le président socialiste Allende) et par le
scandale du Watergate (affaire d’espionnage du siège du parti démocrate sur
les ordres du président républicain Nixon, qui est contraint de démissionner);
- les États-Unis sont confrontés à des concurrents de plus en plus sévères. Alors
qu’ils sont frappés par la crise économique à partir de fin 1973, comme le reste
de l’occident, le Japon – seconde puissance économique mondiale – résiste
bien. De plus, l’URSS profite de la faiblesse états-unienne pour relancer des
opérations militaires (en 1977, l’URSS pointe des missiles balistiques
nucléaires sur l’Europe de l’ouest et en 1979, elle envahit l’Afghanistan).

5
En 1980, le républicain Reagan est élu président avec le slogan « America is back ». Il
compare l’URSS à l’ « Empire du Mal » et réplique aux provocations soviétiques de la
fin des années 1970. Il pointe des missiles balistiques nucléaires sur l’URSS depuis
l’Allemagne en 1984 et il soutient les guérillas anti-communistes en Afghanistan et au
Nicaragua. Les dépenses militaires états-uniennes passent de 4,8% du PIB en 1977 à
6,5% du PIB en 1987, entraînant l’URSS dans une véritable « course aux armements »
(expression désignant l’escalade aux armements dans les années 1980 entre les États-
Unis et l’URSS). Mais cette politique contribue à creuser le déficit budgétaire états-
unien (ils sont contraints, pour la première fois depuis 1917, d’emprunter sur les
marchés étrangers). Elle a aussi pour effet d’essouffler économiquement l’URSS qui,
sous l’accumulation des difficultés à la fin des années 1980 (accident nucléaire de
Tchernobyl en 1986, chute du mur de Berlin en 1989…) n’y résiste pas.
⇒
⇒⇒
⇒ En 1941, les États-Unis sont à nouveau contraints à entrer en guerre (alors que
l’opinion publique y était jusque là opposée) mais le pays assume désormais son
statut de superpuissance mondiale pendant le conflit et pendant la Guerre froide.
III. !"#' #=%" ' ##!''#&'' #,--,
/'&''')!)!*'#!#'#!#
Doc. 1 page 212 : « Le poids des États-Unis dans l’économie mondiale, 1992-2009 »
Doc. 4 page 213 : « Les leviers de la puissance américaine au début du XXI
ème
siècle »
Consigne : Confrontez les documents afin de montrer que les États-Unis sont dans une
situation d’hyperpuissance dans quasiment tous les domaines.
En 1991, avec la disparition de l’URSS, les États-Unis sont en position
d’hyperpuissance (État dont la puissance est sans rivale). Dans les années 1990, plus
aucun état n’est en mesure de les concurrencer. Cette hyperpuissance se manifeste au
plan diplomatique et militaire. Leurs dépenses militaires sont les plus élevées de la
planète et ils disposent de la deuxième armée qui compte le plus grand nombre de
soldats. Ils disposent également d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU
(c’est le cas depuis 1945), lui conférant le droit de veto (possibilité de bloquer une
décision au Conseil de sécurité de l’ONU sur simple opposition d’un des membres) et le
droit de posséder légalement l’arme nucléaire. Grâce à cela, ils interviennent
militairement à la tête de coalitions internationales qu’ils dominent totalement (Irak en
1990-1991, Bosnie en 1995, Kosovo en 1999). Les États-Unis disposent donc de tous
les outils du hard power (capacité d’un État à imposer ses vues par la force).
Mais les États-Unis disposent également d’outils du soft power (capacité d’un État à
diffuser son modèle à d’autres États en utilisant des moyens pacifiques) :
- le soft power se manifeste dans les domaines économiques et financiers. Dans
les années 1990, les États-Unis sont la première puissance économique
mondiale : ils ont le PIB le plus élevé de la planète et disposent de la
capitalisation boursière la plus importante au monde (ce qui leur permet
d’investir massivement à l’étranger). À cette période, leur principal concurrent,
le Japon, entre en récession (ralentissement de la croissance économique) ;
- le soft power se manifeste aussi dans le domaine culturel. Ils attirent du fait
de la croissance économique qu’ils ont retrouvée à ce moment-là
(l’immigration vers les États-Unis repart à la hausse ; ils accueillent le plus
grand nombre d’étudiants étrangers sur leur sol). D’autre part, le modèle
culturel états-unien – l’American way of life – se diffuse sur la planète,
notamment par les exportations de produits de consommation (baskets Nike,
logiciels Microsoft, ordinateurs Apple…) ou par la diffusion des médias états-
uniens (films hollywoodiens, musique, Internet…).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%