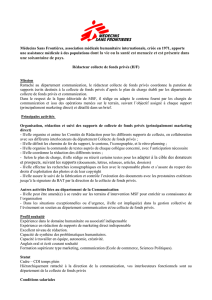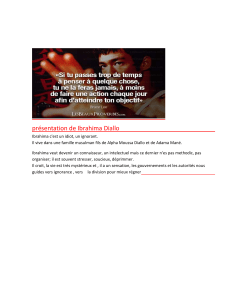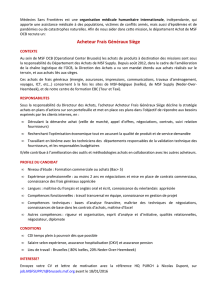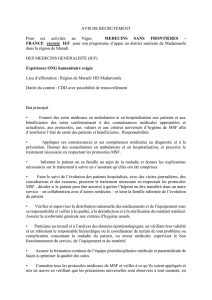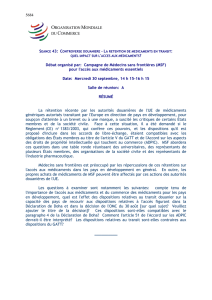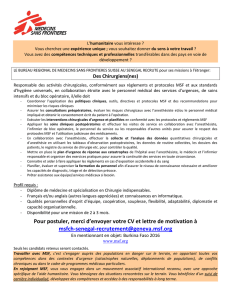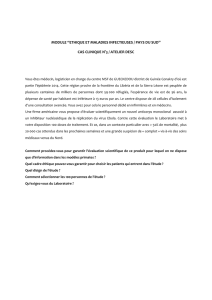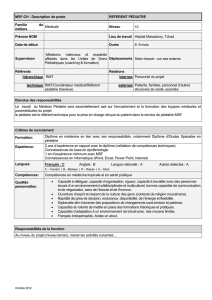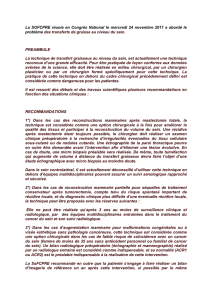La chirurgie en questions - Médecins Sans Frontières

Messages n° 144 - Dossier : La chirurgie en questions
Questions sur la chirurgie
Ce questionnaire a pour but de montrer les différentes tendances coexistantes à MSF
dans le domaine de la chirurgie. Nous l’avons divisé en quatre thèmes : nos
interventions, l’organisation et ses ressources, la qualité de nos pratiques et enfin
l’éthique. Cinq chirurgiens et une médecin ont bien voulu y participer :
- Jean-Paul Dixmeras, chirurgien français, consultant et vice-président du Conseil
d’administration de la section française de MSF.
- Pierre Gielis, chirurgien belge, consultant pour la section belge de MSF et Nathalie
Civet, médecin belge, coordinatrice chirurgie/anesthésie pour la section belge.
- Ibrahima Konate, chirurgien sénégalais, volontaire MSF depuis 2005.
- Stefan Krieger, chirurgien allemand, président de la section allemande de MSF.
- Khaled Menapal, chirurgien afghan, volontaire depuis 1992.
Sur nos interventions
- En chirurgie, quels sont pour vous les contextes qui correspondent le mieux à l’action
humanitaire ?
Khaled Menapal : La chirurgie qui correspond à l’action humanitaire, c’est d’abord la
chirurgie de guerre, avec la présence directe des équipes au plus près des victimes. J’y
ajouterais les contextes où on ne peut pas avoir accès aux victimes pour des raisons de
sécurité ou de confusion militaro-humanitaire : car malgré notre absence, on peut néanmoins
soutenir les structures existantes pour qu’elles restent fonctionnelles (Tchétchénie, Irak…).
Enfin, les contextes où les moyens locaux ne permettent pas de couvrir la chirurgie d’urgence
(y compris les cas d’urgence obstétricale) correspondent également pour moi à l’action
humanitaire.
Pierre Gielis et Nathalie Civet : Ces contextes sont ceux des urgences, des régions
dépourvues de tout accès aux soins, ou de tout accès libre aux soins, surtout en milieux
instables.
Stefan Krieger : Il s’agit pour moi des situations de guerre, d’après guerre, de toutes les
situations précaires, et des conflits chroniques.
Jean-Paul Dixmeras : Qu’elles soient d’ordre chirurgical ou autre, nos actions sont définies
par la Charte : « Les Médecins Sans Frontières apportent leurs secours aux populations en
détresse, aux victimes de catastrophes d’origines naturelles ou humaines, de situation de
belligérance… ». Nos missions chirurgicales actuelles rentrent dans ce cadre et peuvent être
classées selon les projets en : missions de chirurgie générale en milieu isolé ou dans le cadre
d’un hôpital général (en situation de conflit ou non), missions de réponse aux catastrophes
naturelles, centre de traumatologie, programme de reconstruction post-conflit. La charte
précise que les MSF « s’engagent à respecter les principes de déontologie de leur
profession ». Il en résulte que la bonne réponse à l’action humanitaire en chirurgie correspond
davantage à un niveau de savoir-faire – adapté à des exigences opérationnelles – qu’à un
contexte.

Ibrahima Konate : Les contextes qui répondent le mieux à l’action humanitaire sont les
situations de guerre, mais aussi les situations où les besoins en services urgents de santé ne
sont pas couverts.
- Au sein de MSF, la chirurgie doit-elle se limiter à des procédures « de base » orientées
sur le « life saving » et l’urgence ? Existe-il une place pour des programmes de chirurgie
programmée ou à haute technicité (chirurgie reconstructrice par exemple, comme en
Tchétchénie ou en Jordanie) ?
Khaled Menapal : Pourquoi ne pas faire de la chirurgie de haute technicité quand le contexte
le permet, et que cela correspond à une demande du terrain ? Il ne faut pas opposer ce type de
chirurgie à la chirurgie programmée, parce que d’après mon expérience en situation de guerre
ou d’urgence, il nous arrive d’avoir la chance de ne pas avoir de blessés de guerre à prendre
en charge : ce qui permet d’effectuer de la chirurgie froide ou programmée. J’ai aussi constaté
une mauvaise interprétation de la chirurgie d’urgence par l’équipe de coordination, qui ne
voulait pas pratiquer de la chirurgie non liée à la guerre. Je l’ai pratiquée quand même car
pour moi, l’essentiel était d’aider le plus grand nombre de malades (blessés de guerre ou pas)
toujours avec l’accord de l’équipe chirurgicale (anesthésiste, infirmier bloc opératoire).
Pierre Gielis et Nathalie Civet : Dans ses projets chirurgicaux et autres, MSF doit toujours
se souvenir que notre action n’est que temporaire et que quand nous partons, nous ne devons
pas laisser une organisation dont les responsables locaux ne pourront pas assurer la continuité.
Il existe de la chirurgie programmée, mais elle doit aussi être limitée en technicité. Elle doit
répondre à une incapacité physique, ou à une menace sur l’intégrité physique. Nous avons un
devoir de formation, et il faut commencer à former et à s’assurer de l’application des
standards minimaux de la chirurgie (hygiène générale, stérilisation et transfusion, nombre
suffisant et formation du personnel et post-opératoire de qualité) avant d’augmenter la
technicité. Cette technicité ne pourra être intégrée de manière qualitative qu’une fois les bases
connues. La chirurgie reconstructrice (fistules obstétricales, séquelles de brûlures, séquelles
de poliomyélite, chirurgie de la main, de la face, etc.) peut exister parallèlement à une activité
chirurgicale régulière, mais de manière ponctuelle et parfaitement organisée, avec une
formation préalable et la définition d’une stratégie adaptée au contexte.
Stefan Krieger : Bien sûr, il existe une place pour ces activités ! La chirurgie reconstructrice
en situation de guerre ou d’après guerre, la chirurgie des brûlures et d’ostéomyélites, ou
encore la chirurgie de la main (guerre / après guerre) sont des activités qui ont toute leur place
à MSF.
Jean-Paul Dixmeras : En apparence au moins, le « life-saving » et l’urgence semblent
s’imposer d’eux-mêmes. Pour autant, cette vision me paraît simpliste, insatisfaisante et
insuffisante : d’une part parce que l’urgence n’est pas toujours accessible (je pense par
exemple aux problèmes posés par l’Irak ou l’Afghanistan aujourd’hui, mais aussi aux
difficultés d’accès dans certaines catastrophes naturelles) ; d’autre part parce qu’on ne peut
pas considérer un travail terminé au prétexte d’une survie assurée. Indiscutablement, dans la
mesure du possible technique et matériel, la réparation doit être poursuivie. Par rapport à
certains programmes tels que la nutrition ou la prise en charge du sida, la chirurgie a
« l’avantage » de donner des résultats définitifs. Profitons-en ! Un patient verticalisé ne
redeviendra pas grabataire, une « gueule cassée » ne sera plus jamais une frayeur pour lui-
même et son entourage.

Non, la chirurgie au sein de MSF ne doit pas se limiter à des procédures de base. Il y a une
place pour la haute technicité, toujours dans le respect des principes déontologiques de la
profession.
Ibrahima Konate : Oui je pense que la chirurgie programmée a largement sa place dans le
contexte humanitaire. Le « life saving » a certes connu ses moments de gloire au début, mais
la chirurgie depuis une vingtaine d’années a bénéficié de nombreux progrès. Il est
actuellement injustifié de ne pas essayer d’en faire plus. Les techniques de guerre mobilisent
plus de moyens et de technologie ; il est donc normal que la médecine humanitaire se
modernise afin d’obtenir des résultats plus satisfaisants.
- Y a-t-il des spécialités chirurgicales que vous estimez aujourd’hui négligées par MSF,
ou dans lesquelles vous souhaiteriez voir MSF s’investir ? Quelles sont-elles et
pourquoi ?
Khaled Menapal : La volonté de MSF d’en faire plus au sujet des fistules vésico-vaginales
me semble une initiative très importante : il faut en faire plus, développer davantage
d’expertise et installer des centres régionaux servant de centres de référence pour les missions
et les patients des régions où nous sommes impliqués.
Pour autant, il s’agit moins de spécialités négligées sur nos missions, que d’un manque
d’instruments de base ou de facilités. J’ai souvenir de situations où n’existaient pas de
possibilité de transfusion, pas de radiologie, et parfois même pas d’autoclave. Il m’est aussi
arrivé de travailler avec une table d’opération qui ne me permettait pas de changer la position
du malade. Il y a donc un standard minimum à respecter pour envisager la pratique
chirurgicale.
Mais considérant que la spécialité essentielle de MSF est la chirurgie de guerre, le problème
est que nous ne sommes pas présents au cœur des contextes d’intervention des forces
américaines et de leurs alliés. Pour moi, MSF doit faire plus de démarches contre cette
inaccessibilité aux victimes de guerre.
Pierre Gielis et Nathalie Civet : Depuis des années, quelques-uns de la section belge tentent
de promouvoir la chirurgie des fistules d’origine obstétricale. On connaît le handicap
physique, social et psychologique, le nombre de cas également, le désintérêt des familles, des
cultures et des croyances locales vis-à-vis de ces femmes, rejetées et abandonnées. Cette
même idée peut s’appliquer à d’autres pathologies, d’autres handicaps physiques : bec de
lièvre, les séquelles de brûlures, les séquelles de poliomyélite. Mais il ne faut pas sous-estimer
le fait que de telles pathologies sous-entendent une prise en charge pluridisciplinaire.
Stefan Krieger : La chirurgie en traumatologie est négligée, on accepte trop vite des limites.
Quant à la chirurgie des fistules, il nous faut faire plus et mieux, surtout dans le domaine de la
formation.
Jean-Paul Dixmeras : Paris ne s’est pas fait en un jour ! Dans de nombreux domaines, MSF
a dû faire appel à ses capacités d’innovations. La chirurgie ne fait pas exception. Chaque
spécialité chirurgicale pose des problèmes spécifiques qu’il faut définir puis résoudre. La
prise en charge des fistules vésico-vaginales est un bon exemple : la « clientèle » existe, mais
les praticiens sont rares et les résultats incertains ou incomplets. Il faudrait aussi se pencher
sur le problème des brûlés et de leurs séquelles, éventuellement sur l’urologie, les cataractes.
La liste n’est pas limitative.

Ibrahima Konate : La chirurgie orthopédique est très largement négligée. Elle devrait être
plus élaborée, mais les indications chirurgicales doivent être cadrées. Dans les missions
basées dans de grands hôpitaux tels que Bouaké, on peut faire de l’ostéosynthèse du moins en
traumatologie. Il faut simplement améliorer l’environnement. Nous savons tous que le
bénéfice est net, surtout pour des sujets généralement jeunes. En revanche, la chirurgie
élaborée comme les arthroplasties n’a pas encore sa place.
L’organisation et ses ressources
- Les décisions d’ouverture et de fermeture de programmes chirurgicaux répondent-
elles à des critères opérationnels bien définis ? Ces décisions sont-elles suffisamment
concertées et coordonnées ?
Khaled Menapal : A mon avis, les décisions les plus problématiques concernent les
fermetures de projet, car même si les conditions et le contexte évoluent dans le bon sens, dès
que MSF quitte un programme chirurgical, celui-ci ne fonctionne plus correctement. De plus,
un hôpital soutenu par MSF devient très vite une structure de référence, alors que les autorités
ne sont pas toujours capables de maintenir les structures hospitalières au niveau fonctionnel,
après notre départ. Encore faut-il avoir conscience qu’on ne peut pas rester éternellement sur
un projet. Il nous appartient donc de mieux préparer le terrain pour envisager un départ
acceptable.
Pierre Gielis et Nathalie Civet : Non, notamment à cause d’une mauvaise définition
générale des objectifs opérationnels, et de l’analyse du contexte d’un programme. S’ensuit le
même défaut au niveau de la définition d’un programme chirurgical.
Stefan Krieger : Non, il nous faut des critères plus clairs, acceptés par tous les centres
opérationnels, car la coordination est insuffisante.
Jean-Paul Dixmeras : Les décisions d’ouverture et de fermeture sont du ressort du
département des opérations. Ces décisions répondent à l’analyse d’un contexte humanitaire et
des besoins formulés par les équipes de terrain. Ce processus n’est pas mécanique. Il est
difficile et parfois imparfait, mais la réflexion doit être rapide, d’autant plus que le temps est
compté dans l’urgence. Un arbre décisionnel plus complexe risque donc d’entraîner un
manque de réactivité préjudiciable à notre efficacité.
Ibrahima Konate : Il y a sûrement un travail à faire à ce niveau. Pour un praticien, une
fermeture de mission n’est jamais une décision facile à accepter. Pour les missions en cours,
auxquelles j’ai participé, les programmes mis en place me paraissaient en tout cas justifiés.
- La spécialisation croissante des chirurgiens est-elle un frein au déploiement des
activités chirurgicales dans nos contextes d’intervention ?
Khaled Menapal : Il est sûr qu’avec le phénomène d’hyperspécialisation, on ne dispose pas
de chirurgiens capables de prendre en charge un large domaine de pathologies. On rencontre
d’ailleurs ce même type de problèmes quand on travaille avec du matériel de base, sans les
instruments sophistiqués disponibles en Europe ou en occident. Ce sujet a été évoqué par un
représentant du CICR, lors de la journée chirurgicale organisée à Paris le 9 décembre dernier.
Dans un autre registre, on constate aussi de moins en moins de jeunes chirurgiens dans nos

missions, et la moyenne d’âge élevée des participants à cette journée chirurgicale en
témoigne. Nous sommes donc confrontés à deux problèmes : des chirurgiens hyperspécialisés
et une jeune génération peu engagée dans l’humanitaire : il faut en être conscient et trouver
des solutions dans l’avenir.
Pierre Gielis et Nathalie Civet : Elle risque de l’être pour plusieurs raisons. En résumé,
l’hyperspécialisation demande une technologie sophistiquée, inapplicable dans les contextes
dans lesquelles travaille la section belge. Les jeunes chirurgiens n’ayant plus acquis de
connaissance et surtout de pratiques chirurgicales générales, risquent d’être perturbés par cette
chirurgie du pauvre. Ils sont livrés à eux-mêmes pour établir le diagnostic, sans généralement
pouvoir le confirmer par des examens techniques complémentaires pratiqués dans les pays
économiquement riches.
Stefan Krieger : Je crois plutôt qu’il nous faut envisager la création d’un centre de formation
chirurgical à MSF. Ceci permettrait de standardiser et d’améliorer un certain nombre de nos
pratiques.
Jean-Paul Dixmeras : Non, la spécialisation croissante des chirurgiens n’est pas un frein au
déploiement d’activités chirurgicales dans nos contextes d’intervention, au contraire ! Les
qualités et les connaissances demandées au chirurgien exerçant dans un centre de chirurgie
générale en milieu isolé ne sont pas celles demandées au chirurgien exerçant dans un centre
de chirurgie réparatrice. Plus il y a de missions chirurgicales, plus les besoins sont variés. Plus
le « carnet d’adresses » est rempli, plus il est possible de proposer des postes adaptés aux
aptitudes de chacun.
Ibrahima Konate : Je crois personnellement que cette hyperspécialisation pourrait au
contraire donner une meilleure prise en charge et justifier à long terme les actions menées sur
le terrain. Cependant il faut au préalable que la politique de prise en charge de nos patients
soit clairement précisée, c'est-à-dire chercher à apporter des solutions optimales éthiquement,
scientifiquement, et économiquement acceptables. D’autre part, ne pas tenir compte du profil
du futur chirurgien sera un problème pour répondre aux besoins de nos missions à long terme.
Le système de formation continue pourrait être un très bon moyen de donner des
connaissances suffisantes pour une meilleure pratique sur le terrain.
- A propos de la notion de « main chirurgicale », diriez-vous que la pratique chirurgicale
est exclusivement l’affaire des chirurgiens diplômés ? En ce sens, doit-on former des
médecins généralistes à des pratiques chirurgicales ?
Khaled Menapal : Je suis réservé sur cette question, car il existe quand même des dangers
dès lors que des complications surviennent.
Pierre Gielis et Nathalie Civet : Au niveau de notre section, nous avons formé des médecins
en chirurgie d’urgence et de base, surtout gynécologique et obstétricale. Nous formons aussi
des chirurgiens et gynéco-obstétriciens aux techniques de réparation des fistules vaginales.
Cela dépend des contextes et des besoins locaux dans lesquels vous travaillez, des possibilités
professionnelles des médecins locaux, de leur qualité et motivation. Ce faisant, vous avez plus
de chance d’assurer une certaine continuité lors de la fermeture de la mission. Dans de
nombreux pays africains, notamment en RDC ou les pays de l’est africain anglophone, les
médecins généralistes reçoivent une formation basique en chirurgie élémentaire et gynéco-
obstétricale en particulier (Tropical Doctor). Le problème est d’évaluer leur compétence
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%