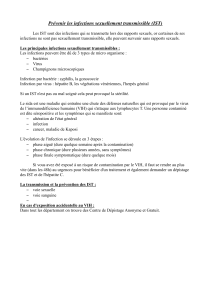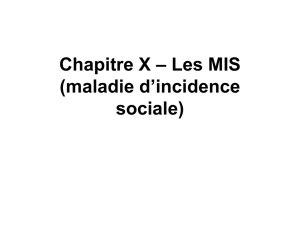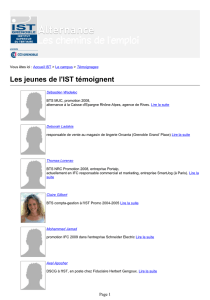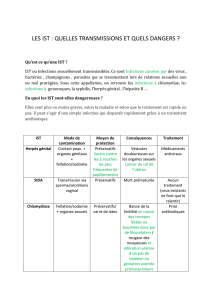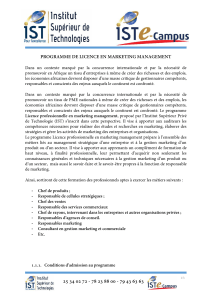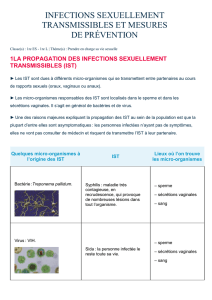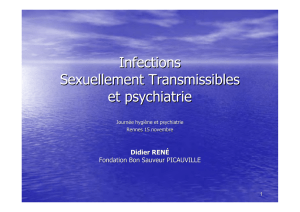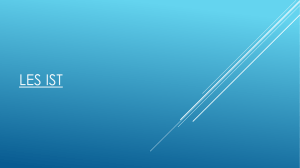Stratégie mondiale du secteur de la santé sur les infections

1
Introduction et contexte
Ce projet de stratégie mondiale du secteur de la santé sur les infections
sexuellement transmissibles, 2016-2021, a été élaboré en appui d’une série de
consultations multi-parties prenantes qui se tiendront de mars à
décembre 2015. Elle s’appuie sur l’évaluation de la Stratégie mondiale de
lutte contre les infections sexuellement transmissibles : 2006-2015, et sera
présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé en 2015. Ce rapport
recommande notamment :
de renforcer les mécanismes de financement des services relatifs aux
infections sexuellement transmissibles (IST), y compris le dépistage, si
nécessaire, et les capacités en termes de ressources humaines ;
d’élargir l’accès à ces services en intégrant la prévention et la prise en
charge des IST dans les plans d’action contre le VIH, dans les
programmes de santé génésique et dans d’autres dispositifs essentiels ;
de conseiller les pouvoirs publics sur les mécanismes permettant
d’étendre l’échelle des interventions, en particulier au profit des
populations vulnérables et des populations clés ;
de renforcer la surveillance et de mieux connaître la prévalence,
l’étiologie et la résistance aux antimicrobiens ;
d’accélérer l’accès aux innovations grâce au développement de tests
diagnostiques dans les lieux de soins et à de nouvelles interventions
préventives, par exemple des vaccins, des microbicides et la
promotion de la santé.
Ce projet de stratégie énonce une vision, un but et des actions pour le
secteur mondial de la santé et définit des cibles en vue d’élargir, de
renforcer et d’accélérer la riposte aux IST, conformément aux stratégies et
aux plans sanitaires mondiaux connexes, notamment pour la santé sexuelle
et génésique, la santé de la mère et du nouveau-né, le VIH, les maladies non
transmissibles, l’hépatite virale, la sécurité transfusionnelle et la tuberculose.
Ce projet de stratégie abrégé est disponible dans plusieurs langues, en appui
de la consultation en ligne. Il ne saurait constituer une version complète ou
Stratégie mondiale du secteur de la santé sur
les infections sexuellement transmissibles,
2016-2021
Version abrégée – 10 mars 2015

2
quasi définitive de la stratégie du secteur de la santé sur les IST pour 2016-
2021. Ce n’est qu’une base de discussion. Une version plus longue de ce
projet est également disponible en anglais.
Pourquoi le renforcement de la riposte face aux IST devrait être une priorité
mondiale
D’après les estimations préliminaires pour 2012, le nombre de nouveaux cas
pour quatre IST curables reste élevé parmi les 15-49 ans : Chlamydia
trachomatis (146 millions), Neisseria gonorrhoeae (51 millions), syphilis
(5 millions) et Trichomonas vaginalis (239 millions). Le taux de prévalence de
certaines IST virales est analogue, avec 417 millions de personnes infectées
par le virus Herpes simplex type 2 et environ 291 millions de femmes
contaminées par le papillomavirus humain.
Les infections dues à des agents pathogènes sexuellement transmissibles
compromettent la qualité de la vie, la santé sexuelle, génésique et de
l’enfant, mais elles ont aussi des effets indirects en facilitant la transmission du
VIH par voie sexuelle et via leur impact sur les économies nationales et
l’économie des ménages.
Les complications imputables aux IST pèsent fortement sur la santé sexuelle et
génésique, et elles touchent de manière disproportionnée les femmes,
surtout là où les ressources sont limitées. Non seulement certaines IST
provoquent une infection aiguë, mais elles accroissent considérablement le
risque d’acquisition du VIH. Ainsi, une infection par la syphilis pendant la
grossesse peut entraîner le décès du fœtus ou du nouveau-né ; la gonorrhée
et la chlamydiose sont des causes majeures d’infection génitale haute,
d’issue défavorable de la grossesse et de stérilité féminine, ainsi que de
mortinaissance, de mort du nouveau-né ou de malformations congénitales.
D’autres agents pathogènes sexuellement transmissibles, tels que le
papillomavirus humain (PVH) et le virus de l’hépatite B, sont responsables
d’un grand nombre de cancers du col et de cancers hépatiques,
respectivement. Les IST engendrent une dégradation de la santé sexuelle et
une stigmatisation, et elles peuvent être source de violences commises par le
partenaire. Des moyens de lutte et d’élimination appropriés permettront de
faire reculer la maladie et la souffrance.
Les opportunités de progrès sont nombreuses
Depuis la validation de la dernière stratégie, en 2006, la grande majorité des
pays ont révisé leurs politiques et leurs directives relatives aux IST, et adopté
l’approche syndromique recommandée pour la prise en charge de ces
infections. Cependant, à l’échelle mondiale, il n’y a guère eu de progrès
dans la réduction de la charge des IST au cours de la dernière décennie. On
constate un recul sensible de l’incidence d’Haemophilus ducreyi (chancre),
des taux de syphilis, des infections à gonocoques et de la conjonctivite
néonatale, un accroissement du dépistage de la syphilis chez les femmes

3
enceintes et un plus large accès à la vaccination contre le PVH. Ces
avancées permettraient d’organiser une riposte graduelle. Or, l’urgence
n’est plus à l’ordre du jour depuis quelques années. Par manque de volonté
politique et sous l’effet de la stigmatisation généralisée des problèmes de
santé sexuelle, les services de lutte contre les IST sont de plus en plus négligés,
surtout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En conséquence, on
tarde à leur allouer suffisamment de financements et de ressources
humaines.
Il existe pourtant des opportunités considérables de renforcer et de
développer ces services. De nouvelles méthodes et de nouveaux outils sont
disponibles pour étoffer et affiner les systèmes d’information stratégique sur
les IST. Des technologies et des interventions efficaces, qui ont fait leurs
preuves et d’un coût abordable, permettent de prévenir, de diagnostiquer
et de prendre en charge les IST. On peut élargir l’accès en intégrant la
prévention et la prise en charge des IST dans les services de soins de santé
primaires, de santé génésique et de lutte contre le VIH qui sont déjà en
place. Les pays peuvent exploiter le potentiel offert par les nouvelles
technologies et approches en les utilisant plus largement et stratégiquement.
Et ils peuvent accélérer les progrès en encourageant plus résolument les
innovations (nouveaux vaccins, microbicides et tests diagnostiques dans les
lieux de soins).
Une stratégie en phase avec les Objectifs de développement durable
La plupart des outils visant à atteindre les cibles d’ici 2030 sont disponibles, et
des innovations potentiellement fondamentales sont en vue. Cependant, si
l’on veut les utiliser pour produire un effet maximal, il faudra rapidement
investir davantage dans la riposte aux IST, concentrer les ressources sur les
programmes les plus efficaces, ainsi que sur les populations et les zones
géographiques qui en ont le plus besoin, et relier les interventions concernant
les IST à d’autres services de santé, pour un bénéfice mutuel. Les ressources
étant limitées, les pays devront planifier soigneusement leurs investissements
et les argumenter de manière irréfutable, afin de justifier l’allocation de
moyens internes et externes supplémentaires visant à atteindre les cibles. Ces
plans d’investissement doivent définir et chiffrer l’ensemble des interventions
et des services nécessaires d’après la situation du pays, déterminer
l’utilisation des ressources la plus stratégique, plaider en faveur des
interventions présentant le meilleur rapport coût-efficacité, indiquer la
répartition des ressources la plus appropriée entre les différents niveaux du
système de santé et repérer les sources de financement potentielles et
fiables. Une riposte qui mettrait fin à l’épidémie d’IST contribuerait très
largement à l’amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés, des
femmes et des hommes, de la santé sexuelle et de la lutte contre le VIH et,
par extension, à la réalisation des principaux Objectifs de développement
durable.

4
Structure de la stratégie
La stratégie mondiale du secteur de la santé sur les infections sexuellement
transmissibles 2016-2021 s’appuie sur les réalisations et sur les enseignements
des efforts antérieurs, et elle est en phase avec d’autres stratégies et plans
sanitaires mondiaux ou régionaux, notamment avec ceux portant sur le VIH,
la santé sexuelle et génésique, la santé de la mère et de l’enfant et les
maladies non transmissibles.
Les quatre orientations stratégiques sont les suivantes :
1. Des services et des interventions essentiels et de qualité
2. Impact et équité – quelles populations et où ?
3. L’innovation au service d’une accélération des interventions
4. Des financements pour des actions durables
Une section transversale est consacrée à l’instauration d’un environnement
propice à la prestation des services et à l’impact des actions. Elle évoque
l’information stratégique pour les actions de sensibilisation et l’investissement,
ainsi que le renforcement des systèmes, des partenariats et des liens. La
dernière section traite de la mise en œuvre de la stratégie.
La vision, le but, les cibles et les principes directeurs
La stratégie énonce une vision, un but et des actions pour le secteur mondial
de la santé, dont doivent bénéficier toutes les personnes exposées aux IST :
les enfants, les adolescents et les adultes, les populations riches et pauvres,
les femmes et les hommes, et toutes les populations clés.
La vision
Zéro nouvelle infection par les IST, zéro décès lié au sida et zéro discrimination
dans un monde où les personnes atteintes d’IST vivent longtemps et en
bonne santé.
Le but
Éliminer/enrayer les épidémies d’IST qui constituent un important problème
de santé publique, et veiller à la bonne santé et au bien-être des individus
atteints d’IST, quel que soit leur âge.
Les cibles mondiales pour 2030
Un effort concerté en vue de déployer à plus grande échelle des
interventions et des services efficaces peut permettre de réaliser l’objectif
d’élimination des IST en atteignant un ambitieux ensemble de cibles :

5
réduction de 90 % de l’incidence de T. pallidum (année de référence :
2015).
réduction de 90 % de l’incidence de N. gonorrhoea (année de
référence : 2015).
cas de syphilis congénitale ≤ 50 pour 100 000 naissances vivantes dans
100 % des pays.
Les jalons
Afin d’encourager et de mesurer les progrès en direction de ces cibles, Il est
proposé de poser les jalons suivants pour 2030 :
80 % des pays pratiquent le dépistage de la syphilis et du VIH chez 95 %
des femmes enceintes, moyennant un consentement libre, préalable et
éclairé.
85 % des populations clés ont accès à un éventail complet de services
de lutte contre les IST et le VIH, notamment à des préservatifs.
100 % des pays proposent des services de lutte contre les IST ou orientent
vers ces services dans toutes les structures de soins de santé primaires,
de planification familiale axée sur le VIH et de consultations prénatales.
80 % des pays vaccinent contre le PVH dans le cadre de leur
programme de vaccination national.
80 % des pays rendent compte de la résistance de N. gonorrhoea aux
antimicrobiens.
Les principes directeurs
Les principes suivants guident la stratégie :
1. Couverture sanitaire universelle
2. Tutelle des pouvoirs publics et responsabilisation.
3. Interventions, services et politiques reposant sur des données probantes.
4. Protection et promotion des droits fondamentaux, de l’égalité entre les
sexes et de l’équité en santé.
5. Partenariats, intégration et mise en relation avec les secteurs, les
programmes et les stratégies concernés.
6. Participation significative des personnes atteintes d’IST, des populations
clés et des communautés touchées.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%