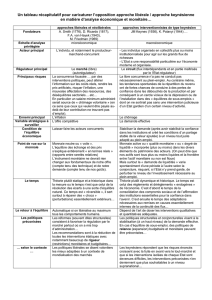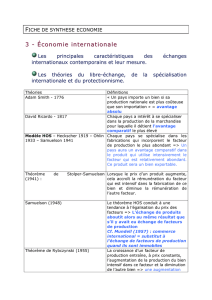Quel bilan tirer de lÕUEM europ_enne

Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
1
Quel bilan tirer de l’UEM européenne ?
Eléments de correction
Comment définir l’Union économique et monétaire ?
On peut définir l’UEM comme une étape dans une dynamique d’intégration qui concerne un certain
nombre de pays européens. On s’appuie ici sur la présentation faite par Bela Belassa pour qui il existe
des degrés d’intégration différents qui vont de la constitution d’une zone de libre échange à l’UEM :
- 1) la constitution d’une zone de libre échange ;
- 2) la réalisation d’une union douanière ;
- 3) la création d’un marché commun (la libre circulation concerne désormais les personnes et les
capitaux) ;
- 4) l’union économique (mise en place de règles communes qui permettent de faciliter les
circulations des biens, services, capitaux et personnes) ;
- 5) l’union économique et monétaire (qui s’accompagne de politiques économiques communes et
de l’intégration monétaire).
Attention, chaque nouvelle étape englobe la précédente et lui rajoute un nouvel élément.
Par exemple l’union douanière = zone de libre échange + tarif commun ;
Union économique = union douanière (libre circulation des biens) + libre circulation des services, des
personnes et des capitaux ; l’union économique aboutit donc au marché unique ;
Union économique et monétaire = union économique + les politiques communes qui découlent de la mise
en œuvre d’un espace sans frontière. Ces politiques communes portent sur plusieurs domaines,
notamment le domaine monétaire (système monétaire, monnaie commune ou monnaie unique).
Conclusion : à partir de la définition de Béla Belassa il est possible de définir ce qu’est une UEM : il
y a union économique et monétaire lorsque des pays choisissent de créer un marché commun, mettent un
œuvre des politiques communes et adoptent un système monétaire commun.
Cette présentation suit une logique particulière qui est la suivante : l’intégration est d’abord économique,
elle s’ouvre dans un premier temps aux échanges commerciaux, puis aux facteurs de production.
Ensuite, en raison de l’intégration de ces échanges, les Etats mettent en place des règles communes (ce
qui justifie par exemple une politique de la concurrence commune) afin d’harmoniser les conditions de
ces échanges.
Enfin, étant donné que les Etats deviennent économiquement de plus en plus intégrés, cela conduit à la
mise en œuvre de politiques économiques et monétaires communes (puisque les « problèmes » qui le
concernent sont désormais communs).
On constate donc que la dimension politique de l’intégration « politique » succède à l’intégration
« économique », ce qui reflète la logique que l’on retrouve dans la théorie du couronnement (c’est
l’intégration économique va conduire à l’intégration politique ; dit autrement, l’intégration politique
« couronne » l’intégration économique puis monétaire).
Si l’on cherche à appliquer cette présentation à l’histoire de la construction européenne, on constate deux
choses :
- il y a certains décalages historiques entre cette présentation et ce qui a été fait en Europe : par
exemple, la politique agricole commune se met en place avant même la réalisation de l’union
douanière (1968) ou de la politique européenne de la concurrence (années 1980).
- cependant, cette présentation respecte bien l’idée qui va prévaloir en Europe qui est celle d’une
intégration politique qui arrive a posteriori par rapport à l’intégration économique, parce que c’est
l’interdépendance croissante des économies européennes qui pousse à réfléchir à de nouveaux
cadres politiques et institutionnels pour faire fonctionner la coopération entre les différents Etats.
On se rappelle en effet que le projet d’intégration européen qui émerge après guerre est avant tout
un projet politique (pensez à la création du Conseil de l’Europe en 1947 ou au projet de CED)
mais que face aux difficultés à réaliser cette intégration politique, le choix sera fait d’utiliser une
« stratégie des petits pas » afin de construire peu à peu l’Europe à partir du plus petit
dénominateur commun, les échanges économiques.

Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
2
Il est possible de s’appuyer sur une autre définition de l’UEM, qui est plus « institutionnel ». En effet, on
appel cette terminologie apparaît dans l’accord qui vise la création d’une monnaie unique avant le 01
janvier 2002 et le transfert du pouvoir monétaire à la BCE. L’UEM se restreint donc à cette étape de la
construction européenne qui marque l’entrée dans la monnaie unique après la réalisation du marché
unique.
Il est bien sur indispensable de faire référence à cet événement dans la copie, mais je pense que la
définition de Belassa est beaucoup plus pertinente pour traiter du sujet. Elle permet notamment de se
projeter historiquement sur toute la dynamique de la construction européenne en se demandant quel bilan
il est possible de tirer de la réalisation du marché unique, du passage à la monnaie unique et de la mise en
œuvre de politiques économiques « européennes ».
Dans une première partie, nous tirons un bilan plutôt positif de la réalisation de l’UEM en Europe. Nous
chercherons à rappeler les objectifs de cette dynamique d’intégration, montrerons qu’un certain nombre
de ces objectifs ont été atteints ; nous montrerons aussi que l’Europe a su évoluer pour faire face à des
enjeux nouveaux.
Dans une seconde partie, nous tirons cette fois un bilan davantage critique de la réalisation de l’UEM.
L’intégration européenne n’est pas encore aboutie, et surtout, elle semble produire des effets pervers qui
remettent en cause sa viabilité. Nous nous demanderons alors quels peuvent être/devraient être les
nouveaux domaines de l’intégration européenne.
1. Le bilan positif de l’UEM : paix durable, croissance et rattrapage économique
1.1 Progresser dans l’intégration économique, monétaire et politique : les défis réussis de
l’approfondissement de l’UE
Le point de départ : rappeler qu’il existe bien avant le Traité de Rome (1957) l’idée que les nations
européennes doivent progresser vers une coopération de plus en plus étroite. On peut remonter jusqu’au
discours de V.Hugo lors de la Conférence de la Paix (1848). Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, cette idée d’une Europe unie refait surface.
Le premier défi qui est lancé à la construction européenne consiste alors à savoir quelle forme doit
prendre cette coopération : politique, militaire, monétaire, économique ?
Il faut donc faire ici plusieurs rappels historiques pour montrer que face aux difficultés de créer une
Europe politique, les « concepteurs » de l’intégration européenne, en particulier J.Monnet ou
R.Schuman vont axer la dynamique européenne d’abord sur les échanges et la circulation des biens,
personnes, travailleurs et capitaux : rappels du Plan Marshall (+ doctrine Truman, CECA, CED) jusqu’à
Traité de Rome. Il faut ensuite rappeler que cette intégration économique a conduit à l’Acte unique, au
Traité de Maastricht puis au Traité de Lisbonne. Il est possible dans cette partie de passer en revue
différentes politiques économiques européennes : politique commerciale, politique agricole,
politique de la concurrence par exemple.
Rapidement pourtant, la question de l’intégration monétaire se pose aussi : il faut faire référence aux
plans Barre (1969) et Werner (1971). La fin du système de Bretton Woods marque un tournant avec la
volonté des pays membres de maintenir entre eux des changes fixes. Ce qui débouche au serpent
monétaire puis au SME. Il faut alors rappeler que l’Acte unique (J.Delors) (et la libre circulation des
capitaux) pousse les pays du SME dans le triangle des incompatibilités qui va conduire à la mise en
œuvre de la monnaie unique, et donc à une intégration monétaire totale. Le second défi de l’intégration
européenne aura donc été celui de l’intégration monétaire.
Le troisième défi renvoie à la répartition des compétences entre l’Europe et les Etats membres. On
vient en effet de voir que l’intégration monétaire a abouti à la création d’une monnaie unique, et donc à
un transfert de souveraineté monétaire. Depuis 1957, la répartition des compétences entre les Etats
membres et l’UE a évolué et certaines compétences ont été progressivement transmises au niveau
Européen. Comment cela s’est-il traduit en terme de gouvernance européenne ? J.Delors parle à propos
de l’UE d’un ovni politique non identifié dans le sens où l’Europe est plus qu’une confédération (dans

Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
3
laquelle chaque Etat reste totalement souverain dans ces décisions et qui fonctionne à l’unanimité) et une
fédération (dans laquelle il existe un intérêt général supérieure aux nations qui la compose et qui
fonctionne avec un exécutif et un législatif qui lui sont propres). Au fur et à mesure de la construction
européenne, le projet européen a développé des éléments de fédéralisme (comme la monnaie unique par
exemple) mais sans pour autant faire disparaître le rôle des Etats membres (MES, mécanisme de co-
législation, domaines de compétences exclusifs des Etats membres).
En conclusion : l’intégration européenne a su répondre à un premier défi économique : par quel(s)
domaine(s) progresser dans l’intégration ? Un second défi monétaire : quelle coopération monétaire
mettre en place ? Un troisième défi politique : quelle répartition des compétences entre Etats membres et
Europe ? Conséquence : on a donc assisté à une véritable dynamique d’approfondissement progressif
depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à l’émergence de l’UEM qui signe là la réussite de l’intégration
européenne. L’UE a su finalement passer d’une étape à l’autre dans la présentation de B.Belassa pour
tendre vers un approfondissement de l’intégration politique tout en suivant la stratégie des petits pas
défendue et mise en œuvre par J.Monnet.
1.2 Intégration économiques et monétaire, convergence et rattrapage des économies en retard
L’intégration économique et monétaire européenne s’est donnée une série d’objectifs : croissance,
rattrapage, stabilité monétaire. Nous allons montrer ici que ces objectifs ont été atteints.
Le Traité de Rome a pour objectif l’instauration d’une paix durable en Europe. Cette paix durable est le
produit d’une dynamique vertueuse qui s’appuie sur l’essor des échanges économiques entre pays
membres (marché commun) et sur la mise en place de politique commune (PAC). Durant les années
1970, suite au premier élargissement (1973) et à la montée du chômage, l’Europe élargit le champ (région
en retard, touchée par la désindustrialisation ...) ainsi les instruments (FEDER) des politiques régionales
avec comme objectif essentiel de renforcer la cohésion sociale en luttant contre les inégalités territoriales.
La question de la convergence « réelle » des économies se pose donc. Durant les années 1980/1990,
c’est sur la réalisation du marché unique, puis sur la création de la monnaie unique, que repose cette
dynamique de convergence.
Il faut ici reprendre les arguments du cours sur les effets positifs attendus de l’intégration économique,
de la réalisation d’une « économie sans frontières » : effet pro-concurrentiel, effet de rationalisation des
activités, diversification de l’offre, économie d’échelle … citer le rapport Checchini
Il faut aussi reprendre les documents du cours qui font le point sur la mesure des gains en termes de
croissance et d’emploi de l’approfondissement de l’intégration éco et monétaire sur la période des années
1990/début des années 2000. On constate que globalement/en moyenne tous les pays membres ont obtenu
des gains de croissance et une baisse du chômage grâce à l’intégration européenne, sauf l’Italie. Ce cas
italien nous amène d’ailleurs à préciser davantage les périodes de croissance et convergence des
économies des pays membres. Pour les premiers Etats membres « en retard » (comme l’Italie), la
convergence réelle se fait plutôt dans les années 1970/1980, puis s’arrête à partir des années 1990. Pour
les nouveaux Etats membres des années 1970 /1980 (Grèce, Portugal, Espagne, Irlande), la convergence
et le rattrapage économique ont plutôt lieu dans les années 1990 et surtout durant la décennie 2000. On
citera ici l’évolution de l’écart de pib/tête entre la Grèce et l’Allemagne.
On pourra rappeler ici pour conclure sur cet argument, le fait que l’UE est aujourd’hui la première
économie mondiale (part du pib européen dans le Pib mondial, part de l’UE dans les échanges
commerciaux mondiaux).
Concernant maintenant la question de la stabilité monétaire, il faut reprendre ici l’histoire de
l’intégration monétaire en Europe et rappeler l’évolution des problématiques monétaires à partir des
années 1970. Les années 1970 sont caractérisées par la volonté de lutter contre l’instabilité des taux de
change enclenchée par la crise du système de Bretton Woods. Ce qui conduit à la création du serpent
européen puis du SME. Les années 1980 sont caractérisées par la volonté de lutter contre l’inflation, ce
qui va conduire de nombreux pays à ancrer leur monnaie sur le DM et à pratiquer des politiques de
désinflation compétitive (France). Les années 1990 sont marquées, quant à elles par le passage à la
monnaie unique. Des critères de convergence « nominaux » sont mis en œuvre (vous pourriez rappeler ici

Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
4
le débat « économistes » / « monétaristes »). A de rares exceptions (Belgique, Grèce), ces critères sont
respectés par les pays candidats à la monnaie unique. La politique monétaire devient une politique
européenne, l’objectif de la BCE est de « contrôler » l’évolution du niveau général des prix avec une cible
d’inflation de 2%. La BCE a parfaitement réussi cette mission durant les années 2000. Elle s’est appuyée
sur une crédibilité forte vis-à-vis des AE (qui n’anticipent pas une hausse de l’inflation). Cette crédibilité
de la politique monétaire provient en partie du statut de la BCE : une banque centrale indépendante du
pouvoir politique, et donc indépendante des pressions politiques qui iraient dans le sens de telle ou telle
politique monétaire. Cette crédibilité de la politique monétaire, cette capacité à contrôler l’inflation, est
bien évidemment une « nouveauté » pour des pays comme l’Italie, où l’inflation est historiquement forte ;
ce sont des réussites à mettre au crédit de l’UEM.
Conclusion première partie : jusqu’aux années 2000, les différents élargissements de l’UE n’ont pas
conduit à remettre en question le projet d’une Europe dans laquelle les peuples vivent en paix et dans le
progrès économique et social. A l’exception des guerres dans l’ex-yougoslavie ou de tensions internes
(Irlande du Nord ou pays Basque par exemples), les pays européens ont connu depuis la fin de la seconde
guerre mondiale une période de croissance et de paix unique dans l’histoire moderne (depuis la révolution
industrielle). Ce qui justifie certainement l’attribution du Prix Nobel de la Paix à l’UE en 2012.
Pour autant, le bilan n’est pas entièrement positif, on constate que l’intégration se heurte à des limites (qui
empêchent l’UE à ressembler à une économie sans frontières sur le modèle des Etats-Unis).
On constate aussi que la construction européenne possède des failles (que la crise des dettes souveraines à
mise à jour) et des effets pervers, qui remettent aujourd’hui en cause sa pérennité (citer Grexit). Face aux
difficultés rencontrées par l’Union européenne quelles dimensions de l’intégration fat-il dorénavant
chercher à développer. Quels sont les nouveaux défis de la construction européenne ?
2. L’avenir de l’UEM en question : les limites de l’intégration économie et monétaire
2.1 La disparité des situations européennes : l’intégration européenne à l’arrêt
Que faut-il entendre par disparité des situations ?
D’une part, au fait que le marché unique européen accompagné de la monnaie unique ne s’est pas traduit
par le disparition des effets frontières entre les économies nationales. Les échanges commerciaux se font
toujours en priorité entre AE d’un même pays, même si la distance géographique est plus importante
qu’avec des AE d’un pays frontalier. Cet effet frontière freine l’intégration du marché des biens et des
services. Les limites concernant les échanges de service ont d’ailleurs fait l’objet d’un rapport en 2010, le
rapport Monti.
D’autre part, la mobilité du travail est relativement faible par rapport aux Etats-Unis (8 fois plus
faible), ce qui freine bien sur l’intégration du marché du travail. Cette mobilité défaillante de la main
d’œuvre a une conséquence importante : dans la zone monétaire formée par l’euro, il n’est pas possible de
s’appuyer sur la mobilité des actifs pour pouvoir absorber des chocs asymétriques.
Ensuite les politiques sociales et fiscales sont des compétences souveraines des Etats membres. Il en
résulté des disparités de régimes sociaux (développer la typologie d’Esping Andersen), mais surtout des
comportements non coopératifs. Le marché unique a augmenté la concurrence mais la monnaie unique
a transféré à l’Europe la politique monétaire et les politiques budgétaires sont coordonnées par le PSC et
le Traité pour la stabilité, ce qui conduit les Etats a cherché de nouveaux instruments pour stimuler
l’activité sur leur territoire. Certains Etats utilisent donc des stratégies de dévaluations compétitives pour
améliorer la performance des entreprises installées sur leur territoire. Conséquence : le marché unique au
lieu de créer des solidarités de fait entre pays européens, produit au contraire des stratégies de cavalier
seul non coopératives.
En outre, si l’on se penche sur la redistribution opérée entre régions européennes, on constate que les
inégalités reculent moins en Europe qu’aux Etats-Unis. Ceci s’explique également par le fait qu’il revient
aux Etats d’assurer la redistribution des richesses au sein de leur propre territoire. On arrive alors à une
situation paradoxale : les Etats membres réduisent en moyenne davantage les inégalités que les Etats-

Nicolas Danglade
Camille Vernet 2015-2016
5
Unis, mais au sein de l’UE, le recul des inégalités y est globalement plus faible. L.Davezies explique ce
paradoxe par le fait que les régions riches des Etats riches n’aident pas les régions pauvres des Etats
pauvres (illustrez avec exemple Allemagne/Portugal). Il en résulte un mécontentement de la part des
régions riches des pays les plus pauvres qui contestent ce jeu de la redistribution nationale et expriment
des demandes de séparatisme territorial (Catalogne, Wallonie par exemple), ce que Davezies appelle le
« nouvel égoisme territorial ».
Enfin, le dernier argument pour permet de souligner les limites de l’intégration européenne est celui qui
concerne l’hétérogénéité croissante des Etats membres. Depuis le début des années 2000, les
économies européennes se séparent en deux groupes : ceux du Nord et ceux du Sud. Dans les pays du
Sud, le tissu industriel recule de manière très importante, les économies sont marquées par un déficit
croissant de la balance courante qui est financé par des entrées de capitaux provenant des pays de
l’Europe du Nord (qui sont eux exportateurs nets). Pour expliquer cette divergence des structures
productives : il faut s’appuyer sur le modèle cœur-périphérie de P.Krugman développé dans les années
1990 (en opposition avec les prédictions de la Commission européenne de l’époque), il faut aussi rappeler
les divergences de politiques économiques entre pays du nord et pays du sud (pendant que l’Allemagne
met en place les réformes du marché du travail Hartz, les espagnols pratiquent la spéculation
immobilière), il faut enfin expliquer pourquoi la politique monétaire unique est pro-cyclique à partir du
moment où l’inflation est différente entre les pays. Ce qu’il faut bien avoir en tête, c’est que durant les
années 2000, les pays du Sud rattrapent en termes de pib/tête les pays du Nord, leur croissance est plus
élevée, mais que durant cette période leur structure productive change (recul industrie et PGF) et que la
consommation dans ces pays est en réalité de plus en plus financée grâce à l’entrée de capitaux
étrangers qui apportent de la liquidité. D’une certaine manière, cette croissance est une croissance en
trompe l’œil car il faut bien rembourser une partie important du financement externe. Marché unique +
monnaie unique ont donc rendu les économies européennes de plus en plus hétérogènes ; et les économies
du sud dépendantes du financement des économies du Nord. La crise des dettes souveraines : moment
où se financement se bloque (sudden stop).
Quelle réponse a apporté l’UE à cette crise ? A partir du moment où la Grèce ne sort pas de l’euro, que
le travail est peu mobile et qu’il n’y a pas de transferts budgétaires de l’UE vers les pays à balance
courante déficitaire, la seule solution possible = réduire le déséquilibre de la balance courante en
réduisant la demande intérieure et en stimulant les exportations = politique de dévaluation interne.
La construction européenne produit donc un effet : hétérogénéité croissante des économies mais elle
n’accompagne pas cette hétérogénéité d’un instrument capable de la gérer (transferts budgétaires ou
mobilité du travail).
On peut néanmoins rappelé que ce n’est pas la première fois que l’Europe connaît une grave crise. Il faut
se souvenir de l’eurosclérose des années 1970/1980. Faut-il alors affirmer comme J.Monnet que l’Europe
se construit dans les crises ?
2.2 Développer la dimension sociale et fiscale de l’Europe pour sortir de la crise : pour une nouvelle
gouvernance européenne
Nous avons vu qu’au sein de l’UE se développent des stratégies de dumping social et fiscal, et que la
seule réponse aux crises de balance de paiements, qui découlent de l’hétérogénéité des économies,
consiste à pratiquer des politiques d’austérité qui cassent la croissance réelle et réduisent la croissance
potentielle.
Est-il possible de dépasser ces situations qui condamnent à terme le projet européen ?
L’intégration européenne ne peut rester en l’état et on connaît les enjeux de la construction européenne
aujourd’hui : supprimer les comportements non coopératifs et permettre la cohabitation d’économie
dont les structures productives sont différentes (ce qui signifie des balances courantes structurellement
déficitaires pour certains pays).
Les réponses que l’on peut apporter à ces problèmes renvoient aux compétences sociales et fiscales qui
sont encore aujourd’hui des compétences exclusives des Etats membres. On peut donc se demander dans
quelle mesure il est possible de transférer au niveau européen une partie de ces compétences ?
L’existence d’une assurance chômage européenne serait ainsi utile pour favoriser la mobilité du travail ;
 6
6
1
/
6
100%