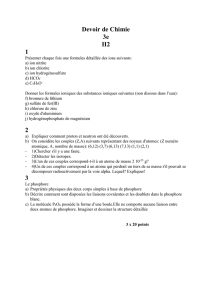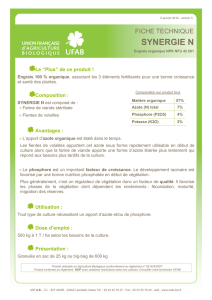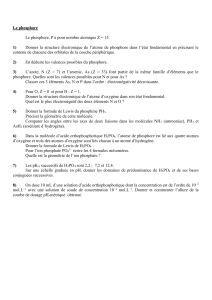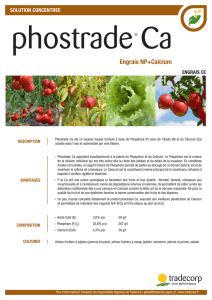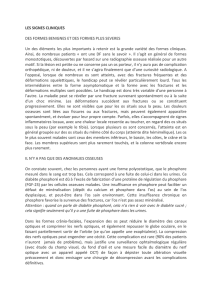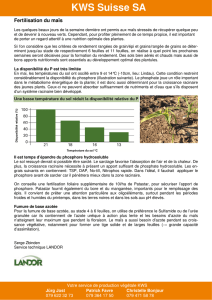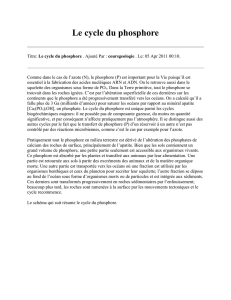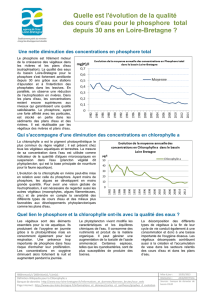La gestion du phosphore et l`agriculture biologique - Capbio

36 DOSSIER
Plus que le mode de production
(conventionnel ou biologique) c’est le
niveau d’intensification et la nature
même des espèces animales ou végé-
tales présentes sur l’exploitation qui
déterminent les besoins en phosphore
des systèmes agricoles en place.
En plus de satisfaire aux exigences de
la réglementation conventionnelle sur
le phosphore, le mode de production
biologique interdit l’usage :
l des phytases en alimentation animale,
l des engrais minéraux de synthèse
pour la fertilisation.
Les matières organiques constituent la
source principale de phosphore en bio
dans nos départements.
En complément, les engrais phospha-
tés autorisés par le cahier des charges
AB (phosphates naturels, scories…)
peu solubles, présentent une faible
bio disponibilité, particulièrement en
sol basique ou neutre. Il convient donc
d’être attentif à l’évolution du phosphore
dans les sols en agriculture biologique
particulièrement en absence d’apport
de matières organiques.
En agrobiologie on raisonne la ferti-
lisation à l’échelle de la rotation plutôt
qu’en fonction des besoins de la culture
en place. La réponse aux besoins en
phosphore passe préférentiellement
par des apports de matières organiques
compostées, ainsi que l’utilisation d’en-
grais verts pour stimuler l’activité biolo-
gique du sol et favoriser la bio disponi-
bilité du phosphore présent dans le sol .
L’accès impératif des animaux au plein
air constitue une autre particularité
du cahier des charges de l’élevage
biologique.
Le dimensionnement des parcours
fait l’objet d’une réglementation qui
limite le nombre d’animaux sur la base
d’un chargement équivalent à 170 kg
d’azote/ha.
Pour les mono gastriques, et plus par-
ticulièrement la volaille, les rejets de
phosphore sur les parcours ne sont pas
homogènes. Il convient d’apporter une
attention accrue à l’implantation de
ces parcours (topographie, distances
à l’eau) ainsi qu’à la répartition des
animaux qui y séjournent. Le risque de
fuites de phosphore par ruissellement
sur ces zones est réel et des réflexions
sont en cours sur les techniques qui
pourraient permettre d’atténuer ces
risques sur le milieu.
La gestion du phosphore
et l’agriculture biologique
Mieux gérer les déjections des volailles sur parcours
De nombreuses espèces de volailles peuvent être produites sur parcours : volailles de chair ou poules pondeuses avec signe
de qualité ainsi que les canards en pré gavage.
Il convient de limiter le plus possible les risques de lessivage en évitant le ruissellement (mauvaise gestion des eaux de
pluie), en favorisant une bonne utilisation de la surface du parcours, en mettant en place si besoin une bande enherbée
(5m). Il est nécessaire d’assurer une bonne répartition des volailles sur le parcours. Il a en effet été montré que les surfaces
les plus exploitées sont les zones frontales et les zones ombragées situées à 30-40 m du bâtiment. Pour que les volailles
explorent plus le parcours, il faut jouer sur l’attractivité des zones sous-exploitées. On peut les attirer en mettant en place
des systèmes de couloir, arbustes par exemple, dans le prolongement des trappes à 3m du bâtiment et en implantant de
la végétation dès 20 à 30m après les trappes. Elle peut être constituée d’arbres de différentes hauteurs. D’autres pratiques
visent à limiter les pertes de phosphore comme placer des gouttières sur les toits des bâtiments, racler la zone bétonnée
devant les trappes pour récupérer les déjections et réensemencer les zones surexploitées .
En plus de la réglementation générale sur le phosphore, le mode
de production biologique doit composer avec l’interdiction
d’utiliser des engrais minéraux chimiques. Phosphates naturels
et matières organiques sont les seules ressources phosphatées
autorisées, une spécificité qu’il peut être difficile de gérer en
tenant compte des réglementations liées à l’épandage.
Aménager ses parcours pour favoriser
l’exploration par les volailles.
www.capbi -bretagne.com
1
/
1
100%