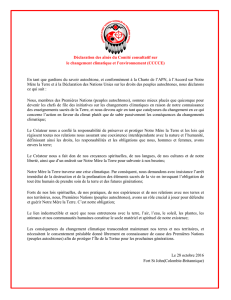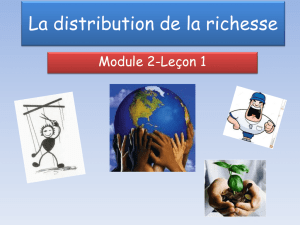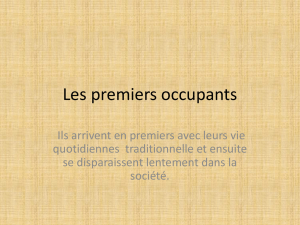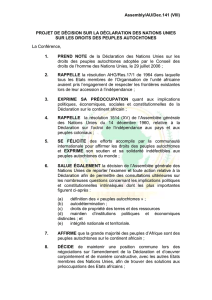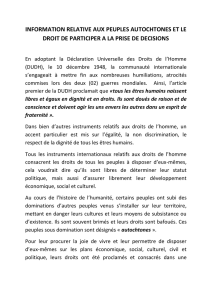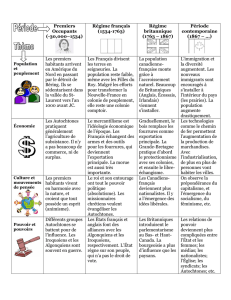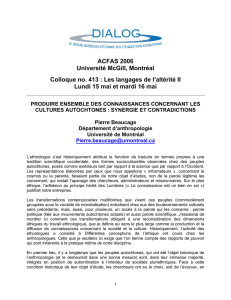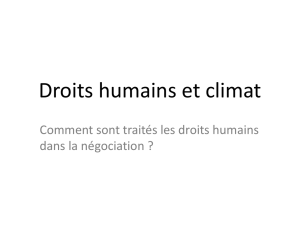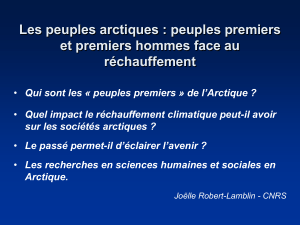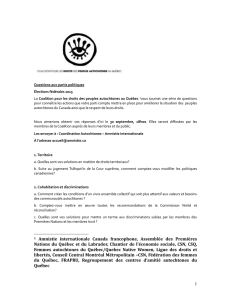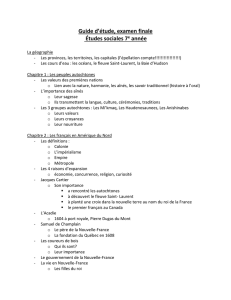Imaginer des solutions de rechange pour un développement durable

Institut canadien de recherches sur les femmes – FemNorthNet
Conception accessible par Forest Communications. 1
Feuillet no10
Ce document fait pare
d’une série de dix
feuillets d’informaon
traitant des femmes et
du développement de
l’industrie d’extracon des
ressources naturelles. Tous
les feuillets d’informaon
sont disponibles au www.
fnn.criaw-icref.ca et vous
y trouverez aussi des
ressources addionnelles
sur les sujets abordés.
CRIAW-ICREF reconnait
sa présence et son travail
en territoire autochtone.
Nous reconnaissons avec
respect l’héritage de
lacolonisaon sur les
peuples autochtones.
Cee publicaon a été
créée par le Réseau du Nord
féministe. Traducon par
Michele Briand. Pour la liste
complète des contributeurs
consulter notre site Web.
978-1-894876-75-9
IMAGINER DES SOLUTIONS
DE RECHANGE POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce feuillet d’informaon met l’accent sur la nécessité d’un développement viable
des ressources naturelles an que les populaons du Nord, y compris les diverses
femmes de ces communautés, puissent en rer un meilleur par. Il propose
des façons de préparer l’avenir en se basant sur des principes diérents de ceux
d’aujourd’hui, notamment:
• la pleine reconnaissance des droits et du contrôle des Autochtones sur leurs
territoires tradionnels
• des changements dans la distribuon de la richesse issue de l’extracon
des ressources
• l’ulisaon des ressources naturelles à un rythme raisonnable et viable.
Reconnaissance des droits des Autochtones et du contrôle par les
peuples de leurs territoires traditionnels
Les peuples autochtones du Canada ont inves beaucoup de temps et d’eorts, sans
parler de nombreux recours judiciaires, pour commencer à reprendre le contrôle des
terres et des cours d’eau qu’ils ulisaient depuis bien avant la colonisaon. Malgré
la lenteur du processus, d’importantes décisions judiciaires et diverses ententes ont
reconnu les droits des Autochtones et leur pouvoir de prendre des décisions.
La Cour suprême du Canada a rendu un jugement historique le 26 juin 2014 en
reconnaissant que les droits territoriaux des autochtones s’étendent aux terres
ulisées tradionnellement, y compris à l’extérieur des sites d’établissement. Cee
cause impliquait la Naon Tsilhqot’in, au centre-nord de la Colombie-Britannique.
Depuis plus de 20 ans, la Naon Tsilhqot’in tentait par l’entremise des tribunaux et
de barrages rouers de stopper l’extracon des ressources (exploitaon foresère)
sur son territoire tradionnel. La Cour suprême a nalement jugé en leur faveur.
La signicaon de la décision Tsilhqot’in
Cee décision de la Cour suprême annonce une nouvelle manière d’aborder les
revendicaons territoriales non résolues à des tres autochtones, parculièrement

IMAGINER DES SOLUTIONS DE RECHANGE DURABLES
2
dans le nord du Québec, l’est du Canada et au
Labrador, où il n’existe pas de traités. (En signant un
traité, les peuples autochtones peuvent céder ou
abandonner leurs droits à la terre. En l’absence de
traités, la terre est qualiée de non encore cédée.)
Cee décision par le plus haut tribunal du pays a
fourni une dénion plus précise de ce qu’est un
tre ancestral et des façons de le reconnaître. Cee
décision donne aux Premières naons qui tentent
d’obtenir des droits sur des territoires non encore
cédés des ouls pour établir leurs droits à un tre
ancestral et par conséquent, au contrôle d’un
territoire.
Le tre ancestral donne aux groupes autochtones
le droit de:
• jouir du territoire et l’occuper
• posséder le territoire
• rer des avantages économiques du territoire
• décider de l’ulisaon et de la geson du territoire.
« Journée historique à Xeni Gwet’in ». Rencontre entre la
première ministre et le ministre des Relaons autochtones
et de la Réconciliaon et les chefs de la Naon Tsilhqot’in
pour signer une Lere d’entente par suite de la décision de
la Cour suprême du Canada. – Photo de la province de la
Colombie-Britannique (2014, licence CC BY-NC-ND 2.0)
Une nouvelle époque de consultaon
et de consentement
La décision Tsilhqot’in enjoint au gouvernement
fédéral d’obtenir un consentement avant toute forme
de développement sur des terres non encore cédées.
Cee exigence de consentement ne s’applique pas
sur des terres soumises à d’autres types d’ententes
(comme des traités), où seul le devoir de consultaon
s’impose. Cee disposion ouvre la possibilité pour les
naons autochtones de parciper au développement
économique à tre de partenaires plus égaux.
Mais des restricons s’appliquent:
• des projets majeurs comme des mines ou
des pipelines peuvent être mis en œuvre
sans le consentement des Autochtones, si
le gouvernement peut faire la preuve d’un
« objecf public réel et impérieux » et orir une
compensaon au groupe autochtone
• les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent
réglementer les acvités économiques, telles les
praques de foresterie, sur les terres non encore
cédées, avec ou sans consentement, si un besoin
public est reconnu comme réel et impérieux.
Aux termes de la décision de la Cour suprême, les
peuples autochtones n’obendront pas tous accès à
un tre ancestral sur leur territoire tradionnel, même
s’ils saisissent les tribunaux, notamment les groupes qui
ont déjà cédé leurs terres par traité. D’autre part, divers
peuples autochtones au Canada et ailleurs croient que
leurs droits au territoire ne peuvent être ni vendus, ni
achetés, ni échangés, ni abrogés par un quelconque
gouvernement ou pour toute raison que ce soit.
Que signie la décision en termes généraux?
La décision s’applique à de nombreux groupes
autochtones qui vivent sur des territoires non encore
cédés et les ulisent. C’est parculièrement vrai pour
la Naon NunatuKavut qui a beaucoup en commun
avec la Naon Tsilhqot’in:

TENIR COMPTE DES FEMMES DE LA RÉGION 3
Le village de Red Bay, primé en 2013 comme site du
patrimoine mondial par l’UNESCO en raison de son
industrie basque de pêche à la baleine, est situé en
territoire tradionnel Nanatukavut. Parcs Canada collabore
avec le gouvernement Nanatukavut à la protecon
de l’héritage et des sites sacrés de la naon inuite
NunatuKavut du sud du Labrador. – Photo par
Wiegee (2004)
• les deux naons se sont vu refuser des tres en
raison de règlements sur la vie semi-nomadique.
Par le passé, elles n’ont pas répondu aux strictes
normes gouvernementales exigeant qu’elles
occupent un territoire donné en tout temps.
Dans la décision Tsilhqot’in, la Cour suprême a
rejeté cee idée, armant que les groupes semi-
nomadiques possèdent des droits aux tres des
terres qu’ils ont tradionnellement occupées.
• La communauté du NunatuKavut a vu ses tres
ancestraux reconnus par le passé. Ces tres leur
ont ensuite été rerés en raison de leur échec à
passer les tests stricts et déraisonnables relafs à
la connuité (relaon connue avec le territoire).
La décision Tsilhqot’in a redéni la connuité
et armé qu’il ne s’agissait pas d’un mof
raisonnable pour le gouvernement de rejeter
la revendicaon de tres.
• Les deux naons ont trouvé les gouvernements
récents à reconnaître leurs droits; la récente
décision a précisé l’obligaon des gouvernements
d’accommoder les Autochtones.
Déclaraon des Naons Unies sur les droits des
peuples autochtones
La Déclaraon des Naons Unies sur les droits des
peuples autochtones (DDPA) énumère les droits que
les États membres des Naons Unies doivent respecter
en vue de bâr des relaons saines et viables avec
les peuples autochtones. Elle conent des principes
touchant au développement des ressources basés
sur le respect des droits humains, la jusce, la non-
discriminaon et la réconciliaon.
Les Naons Unies ont adopté la Déclaraon en
septembre 2007, plus de 30 ans après le début des
travaux par des groupes autochtones du monde
ener. Le Canada est l’un des quatre pays à avoir
voté contre la DDPA lors de son adopon, armant
que la Déclaraon allait trop loin en accordant
aux Autochtones des tres de propriété sur leurs
territoires tradionnels, ainsi qu’un droit de veto sur
des lois fédérales et la geson locale des ressources.
Mais trois ans plus tard, en novembre 2010, le
gouvernement canadien signait et endossait la DDPA.
La DDPA s’applique à l’extracon des ressources parce
qu’elle requiert des États naons:
• qu’ils reconnaissent et respectent les droits des
peuples autochtones, leurs instuons, leurs
cultures et leurs tradions
• qu’ils meent n à toute forme de discriminaon
et fassent la promoon d’une enère parcipaon
des peuples autochtones dans toutes les aaires
les concernant, y compris leur droit à demeurer
disncts et à poursuivre leurs propres visions du
développement économique et social
La Déclaraon des Naons Unies sur
les droits des peuples autochtones
(DDPA) vise à inciter les pays à changer
leurs lois, praques et programmes.

IMAGINER DES SOLUTIONS DE RECHANGE DURABLES
4
Comment appliquer la Déclaraon des Naons
Unies sur les droits des peuples autochtones:
• Adopter la Déclaraon et s’assurer que
toutes les poliques et procédures du pays
respectent ses normes.
• Travailler avec les organisaons autochtones
en vue d’inciter le gouvernement et les
industries à mere en applicaon la
Déclaraon.
• La Déclaraon peut servir de cadre aux
gouvernements et aux entreprises
pour guider leur travail avec les
communautés autochtones.
• Le milieu de l’enseignement peut inclure de
l’informaon sur la DDPA dans les cours en
vue d’éduquer le public sur sa signicaon
au Canada.
Source: Indigenous Bar Associaon, 2011
• qu’ils reconnaissent le droit des peuples
autochtones à l’autodéterminaon
• qu’ils permeent aux peuples autochtones de
parciper pleinement et ecacement à toutes les
décisions pouvant aecter leurs terres
• qu’ils favorisent les partenariats et la collaboraon
entre les États et les peuples autochtones
• qu’ils meent sur pied un mécanisme de
consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause en vue de protéger les
droits des peuples autochtones à décider de quand
et comment devra se produire le développement.
Pourquoi la DDPA est-elle importante pour les
femmes autochtones?
Les femmes autochtones ont parcipé très acvement
à l’élaboraon de la Déclaraon pendant les deux
décennies de négociaons. La DDPA accorde aux
femmes autochtones des droits formels dans plusieurs
domaines, notamment:
• le droit de prendre part aux décisions dans les
aaires qui aectent leurs droits
• le droit à une naonalité et le droit d’appartenir à
une communauté ou une naon autochtone, basés
sur les tradions et coutumes de la communauté
ou de la naon impliquée
• le droit à tous les niveaux et toutes les formes
d’éducaon sans discriminaon et la possibilité
de partager leurs histoires, langues, tradions
orales, philosophies et liératures avec les
généraons futures
• des droits égaux à ceux des hommes en maère
de parcipaon à la polique et aux aaires
publiques et dans les rôles de représentaon
de leurs communautés et de leurs pays.
La Déclaraon arme également que le mariage
ne peut forcer les femmes à changer de naonalité
ou à devenir apatrides. Les naons doivent aussi
prendre des mesures pour améliorer les condions
économiques et sociales des femmes autochtones.
Au Canada, la DDPA peut fournir aux peuples
autochtones, et aux femmes, des moyens de protéger
la terre et l’eau pour les généraons futures. La
Déclaraon peut également leur permere d’exercer
un meilleur contrôle sur le type et la portée des
projets de développement des ressources dans leurs
communautés, ainsi que sur le partage de la richesse.
Changer la distribution de la richesse issue
de l’extraction des ressources
La DDPA ulise une perspecve des droits de la
personne pour concevoir des relaons plus égalitaires.
Mais il s’agit aussi d’un enjeu économique.
La richesse créée par l’extracon et le développement
des ressources dans le Nord n’a pas été partagée. Les
prots résultant des projets de développement ont
plutôt élargi l’écart entre:
• les entreprises et les populaons
• les riches et les pauvres
• le nord et le sud du Canada.

TENIR COMPTE DES FEMMES DE LA RÉGION 5
Ce sont les entreprises, et non les gens, qui ont le
plus bénécié de la phase d’expansion de l’extracon
des ressources au Canada. La part du revenu naonal
détenue par les entreprises est à son plus haut niveau
depuis les 40 dernières années. Au cours des quinze
dernières années, les entreprises canadiennes ont
engrangé des prots de plus de 700 milliards. Pendant
la même période, la dee du Canada a augmenté de
660 milliards, soit 50 000$ par ménage canadien.
Un écart croissant sépare également les riches et
les pauvres au Canada. Cet écart est frappant dans
la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Entre 1981
et 2005, TNL connaissait les niveaux de croissance
économique parmi les plus élevés au Canada.
L’économie provinciale (produit intérieur brut) est
passée d’environ 5 à 21 milliards. Qu’est-il advenu
de toute cee richesse?
• Durant cee période, le pourcentage des prots
par comparaison à celui des salaires était de 70% à
Terre-Neuve, contre 51% dans le reste du Canada.
Autrement dit, les entreprises opérant dans cee
province se payaient elles-mêmes 70 cents pour
chaque dollar payé en salaire, contre 51 cents dans
le reste du Canada.
• En 2008, le pourcentage des prots par rapport
aux salaires à Terre-Neuve-et-Labrador était
deux fois plus élevé que dans le reste du Canada,
à environ 125%. Cela veut dire qu’en 2008, les
entreprises se payaient elles-mêmes beaucoup
plus généreusement qu’elles ne payaient leurs
travailleuses et travailleurs.
Le revenu des dirigeants déjà bien nans des
entreprises a également augmenté à un rythme
beaucoup plus rapide à Terre-Neuve que dans le
reste du pays. Par comparaison, les salaires des
travailleurs sont loin d’avoir suivi le rythme de la
croissance économique. Et comme ailleurs, les salaires
des femmes, des Autochtones et des personnes en
situaon de handicap sont plus faibles que ceux
des hommes. En d’autres mots, les populaons ne
reçoivent pas une part équitable des avantages
économiques issus de l’extracon des ressources.
Depuis quelques années, Terre-Neuve-et-Labrador
compte sur les redevances de l’industrie de l’extracon
des ressources pour défrayer une bonne pare des
dépenses publiques. L’eondrement en 2015 de la
demande mondiale pour les maères premières
telles le pétrole, le gaz et le minerai de fer a réduit les
revenus de la province. En réacon, le gouvernement
provincial de TNL a eectué des coupures drasques
aux dépenses publiques pour gérer l’augmentaon
de sa dee, après avoir été pendant presque une
décennie l’une des plus solides économies du pays.
Il existe des façons plus logiques et plus intelligentes
de gérer la richesse issue du développement des
ressources naturelles dans le Nord du Canada.
La Norvège: un modèle pour le Nord du Canada
Depuis la découverte de gisements sur son plateau
connental en 1969, la Norvège a soigneusement
géré sa producon de pétrole en vue d’assurer
un développement durable. Ses poliques ont
protégé l’environnement et réservé des richesses
pour la populaon actuelle, de même que pour les
généraons futures.
Le gouvernement norvégien possède 80% des
infrastructures de producon et de transport du
pétrole. Il peut dénir et diriger le développement
des ressources parce qu’il perçoit et invest les
revenus de la producon de pétrole au nom de la
populaon de la Norvège.
Plateforme pétrolifère Draugel au large de la Norvège –
Photo par BoH (2013, licence CC BY-SA 3.0)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%