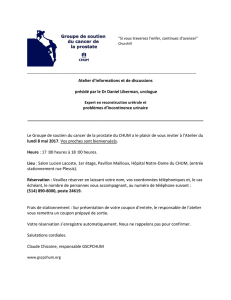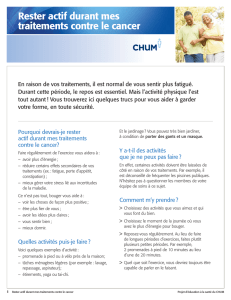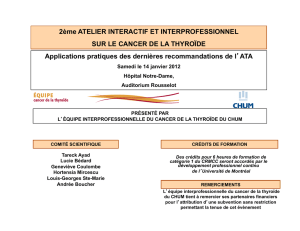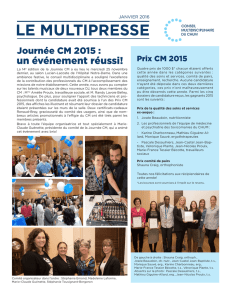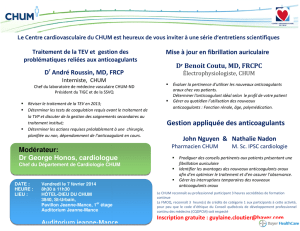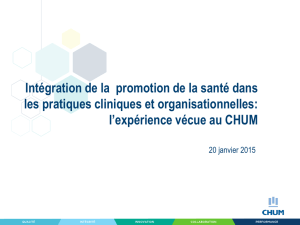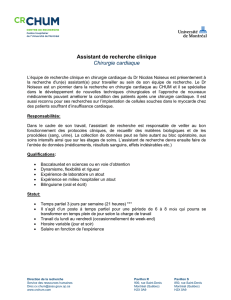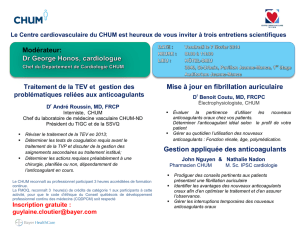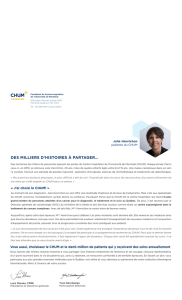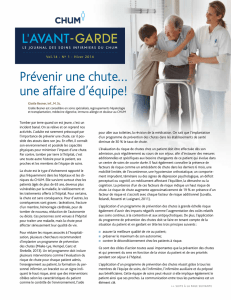2011 Volume 2 Numéro 3 : Des nouvelles du Réseau

Centre hoSpitalier de l’UniverSité de Montréal
ChUMagazine
volUMe 2 n
0
3 - 2011
DOSSIER
URGENCES
TÉMOIGNAGE D’UN
GREFFÉ DU REIN
Alors qu’il assiste à un match de
hockey, son téléavertisseur sonne,
mais Pierre Martel, en attente
d’un rein depuis de longs mois,
ne l’entend pas à cause du bruit
ambiant. Un message au micro lui
demande de se rendre à l’extérieur
de l’aréna. Les policiers l’attendent
pour le conduire au CHUM.
Suite page 5
SPÉCIAL DON D’ORGANES ET DE TISSUS
LA PRATIQUE COLLABORATIVE, ÇA S’APPREND
SAISON ARTISTIQUE 2011- 2012

chumagazine est publié par la
Direction des communications du CHUM
3840, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2W 1T8
ÉDITRICE
Ève Blais
RÉDACTRICE EN CHEF
Camille Larose
COLLABORATION
Sandra Aubé, Lise Boisvert, Éloi Courchesne,
Nathalie Forgue, Geneviève Frenette, Andréa Galli,
Élodie Grange, Jacynthe Genesse, Sylvie Lafrenière,
Sabrina Ourabah, Técia Pépin, Sylvie Vallée
CONCEPTION GRAPHIQUE
André Dubois
CONSEILLER GRAPHIQUE
André Bachand
PHOTOGRAPHES
Martin Viau (page couverture), Stéphane Gosselin,
Dominique Lalonde, Luc Lauzière, Stéphane Lord
Photos de la soirée de reconnaissance : Redji Poirier
RÉVISION
Johanne Piché
IMPRESSION
Imprimerie Moderne
chumagazine est publié six fois l’an, tous les deux mois.
Les textes et photos doivent parvenir à la rédaction six semaines
avant la parution du numéro bimestriel.
Sauf pour les infirmières, le masculin est utilisé dans les textes
afin de faciliter la lecture et désigne aussi bien les hommes que les
femmes.
Les articles du chumagazine peuvent être reproduits sans
autorisation, avec mention de la source. Les photos ne peuvent
pas être utilisées sans autorisation.
DISPONIBLE SUR L’INTRANET DU CHUM
Accueil/dc/publications/chumagazine/volume2numéro3
DISPONIBLE SUR LE WEB
chumagazine.qc.ca
ISSN 1923-1822 chumagazine (imprimé)
ISSN 1923-1830 chumagazine (en ligne)
POUR JOINDRE LA RÉDACTION, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
camille.larose.chum@ssss.gouv.qc.ca, 514 890-8000, poste 23679
INTERNET
chumontreal.com
ACTUALITÉ
Les technologistes médicaux se font connaître ............................................ 7
La salle d'attente axée santé du Centre des naissances ......................... 8
Le Dr Soulières publie ....................................................................................................... 11
Brèves ...................................................................................................................................... 26
Les prix Reconnaissance de la DSI ........................................................................ 30
La soirée Reconnaissance des employés et médecins ............................. 31
RUBRIQUES
Édito ........................................................................................................................................... 3
Félicitations ........................................................................................................................... 10
Nouvelles du RUIS ............................................................................................................. 10
Les commissaires vous informent .......................................................................... 11
Les interventions AINÉES ............................................................................................. 12
La page de la recherche ................................................................................................. 13
La Fondation du CHUM ................................................................................................... 17
La promotion de la santé ............................................................................................... 24
C. A. ........................................................................................................................................... 25
Agrément ............................................................................................................................... 28
Nouveau CHUM .................................................................................................................. 29
A LA UNE
LANCEMENT
Arts et culture à l'hôpital
Pages 23
SPECIAL
Don d’organes et de tissus
Pages 4,5 et 6
COLLOQUE
La pratique collaborative
Pages 14, 15 et 16
DOSSIER
URGENCES
Pages 18 à 22
Formé de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital Notre-Dame et de l’Hôpital Saint-Luc, au cœur de Montréal, le
CHUM est le plus grand centre hospitalier universitaire francophone en Amérique du Nord. À ce
titre, il occupe une place prépondérante dans l’application d’approches de soins novatrices, dans
la recherche de nouvelles connaissances, de même que dans la transmission du savoir auprès des
professionnels et futurs professionnels de la santé.
En plus d’accueillir la clientèle adulte de son territoire désigné, le CHUM reçoit des patients de
partout au Québec dans les spécialités où il possède une expertise reconnue, notamment en on-
cologie, maladies cardiovasculaires et métaboliques, neurosciences, médecine des toxicomanies,
hépatologie (spécialité des maladies du foie), transplantation d’organes, plastie de reconstruction y
compris les soins aux grands brûlés et, plus récemment, en gestion de la douleur chronique.
Structuré en grandes unités cliniques regroupant plusieurs spécialités, le CHUM place le patient au cœur
de son ac tion, de sor te que ce sont les spécialistes qui se relaien t auprès des malades et non l’ inverse.
Une réalité qui sera de plus en plus tangible grâce à la construction du nouveau CHUM, au 1000
rue Saint-Denis, et de son centre de recherche avoisinant, où médecins, chercheurs et autres
professionnels de la santé travailleront coude à coude sous un même toit.
LE PATIENT EST AU CŒUR DE NOTRE ACTION
(et en page couverture de chumagazine).
HÔTEL-DIEU DU CHUM
3840, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2W 1T8
HÔPITAL NOTRE-DAME DU CHUM
1560, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 4M1
HÔPITAL SAINT-LUC DU CHUM
1058, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3J4
UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
514 890-8000
INTERNET :
chumontreal.com

EDITORIAL
| CHUMAGAZINE | 3
Les urgences sont souvent la porte d’entrée des patients dans le
système de santé : manque de médecins de famille, méconnaissance
des ressources communautaires existantes, mais aussi problématiques
de santé aiguës bien réelles les conduisent chez nous. Il est de notre
devoir de les soigner, mais aussi de les guider, les orienter vers les
ressources les mieux adaptées à leur état de santé. Le bon patient
au bon endroit avec le bon soignant, voilà une idée qui guide
présentement nos actions.
La durée des séjours aux urgences fait régulièrement la une des
journaux : la présence de patients sur civière à l’urgence pendant plus
de 24 heures est un problème bien réel, ainsi que le difficile accès aux
lits d’hospitalisation des étages. Si nous pouvons prendre des actions
concrètes afin d’améliorer la situation, cette dernière reflète toutefois
certaines imperfections du réseau de la santé. Au CHUM, nous faisons
toutefois le choix, en tant que leaders de la santé au Québec, de ne pas
rester les bras croisés dans l’attente de solutions venues d’ailleurs. Le
dossier des urgences, par son importance pour la santé des patients
et son impact sur le quotidien des soignants, ne saurait attendre et
nous faisons le choix d’être proactifs.
En lisant le dossier du CHUMAGAZINE, vous constaterez que
plusieurs actions ont été prises au CHUM afin de changer la donne :
innovation dans les approches, participation à toutes les tables de
discussion sur le sujet et création de nouvelles tables au besoin, appel
à la technologie partout afin de raffiner les processus, partenariats,
etc. Tout cela parce que nous avons une obligation de résultats : nous
le devons à nos patients avant tout, dont les intérêts passent avant
les nôtres, mais aussi à tout le réseau de la santé qui compte sur un
hôpital exemplaire. Nous nous dirigeons en 2016 - c’est demain - vers
un nouvel hôpital dont l’urgence comptera 51 civières, alors que les
trois hôpitaux formant le CHUM en comptent aujourd’hui plus de
cent. On comprendra mieux l’importance, pour ne pas dire l’urgence,
sans jeu de mots, de poursuivre les efforts.
Il est important de faire tout ce qui peut être fait, dans l’hôpital
comme avec les instances externes, pour atteindre cet objectif,
somme toute plus que raisonnable, du 12 heures d’attente maximum
à l’urgence avant d'obtenir un lit.
Un comité chapeaute la réflexion renouvelée sur les urgences et
entreprend des actions audacieuses, dont vous pourrez lire le coup
d’envoi dans cette édition. Vous constaterez aussi que certaines
personnes ont fait de cette cause la leur et qu’elles y investissent
temps et énergie afin de changer la donne – et cela fonctionne !
Je crois sincèrement que chaque individu doit se sentir interpelé :
qu’il soit surspécialiste ou commis, chacun peut faire la différence.
Prendre le temps de reconsidérer sa façon de travailler en fonction de
l’objectif à atteindre est le devoir de tous les intervenants du CHUM,
et j’oserais avancer de tous les intervenants du réseau. Le CHUM
fait et continuera de faire sa part. Il prendra tous les moyens mis à
sa disposition et consacrera une énergie inépuisable à améliorer le
sort des personnes qu’il accueille nuit et jour. C’est un engagement
formel.
Ces efforts pourront vraisemblablement être éclairés par la saison
artistique du CHUM, lancée en ce dernier jour de mai dans la chapelle
des religieuses hospitalières, devant un parterre de patients et de
soignants, réunis non pas devant la maladie à soigner, mais bien pour
écouter quelques grands airs de Puccini. Le CHUM, c’est aussi cela,
un lieu qui donne l’occasion d’entendre, et de voir, du beau.
Christian Paire, directeur général
Vers
l’urgence
DE DEMAIN

4 | CHUMAGAZINE |
SPECIAL DON D'ORGANES ET DE TISSUS
Ces dernières années, la population
du Québec a grandement évolué dans
sa réflexion sur le don d’organes et
les Québécois y sont de plus en plus
favorables, tous les sondages l’indiquent.
Pourtant, les donneurs sont rares et, au
CHUM comme dans tout le réseau, des
efforts restent à faire pour augmenter les
dons. Après le Signez don et le Dites le don
de vive voix, voici le Pensez don, qui invite
la communauté hospitalière toute entière
à bonifier ces pratiques afin d’identifier
tous les donneurs potentiels à l’hôpital.
Il faut savoir d’abord que seulement 1 %
des décès survenant à l’hôpital peuvent
aboutir au don d’organes, et qu’un
seul donneur peut donner jusqu’à huit
organes, donc sauver potentiellement
huit vies : c’est pourquoi il est important
de les identifier tous et de n’en rater aucun.
Québec-Transplant, l’organisme mandaté
par le gouvernement pour coordonner les
dons d’organes et de tissus, a produit un
DVD soulignant les meilleures pratiques en
ce sens, que CHUMAGAZINE décrit ici.
DES OUTILS EFFICACES
L’Hôpital de Hull a conçu de nombreux
outils : conférences de sensibilisation visant
à ce que tout le personnel au chevet des
patients sache comment déterminer un
éventuel donneur d’organes, une bannière
colorée attire vers un kiosque d’information et
il existe un comité de don d’organes très actif.
Au CHUM, une bannière en forme de ruban
vert est déployée sur la porte du bureau des
infirmières de liaison en don d’organes et
de tissus, près de l’auditorium Rousselot.
Sous peu, ces affiches autoportantes se
retrouveront dans les entrées principales
des trois hôpitaux du CHUM. Le comité
de Hull a créé et amélioré un algorithme
d’identification des donneurs potentiels
qui indique la marche à suivre : patient de
tout âge avec atteinte neurologique grave
et irréversible, intubé sous ventilation
mécanique, sont les critères décrits pour
que le soignant appelle l’infirmière de liaison
en don d’organes et Québec-Transplant,
lesquels prendront en charge la suite du
processus. Un tel algorithme (ci-dessous)
existe au CHUM depuis 2007 et est remis aux
équipes des soins intensifs, des urgences et
de toute unité susceptible d’accueillir des
donneurs potentiels. Il est distribué aux
infirmières, résidents et médecins lors des
présentations et formations et au personnel
dans les kiosques tenus pendant la Semaine
annuelle du don d’organes et de tissus. En
outre, mesure simplissime et ô combien utile
et efficace, le dossier du patient indique si le
patient a signé sa carte d’assurance maladie,
cela dissipe rapidement les doutes et permet
de gagner un temps précieux.
UN RÔLE POUR
L’INHALOTHÉRAPEUTE
À l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
on a insisté sur la sensibilisation des
inhalothérapeutes : après tout, ce sont eux
qui intubent les patients et ils apprennent
avant tout le monde la gravité du pronostic.
À eux d’en informer l’infirmière-ressource
et Québec-Transplant. Cette tâche a été
ajoutée à leur feuille de travail. Au CHUM, la
détermination des donneurs potentiels par
les inhalothérapeutes devrait se concrétiser
d’ici l’été.
DISTINGUER L’ANNONCE DE LA
MORT DE LA DEMANDE DE DON
Au CHU de Sherbrooke tout comme au
CHUM, c’est le découplage de l’approche
aux familles qui a fait l’objet d’une réflexion,
donnant de meilleurs résultats. L’annonce
de la mort prochaine du patient et la
demande du don d’organes ne doivent pas
être réalisées par la même personne ni dans
la même rencontre : c’est ce qu’on appelle
le découplage. C’est d’habitude le médecin
qui annonce la mauvaise nouvelle, mais
ce peut être une infirmière, l’infirmière de
liaison en don d’organes, l’intervenant en
soins spirituels ou toute autre personne
qui a établi un lien particulier avec les
Pensez don
les meilleures pratiques

| CHUMAGAZINE | 5
proches qui discutent du don d’organes. Preuve de l’évolution des
mentalités : de plus en plus de familles ressentent le besoin de donner
un sens au deuil qu’elles vivent par le don des organes et des tissus
de l’être aimé, les soignants peuvent donc souvent profiter de cette
ouverture d’esprit.
UN EXEMPLE MULTICULTUREL
Le DVD raffine encore plus cette méthode de découplage en décri-
vant un cas particulier survenu à l’Hôpital de Montréal pour enfants
du CUSM, celui d’un bébé inuit de 20 mois chez qui on a prélevé le
cœur. Toute une équipe a entouré les parents, ici pour simplement
écouter et s’informer de la culture et des coutumes liées à la mortalité,
là pour expliquer les nuances entre un cœur qui bat encore et la mort
du cerveau, une famille déchirée par la peine et une autre, gonflée
d’espoir, des notions contradictoires difficiles à saisir en ces moments
pénibles. Les besoins spirituels ont été pris en charge par les interve-
nants qui ont créé un rituel funéraire inspiré de la culture et satisfai-
sant la famille. Il a aussi fallu rassurer les parents quant à l’intégrité du
corps qui serait transporté dans le Grand-Nord et exposé là-bas. On
a même pensé à ne pas mettre le logo de Québec-Transplant sur les
lettres de suivi pour préserver la confidentialité du processus.
LA NOUVELLE PRATIQUE DU DDC
Enfin, la vidéo décortique le tout dernier processus, celui du
prélèvement par suite de décès cardiocirculatoire (DDC), décrit à partir
d’une équipe de l’Hôpital Saint-François d’Assise du CHUQ, expliqué
en partie par le Dr Jean-François Lizé, pneumologue et intensiviste du
CHUM, également directeur médical adjoint à Québec-Transplant.
On y suit un patient aux soins intensifs qui présente tous les critères
pour un don après décès par arrêt cardiocirculatoire (DDC) (voir
encadré), dont les gestes chirurgicaux de prélèvement diffèrent d’un
don après décès neurologique (DDN).
Première étape, la famille demande l’arrêt des traitements après
plusieurs semaines angoissantes et consent au don d’organes. Une
équipe est ici aussi mobilisée : la famille répond à un questionnaire
sociomédical indiquant, entre autres, qu’elle souhaite être présente au
moment de l’arrêt des traitements. Tout le processus est révisé, depuis
la demande de matériel spécifique jusqu’aux prélèvements, et le rôle
de chaque intervenant est précisé. En salle d’op, les toutes premières
minutes sont cruciales, car il faut faire vite et bien : couper les gros
canaux, réfrigérer les organes, disséquer, effectuer les prélèvements.
Un premier cas de don d’organes après arrêt cardiocirculatoire a
été réalisé avec succès à l’Hôpital Notre-Dame en juillet 2010.
Suite en page 6
Manon Levesque et Marie-Josée Lavigne, les deux infirmières de liaison en don d’organes et
de tissus du CHUM
Pierre Martel, greffé d’un rein
UNE DEUXIÈME VIE
grâce à un don d’organe
En voyage en Chine, Pierre Martel ne se doutait pas que sa vie
était sur le point de basculer. Parce qu’il avait des symptômes
similaires à la grippe, un pharmacien lui vend un médicament qui
n’aura pas l’effet escompté. De retour au pays, il apprend plutôt
qu’une bactérie mangeuse de chair s’est attaquée à un de ses reins
et s’est même propagée dans son sang. C’est le choc pour lui, sa
femme et ses enfants !
Commencent alors les pénibles traitements de dialyse qui
demandent tant de temps, sans compter les médicaments qu’il
doit prendre chaque jour. Lorsqu’une greffe de rein devient
nécessaire, Pierre Martel doit rester encore de longs mois sur la
liste d’attente. L’histoire du grand jour n’est pas banale. En 2003,
alors qu’il assiste à un match de hockey, son téléavertisseur sonne,
mais Pierre ne l’entend pas à cause du bruit ambiant. Qu’à cela
ne tienne : un message au micro de l’aréna lui demande de se
présenter à l’extérieur ! Des policiers l’attendent pour le conduire
au CHUM : on a enfin un rein pour lui et comme le donneur vient
tout juste de décéder, chaque minute compte! Pas le temps de se
demander ce que les gens vont penser de lui, si vivement emmené
par les policiers ! Il est greffé à l’Hôpital Notre-Dame par le Dr Azemi
Baraba, une grande opération qui a dû avoir son lot de mauvais
moments, mais dont il préfère ne garder que de bons souvenirs. Le
Dr Michel Pâquet assure le suivi. Il aura fallu sept ans à Pierre Martel
pour recevoir le plus précieux des cadeaux ! Aujourd’hui âgé de
62 ans, il se porte bien. Il a pris sa retraite, profite pleinement de la
vie et donne régulièrement des conférences sur le don d’organes.
Il demeure un grand amateur de voyages et passe maintenant ses
hivers en Floride entouré des siens. Une histoire qui démontre à
quel point le don d’organes est vital !
Témoignage
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%