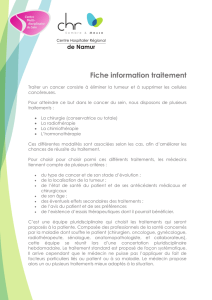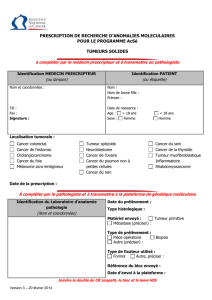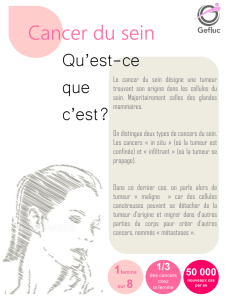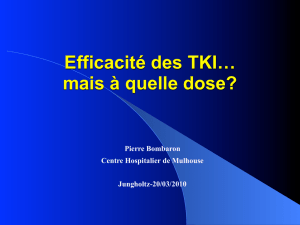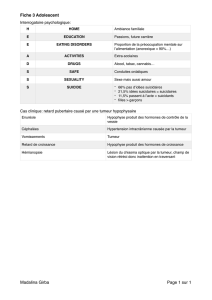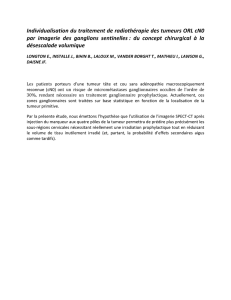les mélanomes malins ano-rectaux a propos de deux cas

Médecine du Maghreb 1996 n°60
RÉSUMÉ
Les auteurs rapportent deux cas de mélanome malin
anorectal colligés à la Clinique Médicale B au CHU Ibn
Sina. C’est une affection rare, de mauvais pronostic. La
chirurgie reste actuellement le seul volet thérapeutique.
SUMMARY
The authors re p o r t two cases of anorectal malignant
melanoma, seen and managed in the service of Mede-
cine B. It’s a very uncommun affection of bad pronostic.
At the present time, the surgical management is the
only therapeutical attitude.
reste du bilan d’extension est négatif. Mais le patient est
décédé quelques jours après son admission à l’hôpital.
Observation 2 : Mr K. MBAREK. Âgé de 64 ans hospita-
lisé en Juillet 1993 pour des proctalgies qui durent depuis
une année, accompagnées de rectorragies. L’examen proc-
tologique en position genu pectorale révèle une tumeur
bourgeonnante à 5 cm de la marge anale occupant l’hémi
circonférence gauche du rectum, de 4 cm de diamètre.
L’examen anatomo-pathologique d’un fragment biopsique
de la tumeur est en faveur d’un mélanome malin achro-
mique.
Le lavement baryté révèle un aspect radiologique en faveur
d’un processus tumoral bourgeonnant ano-rectal situé à
5 cm de la marge anale et étendue sur 4 cm.
L’échotomographie abdominale montre une paroi rectale
épaissie d’allure tumorale avec présence d’adénopathies
satellites ; le foie est homogène. La radio pulmonaire est
normale. L’intervention chirurgicale a consisté à une large
résection locale de la tumeur. Une chimio-radiothérapie
était prévue, mais le malade a développé rapidement des
métastases pulmonaires.
DISCUSSION
Le mélanome malin ano rectal (MMAR) est une affection
rare (1 à 3% de tous les mélanomes). On l’estime de 0,25 à
1,25% de toutes les tumeurs anales (1).
Il survient à tous les âges avec un pic de fréquence vers la
6ème décade. Il existe une légère prépondérance féminine,
alors que dans notre série nos deux malades sont de sexe
masculin et âgés respectivement de 73 et 64 ans.
Sur le plan étiopathogénique, si l’action des radiations
solaires ne peut être retenue dans la localisation anale,
l’hypothèse d’une irritation chronique entretenue par le
traumatisme de la défécation paraît bien artificielle (2).
Le diagnostic du MMAR reste dans la plus part des cas très
tardif. Le délai entre les signes révélateurs et la consulta-
tion est variable (Tableau 1).
LES MÉLANOMES MALINS ANO-RECTAUX
A PROPOS DE DEUX CAS
N. BENZZOUBEIR, H. KRAMI, N. DAFIRI, H. OUAZZANI, M. SOUALHI,
L. OUAZZANI, F. FADLI, Z. HAKAM, F; SOUIDINE, A. BENNANI*.
* Clinique Médicale B. CHU - Avicenne - Rabat.
Les mélanomes malins (MM) sont des tumeurs malignes
développées aux dépens du système pigmentaire. La loca-
lisation ano-rectale se caractérise par sa rareté : 3ème rang
après les localisations cutanées et oculaires, et par son pro-
nostic extrêmement sombre. A propos de deux observa-
tions colligées à la Clinique Médicale B à Avicenne, nous
voudrions souligner les principales caractéristiques de cette
affection.
OBSERVATIONS
Observation 1 : Mr T. AHMED. Âgé de 73 ans est hospi-
talisé en Juillet 1991 pour des proctalgies évoluant depuis
1 mois accompagnées de rectorragies, d’émissions glaireu-
ses et d’un prurit anal. On découvre à l’examen proctolo-
gique une énorme tumeur bourgeonnante de consistance
pierreuse, de couleur noirâtre de 10 cm de diamètre. Cette
tumeur anale circonférentielle et sténosante empêchait la
pratique d’un toucher rectal. L’examen somatique décou-
vre deux volumineuses adénopathies inguinales bilatérales,
dures et fixées par rapport au plan profond.
L’examen anatomo-pathologique d’un fragment biopsique
de la tumeur anale montre qu’il s’agit d’un mélanome. Le

Médecine du Maghreb 1996 n°60
Auteurs Nb de cas Délais moyens (en mois)
Angeras (3) 11 6
Huguier (7) 17 4,5
Pack (9) 20 8
Notre série 2 6,5
Les signes révélateurs sont dominés par les manifestations
proctologiques (tableau 2).
La constatation par le patient d’adénopathies inguinales
n’est pas rare (7 fois sur 49 dans le travail de stearns) (11).
Tableau 2 : Signes fonctionnels et généraux rapportés
par PYPER (14 patients), CHIU (34 patients),
notre série (2 patients)
Signes cliniques Pyper (10) CHIU (6) Notre série
Rectorragies 12 (85,7%) 24 (70%) 2 (100%)
Constipation 7 (50%) 10 (29%) 0
Douleurs anales 6 (42,8%) 16 (47%) 2 (100%)
Masse 4 (28,5%) 13 (38%) 1 (50%)
Amaigrissement 4 (28,5%) 2 (6%) 1 (50%)
Macroscopiquement ; l’aspect habituellement observé du
MMAR est celui d’une tumeur végétante souvent polypoï-
de et dure. Le siège le plus fréquent est la partie haute du
canal anal, le pôle inférieur arrivant à la ligne pectinée, le
pôle supérieur s’étendant au bas rectum. La taille de la
tumeur varie de quelques millimètres à plusieurs centimè-
tres (2) (dans notre série, elle atteignait respectivement 10
et 4 centimètres).
Rarement il envahit toute la circonférence et devient sté-
nosant (observation 1), le plus souvent il s’étend dans le
rectum (observation 2), ou s’extériorise par l’orifice anal
sous forme d’une masse bourgeonnante (observation 1).
L’aspect macroscopique de la lésion permet dans la majo-
rité des cas d’évoquer hautement le diagnostic du MM.
Toutefois une thrombose hémorroïdaire ou un prolapsus
étranglé peuvent poser dans certains cas quelques diff i -
cultés diagnostic. Par ailleurs, l’absence de pigmentation
peut faire méconnaître l’éventualité d’un MM devant
n’importe quelle lésion bourgeonnante ano-rectale. Dans
tous les cas, le diagnostic ne peut être qu’histopathologi-
que. Cependant, la biopsie comporte un risque, elle est
considérée comme traumatisante donnant un coup de fouet
à l’évolution de la tumeur; Ce qui explique qu’un certain
nombre d’auteurs ont proposé un cytodiagnostic par racla-
ge ou par ponction de toutes les tumeurs brunâtres (8).
L’extension du MMAR se fait de proche en proche, mais
aussi par voie lymphatique et sanguine. Ainsi, il est habi-
tuel de distinguer les stades I (lésion limitée au canal anal),
II (présence de métastases viscérales essentiellement le
foie, le poumon, le cerveau et l’os) (2). D’une façon géné-
rale, le pronostic du MM cutané dépend essentiellement de
l’épaisseur de la tumeur (5).
C’est ainsi que pour une certaine épaisseur inférieure à
0,75 mm il n’y a aucune métastase, par contre ce pour-
centage atteint 84% pour une lésion de plus de 3 mm
d ’ é p a i s s e u r. Or les MM de la région anale sont habituel-
lement découverts très tardivement, ceci explique l’échec
thérapeutique dans la mesure où l’on est, lors du diagnostic
initial devant une lésion déjà dépassée.
Les moyens thérapeutiques sont représentés essentielle-
ment par la chirurgie. L’acte le plus réalisé est l’amputation
abdomino-périnéale (AAP) avec curage ganglionnaire
inguinal et pelvien. D’autres thérapeutiques ont été
essayées (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie),
mais leurs résultats restent décevants.
La plupart des séries de la littérature font surtout état de
traitements chirurgicaux : HUGUIER et LUBOINSKI (7)
ont rapporté 17 malades, avec une survie moyenne de 14
mois ; 4 malades étaient en vie plus de 36 mois après le
traitement, 2 patients traités par irradiation seule ont sur-
vécu 6 et 19 mois. BOLIVAR et Coll. (4) ont présenté deux
observations avec des survies de 4 et 5 ans après A.A.P.
Dans la série de 36 patients de WANEBO et Coll (12), la
médiane de survie était de 21 mois après exérèse localisée
et de 7 à 14 mois en cas d’A.A.P.
CONCLUSION
Les MMAR sont des tumeurs rares. Malgré leur aspect
macroscopique caractéristique, leur diagnostic est généra-
lement tardivement porté. Leur pronostic reste redoutable
surtout lié à l’évolution métastatique. La chirurgie reste la
principale arme thérapeutique.
LES MÉLANOMES ANO-RECTAUX… 17

Médecine du Maghreb 1996 n°60
N. BENZZOUBEIR, H. KRAMI, N. DAFIRI, H. OUAZZANI, M. SOUALHI,
L. OUAZZANI, F. FADLI, Z. HAKAM, F; SOUIDINE, A. BENNANI
18
BIBLIOGRAPHIE
1 - R. ALAOUI et Coll.
Le mélanome ano rectal primitif.
Med Chir. Dig. 1987, 16 : 351-353.
2 - M. AMOURETTI et Coll.
Les mélanomes malins ano-rectaux.
M.C.D. - 1984 - 13 - n°1 : 47-49
3 - ANGERAS et Coll.
Primary anorectal malignant melanome.
Journal of surgical oncology, 1983, 22 : 261-264.
4 - J.C. BOLIVAR et Coll.
Melanoma of the anorectal region.
Surg. Gynecol. Obstet. 1982, 154 - 337-341.
5 - A. BRESLOW.
Pronostic des mélanomes malins : influence de l’épaisseur de la tumeur et
des niveaux d’invasion.
C.M., 28-4-1979 : 101-117.
6 - Y.S. CHIU et Coll.
Malignant melonoma of the anorectume.
Dis. Col. Rect. 1980, 23, 2 : 122-124.
7 - M. HUGUIER et Coll.
Les mélanomes malins ano rectaux.
Arch. Fr Mal App. Dig. 1973, 62 : 579-590.
8 - R. LAUMONIER et Coll.
Mélanomes malins du rectum glandulaire.
Arch. Fr. App. Dig. 1962, 51 : 700-705.
9 - G.T. PACK et Coll.
End results in the treatment of malignant melanoma.
Ann. Surg. 1952, 136 : 905-911.
10 - P.C. PYPER et Coll.
Melanome of the anal canal.
Br. J. Surg. 1984, 71, 671-672.
11 - M.W. STEARNS.
Malignant melanoma In : Néoplasms of the colon, rectum and anus.
Wilcy. New York, 1980, 123.
12 - H.J. WANEBO et Coll.
Anorectal melanome.
Cancer, 1981, 47, 1891-1900.
1
/
3
100%