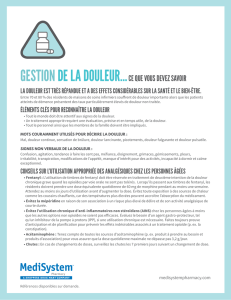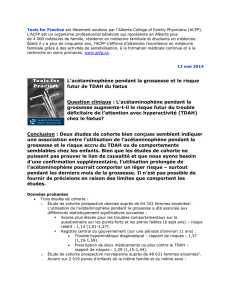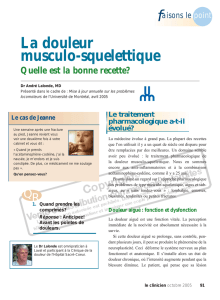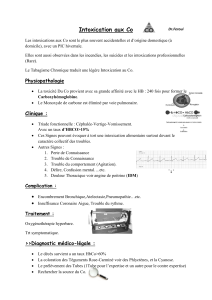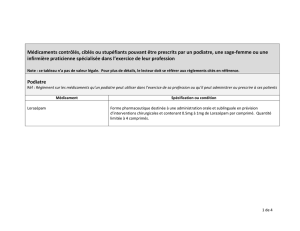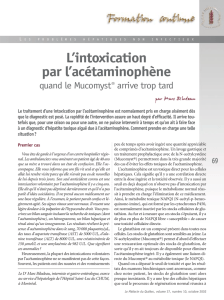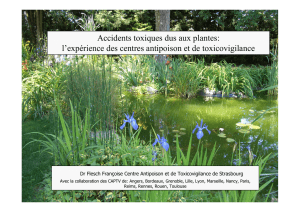L`acétaminophène, pas si banal que ça

www.ProfessionSante.ca | cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 1
✓ Connaître la réglementation actuelle
sur l’acétaminophène.
✓ Présenter les statistiques d’intoxications
du Centre antipoison du Québec.
✓ Réviser les mécanismes de toxicité de
l’acétaminophène.
✓ Reconnaître les signes et symptômes
d’intoxication aiguë ou chronique à
l’acétaminophène.
✓ Savoir quand et à qui adresser
un patient présentant des signes et
des symptômes d’intoxication à
l’acétaminophène.
Objectifs pédagogiques
Publié grâce à une subvention sans restrictions de
Révision scientique :
René Blais, M.D., FRCPC, ABMT,
directeur médical du Centre antipoison
du Québec
Pierre-André Dubé
B. Pharm., M. Sc.,
pharmacien et
responsable scientique
en toxicologie clinique
au Centre de toxicologie
du Québec, INSPQ
Avec plus de 430produits différents sur le mar-
ché canadien contenant de l’acétaminophène,
ce dernier est le médicament en vente libre le
plus facilement accessible pour tous les groupes
d’âge1. On peut le retrouver comme ingrédient
actif unique dans plusieurs produits de teneurs
et de formats différents (Tableau I) ou en asso-
ciation avec un ou plusieurs produits contre le
rhume, la grippe ou les allergies (dextrométhor-
phane, phényléphrine, pseudoéphédrine, anti-
histaminiques), des opioïdes (codéine ± caféine,
oxycodone, tramadol) et des relaxants muscu-
laires (méthocarbamol). Dans les produits com-
binés pour adultes, on retrouve généralement
300 mg, 325 mg ou 500mg d’acétaminophène
par unité posologique.
L’acétaminophène est indiqué pour le traite-
ment de la douleur légère à modérée et pour la
réduction de la fièvre. Il est considéré comme le
médicament de premier choix pour la gestion de
l’arthrose et de la fièvre chez les enfants2. En
pédiatrie, des doses d’acétaminophène de
10à15mg/kg/dose toutes les 4 à 6 heures par
voie orale ou rectale sont généralement considé-
rées comme sûres et efficaces3. On recommande
une dose cumulative maximale de 90mg/kg/jour
chez l’enfant ou de 75mg/kg/jour chez l’enfant
fiévreux de moins de six ans. Chez l’adulte, les
doses usuelles varient entre 325 mg et 1000mg
toutes les 4 à 8 heures par voie orale ou rectale,
avec un maximum de 4 g/jour.
Réglementation
Au Québec, selon le Règlement sur les conditions
et modalités de vente des médicaments, l’acéta-
minophène est inscrit à l’annexe III, donc vendu
en pharmacie sous le contrôle et la surveillance
constante d’un pharmacien5. Selon ce même
règlement, l’acétaminophène devient hors
annexe (peut donc être vendu hors pharmacie)
lorsque disponible sous forme pharmaceutique
destinée à une administration par voie orale,
dont le format de conditionnement contient
moins de 25unités posologiques de 325mg ou
moins (total 8125mg) et vendue en emballage
unique comprenant un seul format de condition-
nement. L’acétaminophène est donc disponible
en petits formats dans les dépanneurs et les
épiceries, mais le format de plus de 24compri-
més n’est disponible qu’en pharmacie.
Depuis l’automne2010, tous les produits dis-
ponibles sans ordonnance contenant de l’acéta-
minophène doivent satisfaire à la Ligne directrice
de Santé Canada dite « Norme d’étiquetage pour
l’acétaminophène6 ». Cette norme d’étiquetage
détermine les ingrédients acceptables, les poso-
logies et les allégations permises pour ces pro-
duits, ainsi que le caractère d’imprimerie, les
modes d’emploi et les mises en garde spécifiques
aux ingrédients qui seront requis sur les étiquet-
tes. Pour les formulations dites « pédiatriques »,
le format de l’emballage doit être d’au plus 1,92g
pour les unités posologiques de 80mg et de 3,2g
pour celles de 160mg, mais aucune limite n’est
proposée pour les produits destinés aux adultes.
Ainsi, au Québec, une formulation destinée aux
adultes et vendue en pharmacie n’aura aucune
limite de quantité par format, par exemple
200 comprimés de 500mg (100g) (TableauI),
dans la mesure où le format respecte la norme
d’étiquetage de Santé Canada.
Ces dernières années, plusieurs pays ont
adopté différentes approches afin de réduire
l’incidence des intoxications à l’acétamino-
phène.
En 1998, le Royaume-Uni a adopté une poli-
tique pour restreindre le contenu d’acétamino-
phène dans les emballages vendus hors phar-
macie à un maximum de 8g, et à un maximum
de 16g lorsque vendu en pharmacie7,8. Cette
politique encadrait également les produits
contenant de l’acétaminophène en association
avec d’autres médicaments.
En mars2009, l’Allemagne a adopté une
politique pour restreindre la vente d’acétamino-
phène en pharmacie uniquement, autorisant un
maximum de 10g par emballage7.
En juin2009, la Food and Drug Administration
(FDA) américaine a créé un comité consultatif
sur la problématique de santé publique de l’in-
suffisance hépatique induite par l’intoxication
non intentionnelle à l’acétaminophène9. Afin de
réduire les intoxications involontaires à l’acéta-
minophène en vente libre, le comité a émis, en
plus des mesures déjà en cours, les recomman-
dations suivantes :
⦁ Favoriser une meilleure formation du public;
⦁ Améliorer l’étiquetage;
⦁ Limiter la dose quotidienne maximale à
3250mg et à une dose plus faible si plus de
trois boissons alcoolisées sont consommées
quotidiennement;
⦁ Limiter la teneur à 325mg pour les compri-
més à libération immédiate avec une dose
unique maximale de 650mg;
L’acétaminophène,
pas si banal que ça !
as clinique
C
Il est vendredi soir, 20 h 50. Vous recevez
un appel d’une maman très inquiète.
Son jeune garçon de trois ans vient tout
juste de boire au complet la bouteille
de TempraMD nouvellement acquise,
qu’elle avait temporairement laissée
ouverte pour aller chercher une cuillère.
« Est-ce dangereux ? » En tant que
pharmacien, devrait-on diriger la mère
vers le Centre antipoison du Québec,
l’adresser directement à l’urgence ou
bien la rassurer parce que la dose
ingérée n’est pas toxique ?
Tableau I
Formulations simples d’acétaminophène*
Formulation Teneurs Formats
Comprimé 325 mg 24¥; 50; 100; 200; 1000
500 mg 24; 30; 50; 60; 100; 150; 200; 500; 1000
Comprimé 8 heures 650 mg 24; 30; 50; 60; 72; 100; 120; 170; 200
Comprimé 160 mg 18¥; 20¥
325 mg 12¥; 24¥; 50; 100; 120; 200
500 mg 10; 24; 36; 50; 100; 150; 200; 250; 500
Comprimé croquable 80 mg 24¥
160 mg 20¥
Comprimé facile à avaler 500 mg 24; 36; 60; 100; 120; 200
Gélule 500 mg 24; 50; 60; 90; 120
Goutte orale 80 mg/ml 15¥; 24¥
Liquide oral 80 mg/5 ml 100¥
160 mg/5 ml 100¥
Suppositoire 120 mg 4; 12
160 mg 4; 12
325 mg 4; 12
650 mg 4; 12
*Liste non exhaustive. ¥ = disponible hors annexe.
À noter qu’une formulation injectable d’acétaminophène (Ofirmev® 10 mg/ml Sol. inj. IV, fiole 100 ml) est
maintenant homologuée depuis 2010 par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis4.

2 cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 | www.ProfessionSante.ca
⦁ Limiter les options de formulations liquides
pédiatriques à une seule teneur;
⦁ Éliminer les produits contenant de l’acétami-
nophène en association avec d’autres médi-
caments.
Ce comité a également émis des recommanda-
tions pour l’acétaminophène disponible avec
ordonnance médicale :
⦁ Favoriser une meilleure formation du public;
⦁ Améliorer l’étiquetage;
⦁ Utiliser des formats de conditionnement uni-
dose (p. ex., plaquettes thermoformées,
alvéolées);
⦁ Limiter la dose quotidienne maximale à
3250mg;
⦁ Limiter la teneur à 325mg pour les compri-
més à libération immédiate combinant l’acé-
taminophène avec d’autres médicaments
(p. ex., acétaminophène+opioïde).
En juillet 2011, la compagnie pharmaceu-
tique américaine McNeil-PCC a fait parvenir un
avis aux professionnels de la santé à propos de
leur plan de mise en œuvre progressive de nou-
velles mesures conçues pour réduire la possibi-
lité d’une surdose accidentelle d’acétamino-
phène pour leurs produits de marque TylenolMD10.
La première étape fut l’impression de nouvelles
instructions de dosage sur l’emballage de
TylenolMD Extra-Fort vendu aux États-Unis depuis
l’automne 2011, soit :
⦁ prendre 2 comprimés (1000mg) toutes les
6 heures (au lieu de 2 comprimés toutes les
4 à 6 heures);
⦁ ne pas prendre plus de 6 comprimés
(3000mg) en 24 heures, sauf si indiqué par
un médecin (au lieu de 8 comprimés, soit
4000mg, en 24 heures).
À compter de 2012, le fabricant compte éga-
lement réduire les dosages recommandés pour
ses autres produits contenant de l’acétamino-
phène.
Statistiques d’intoxications11,12
Au Québec, les statistiques d’intoxications
proviennent principalement des rapports
annuels du Centre antipoison du Québec
(CAPQ). Ces derniers sont produits à partir des
appels reçus directement du public et des pro-
fessionnels de la santé. Ces statistiques ne
sont donc pas absolues puisqu’elles ne consi-
dèrent que les appels reçus et sous-estiment
généralement le nombre réel d’intoxications
non déclarées au CAPQ. Par contre, elles peu-
vent nous donner une bonne idée de l’impor-
tance d’une problématique de santé publique
à l’échelle provinciale.
Le CAPQ a été consulté pour 1028075 cas
d’intoxications de 1989 à 2010. La répartition
des intoxications est la suivante : produits indus-
triels : 3,76% (n=38670); pesticides : 4,61%
(n=47443); produits domestiques : 46,92%
(n = 482 322); médicaments : 43,21 %
(n=444205).
Cela fait maintenant plus d’une vingtaine
d’années que l’acétaminophène est la première
cause d’intoxication au Québec. Depuis 2004, on
rapporte annuellement une moyenne de 4103
cas d’intoxications à l’acétaminophène, ce qui
représente environ 20% des intoxications d’ori-
gine médicamenteuse et près de 10% de toutes
les intoxications.
Les enfants de 0 à 5ans constituent le
groupe d’âge le plus fréquemment impliqué. Le
pourcentage des intoxications à l’acétamino-
phène dans ce groupe, qui était de 56% en
1990, a progressivement diminué pour s’établir
à 43% en 2009. Il s’agit d’ingestions acciden-
telles dans 82% des cas et d’erreurs thérapeu-
tiques dans 17% des cas. Heureusement, plus
de 85% des expositions à l’acétaminophène
rapportées dans ce groupe concernent des doses
ingérées inférieures à la dose toxique et ne
nécessitent donc aucun traitement. En effet, la
plupart des jeunes enfants ingèrent des formes
posologiques pédiatriques d’acétaminophène
qui contiennent, pour la plupart, des quantités
totales inférieures aux doses toxiques pour la
majorité des enfants et donnent rarement lieu à
des intoxications significatives.
Chez les enfants de 5 à 12ans, le CAPQ fait
état de 123cas rapportés en 2009, dont la
plupart étaient accidentels. On note cepen-
dant 15intoxications intentionnelles chez les
moins de 12ans.
La situation est beaucoup plus alarmante
chez les 12 à 25ans. En effet, les adolescents
et les jeunes adultes représentent 21% de
toutes les intoxications par ce produit et plus
de 75% de ces expositions sont intentionnel-
les. De fait, l’acétaminophène, un médicament
qui leur est facilement accessible, est en
cause dans près de 34% de toutes les intoxi-
cations médicamenteuses volontaires rappor-
tées dans ce groupe d’âge.
Le pourcentage d’intoxications chez les 25
à 64ans, qui était de 12,3% en 1990, a forte-
ment augmenté, pour atteindre 23,4% en
2009. Il s’agit d’ingestions intentionnelles
dans 69% des cas et d’erreurs thérapeutiques
dans 18% des cas. Contrairement aux exposi-
tions accidentelles de l’enfant qui sont, la
plupart du temps, bénignes, les intoxications
intentionnelles chez les adolescents et les
adultes nécessitent des soins en milieu hospi-
talier dans près de 64% des cas, alors que les
victimes d’erreurs thérapeutiques doivent
consulter dans plus de 40% des cas.
Parmi les 65 ans et plus, seulement
110 intoxi cations ont été rapportées au CAPQ
en 2009. Il s’agissait principalement d’inges-
tions intentionnelles dans 40% des cas et
d’erreurs thérapeutiques dans 37% des cas.
Depuis 2003, parmi les 31décès résultant
d’une intoxication à l’acétaminophène rappor-
tés au CAPQ, 9 (29%)sont survenus au cours
de 2009 seulement.
Physiopathologie13-16
Le métabolisme de l’acétaminophène s’effec-
tue essentiellement au niveau hépatique. Sa
biodisponibilité orale est d’environ 75 % sui-
vant le premier passage hépatique. Les deux
voies métaboliques principales qui sont impli-
quées dans le métabolisme de l’acétamino-
phène sont la glucuroconjugaison et la sulfo-
conjugaison (figure 1). La troisième voie
métabolique est catalysée principalement
par l’enzyme CYP2E1 (mais aussi CYP1A2 et
CYP3A4) du cytochrome p450. L’acétami-
nophène est ainsi métabolisé par désacétyla-
tion et N-hydroxylation.
Le métabolite N-acétyl p-benzoquinone imine
(NAPQI) est l’intermédiaire toxique de l’acétami-
nophène. À dose thérapeutique d’acétamino-
phène, le NAPQI est rapidement neutralisé par
une réaction avec le glutathion endogène, puis
éliminé dans l’urine à la suite d’une réaction de
conjugaison avec la cystéine et l’acide mercap-
turique. Lors d’une intoxication à l’acétamino-
phène, cette voie métabolique gagne en impor-
tance par saturation de la glucuroconjugaison et
de la sulfoconjugaison. Dans l’éventualité où les
concentrations de glutathion deviennent insuffi-
santes pour neutraliser le NAPQI, ce dernier peut
générer une toxicité cliniquement significative.
L’adduction du NAPQI aux protéines cellulaires a
pour conséquence de modifier les structures et
les fonctions de ces dernières. Ainsi, le NAPQI
perturbe l’homéostasie calcique, génère une
perte d’ATP et de l’œdème cellulaire, produit des
radicaux réactifs de l’oxygène et de la nitrotyro-
sine avec peroxydation lipidique. On assiste
ensuite à une augmentation de la perméabilité
des mitochondries, qui entraînera rapidement la
mort cellulaire. Cela entraîne ainsi une nécrose
centrolobulaire et, finalement, une hépatite cyto-
lytique. Une atteinte rénale découlant du même
mécanisme d’action est également possible.
Selon certains auteurs, les patients souf-
frant d’alcoolisme chronique, de malnutrition,
d’anorexie, de boulimie, du sida, de fibrose kys-
tique ou de jeûne prolongé pourraient présenter
des concentrations de glutathion endogène
plus faibles que la normale et être ainsi plus
susceptibles de réagir négativement à des
doses suprathérapeutiques d’acétaminophène.
Ces affirmations constituent cependant une
zone grise dans la littérature médicale. En
effet, d’autres recherches montrent plutôt un
glutathion cellulaire augmenté lors de mala-
dies hépatiques, accompagné ou non d’une
diminution de l’activité enzymatique des cyto-
chromes hépatiques. Étant donné l’ambiguïté
actuelle des données et jusqu’à ce que d’autres
études clarifient ces hypothèses, les toxicolo-
gues considèrent généralement ces facteurs
comme augmentant le risque d’hépatoxicité
lors d’une intoxication à l’acétaminophène.
Somme toute, trois mécanismes de toxicité ont
été proposés à propos de l’acétaminophène :
1 mécanismes de détoxication surchargés;
2 induction enzymatique (p. ex., prise régulière
d’isoniazide, prise chronique d’alcool);
3 circonstances favorisant la déplétion en glu-
tathion (p. ex., facteur génétique, intoxica-
tion, dénutrition, troubles des conduites ali-
mentaires ou alcoolisme chronique).
Signes et symptômes de
l’intoxication16,17
On peut classifier l’intoxication à l’acétamino-
phène en troiscatégories principales
1 ingestion unique : ingestion en une seule
dose ou ingestion de doses multiples durant
moins de 8heures;
2 ingestion échelonnée : ingestion de doses
multiples durant plus de 8heures, mais
moins de 24heures ou ingestion d’acétami-
nophène dont l’heure est inconnue ou suspi-
cion d’ingestion d’acétaminophène;
3 ingestion suprathérapeutique : ingestion
répétée de doses suprathérapeutiques durant
plus de 24heures ou ingestion répétée de
doses thérapeutiques à intervalles trop rap-
prochés durant plus de 24heures.
La symptomatologie de l’intoxication aiguë à
l’acétaminophène est résumée et présentée
dans le Tableau II.
Traitement
Le traitement de l’intoxication à l’acétamino-
phène se résume principalement en une décon-
tamination gastro-intestinale adéquate à l’aide
Tableau II
Stades d’intoxication aiguë à l’acétaminophène
Stade Durée après Effets observés
l’ingestion (h)
I < 24 h ⦁ Asymptomatique, nausées, vomissements, anorexie
(enfants surtout), diaphorèse
⦁ Début de l’augmentation des taux d’AST en premier, puis
d’ALT (18 à 24 heures après l’ingestion)
II 24 h à 72 h ⦁ Résolution ou non des symptômes initiaux
⦁ Douleur abdominale dans le quadrant supérieur droit,
tachycardie
⦁ Poursuite de l’augmentation des taux d’AST et d’ALT et,
dans des intoxications sévères, des taux de bilirubine
et du RNI
III 72 h à 96 h ⦁ Insuffisance hépatique et/ou rénale, pancréatite, ictère,
coagulopathie, hypoglycémie, encéphalopathie hépatique
progressive, acidose métabolique
⦁ Atteinte des taux maximaux en AST, ALT, bilirubine et RNI
⦁ Par contre on peut observer une diminution des taux d’AST
et d’ALT à la suite de la destruction des cellules hépatiques,
accompagnée d’une hausse du RNI.
IV > 120 h ⦁ Résolution complète des symptômes et des insuffisances
ou évolution vers une insuffisance de multiples organes
(parfois fatale)
Adaptation et mise à jour de la référence16.
NHCOCH3
OG
OOHOH
SG
OHOH
NHCOCH3
CYP2E1
Glucuronide Acétaminophène
Conjugé avec
glutation
NAPQI Hydroxyde
Sulfate
NHCOCH3
NHCOCH3NHCOCH3
NHCOCH3
OSO3
OH
OH
CYP2A6
1 %
25 %60 %
12-15 %
Figure 1
Voies métaboliques de l’acétaminophène
Reproduction autorisée par le Bulletin d’information toxicologique16.

www.ProfessionSante.ca | cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 3
du charbon de bois activé (CharcodoteMD) et/ou
de l’administration de l’antidote de l’acétamino-
phène, à savoir la n-acétylcystéine (NAC,
MucomystMD) par voie intraveineuse. Ces traite-
ments doivent être commencés le plus tôt possi-
ble afin d’éviter une hépatotoxicité qui pourrait
aller jusqu’à une greffe hépatique, ou même
entraîner le décès.
L’antidote n-acétylcystéine permettrait prin-
cipalement de maintenir ou de rétablir les
concentrations hépatiques de glutathion, afin de
favoriser sa conjugaison au NAPQI ainsi que l’éli-
mination rénale du complexe non toxique NAPQI-
glutathion (acide mercapturique). La n-acétyl-
cystéine aurait aussi une capacité de sulfatation,
en fournissant un groupement sulfhydrile. De
plus, on croit que la n-acétylcystéine pourrait
agir à titre de substitut du glutathion et ainsi se
combiner directement avec le NAPQI pour le
détoxiquer.
Le CAPQ a récemment publié en détail son
protocole de traitement de l’intoxication à l’acé-
taminophène en milieu hospitalier17. Cependant,
ce protocole s’adresse principalement aux pro-
fessionnels en établissements de santé. Alors,
que peut faire un pharmacien en milieu commu-
nautaire ?
En 2006, l’American Association of Poison
Control Centers (AAPCC) a publié un consensus
basé sur les données probantes quant à la ges-
tion des intoxications à l’acétaminophène en
milieu ambulatoire par les spécialistes d’un cen-
tre antipoison18. De ce consensus ressortent les
recommandations générales suivantes :
1. L’histoire initiale devrait inclure l’âge du
patient et son intention, la formulation spé-
cifique et la dose d’acétaminophène, le type
d’ingestion (simple ou multiple), la durée
d’ingestion, ainsi que la médication conco-
mitante, s’il y a lieu;
2. Tout patient ayant déclaré s’être automutilé,
étant soupçonné de s’être automutilé, ou qui
est victime d’une administration malicieuse
d’acétaminophène devrait être adressé
immédiatement à un service d’urgence,
indépendamment de la quantité ingérée;
3. Tout patient présentant des signes compati-
bles avec une intoxication à l’acétamino-
phène (par exemple des vomissements répé-
tés, une douleur abdominale dans le qua-
drant supérieur droit ou des changements de
l’état mental) doit être adressé immédiate-
ment à un service d’urgence pour une éva-
luation médicale;
4.
Les patients adressés à l’urgence doivent
avoir une concentration sérique d’acétamino-
phène déterminée immédiatement après leur
arrivée ou dès que possible, soit ≥ 4 heures
après l’ingestion, mais pas trop tardivement
pour entamer le traitement < 8 à
10 heures après l’ingestion. Si le temps d’in-
gestion est inconnu, le patient doit être immé-
diatement dirigé vers un service d’urgence;
5. Le charbon de bois activé peut être envisagé
si : 1) un spécialiste d’un centre antipoison
soutient son utilisation préhospitalière;
2) une dose toxique d’acétaminophène a été
ingérée; et 3) moins de 2 heures se sont
écoulées depuis l’ingestion unique.
6. La décontamination gastro-intestinale pour-
rait particulièrement être utile si l’acétylcys-
téine ne pouvait être administrée dans les
8 heures suivant l’ingestion unique. La
décontamination gastro-intestinale n’est
pas nécessaire suivant une ingestion supra-
thérapeutique.
7. Si le premier contact avec le centre antipoi-
son survient plus de 36 heures après la fin de
l’ingestion et que le patient est asymptoma-
tique, le patient ne nécessite pas une évalua-
tion plus poussée de la toxicité de l’acétami-
nophène.
Les doses toxiques d’acétaminophène sont
les suivantes17,19
⦁ Ingestion unique ou échelonnée
d’acétaminophène :
◾ ≥ 200 mg/kg chez l’enfant < 6 ans;
◾ ≥ 150 mg/kg ou 7,5 g selon le pire scé-
nario chez l’enfant ≥ 6 ans et l’adulte;
⦁ Ingestion suprathérapeutique
d’acétaminophène :
◾ > 90 mg/kg/24 h chez l’enfant ou
> 75 mg/kg/24 h chez l’enfant fiévreux de
moins de 6 ans;
◾ > 4 g/24 h ou > 150mg/kg selon le pire
scénario chez l’adulte;
◾ > 4 g/24 h ou > 100mg/kg selon le pire
scénario chez les patients dont les pro-
blèmes de santé peuvent augmenter la
susceptibilité à la toxicité de l’acétamino-
phène (alcoolisme, jeûne prolongé, traite-
ment à l’isoniazide).
Occasionnellement, des patients plus récal-
citrants aux soins octroyés en milieu hospitalier
signent un formulaire de refus de traitement ou
quittent l’hôpital avant même d’avoir terminé
leur traitement par la n-acétylcystéine (protocole
de 21 heures). Quelles sont alors les options qui
s’offrent aux cliniciens pour tenter malgré tout
un traitement antidotique chez cette clientèle
particulière ? Il est possible, uniquement après
consultation auprès d’un spécialiste du CAPQ,
de poursuivre un traitement par la n-acétylcys-
téine par voie orale en utilisant la formulation
injectable (200mg/ml; 20%) diluée dans du jus
de fruits, une boisson de type soda ou dans de
l’eau, afin d’obtenir une concentration finale de
5%. Le protocole antidotique par voie orale le
plus étudié, d’une durée de 72 heures, est défini
de la façon suivante: une dose de charge de
140mg/kg, suivie d’une dose de maintien de
70mg/kg répétée toutes les 4 heures pour 17
doses supplémentaires20. L’administration de
cet antidote par voie orale peut induire les effets
indésirables suivants: nausées et vomissements
(50%), diarrhée, dysgueusie et, plus rarement,
de l’urticaire21. La présence de vomissements
pourra nécessiter la répétition d’une ou plusieurs
doses, ou l’administration d’un antiémétique
(p. ex., métoclopramide), ou même une réhospi-
talisation. De plus, le charbon activé peut par-
tiellement adsorber l’antidote et ainsi nécessi-
ter de plus fortes doses de ce dernier. Quelle
que soit la voie d’administration de l’antidote,
la n-acétylcystéine peut être poursuivie au-
delà de la durée usuelle du protocole afin de
traiter le patient jusqu’à la diminution des
transaminases (AST, ALT) et du RNI, et jusqu’à
ce que la concentration sérique d’acétamino-
phène soit inférieure à 66 μmol/l21. Le patient
devra donc être réévalué par un médecin en
clinique externe après le traitement et subir
certains examens de laboratoire de contrôle22.
Idéalement, le pharmacien communautaire ne
devrait pas recevoir ce genre d’ordonnance
antidotique, car les patients devraient être
traités en milieu hospitalier, mais des excep-
tions peuvent se présenter, même si ce n’est
pas une situation optimale.
Certains patients pourraient demander
conseil auprès de leur pharmacien avant de
prendre un produit naturel « antidotique » dis-
ponible en pharmacie, afin d’éviter de se pré-
senter à l’urgence. Aucune donnée probante
n’appuie l’utilisation des capsules ou compri-
més de charbon activé ou contenant de l’acé-
tylcystéine, des produits potentiellement en
vente en pharmacie ou sur Internet23. La mor-
bidité et la mortalité qui résultent d’une intoxi-
cation à l’acétaminophène étant non négli-
geables, le pharmacien se doit de refuser la
vente de tels produits aux patients et de diriger
immédiatement ces derniers vers le service
d’urgence le plus proche.
En règle générale, on permettra une reprise
de la médication contenant de l’acétamino-
phène à la suite d’une ingestion suprathéra-
peutique mineure de celui-ci au moins
48 heures après la surdose, si le patient est
demeuré asymptomatique.
Conclusion
L’acétaminophène constitue une cause impor-
tante d’intoxication non seulement au Québec,
mais partout dans le monde. Tout pharmacien
doit savoir reconnaître cette intoxication poten-
tiellement létale et adresser le patient au Centre
antipoison du Québec ou au service médical
d’urgence le plus proche dès qu’une intoxication
est suspectée.
Les pharmaciens sont invités à suivre les
publications conjointes de l’équipe de toxicologie
clinique de l’Institut national de santé publique
du Québec et des professionnels du Centre anti-
poison du Québec figurant sur le portail
Toxicologie clinique, accessibles gratuitement
grâce au lien suivant : http://portails.inspq.
qc.ca/toxicologieclinique/accueil.aspx. ❰
as clinique
C
En interrogeant la mère, on apprend que
le jeune garçon n’a aucune maladie chro-
nique, ne prend aucun médicament et
n’est pas connu pour souffrir d’allergies.
Outre une légère fièvre, il est asymp-
tomatique et s’amuse avec ses jouets.
La bouteille de Tempra en question
contenait 24ml d’acétaminophène d’une
concentration de 80mg/ml, soit un total
de 1920 mg. Pour ce jeune garçon de
15kg, la dose maximale ingérée est de
128mg/kg, inférieure à la dose toxique
établie à 200mg/kg pour son groupe
d’âge lors d’une ingestion unique. Vous
rassurez la mère en lui disant que la dose
ingérée accidentellement par son fils
n’est pas toxique, mais lui demandez de
ne pas lui redonner d’acétaminophène
durant les 48heures prochaines. Par
mesure de prudence, vous lui donnez les
coordonnées du Centre antipoison du
Québec (1800463-5060) et lui conseillez
de contacter un spécialiste en informa-
tion toxicologique.
Diriger
immédiatement le patient
au service d’urgence
le plus près.
Toxicité improbable.
aucune référence et aucun
traitement nécessaires.
Diriger
immédiatement le patient
au service d’urgence
le plus près.
Diriger le patient ou son
représentant à un spécialiste du
Centre antipoison du Québec au
1 800 463-5060.
Intention malveillante, suicidaire
ou présence d’automutilation?
NON
Plus de 36 heures écoulées depuis l’ingestion
et patient asymptomatique ?
NON
Présence de signes d’atteinte hépatique (vomissements
répétés, ictère, douleur abdominale dans le quadrant supérieur
droit, changement de l’état mental)?
NON
Ingestion unique ou échelonnée:
≥ 200 mg/kg chez l’enfant < 6 ans;
≥ 150 mg/kg ou 7,5 g selon le pire scénario
chez l’enfant ≥ 6 ans et l’adulte.
Ingestion suprathérapeutique:
> 90 mg/kg/24 h chez l’enfant ou > 75 mg/kg/24 h chez l’enfant
fiévreux de moins de 6 ans;
> 4 g/24 h ou > 150 mg/kg selon le pire scénario
chez l’adulte ou
> 100 mg/kg selon le pire scénario chez les patients avec des
conditions pouvant augmenter la susceptibilité à la toxicité de
l'acétaminophène (alcoolisme, jeûne prolongé, traitement à
l'isoniazide).
OUI
OUI
OUI
OUI
L’algorithme suivant permet d’orienter le patient
ecommandations au patient
R
Voir page 4 pour
l'entrevue-conseil

4 cahier de FC de L’actualité pharmaceutique | mars 2012 | www.ProfessionSante.ca
uestions de formation continue
Q
Répondez maintenant en ligne sur www.ProfessionSante.ca
1. Santé Canada. Base de données sur les
produits pharmaceutiques. Santé Canada
2010-04-01; [En ligne.] http://webprod.
hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
(Consulté le 2011-08-22.)
2. Canadian Pharmacists Association.
Acetaminophen (CPhA Monograph).
Compendium of Pharmaceuticals and
Specialties, online version (e-CPS) 2009-10;
[En ligne.] www.e-therapeutics.ca (Consulté
le 2011-08-22.)
3. Sullivan JE, Farrar HC. Fever and antipy-
retic use in children. Pediatrics 2011 Mar;
127(3): 580-7.
4. Gray T, Hoffman RS, Bateman DN.
Intravenous paracetamol - An international
perspective of toxicity. Clin Toxicol (Phila)
2011 Mar; 49(3): 150-2.
5. Règlement sur les conditions et modalités
de vente des médicaments. Publications
du Québec 2011-08-01; [En ligne.] www2.
publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamic-
Search/telecharge.php?type=3&file=/P_10/
P10R12.HTM (Consulté le 2011-08-13.)
6. Norme d’étiquetage pour l’acétaminophène.
Santé Canada 2009-09-21; [En ligne] www.
hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/
prodpharma/applic-demande/guide-ld/
label_stand_guide_ld-fra.pdf (Consulté le
2011-08-13.)
7. Bateman DN. Limiting paracetamol pack
size: has it worked in the UK? Clin Toxicol
(Phila) 2009 Jul; 47(6): 536-41.
8. Hawkins LC, Edwards JN, Dargan PI. Impact
of restricting paracetamol pack sizes
on paracetamol poisoning in the United
Kingdom: A review of the literature. Drug
Saf 2007; 30(6): 465-79.
9. Krenzelok EP. The FDA Acetaminophen
Advisory Committee Meeting - What is the
future of acetaminophen in the United
States? The perspective of a commit-
tee member. Clin Toxicol (Phila) 2009
Sep;47(8):784-9.
10. McNeil Consumer Healthcare: Dear
Healthcare Professional letter for new
dosing instructions for Tylenol(R) pro-
ducts. McNeil Consumer Healthcare Fort
Washington, PA 2011; [En ligne.] www.
tylenolprofessional.com/letter_plans_for_
new_dosing_instructions.html (Consulté le
2011-08-22.)
11. Lefebvre L. Acétaminophène : première
cause d’intoxication au Québec. Bulletin
d’information toxicologique 2011-01-26;
[En ligne.] http://portails.inspq.qc.ca/
toxicologieclinique/statistiques-acetami
nophene--premiere-cause-dintoxication-
au-quebec.aspx (Consulté le 2011-08-13.)
12. Lefebvre L. Statistiques générales d’intoxi-
cations 2010 (non publiées); 2011.
13. Tanaka E. In vivo age-related changes in
hepatic drug-oxidizing capacity in humans.
J Clin Pharm Ther 1998 Aug; 23(4): 247-55.
14. Rumack BH. Acetaminophen misconcep-
tions. Hepatology 2004 Jul; 40(1): 10-5.
15. Dart RC. Medical toxicology. 3rd ed.
Philadelphia: Lippincott, Williams &
Wilkins; 2004.
16. Tremblay PY. Mécanismes d’action et de
toxicité de l’acétaminophène. Bulletin
d’information toxicologique 2011-01-26;
[En ligne.] http://portails.inspq.qc.ca/
toxicologieclinique/physiopathologie-meca
nismes-d-action-et-de-toxicite-de-l-aceta
minophene.aspx (Consulté le 2011-08-13.)
17. Dubé PA. Protocole de traitement de l’in-
toxication à l’acétaminophène. Bulletin
d’information toxicologique 2011-01-26;
[En ligne.] http://portails.inspq.qc.ca/
toxicologieclinique/protocole-de-traitement-
de-lintoxication-a-lacetaminophene.aspx
(Consulté le 2011-08-13.)
18. Dart RC, Erdman AR, Olson KR,
Christianson G, Manoguerra AS, Chyka
PA, Caravati EM, Wax PM, Keyes DC, Woolf
AD, Scharman EJ, Booze LL, Troutman WG.
Acetaminophen poisoning: An evidence-
based consensus guideline for out-of-
hospital management. Clin Toxicol (Phila)
2006; 44(1): 1-18.
19. Bailey B, Blais R, Gaudreault P, Gosselin
S, Laliberté M. Les antidotes en toxicologie
d’urgence. 3e éd. Centre antipoison du
Québec; 2009.
20. Smilkstein MJ, Knapp GL, Kulig KW, Rumack
BH. Efficacy of oral N-acetylcysteine in
the treatment of acetaminophen overdose.
Analysis of the national multicenter study
(1976 to 1985). N Engl J Med 1988 Dec 15;
319(24): 1557-62.
21. Howland MA, Hendrickson RG. Antitodes
in depth (A4): N-acetylcysteine. In:
Mcgraw Hill, editor. Goldfrank’s Toxicologic
Emergencies. 9 ed. 2011. p. 500-7.
22. Heard KJ. Acetylcysteine for acetaminophen
poisoning. N Engl J Med 2008 Jul 17;
359(3): 285-92.
23. Burda AT, Ipema HJ, Wahl MS. Self-
treatment of acetaminophen overdose with
dietary-supplement acetylcysteine. Am
J Health Syst Pharm 2011 May 1; 68(9):
786-7.
Références
L’acétaminophène, pas si banal que ça !
Santé publique
Question 1
Lequel de ces énoncés est faux ?
a)
Depuis plus de 20 ans, l’acétaminophène est
la première cause d’intoxication au Québec.
b)
L’acétaminophène est présent dans plusieurs
formulations simples et combinées.
c)
L’antidote utilisé lors d’une intoxication à
l’acétaminophène, la n-acétylcystéine, est
généralement administré par voie orale.
Question 2
Quelle est la principale toxicité redoutée lors
d’une intoxication à l’acétaminophène ?
a) Pancréatite
b) Hépatite
c) Reflux gastro-œsophagien
d) Saignements
Question 3
Lequel de ces énoncés est faux ?
a) L’acétaminophène est principalement éli-
miné par glucuroconjugaison et par sulfo-
conjugaison.
b) L’acétaminophène est 10 fois plus toxique
que son métabolite n-acétyl p-benzoquinone
imine (NAPQI).
c) Un fort inducteur du CYP 2E1 (p. ex., prise
chronique d’isoniazide) peut augmenter la
toxicité de l’acétaminophène en élevant
la production de NAPQI, surtout lors de
la consommation de doses suprathéra-
peutiques d’acétaminophène ou de l’arrêt
récent de l’inducteur/substrat.
d) Chez les adolescents, 75% des intoxications
par acétaminophène sont d’origine inten-
tionnelle.
Question 4
Il a été démontré que les capsules de charbon
activé présentes dans la section des produits
naturels sont très efficaces comme décontami-
Veuillez noter que les articles de formation continue
sont dorénavant valides PENDANT UN AN après leur
publication ou mise en ligne.
L’Ordre des pharmaciens du Québec accor dera 1,5 UFC aux participants
qui auront au moins 6 bonnes réponses sur 8.
Date limite : 8 mars 2013
Adieu télécopieur ! Maintenant, c’est en ligne !
Veuillez noter qu’il n’est désormais plus possible de nous faire parvenir vos formulaires de formation continue par télécopieur.
Vous devez maintenant répondre aux questions de formation continue en ligne, dans le portail Profession Santé.
Vous n’êtes pas encore inscrit?
Vous devez d’abord le faire en vous rendant au www.professionsante.ca
Une fois votre inscription conrmée et activée, vous pourrez faire votre formation continue
en cliquant sur l’onglet «Formation continue», puis sur «FC en ligne».
Pour toute question, veuillez communiquer avec : Francine Beauchamp, coordonnatrice de formation continue,
par téléphone : 514 843-2595, ou par courriel : [email protected]
x
Publié grâce à une subvention sans restrictions de
Suite de la page 3
ntrevue-conseil
E
Voici différentes informations à prendre en considération si vous suspectez une
intoxication à l’acétaminophène, avant de contacter le centre antipoison :
⦁ Nom et prénom
⦁ Âge, sexe et poids
⦁ Antécédents pertinents (allergies, maladies chro-
niques, tentatives de suicide)
⦁ Habitudes de vie (grossesse, alcoolisme, taba-
gisme, toxicomanie)
⦁ Type d’exposition (accidentelle, erreur thérapeu-
tique, volontaire)
⦁ Nom commercial exact du produit contenant de
l’acétaminophène
⦁ Date et heure de la dernière ingestion d’acéta-
minophène
⦁ Définir le type d’ingestion (unique, échelonnée,
suprathérapeutique)
⦁ Calculer la dose totale d’acétaminophène ingé-
rée
⦁ Médicaments concomitants et autres drogues
(particulièrement les inducteurs du CYP2E1)
⦁ Symptomatologie actuelle
⦁ Service d’urgence le plus proche
⦁ Adresser le patient ou son représentant au
Centre antipoison du Québec
nants gastro-intestinaux lors d’une intoxication
aiguë ou chronique à l’acétaminophène.
a) Vrai b) Faux
Question 5
La n-acétylcystéine permet principalement
d’augmenter l’élimination de l’acétaminophène
en régénérant le glutathion hépatique.
a) Vrai b) Faux
Question 6
Un patient sous pilulier reçoit régulièrement
1 g d’acétaminophène quatre fois par jour. Il y a
deux jours, il a consulté à l’urgence en soirée et
a reçu l’ordonnance « Tramacet 2 co q6h régulier
x 48 h, puis PRN », qu’il s’est procurée dans une
autre pharmacie. Sa conjointe vous consulte car,
depuis ce matin, il semble beaucoup plus fatigué
que d’habitude et a vomi deux fois. De quel
type d’ingestion s’agit-il ?
a) Ingestion unique
b) Ingestion échelonnée
c) Ingestion suprathérapeutique
Question 7
Un patient vous consulte après avoir tenté, sans
succès, de traiter son mal de dents en ingérant
1 g d’acétaminophène toutes les 1 à 2 heures
depuis 16 heures. De quel type d’ingestion
s’agit-il ?
a) Ingestion unique
b) Ingestion échelonnée
c) Ingestion suprathérapeutique
Question 8
Un patient qui est toujours asymptomatique
18 heures après l’ingestion d’une dose poten-
tiellement toxique d’acétaminophènedoit être
adressé à l’urgence pour effectuer des tests san-
guins supplémentaires et faire une évaluation
médicale complète.
a) Vrai b) Faux
1
/
4
100%