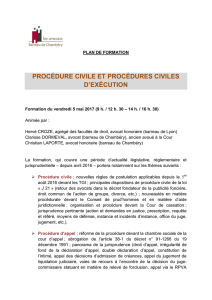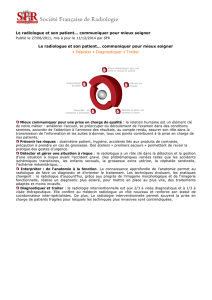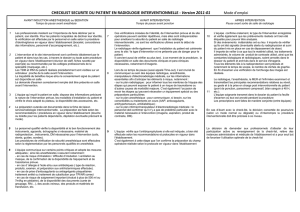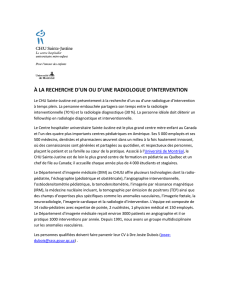La Tribune juridique du radiologue

Sommaire
En bref 1
Les règles de traçabilité des produits
de contraste
Amélioration des pratiques : le Guide
de la HAS du 21 mai 2014 « Améliorer
le suivi des patients en radiologie
interventionnelle et actes radioguidés :
Réduire le risque d’effets déterministes »
Destruction des clichés radiologiques :
engagez-vous votre responsabilité ?
Différences entre responsabilité civile,
administrative, ordinale et pénale
Jurisprudence 4
A propos de l’imposition supplémentaire
à régler par une clinique ayant loué à
des radiologues libéraux des locaux et
du matériel et du périmètre de l’assiette
de la taxe professionnelle
Cas pratiques 6
1 Suspiçion de fibrose néphrogénique
systémique consécutive à une injection
de Gadolinium
2 Vos obligations dans le cadre de la
prise en charge d’un patient mineur
En bref
Lettre d’information juridique éditée par L’Entreprise Médicale
La Tribune juridique
du radiologue
Janvier 2015
Les règles de traçabilité des produits de contraste
Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon
Les produits de contraste sont des produits dits frontière, considérés par consensus
comme des médicaments (Meddev 2.1/3 rev.3 de la Commission européenne et
AFSSAPS 2006). Leur utilisation implique donc le respect de la réglementation relative
à la pharmacovigilance au sens de l’article L. 5121-22 du Code de la santé publique
(CSP).
L’article L. 5121-25 du CSP met à la charge des professionnels de santé une obligation
de déclaration de « tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou [à un
produit de santé] dont ils ont connaissance » au centre régional de pharmacovigilance.
Au titre de cette obligation, les radiologues doivent donc signaler les effets indésirables,
y compris seulement suspectés, mais encore renseigner très soigneusement le dossier
de leurs patients afin de permettre la traçabilité du produit, à savoir notamment :
• le n° de lot,
• la date de péremption
• la date de mise sur le marché, etc.
En établissement de santé, la traçabilité est assurée par la pharmacie à usage intérieur.
Se pose donc la question de la traçabilité du produit lorsque celui-ci est fourni
directement par le patient. En toute hypothèse, les obligations déclaratives pesant sur
le radiologue au titre de la pharmacovigilance devront, y compris dans ce cas, être
remplies.
L’injection d’un produit de contraste est un acte de soin dont le radiologue est
responsable. Depuis le revirement de jurisprudence de 2012 de la Cour de cassation,
le patient qui voudrait engager la responsabilité du radiologue devra prouver sa
faute, la Haute Juridiction ayant écarté l’application du régime spécifique des produits
défectueux comme de la responsabilité sans faute dans le cas de l’utilisation d’un
produit.
TJ radio n°36.indd 1 18/12/2014 10:05

En bref
Un travail spécifique a porté sur la radiologie
interventionnelle à l’occasion de la production du
guide méthodologique du 21 mai 2014 « Améliorer
le suivi des patients en radiologie interventionnelle et
actes radioguidés ».
Après avoir rappelé la définition proposée par la
Société Française de Radiologie et la Fédération de
Radiologie Interventionnelle selon laquelle la radiologie
interventionnelle recouvre l’ensemble des actes
médicaux invasifs ayant pour but le diagnostic et/ou le
traitement d’une pathologie et réalisés sous guidage et
contrôle d’un moyen d’imagerie, la HAS souligne que
la gestion du risque porte bien évidemment et avant
tout sur la prévention du risque, en amont de l’acte,
quand l’indication est posée, ou en cours de réalisation
de la procédure.
La HAS insiste cependant sur le fait qu’un
dysfonctionnement est toujours possible et met ainsi
l’accent sur l’évaluation du suivi des patients,
notamment concernant les effets déterministes.
La HAS rappelle que les médecins réalisant des actes
de radiologie interventionnelle doivent :
• S’engager dans la démarche d’accréditation
des pratiques à risque et définir des niveaux de
référence interventionnels locaux ;
• Organiser une consultation de pré-intervention
pour apprécier les risques potentiels et prendre
une décision partagée avec le patient en
fonction du bénéfice/risque ;
• Informer le patient lors de la consultation
spécifique préalable et obtenir un consentement
éclairé sur le bénéfice/risque du geste. Cette
consultation permettra également de lui
expliquer comment il sera suivi après l’acte et
de vérifier son adhésion au suivi envisagé ;
• Suivre la dose pendant la procédure et la tracer,
ce qui permettra le cas échéant de modifier ou
d’interrompre les modalités de réalisation ;
• Organiser un suivi systématique centré sur :
– l’information du patient avant la sortie sur la
nécessité d’un suivi ;
– l’information à fournir au médecin traitant
en précisant les signes d’appel à surveiller ;
– une consultation de suivi systématique à 3
mois et en cas de signe ;
– l’envoi en dermatologie pour une prise en
charge spécifique en cas de signe ;
– la prise en compte de la douleur importante
pouvant justifier l’intervention d’un centre
anti douleur.
Amélioration des pratiques : le Guide de la HAS du 21 mai 2014
« Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle
et actes radioguidés : Réduire le risque d’effets déterministes »
Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber
Les clichés radiologiques (y compris comptes rendus) font
parties des éléments du dossier médical définis en tant
« qu’information relative à la prise en charge du patient :
imagerie ».
Le dossier médical appartient au patient et la destruction
d’un de ces éléments revient à détruire une chose
qui n’appartient pas au professionnel de santé. Le
radiologue est soumis aux obligations d’information et
chargé de délivrer celles-ci si le patient ou la famille
réclamai(en)t la communication des éléments.
La destruction des clichés radiologiques ne peut se faire
qu’à condition que le radiologue ne puisse plus voir sa
responsabilité civile professionnelle engagée, tant par
le patient (coacteur du système de santé) que par sa
famille (ayant droits).
La destruction ne peut être envisagée qu’après
expiration des délais de prescriptions applicables et une
information préalable de la destruction éventuelle de ces
éléments, pour respecter tant l’obligation de conseil que
de délicatesse.
Pour les établissements de santé, la durée minimale de
conservation est de 20 ans à compter du dernier séjour
du patient ou sa consultation externe.
Pour les radiologues libéraux, le délai est de 10 ans
à compter de la dernière consultation et/ou du décès
du patient pour l’hypothèse d’un recours de la famille.
S’agissant d’un mineur, le délai de conservation est de
10 ans par rapport à sa majorité et la destruction n’est
pas envisageable avant la 28ème année de ce dernier.
Cette destruction peut être précédée de copies ou de
remises de contretypes des clichés au patient et/ou à la
famille qui en ferait la demande écrite en justifiant de
leurs qualités respectives.
La destruction par dilacération ou brulage est évidente
car les dossiers médicaux ne peuvent ainsi rejoindre
la voie publique, l’imagerie du corps humain restant
un élément patrimonial qui ne peut être récupéré
ou insusceptible de faire l’objet d’une appréhension
quelconque.
Destruction des clichés radiologiques : engagez-vous votre
responsabilité ?
Philippe Jalley, Avocat au Barreau de Meaux
2
TJ radio n°36.indd 2 18/12/2014 10:05

Le régime juridique de la responsabilité n’est pas
uniforme en droit français. Les procédures et les
juridictions sont différentes selon que le médecin
exerce en secteur privé ou en secteur public et selon
que le patient souhaite obtenir une indemnisation ou
une sanction du praticien.
• Si vous exercez en libéral et que le patient
recherche une indemnisation, vous pourriez
voir votre responsabilité civile recherchée. Cette
responsabilité est appréciée par les juridictions
civiles de l’ordre judiciaire, à savoir :
1. le Tribunal de grande instance (TGI), en
première instance,
2. la Cour d’appel, en cas d’appel,
3. la Cour de cassation (chambres civiles),
en dernier ressort. Soulignons que la
compétence de la Cour de cassation se
limite à l’appréciation des règles de droit
appliquées et non aux faits.
Le délai de prescription (délai pendant lequel
peuvent s’exercer les poursuites) est de dix
ans à compter de la date de consolidation du
dommage.
La sanction réside dans la condamnation à
verser des dommages et intérêts au patient,
qui seront pris en charge par l’assureur en
responsabilité civile professionnelle (RCP).
• Si vous exercez en secteur public et que le
patient recherche une indemnisation, c’est la
responsabilité administrative de l’hôpital qui
sera recherchée. La responsabilité de l’hôpital
est appréciée par les juridictions administratives,
à savoir :
1. le Tribunal administratif, en première instance,
2. la Cour administrative d’appel, en cas d’appel,
3. le Conseil d’Etat, en dernier ressort. Comme
la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ne
juge pas les faits. Il étudie seulement le point
de savoir si les juridictions de fond (Tribunal
administratif et Cour administrative d’appel)
ont bien appliqué le droit, sans examiner le
fond de l’affaire.
La responsabilité civile d’un médecin hospitalier
peut être engagée s’il commet une « faute
détachable du service » (c’est-à-dire, selon la
Cour de cassation, « une faute d’une gravité
certaine » [Cour de cassation, Première Chambre
civile, 21 octobre 1997] ou qui constitue « un
manquement inexcusable à ses obligations
d’ordre professionnel et déontologique » [Cour
de cassation, Chambre criminelle, 25 mai
1982]).
Le délai de prescription et la sanction sont
identiques à ceux de la responsabilité civile.
• Par ailleurs, quel que soit votre mode d’exercice
et si le patient recherche une sanction à votre
encontre, vous pouvez voir votre responsabilité
pénale et/ou disciplinaire engagée(s).
––En matière pénale (délits), la responsabilité
est appréciée par les juridictions de l’ordre
judiciaire, à savoir :
1. le Tribunal correctionnel, en première
instance,
2. la Cour d’appel, en cas d’appel,
3. la Cour de cassation (chambre criminelle).
Le délai de prescription est de trois ans (délits).
La sanction peut consister à la condamnation
à une peine d’emprisonnement avec ou sans
sursis et/ou à une peine d’amende qui n’est pas
prise en charge par l’assureur en RCP.
––En matière disciplinaire, la responsabilité
est appréciée par les juridictions ordinales,
à savoir :
1. la Chambre disciplinaire de première instance,
2. la Chambre disciplinaire nationale, en cas
d’appel,
3. le Conseil d’Etat.
En matière disciplinaire, il n’existe aucun délai
de prescription, l’action étant imprescriptible.
Quant à la sanction, elle peut aller de
l’avertissement à la radiation en passant par le
blâme ou la peine de l’interdiction d’exercer la
médecine avec ou sans sursis.
Ces différentes responsabilités ne sont pas exclusives
des unes des autres, la recherche d’un cumul de
responsabilités étant possible.
Différences entre responsabilité civile, administrative, ordinale
et pénale
Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris
3
Rédaction achevée au mois de novembre 2014. Textes sujets à
d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire
ou jurisprudentiel.
La Tribune juridique du radioLogue
est une lettre d’information
professionnelle destinée aux radiologues hospitaliers et
libéraux. Les informations qui y sont contenues ont un caractère
général et ne sauraient répondre aux questions relevant de
situations particulières ni engager la responsabilité de Guerbet.
Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de
la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession
juridique réglementée. Les textes publiés dans la Tribune juridique
du radiologue sont l’expression de l’opinion personnelle de leurs
auteurs.
direcTeur de La pubLicaTion :
Jean-Luc Balança -
direcTeur de La rédacTion :
Dr François Prieur -
onT parTicipé à La rédacTion de ce numéro :
Denis
Benayoun, Avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du
Dommage Corporel et en Droit de la Santé ; Audrey Bronkhorst,
Avocat au Barreau de Lyon ; Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au
Barreau de Paris ; Philippe Jalley, Avocat au Barreau de Meaux ;
Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber.
médecin-conseiL
: Docteur Frédéric Plagnol, Radiologue -
sociéTé édiTrice :
L’Entreprise Médicale, SARL au capital de 104 940 F, RCS Nanterre,
SIRET 377 562 277 000 48, Siège social : 3 bis, rue du Dr Foucault
- 92 000 Nanterre -
concepTion eT réaLisaTion :
L’Entreprise Médicale -
dépôT LégaL :
à parution - issn : 1281-0266.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par
quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente
publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue
une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du
1er juillet 1992).
TJ radio n°36.indd 3 18/12/2014 10:05

Jurisprudence
Faits
Observations
A propos de l’imposition supplémentaire à régler par une clinique
ayant loué à des radiologues libéraux des locaux et du matériel
et du périmètre de l’assiette de la taxe professionnelle
Commentaire de la décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 18 février 2014
Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon
Le 2 mars 2001, onze médecins radiologues, agissant
conjointement et solidairement, ont conclu un contrat de
location pour une durée de 9 ans avec la société Clinique
Saint-Antoine de Nice.
Dans le cadre de ce contrat, sont donnés en location par la
Clinique, des locaux destinés à l’exercice de la radiologie
(pour patients hospitalisés ou consultants externes) ainsi
que l’intégralité du matériel d’électroradiologie installé
dans lesdits locaux.
Dans les suites d’un contrôle sur pièces de la situation
de la Clinique, l’administration fiscale a émis des
appels supplémentaires de taxe professionnelle au titre
des années 2003 à 2005 en incluant, dans la valeur
locative des biens, les matériels de radiologie mis à la
disposition des médecins locataires par la Clinique. Les
impositions supplémentaires en résultant ont été mises en
recouvrement le 30 avril 2006.
La Clinique a ainsi saisi le Tribunal Administratif de Nice
pour des montants en litige s’élevant à 15 508 € pour
2003, 15 434 € pour 2004 et 15 753 € pour 2005,
soit un total de 46 695 €.
L’arrêt de la Cour administrative de Marseille est rendu
aux visas des textes suivants :
• Article 1448 du Code général des impôts :
“La taxe professionnelle est établie suivant la
capacité contributive des redevables, appréciée
d’après des critères économiques en fonction de
l’importance des activités exercées par eux sur le
territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la
zone de compétence de l’organisme concerné “.
• Article 1467 du même code : “ la taxe
professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur
locative des immobilisations corporelles dont
le redevable a disposé pour les besoins de son
activité professionnelle.“
La Cour administrative d’appel revient tout d’abord sur
le périmètre de l’assiette de la taxe professionnelle en
précisant que « les immobilisations dont la valeur locative
est intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle en
application des dispositions précitées du a) du 1° de
l’article 1467 du code général des impôts sont les biens
placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci
utilise matériellement pour la réalisation des opérations
qu’il effectue ».
La Cour identifie donc deux critères cumulatifs
permettant d’inclure la valeur locative d’un bien dans
l’assiette fiscale de la taxe professionnelle : le contrôle
exercé sur le bien par le contribuable et l’utilisation du
bien dans le cadre de son activité professionnelle. L’arrêt
commenté apporte des précisions sur cette notion de
contrôle et sur son appréciation.
4
Procédure
La SAS Clinique Saint-Antoine a tout d’abord demandé
au Tribunal Administratif de Nice de la décharger
des cotisations supplémentaires, droits, majorations
et pénalités, de taxe professionnelle qui ont été mis à
sa charge au titre des années 2003 à 2005, pour un
montant de 46 695 €.
Par jugement daté du 24 février 2011, le Tribunal
administratif de Nice a rejeté cette demande pour des
motifs non repris dans l’arrêt de la Cour administrative
d’appel de Marseille.
La SAS Clinique Saint-Antoine a interjeté appel de ce
jugement par-devant la Cour administrative d’appel de
Marseille, laquelle a rendu sa décision le 18 février 2014.
Suite page 5
TJ radio n°36.indd 4 18/12/2014 10:05

5
• 2 mars 2001 : conclusion du contrat de location entre la Clinique et les onze praticiens libéraux ;
• Contrôle sur pièces réalisé par l’administration fiscale : inclusion dans la valeur locative des biens des matériels de radiol-
ogie mis à disposition des praticiens par la Clinique ;
• Emission de rappels d’imposition par l’administration fiscale adressés à la Clinique ;
• 30 avril 2006 : mise en recouvrement des impositions supplémentaires ;
• Saisine du Tribunal administratif de Nice par la Clinique ;
• 24 février 2011 : rejet des demandes de la Clinique par le Tribunal Administratif de Nice ;
• Appel de la Clinique par-devant la Cour administrative d’appel de Marseille ;
• 18 février 2014 : arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rejetant les demandes de la Clinique.
Points clé du dossier
Observations
La Cour administrative d’appel relève d’une part que les
praticiens libéraux :
• percevaient directement leurs honoraires ;
• avaient l’usage des locaux et du matériel ;
• s’étaient engagés au titre du contrat conclu avec
la clinique à assurer la bonne marche du matériel
mis en location et son petit entretien ;
• étaient propriétaires des appareils utilisés pour
les examens d’échotomographie et des appareils
à ultra-sons ;
• disposaient de la possibilité de se faire assister
ou remplacer ;
• enfin prenaient en charge les frais de secrétariat
générés par leur activité.
La Cour relève ensuite que la Clinique pour sa part :
• conservait le contrôle des locaux et des
équipements ;
• choisissait lesdits équipements et qu’elle en
assumait le gros entretien et le renouvellement
outre les frais correspondants ;
• qu’en outre, l’exploitation de ces locaux et
équipement, par l’intermédiaire du personnel
d’entretien et des manipulateurs qu’elle mettait
à la disposition des praticiens radiologues,
constituait l’objet même de son activité.
La Cour en conclut donc que la Clinique « doit être
regardée comme ayant disposé, au sens de l’article
1467 précité du code général des impôts, des locaux
et équipements techniques utilisés par les praticiens en
application du contrat qu’ils avaient conclus avec celle-ci ».
En d’autres termes, la Cour administrative d’appel opte
pour une approche juridique de la notion de contrôle,
puisque, si les praticiens libéraux étaient bien ceux qui
utilisaient les locaux et équipements « concrètement » et
quotidiennement dans le cadre de leur activité, ils ne les
utilisaient que par l’intermédiaire du contrat de location
conclu avec la Clinique, dont la Cour considère qu’elle
« disposait » tant des locaux que du matériel, en d’autres
termes, que la clinique en avait bien le « contrôle » au
sens de l’article 1467 du Code général des impôts.
Les demandes de la Clinique sont ainsi rejetées sur ce
fondement par un arrêt du 18 février 2014.
Il faut donc en conclure que l’assiette de la taxe
professionnelle, dont toute entreprise et profession
libérale s’acquitte est notamment déterminée selon la
valeur – le cas échéant locative – des biens non seulement
employés dans le cadre de l’activité professionnelle,
mais encore dont le contribuable à la disposition, le
terme semblant presque devoir être entendu dans
cet arrêt au sens de « l’abusus », attribut du droit de
propriété.
L’ancienne dénomination de taxe professionnelle a aujourd’hui disparu et l’impôt a été requalifié en CFE : cotisation foncière
des entreprises.
Cette taxe est un impôt local voté et perçu par la commune du lieu de l’établissement, l’EPCI (établissement public de
coopération intercommunale, c’est-à-dire un regroupement de communes) quand il existe et divers organismes.
Concernant les médecins libéraux, une exonération est prévue par l’article 1464 D du Code général des impôts qui prévoit
en son 1er alinéa : « Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les
communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises, à compter
de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au
livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de
2000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A. »
Le point sur la « taxe professionnelle »
TJ radio n°36.indd 5 18/12/2014 10:05
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%