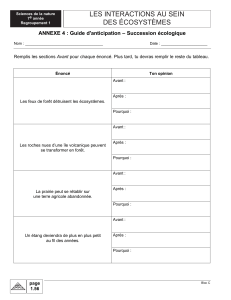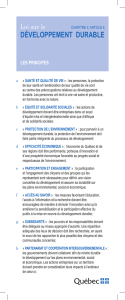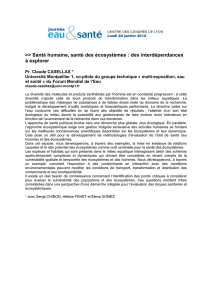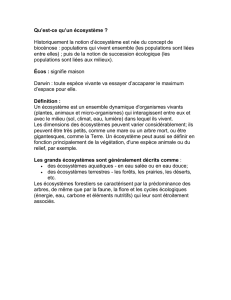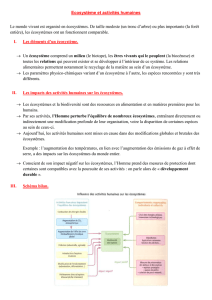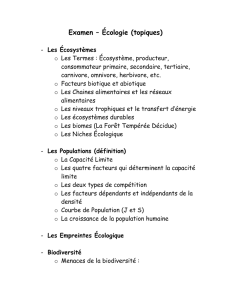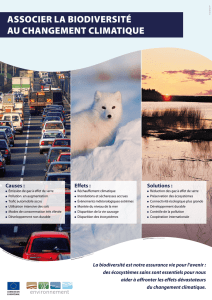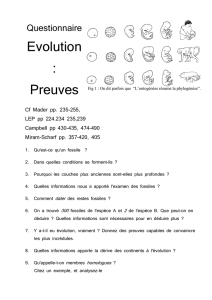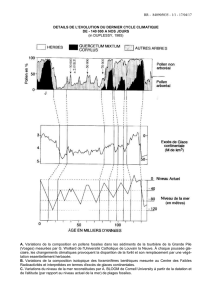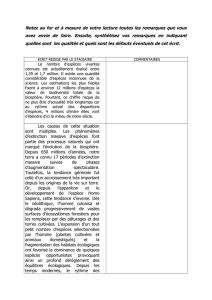Intérêt de l`étude des écosystèmes fossiles - Quentin Gautier

UMR6553 ECOBIO
Université de Rennes 1
Intérêt de l’étude des écosystèmes
fossiles en Ecologie
Rapport bibliographique de Master 2 Ecologie-Environnement
Parcours Ecologie Fonctionnelle, Comportementale et Evolutive
Présenté par Quentin Gautier
Encadrant du stage : Monsieur Philippe Vandenkoornhuyse
Année universitaire
2009-2010

Sommaire
Introduction .............................................................................
1
Le pollen et l’analyse palynologique .......................................
3
Outil d’étude de l’environnement et du climat au Quaternaire ......................... 3
Vers une meilleure compréhension de la mise en place des écosystèmes
actuels ................................................................................................................. 5
Limites de l’approche palynologique ................................................................ 6
Travaux en paléoécologie ........................................................
8
Paléontologie d’environnement : détermination des facteurs biotiques et
abiotiques des paléoécosystèmes ....................................................................... 8
Paléogéographie et évolution : approche pluridisciplinaire ............................ 10
Nouvelles stratégies ...............................................................
11
Le pyroséquençage de masse ........................................................................... 12
Enjeux scientifiques ......................................................................................... 13
Conclusion .............................................................................
14

Liste des figures
Figure 1 : Evolution de 1775 à 2000 des proportions estimées de la couverture terrestre à
partir des séries chronologiques intégrées par référence à la carte de 1775 (d’après Petit &
Lambin, 2002) ............................................................................................................................ 4
Figure 2 : Biomes dérivés des pollens et plantes macrofossiles datant de 6000 ans BP (d’après
Jolly et al., 1998a) ...................................................................................................................... 6
Figure 3 : Représentation schématique des grands types de cénogrammes (d’après Montuire
& Desclaux, 1997) ...................................................................................................................... 9
Figure 4 : Principe du pyroséquençage : technique d’addition séquentielle de nucléotides en
temps réel (d’après Lamoril et al., 2008) ................................................................................. 12

1
Pour réaliser le plus correctement possible mon rapport bibliographique, je suis allé puiser
les informations scientifiques dont j’avais besoin dans divers médias. Celui que j’ai le plus usité
est la base de données Web of Sciences que l’on peut retrouver dans ISI Web of Knowledge. En
entrant les mots clefs voulus tels que : «ancient DNA», «fossil», «paleoecosystem», etc. ou bien
les noms d’auteurs importants dans les domaines qui m’intéressaient, j’ai pu obtenir l’essentiel de
mes publications (articles, reviews). Le moteur de recherche Google m’a également servi pour
obtenir parfois (mais très rarement) des publications scientifiques que Web of Sciences ne
pouvaient me fournir dans son intégralité. En outre, Google a aussi été un bon moyen pour obtenir
des informations complémentaires. La bibliothèque universitaire m’a permis, quant à elle, de me
procurer des ouvrages généraux (la palynologie, la paléoécologie) réalisés par des chercheurs
spécialisés dans le domaine scientifique désiré afin d’accroitre ma compréhension des éléments de
base essentiels à mon objet d’étude. Enfin, mes lectures et mes discussions hors cursus scolaire
ont également été mis à contribution pour élaborer ce rapport.
Introduction
De nos jours, l’idée que les fossiles, et plus généralement les environnements passés,
reflètent l’Histoire est aujourd’hui si courante que nous avons tendance à y voir une vérité de
toujours (Goodfriend et Gould, 1996) or cela n’a pas été toujours le cas. Plusieurs savants grecs de
l’Antiquité, tels le poète et philosophe Xénophane, l’historien Hérodote ou le géographe Strabon,
interprétèrent de façon correcte la nature des fossiles. Pourtant, c’est la conception erronée
d’Aristote (fossiles façonnés directement dans la boue à partir d’une « force formatrice »
mystérieuse) qui, pendant deux mille ans, fit référence. Cependant, à partir du début du
XIXe siècle, la véritable nature des fossiles fut réellement démontrée grâce à l’établissement des
premiers principes de la géologie moderne. Mais c’est principalement le livre L’origine des
espèces, de Charles Darwin publié en 1859, qui bouleversa les idées reçues en sciences
biologiques, notamment en paléontologie, zoologie et biogéographie, allant même au-delà (au
niveau philosophique et religieux) avec la théorie de la sélection naturelle. Dorénavant, les
données fossiles sont regardées et appréhendées de manières totalement différentes. Les
scientifiques peuvent désormais essayer de reconstituer les environnements passés à la lumière de
l’Evolution.

2
Les études historiques sur les écosystèmes se justifient d’emblée par le fait que les
écosystèmes actuels résultent d’une évolution longue de 3,8 milliards d’années (Gall, 1995). C’est
ainsi que l’évolution de la structure des écosystèmes est étudiée à différentes échelles de temps et
souvent de manière différente par les écologues, les systématiciens, les paléontologistes, les
préhistoriens et les archéozoologues. C’est malgré tout un sujet qui unit toutes les disciplines qui
traitent du vivant et de son environnement. Les écologues mettent l’accent sur les structures et les
processus actuels et subactuels dans les écosystèmes, les systématiciens infèrent l’histoire
phylogénétique des taxons et de leur fonction dans les écosystèmes, les paléontologues, les
préhistoriens et les archéozoologues s’attachent d’avantage à documenter directement l’évolution
des écosystèmes par les documents diachroniques mis à jour (Grandcolas, 1998). L’origine de la
biodiversité et les caractéristiques qu’elle a héritées du passé conditionnent bien souvent son
maintien. En d’autres termes, aucune étude sur les systèmes actuels ne peut aboutir ou amener à
une meilleure compréhension, même sur un unique plan fonctionnel, sans que l’on ait
connaissance de l’origine des taxa, des fonctions ou des milieux concernés (Grandcolas, 2003).
Cette compréhension se place donc dans un contexte systémique où les organismes ne sont pas
considérés comme des entités nécessairement indépendantes les unes des autres ou de
l’environnement. Il s’agit alors de comparer les écosystèmes présents et passés sur des sites
écologiquement équivalents (même climat et/ou même région géographique) à travers leurs
caractéristiques à différentes époques, actuelles, subactuelles ou passées (Walker et Laporte, 1970
dans Gall, 1995). Le présent sert donc de référentiel pour l’écosystème passé. Même si
l’écosystème présent peut ne pas correspondre à un écosystème existant dans le passé, les grandes
lois qui régissent sa structure permettent a minima de se « référencer » à certains des facteurs que
l’on cherche à interpréter dans l’écosystème passé et permet des interprétations fonctionnelles par
analogie (Najt & Grandcolas, 2002). Plusieurs champs de recherche peuvent permettre d’apporter
des éléments de réponse pour la reconstitution des paléoécosystèmes.
Le but de ce rapport bibliographique sera de montrer la pertinence de l’étude des
écosystèmes fossiles en Ecologie en réalisant non pas un éventail complet des différents actions
de recherches (le domaine étant très vaste ce qui risquerait d’aboutir à un catalogue d’approches)
mais en se focalisant principalement sur certains champs d’applications qui mettent en évidence,
et de manière significative, l’intérêt que suscite ces paléoenvironnements pour de nombreuses
branches des sciences biologiques. Ce rapport s’articulera ainsi, selon une chronologie bien
définie, autour de plusieurs champs de recherche n’utilisant pas les mêmes outils mais étant
néanmoins complémentaires pour la reconstitution des environnements passés. Il s’agira donc
d’utiliser une chronologie historique des domaines et outils d’études portant sur les
paléoécosystèmes pour mettre en lumière l’évolution et les progrès réalisés dans la compréhension
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%