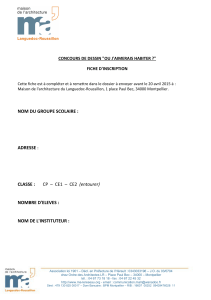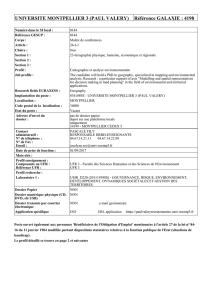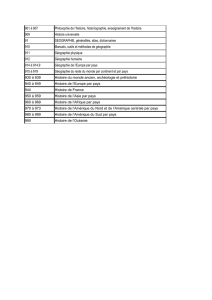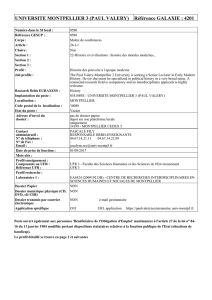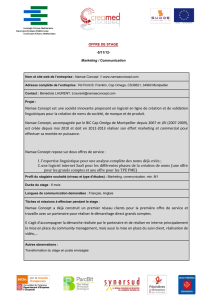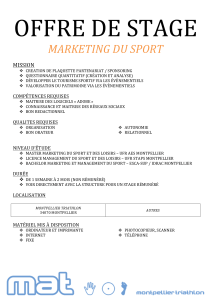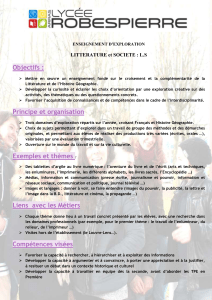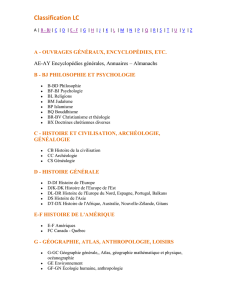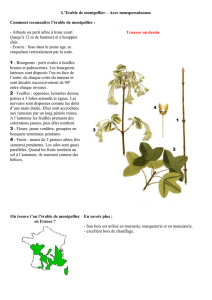6ème Rendez-vous de Géographie culturelle - pacte

Centre
National de la
Recherche Scientifique
Appel à communications
6
e
Rendez-vous de Géographie culturelle, Ethnologie et Études culturelles
en Languedoc-Roussillon
Organisé par :
UMR 5281 ART-Dev- Université Paul Valéry Montpellier 3 – Route de Mende – 34199 Montpellier
cedex 5 artdev@univ-montp3.fr – http://recherche.univ-montp3.fr/artdev/
EMMA EA 741 Université Paul Valéry Montpellier 3 – Route de Mende – 34199 Montpellier cedex 5
isabelle.ronzetti@univ-montp3.fr – http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/
Colloque international
Culture(s) et résistance(s) aujourd'hui
19-21 Juin 2014, Université de Nîmes (France)
Note d’intention scientifique :
La 6
e
édition des « Rendez-vous de Géographie culturelle, Ethnologie et Études culturelles en
Languedoc-Roussillon » souhaite aborder la thématique « Culture(s) et résistance(s)
aujourd’hui ». De quelles natures sont les rapports entre culture(s) et résistance(s) ? Quelles
formes – dialogues, oppositions, transformations – revêtent ces rapports ? On interrogera
aussi bien l’anthropologie – nature et culture, l’histoire – civilisation et culture, la géographie
– territoire et culture, identités et culture, paysages et culture, que les représentations de ces
rapports au travers de différentes expressions artistiques. Quelles sont les manifestations
contemporaines de ces rapports ?
Il s’agit d’appréhender la notion de résistance dans sa pluralité, sa complexité. D’un point de
vue sémantique, il convient de la distinguer de notions voisines, mais néanmoins distinctes :
rébellion, révolte, contestation ; de même, il importe de ne pas la confondre avec ses
différentes manifestations : émeutes, manifestations, émotions anciennes, grèves, et autres
invasiaoes brésiliennes. La résistance est une démarche individuelle ou collective de refus,
qui engage à la fois l’esprit et le corps. Elle s’exprime face à toutes les formes d’oppression,
dans les lieux de pouvoir comme dans ceux du quotidien : la ville, le rural, les lieux de

travail, d’éducation, de coercition, etc. Mais elle prend toujours une dimension politique. La
résistance a un caractère matériel et/ou immatériel. Elle se concrétise par des gestes ou des
paroles, ou par l’absence de gestes ou de paroles, par l’action comme l’inaction, par la
violence comme la non-violence. Elle se distingue du discours usuel et rompt avec
l’acceptation de la banalité du quotidien.
Il faut souligner également l’ambiguïté du concept, qui suppose une dialectique entre le
résistant et le pouvoir auquel il s’oppose, mais aussi entre le mouvement et la conservation :
en 1840, le Parti de la Résistance, conservateur, est créé pour s’opposer au parti du
mouvement. Bien que certains affirment que cette acception « réactionnaire » de la résistance
a disparu, le colloque pourra alors s’intéresser de manière critique aux conservatismes, aux
replis identitaires, aux refus de la modernité, et à ce qui les détermine, mais il devra également
se demander dans quelle mesure la mise en avant du passé, des traditions et des valeurs
ancestrales peut être présentée comme une forme progressiste et positive de résistance. Quel
impact une telle conception peut-elle avoir sur la notion même de modernité ? Il pourra aussi
être question des nouveaux systèmes de contrôle de la résistance. Comment les résistances
culturelles, perçues comme des entraves à la bonne gestion des territoires, suscitent-elles des
pratiques visant à les prévenir, les limiter ou les contourner ? Comment peut-on ainsi les
intégrer dans la conception de projets qu’elles combattent ?
La résistance peut aussi être perçue comme un engagement éthique fort face à des normes
jugées menaçantes. Il s’agit alors de comprendre pour quelles raisons certains groupes, sur
certains territoires, décident d’entrer en résistance : face à des évolutions du monde social
jugées problématiques, à l’évolution des modes de production, à des politiques
d’aménagement du territoire, à l’exclusion, face à la globalisation ou au contraire face à des
projets microcosmiques (effet NIMBY)… La problématique de l’autochtonie et des identités
locales méritera à ce titre d’être abordée, au même titre que le concept d’infrapolitique, dans
la mesure où il concerne les comportements populaires qui se distinguent des pratiques
politiques traditionnelles. Car une réflexion sur le rapport culture(s) – résistance(s) doit
prendre en compte le développement d’une conscience sociale : conscience de classe, de
groupe, de mouvance socialement marginalisée.
L’analyse des résistances culturelles se fera à l’échelle des territoires et des communautés. Il
s’agira à la fois de comprendre en quoi la notion de résistance influence les dynamiques
territoriales et de saisir les enjeux culturels des phénomènes de résistance.
Sur le temps long, les Cévennes offrent l’exemple d’un « territoire de résistance » incarné par
le mythe des Camisards : la Guerre des Cévennes opposa entre 1702 et 1704 les troupes
royales à une population majoritairement protestante, attachée à la liberté de conscience. Il
paraît donc légitime d’étudier comment se construisent et se transforment les images de
résistance des territoires. Quelle place tient la commémoration et quel rôle joue la mémoire
dans la qualification – requalification de ces territoires ? Dans l’actualité plus proche, la
question peut être posée autour d’exemples comme le Larzac, à Notre-Dame des Landes ou
dans le Chiapas. Présente dans les représentations, dans les livres ou dans les chansons, la
résistance peut devenir un label, voire un objet de marketing, ce qui pose la question de la
manipulation des sentiments – émotions, convictions et certitudes – sur lesquels se fonde la
notion de résistance.
Enfin la notion de « contre-culture » qui apparaît aux USA à la fin des années 1960 propose
un modèle de résistance culturelle qui a été diffusé et adopté dans différents contextes. Des

études de cas pourraient éclairer les appropriations diverses de cette notion. Cette entrée
permet d’étudier la résistance comme avant-garde plutôt que comme lieu du conservatisme et
d’interroger les formes de récupération de l’expression résistante de ces cultures.
Pour analyser les relations complexes qui existent entre culture(s) et résistance(s) aujourd’hui,
il faudra s’interroger sur les comportements, les mots et les représentations qu’elle adopte, sur
sa temporalité, de l’urgence à la longue durée, sur les risques collectifs ou individuels qu’elle
fait encourir. Des communications sont attendues autour des axes suivants :
- Terminologies et définitions de la résistance dans ses relations avec la culture.
- Ambiguïté des résistances, entre progrès et conservatismes.
- Enjeux culturels et territoriaux des phénomènes de résistance.
- Usages sociaux et manipulations politiques des mouvements de résistance.
- Contre-cultures et avant-gardes.
Date limite de soumission des propositions de communication :
15 Juin 2013
Comité d’organisation
- Catherine Bernié-Boissard, [email protected]
Géographie, Université de Nîmes, UMR 5281 ART-Dev, Université Montpellier 3
Etudes culturelles, EMMA, EA 741 Etudes anglophones, Université Montpellier 3
- Dominique Crozat, [email protected]
Géographie, UMR 5281 ART-Dev, Université Montpellier 3
- Laurent-Sébastien Fournier, [email protected]
Ethnologie, EA 3260 CENS, Université de Nantes
Evaluation des propositions par le comité scientifique : été 2013
Acceptation/refus des propositions : 15 octobre 2013
Les propositions seront présentées sous la forme d’un document Word d’une à deux pages,
comprises entre un minimum de 2000 signes et un maximum de 4000 et comprendront 5 mots
clés : elles devront mentionner nom et prénom, discipline d’origine, statut, rattachement
institutionnel de l’auteur et adresse électronique.
Les propositions seront impérativement rédigées en Times New Roman de 12 points,
interligne 1,5. Le fichier informatisé du résumé envoyé aux organisateurs par voie
électronique sera simplement nommé par les nom et prénom de l’auteur sous la forme :
NOMPrénom.doc.
Les propositions de communication seront adressées exclusivement à :
Les communications pourront être données en français ou en anglais.

Comité scientifique
Valérie Arrault, professeur d’arts plastiques, Montpellier
Jean-Pierre Augustin, professeur de géographie, Bordeaux
Alain Bertho, professeur d’anthropologie, Paris
Dominique Chevalier, maître de conférences en géographie, Lyon
Paul Claval, professeur de géographie, Paris
Robert Deliège, professeur d’anthropologie, Louvain
Guillaume Faburel, professeur d’urbanisme, Lyon
Isabelle Garat, maître de conférences en géographie, Nantes
David Giband, professeur de géographie, Perpignan
Peter Geschiere, professeur d’anthropologie, Amsterdam
Yves-Charles Grandjeat, professeur de littérature anglophone, Bordeaux
Aline Hémond, maître de conférences en anthropologie, Paris
David Howard, lecturer in geography, Oxford
Régis Keerle, maître de conférences en géographie, Rennes
André Micoud, directeur de recherches en sociologie (CNRS), Saint-Etienne
Emmanuel Négrier, directeur de recherches en science politique (CNRS), Montpellier
Dorothy Noyes, Professor of English and Comparative Studies, Ohio State University
Claire Omhovère, professeur de littérature anglophone, Montpellier
Jean-Noël Retière, professeur de sociologie, Nantes
Matthieu Remy, maître de conférences en lettres modernes, Nancy
Partenaires
Université de Nîmes, Université de Montpellier 3
CNRS Languedoc-Roussillon
Ville de Nîmes, Conseil Général du Gard, Région Languedoc-Roussillon
Centre
National de la
Recherche Scientifique
1
/
4
100%