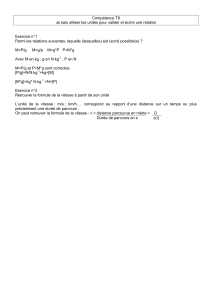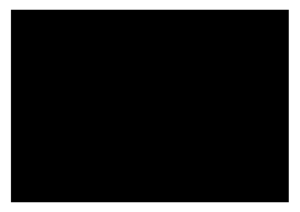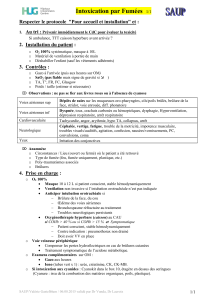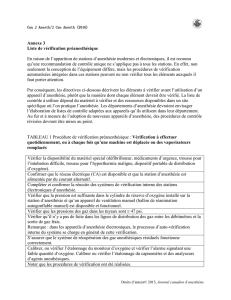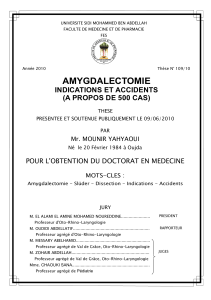anesthesie et amygdalectomie

Accès aux voies aériennes en anesthésie 83
ANESTHESIE ET AMYGDALECTOMIE
C. Mercier, Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale I, CHU, Hôpitaux Breton-
neau et Clocheville, 37044 Tours Cedex 1.
INTRODUCTION
L’amygdalectomie est réalisée dans 90 % des cas chez des enfants de 4 à 10 ans ou
des pré-adolescents.
Sa fréquence en France en 1996 (enquête SFAR) était de 19/10 000 habitants [1]. La
technique d’ablation des amygdales au Sluder tend à disparaître au profit de la dissec-
tion avec hémostase dirigée. Ses indications ont fait l’objet de recommandations par
l’A.N.A.E.S. en 1997 [2]. Elles sont encore majoritairement dues à une surinfection des
amygdales se traduisant par des angines répétées, traitées par une antibiothérapie pro-
longée. Mais les phénomènes d’obstruction avec apnées du sommeil et parfois dysphagie
sont la deuxième cause observée même chez de jeunes enfants de moins de 3 ans [3].
C’est une intervention à risque qui justifie une grande vigilance anesthésique et une
organisation rigoureuse.
Les enquêtes concernant la mortalité et la morbidité sont anciennes et une plus
grande sécurité a été acquise par les progrès des pratiques anesthétiques [4].
Néanmoins quelques décès d’enfants sont encore survenus durant les dix dernières
années d’après les rapports des compagnies d’assurance.
La réussite de cette intervention repose sur une protection des voies aériennes effi-
cace, une hémostase rigoureuse et une surveillance postopératoire stricte tenant compte
et traitant la douleur tout en favorisant une hospitalisation de courte durée.
1. RISQUES ANESTHESIQUES
Ils doivent être évalués lors de la consultation d’anesthésie, car deux problèmes
peuvent être source de difficultés lors de l’anesthésie et il faut prévoir une stratégie
préalable pour en prévenir les complications.
1.1. OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES [3-5]
Elle est responsable d’une respiration bouche ouverte et d’un ronflement nocturne
en rapport avec des amygdales volumineuses occupant parfois plus de 50 % de la
surface pharyngée. Il faut cependant distinguer une hypertrophie bilatérale isolée, sans
signe obstructif ni infectieux de celle s’accompagnant de troubles fonctionnels avec

MAPAR 200184
apnées du sommeil, parfois dysphagie et altération de l’état général. Ces phénomènes
obstructifs peuvent faire porter l’indication chirurgicale d’ablation des amygdales chez
de très jeunes enfants avant 2 ans ou des enfants obèses, ayant un cœur pulmonaire
chronique. Dans ces cas, une polysomnographie est l’examen de référence préopéra-
toire pour juger de la gravité des troubles. Dans de telles situations, on observe une
hypoxémie nocturne avec désaturation profonde et rapport apnée/hypopnée avec index
supérieur à 40 ; le risque d’apnées postopératoires est alors élevé et l’hospitalisation de
jour est contre-indiquée.
Sur le plan anesthésique, cette obstruction peut gêner l’induction par inhalation et
créer rapidement des difficultés de perméabilité des voies aériennes supérieures. Il est
ainsi prudent d’avoir une voie veineuse avant l’induction.
Chez les enfants plus grands, elle est parfois responsable d’intubation difficile dont
les critères classiques doivent être évalués (ouverture buccale, distance thyro-mentale,
signe de Mallampati). La classification de Mallampati n’est par contre pas adaptée
chez les plus jeunes enfants.
Une surinfection peut aggraver les signes d’obstruction se traduisant par des
angines fébriles ou même des abcès récidivants péri-amygdaliens ou rétro-pharyngés
qu’il faudra traiter par une antibiothérapie efficace avant l’amygdalectomie. Cette anti-
biothérapie est également indiquée en cas d’enfant porteur d’une cardiopathie valvulaire
ou d’une C.I.V.
1.2. RISQUE HEMORRAGIQUE [6, 7]
Il varie de 0,5à8% (moyenne 2,6 % selon les grandes séries supérieures à 2 000 cas)
mais le moment de survenue et la nécessité d’une reprise chirurgicale ne sont pas sou-
vent précisées.
Le volume de la perte sanguine peut alors dépasser 10 % de la masse sanguine ;
Cette hémorragie est soit immédiate ou survient quelques heures après l’intervention
(délai entre 6 et 12 heures suivant les auteurs), mais le plus souvent avant la 8e heure
postopératoire.
Les hémorragies tardives liées à une chute d’escarres surviennent entre le 6e et le
10e jour et sont plus fréquentes que les hémorragies des premières heures. Les causes
des hémorragies précoces sont souvent locales, attribuables à un défaut d’hémostase ou
à des anomalies tissulaires ou anatomiques (amygdales très inflammatoires, abcès
récent). Certains auteurs ont proposé une antibiothérapie systématique pour prévenir ce
risque, mais l’efficacité de cette mesure n’a pas été démontrée. Les risques de saigne-
ment justifient donc des mesures indiscutables :
• Si un enfant est atteint d’une coagulopathie constitutionnelle (hémophilie ou maladie
de Von Willebrand) et si l’amygdalectomie est indiscutable, il faut maintenir une
surveillance médicale et hématologique à l’hôpital durant toute la période à risque, et
lui administrer des facteurs de substitution jusqu’au 12e ou 14e jour.
• Par contre, en l’absence d’antécédent familial, ou de signes évoquant un saignement
anormal, ou encore si un bilan antérieur était normal, le bilan d’hémostase systéma-
tique ne s’impose pas selon les recommandations de l’A.N.A.E.S [2]. Son absence
raisonnée ne peut être une menace médico-légale. Mais ceci demeure un sujet de
controverse et ne donne pas lieu à un consensus, car il apparaît qu’un interrogatoire
très précis et attentif est parfois mis en défaut chez quelques patients. Aussi il peut
sembler légitime de réaliser un bilan de coagulation systématique chez les enfants les
plus jeunes (avant 3 ans) n’ayant pas encore subi de traumatisme ou d’intervention
antérieure telle qu’une adénoïdectomie. C’est au nom de ce risque faible que bien des

Accès aux voies aériennes en anesthésie 85
médecins anesthésistes en France continuent de pratiquer un examen de coagulation
de principe, basé sur le taux de plaquettes et la mesure du temps de céphaline activée.
Il faut cependant en connaître les limites. En effet, le TCA peut être allongé par de
mauvaises conditions de prélèvement ou en présence d’anticoagulants circulants,
fréquemment retrouvés en pathologie O.R.L et qui n’ont pas d’incidence sur la
coagulation. Ainsi en cas d’allongement du TCA supérieur à 1,3 par rapport au
témoin chez l’enfant, il est nécessaire de demander la recherche d’anticoagulants
circulants ; si elle est négative, il faut doser les facteurs VIII et IX et le profacteur
Willebrand. En fait le TCA a une très faible sensibilité (3 %) et une faible valeur
prédictive (7 %) dans l’évaluation du risque opératoire [8].
2. L’HOSPITALISATION DE JOUR EST-ELLE RAISONNABLE?
C’est là encore toujours un sujet de débat pour l’amygdalectomie ; l’enquête
«S.F.A.R. 3 jours» a montré que seulement 28 % des anesthésies pour amygdalectomie
sont réalisées en ambulatoire. Ceci est beaucoup plus admis aux U.S.A. [9].
L’hospitalisation de jour est proposée à condition qu’il y ait un protocole d’accord
entre les équipes anesthésiste et O.R.L., et qu’une organisation soit adaptée. Ainsi, pour
les amygdalectomies, il est souhaitable que l’intervention soit réalisée le matin avant
10 heures de manière à poursuivre une surveillance postopératoire au mieux 8 heures.
Il faut aussi que :
• Les patients soient dans la catégorie ASA I ou II (avec un état stable et un traitement
adapté) ;
• L’entourage familial soit coopérant, capable de comprendre et d’exécuter les exigen-
ces de ce mode d’hospitalisation et d’anesthésie, à savoir :
- nécessité du jeûne préopératoire avec éventuel engagement écrit,
- obligation de posséder une ligne téléphonique,
-
retour à domicile en voiture avec une personne accompagnante en plus du conducteur,
- possibilité de revenir rapidement à l’hôpital ; le patient doit donc rester dans un
lieu géographique permettant de le ré-hospitaliser en moins de 30 minutes (domi-
cile, famille, hôtel ou maison des parents).
La famille doit toujours être prévenue que la sortie du patient le soir de l’anesthésie
peut être différée pour des raisons médicales :
• Délai postanesthésique inférieur à 6 heures,
• Déglutition incorrecte,
• Douleur importante et non contrôlée,
•
Saignement au niveau du pharynx lors de l’examen O.R.L. (systématique avant la sortie),
• Vomissements répétitifs,
• Fièvre supérieure à 38°C,
ce qui nécessite de prévoir une hospitalisation dans une unité traditionnelle, en cas
d’unité de chirurgie ambulatoire individualisée.
Ainsi l’hospitalisation courte, dans le respect de ces conditions, est tout à fait
acceptable pour les amygdalectomies car la majorité des hémorragies postopératoires
est décelable très tôt après l’intervention. La réalisation d’enquêtes au retour au domi-
cile pour évaluer la douleur, les troubles du sommeil, la difficulté de l’enfant à s’alimenter
et d’autres complications devraient permettre de mieux déterminer les conséquences de
ce mode d’hospitalisation, de le développer en assurant une prise en charge satisfai-
sante du malade.

MAPAR 200186
3. ANESTHESIE
Il s’agit toujours d’une anesthésie générale. Elle est souvent source d’anxiété pour
les parents qui doivent être informés au mieux lors de la consultation sur les conditions
d’induction, sur le fait que le médecin qui anesthésiera leur enfant est souvent un autre
membre de l’équipe médicale. Les programmes vidéos, des photographies sur les
locaux peuvent aider à diminuer l’angoisse parentale et donc celle de l’enfant [10].
3.1. PREMEDICATION
Une prémédication anxiolytique à base 0,3 à 0,4 mg.kg-1 de midazolam oral ou
rectal, est à discuter dans certains cas. Kain montre l’efficacité sur l’amnésie de
0,5 mg.kg-1 de midazolam administré par voie orale 10 minutes avant l’anesthésie [11].
L’emploi d’anti-inflammatoires (acide niflumique) n’a pas prouvé son efficacité. L’atro-
pine n’est pas utilisée systématiquement.
3.2. INSTALLATION ET MONITORAGE
L’enfant est installé en décubitus dorsal et les éléments de surveillance sont à
respecter de manière intransigeante : électrocardioscope, oxymètre de pouls, pression
artérielle non invasive, capnographe, stéthoscope précordial, système de réchauffement.
Le stéthoscope n’est pas le moniteur du pauvre, il reste très utile en O.R.L. pédiatri-
que car il est le moyen le plus rapide et le plus fiable de diagnostiquer immédiatement
un problème de ventilation et d’obstruction des voies aériennes d’autant que les fuites
autour d’un masque insuffisamment étanche sur le visage de l’enfant peuvent fausser
l’interprétation de la courbe du capnogramme à l’induction.
3.3. INDUCTION [12-14]
L’induction par inhalation est la modalité la plus fréquente chez les enfants de moins
de 7 ans comme l’a montré l’enquête SFAR 1996. Elle doit être précédée d’une
pré-oxygénation systématique de 2à3minutes. Le sévoflurane par ses avantages
hémodynamiques et respiratoires est l’halogéné de référence actuel. Il n’induit pas
d’extrasystole, pas de bradycardie, il y a moins de laryngospasmes. L’administration
d’une concentration de 8 % d’emblée associée à un mélange O2-N2O (50 %) permet
une perte rapide du réflexe ciliaire en 45 secondes et la mise en place précoce d’une
canule oro-pharyngée, utile quand les amygdales sont très obstructives. Par contre, le
délai d’intubation est d’environ 4,5 à 5 minutes avec un mélange oxygène-protoxyde
d’azote à 66 %.
L’induction par voie intraveineuse est donc réservée aux enfants plus âgés, le
propofol doit être administré au moins à la dose de 5 à 6 mg.kg-1.
3.4. ENTRETIEN DE L’ANESTHESIE
L’entretien de l’anesthésie est assuré par un halogéné (sévoflurane ou isoflurane),
avec un mélange oxygène - protoxyde d’azote ou oxygène - air et des morphiniques,
encore insuffisamment utilisés en 1996 (19 % chez les enfants de 1 à 4 ans, 37 % chez
les enfants de 5 à 14 ans).
L’anesthésie doit être suffisamment profonde pour éviter la réflectivité des voies
aériennes supérieures et la réponse catécholaminergique à la stimulation oro-pharyngée.
Le choix du morphinique peut être discuté. Certains anesthésistes utilisent le sufen-
tanil (0,2 à 0,3 mcg.kg-1) ou le fentanyl (2 à 3 mcg.kg-1), d’autres l’alfentanil (10 à
20 mcg.kg-1) avec un relais rapide par la morphine intraveineuse. Le rémifentanil peut
avoir un intérêt du fait de sa cinétique, mais pose le problème du relais antalgique
immédiat au réveil et n’a pas l’A.M.M. chez le jeune enfant.

Accès aux voies aériennes en anesthésie 87
Une perfusion de Ringer-lactate additionnée de 1à2% de glucose, assure la réhy-
dratation de l’enfant sur la base de 4 ml.kg-1.h-1. L’apport initial pour compenser les
heures de jeûne peut être de 15 ml.kg-1 durant la première heure.
La ventilation peut être laissée spontanée puisqu’on utilise rarement un curare. Elle
peut aussi être contrôlée en fonction de la durée de l’intervention. Il est, de toute façon,
nécessaire de faire une vérification de la capnographie et de la concentration d’halo-
géné (fraction inspirée et fraction expirée). Le circuit de ventilation doit être adapté à
une chirurgie céphalique : circuit de Bain par exemple. Il faut également avoir un
système d’évacuation des gaz anesthésiques efficace ou un bas débit de gaz frais pour
diminuer la pollution de l’environnement.
3.5. PROTECTION DES VOIES AERIENNES
Elle est impérative et ne peut être assurée que par une intubation ou un masque
laryngé armé. Or, si l’enquête française de 1996, montrait que l’intubation trachéale
n’était pratiquée chez des enfants de plus de 5 ans que dans 56 % des cas, et chez des
enfants plus jeunes dans seulement 38 % des cas (la place du masque laryngé variant
de 1 % à 6 %), cette situation n’est sans doute plus la réalité actuelle, d’autant que la
technique au Sluder est en voie d’extinction.
3.5.1. INTUBATION [15-17]
L’intubation reste la meilleure sécurité pour la protection des voies aériennes. Elle
peut être réalisée par voie orale ou nasale avec une sonde toujours munie d’un ballon-
net, en PVC ou sonde armée, éventuellement préformée. En cas d’intubation orale, son
calibre doit respecter la sous-glotte de l’enfant suivant la formule :
[âge (en années) + 16] / 4 = taille de la sonde (en mm)
La qualité des sondes armées actuelle permet de les utiliser avant l’âge de 4 ans.
La curarisation n’est pas indispensable du fait de la facilité d’intubation sous sévo-
flurane ou propofol mais, si elle est réalisée, la succinylcholine est le curare le plus
adapté à des conditions d’intubation optimale (en respectant les contre-indications qui
peuvent s’appliquer à tous les curares).
L’avantage de la voie nasale est contestable. Elle permet de libérer le champ opéra-
toire, mais elle complique la réalisation d’une adénoïdectomie associée. Elle facilite le
geste chirurgical quand la technique d’ablation des amygdales utilisée est le Sluder,
avec tamponnement. Mais l’introduction et la progression de la sonde peuvent être
gênées par l’étroitesse des narines ou l’hypertrophie adénoïdienne.
Elle ne protège pas totalement de l’inhalation de sang dans les voies aériennes sous-
glottiques si le ballonnet n’est pas assez étanche. Elle pose le problème des conditions
d’extubation au moment du réveil. C’est cependant la seule technique à préconiser en
cas d’estomac plein, c’est-à-dire en cas de reprise pour hémorragie dans les heures
suivant l’amygdalectomie.
Quelle que soit la voie, il faut toujours être vigilant vis-à-vis des risques d’écra-
sement de la sonde et garder un accès au raccord durant le temps opératoire.
Chez les enfants obèses avec syndrome d’apnées nocturnes, il peut être nécessaire
de réaliser une intubation sur fibroscope souple avec anesthésie locale.
3.5.2. MASQUE LARYNGE [18, 19]
Le masque laryngé armé (M.L.A.) est une alternative intéressante, mais cette
technique n’est pas encore très répandue.
Sa pose nécessite une anesthésie profonde. Le masque peut être difficile à placer en
cas d’amygdales très hypertrophiées (2à4% d’échecs). La pointe peut buter sur les
amygdales hypertrophiques et se retourner en arrière empêchant sa progression.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%