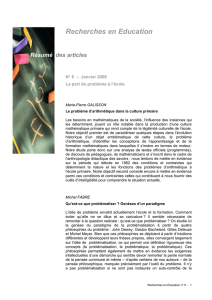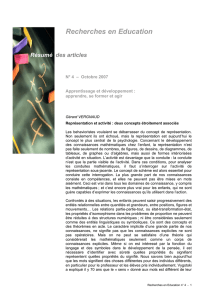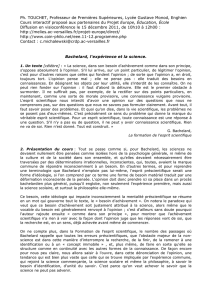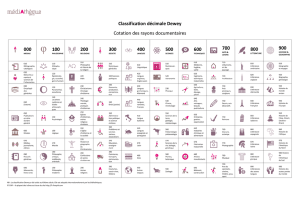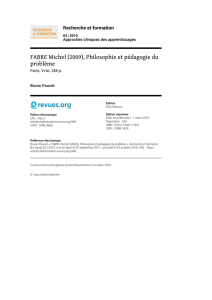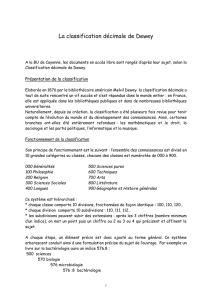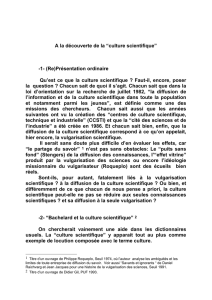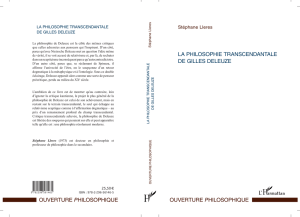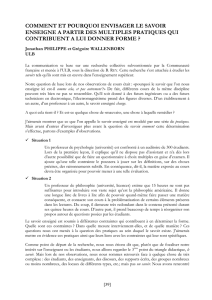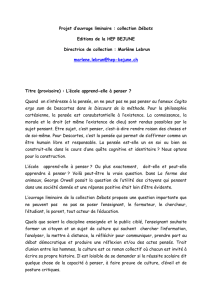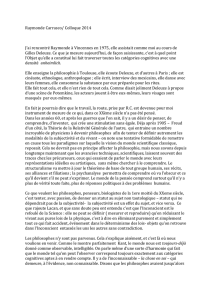Lire la revue - Recherches en Education

1
Recherches
en
Education
La part du problème à l’école
N°6 - Janvier 2009
Centre de Recherche en Education de Nantes
Centre de Recherche en Education de NantesCentre de Recherche en Education de Nantes
Centre de Recherche en Education de Nantes
C.R.E.N.

2
echerche
echercheecherche
echerches
ss
s en Education
en Education en Education
en Education
est la revue du Centre de Recherche en Education de
Nantes (CREN), équipe d’accueil EA 2661. Créée en 2006, elle se propose de publier deux ou
trois numéros par an. Elle est dotée d’un comité de lecture scientifique et d’un comité de
rédaction. Elle est hébergée par le site web du CREN : http://www.cren-nantes.net
Buts de la revue
Recherches en Education se veut une revue généraliste publiant aussi bien des
dossiers thématiques que des articles hors thèmes. Elle se propose de faire connaître
de nouveaux chantiers de recherche en sciences de l’éducation, de diffuser largement
les travaux des laboratoires de recherche en sciences de l’éducation, d’assurer une
visibilité internationale grâce aux facilités de diffusion et de consultation qu’offre
Internet.
Types d’articles publiables dans cette revue
Cette revue est ouverte à toutes les disciplines contributives des sciences de
l’éducation, aux multiples formes qu’y prend la recherche. Toutes les méthodologies
sont admises pourvu qu’elles fassent l’objet d’une explicitation suffisante et d’un usage
rigoureux. La revue publiera donc des articles relevant de recherches théoriques
(revues de questions, travaux d’ordre épistémologique, philosophique ou historique),
de recherches empiriques, de recherches pédagogiques ou didactiques.
Fonctionnement de la revue
Le comité de rédaction soumet les articles à deux lecteurs : un enseignant-chercheur
du CREN et un membre extérieur. En cas de litige, une troisième lecture est
demandée.
Certains numéros de la revue sont thématiques. Ces numéros sont placés sous la
responsabilité scientifique d’un rédacteur invité, lequel pourra être un membre du
CREN ou un enseignant-chercheur d’une autre équipe. Le contenu des dossiers
thématiques est négocié avec le comité de rédaction. Les articles de ces dossiers sont
soumis à une double lecture : une par le rédacteur invité et l’autre par un membre du
comité de lecture.
Au dossier thématique s’ajoutent des articles hors thème dans la rubrique Varia. Ces
articles font l’objet d’une double lecture.
Comité de lecture
Outre les enseignants chercheurs du CREN, le comité de lecture est constitué des
membres extérieurs suivants :
Jean-Pierre Astolfi - Université de Rouen Yves Reuter - Université de Lille
Bertrand Bergier - UCO Angers Bernard Rey - ULB
Marc Bru - Université de Toulouse Patricia Schneeberger - IUFM de Bordeaux
Loïc Chalmel - Université de Rouen Gérard Sensevy - Université de Rennes
Claude Dubar - Université de St Quentin Denis Simard - Université Laval (Québec)
R
RR
R

3
Marc Durand - Université de Genève Michel Soëtard - UCO Angers
Christiane Gohier - Université du Québec Rodolphe Toussaint - Université du Québec
Jean Houssaye - Université de Rouen Agnès Van Zanten - CNRS
Pierre Pastré - CNAM Gérard Vergnaud - CNRS
Henry Peyronnie - Université de Caen Alain Vergnioux - Université de Caen
Gaston Pineau - Université de Tours Jacques Wallet - Université de Rouen
Thierry Piot - Université de Caen Annick Weil Barais - Université d’Angers
Patrick Rayou - IUFM de Créteil Constant Xypas - UCO Angers
Equipe éditoriale
Directeur de publication et rédacteur en chef
Michel Fabre, directeur du CREN
Rédacteur adjoint
Frédéric Tupin
Comité de rédaction
Jean-Pierre Benoit
Carole Daverne
Yves Dutercq
Martine Lani-Bayle
Christian Orange
Secrétariat d’édition
Agnès Musquer
Sylvie Guionnet
Crédit Photo : Superchi
revue@cren-nantes.net
sylvie.guionnet@univ-nantes.fr
http://www.cren-nantes.net
Université de Nantes - UFR Lettres et Langage
Chemin la Censive du Tertre BP 81227 44312 Nantes Cedex 3 France
: 02 40 14 11 01 Fax : 02 40 14 12 11

4
Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France
Vous êtes libres :
. de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
Selon les conditions suivantes :
Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original.
Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser
cette création à des fins commerciales.
Pas de Modification. Vous n'avez pas le droit de modifier, de
transformer ou d'adapter cette création.
- A chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux
autres les conditions contractuelles de mise à disposition de cette création.
- Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire
des droits.
Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions
au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes
citations, parodie...)
Ceci est le Résumé Explicatif du
Code Juridique (la version intégrale du contrat).
Avertissement
ISSN : 1954 - 3077
© CREN – Université de Nantes,
2006

5
Recherches en Education
Recherches en EducationRecherches en Education
Recherches en Education
N° 6 - Janvier 2009
La part du problème à l’école
Edito – Hubert VINCENT.......................................................................................................
7
Marie Pierre GALISSON
Le problème d’arithmétique dans la culture primaire : entre conception d’un modèle
d’apprentissage et enjeux éducatifs et sociaux d’une formation mathématique,
quelques étapes dans la trajectoire d’un objet emblématique d’une culture scolaire ............
9
Michel FABRE
Qu’est-ce que problématiser ? Genèses d’un paradigme ......................................................
22
Alain FIRODE
La notion de problème chez K. Popper et ses implications pédagogiques............................
33
Jean-François GOUBET
Le problème pédagogique comme expression et travail........................................................
42
Silvio GALLO
Le problème et l’expérience de la pensée :
implications pour l’enseignement de la philosophie................................................................
49
Jean-Benoît BIRCK
Créer des problèmes. Eléments pour une pédagogie des problèmes
à partir de Gilles Deleuze........................................................................................................
59
Hubert VINCENT
Problème et émancipation à l’école........................................................................................
66
Varia
VariaVaria
Varia
Sébastien CHARBONNIER
De l’intérêt au savoir : le processus de l’apprentissage chez Dewey et Bachelard ...............
80
Liliane PORTELANCE & Louise GIROUX
La problématisation dans un processus de recherche collaborative......................................
95
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
1
/
147
100%