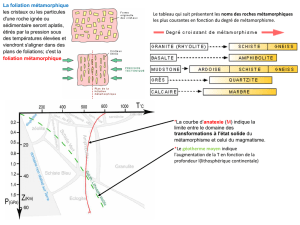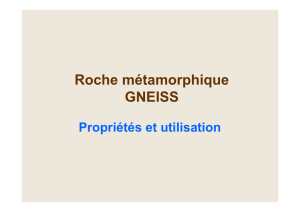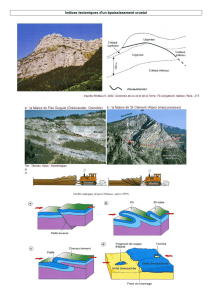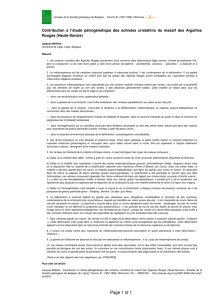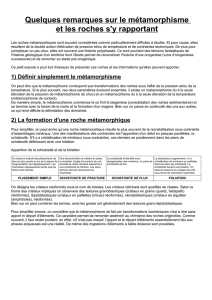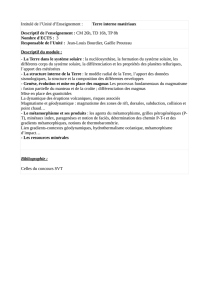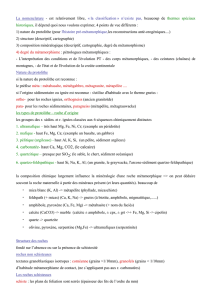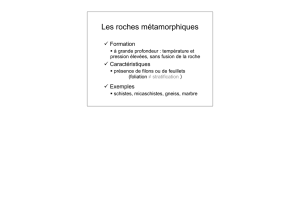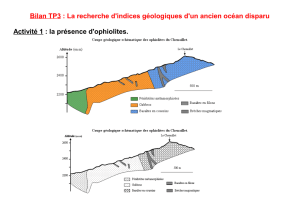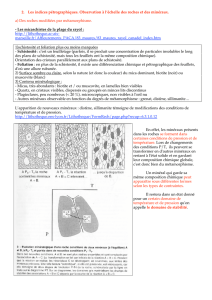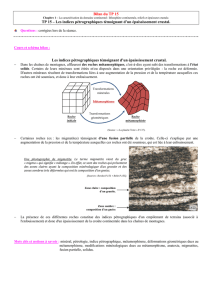la commission de volcanisme dans le bas limousin

Saga Information – N° 286 – Avril 2009
14
L
LA
A
C
CO
OM
MM
MI
IS
SS
SI
IO
ON
N
D
DE
E
V
VO
OL
LC
CA
AN
NI
IS
SM
ME
E
D
DA
AN
NS
S
L
LE
E
B
BA
AS
S
L
LI
IM
MO
OU
US
SI
IN
N
Par Yves Grimault,
membre de la Commission de volcanisme de la SAGA.
Figure 11 – Plis hectométriques de la carrière de Chambon. Ce sont en fait des replis apparus sur les flancs de l’antiforme
de Tulle, lors de la phase tectonique finale qui a vu se former cette même antiforme, de direction axiale à peu près nord-sud.
De Brive à Tulle, cette sortie de la Commission de
volcanisme de la SAGA, en septembre 2007, nous a
permis de traverser des terrains malmenés par les
mouvements tectoniques, dans la région du Bas
Limousin, qui recèlent les indices incontestables du
métamorphisme régional.
Elle a fait suite à une série d’« Entretiens sur le
métamorphisme » donnés par Dominique Rossier, que
les membres de la Commission sont heureux de comp-
ter parmi eux. Sa documentation, ses connaissances
et son enthousiasme ont fait merveille, tant pour nous
intéresser à cette matière ardue qu’est le métamor-
phisme que pour nous permettre d’en saisir les pré-
mices, l’essentiel. Je ne peux manquer, en débutant ce
compte rendu, de le remercier pour sa patience et sa
disponibilité sans lesquelles il nous aurait été impos-
sible de mener jusqu’au bout les travaux autour de
cette sortie.
Il n’y a, bien sûr, rien de mieux que d’observer en
place et de toucher les matériaux que l’activité de la
Terre fabrique pour remettre en ordre les savoirs
apportés par les Entretiens et accéder ainsi à une
meilleure compréhension des phénomènes. Rien de
mieux, également, que d’avoir à en rendre compte
pour affermir nos connaissances.
Ce que nous vous proposons de faire dans les lignes
qui vont suivre est un voyage à la fois au cœur des
lois de la physique, pression et température, dans la
gigantesque échelle des temps géologiques et dans
l’espace géographique mouvant, autant que dans les
profondeurs de la croûte terrestre et les microstruc-
tures de la matière.
Accrochons nos ceintures… Top départ !

Saga Information – N° 286 – Avril 2009
15
Le métamorphisme régional
du Bas Limousin
Il appartient au type très répandu de métamorphisme
de moyennes pressions et d’assez hautes tempé-
ratures. Ce métamorphisme des marges occidentales
du vieux massif hercynien résulte de l’enfouissement
d’écailles de la lithosphère continentale, lors de la
subduction puis de la collision entre deux plaques
tectoniques, responsables de la création de la chaîne
hercynienne du Dévonien au Carbonifère.
D’ouest en est, ce métamorphisme croît en intensité ;
on parle de gradient métamorphique, et dans notre
cas, de gradient prograde : c’est-à-dire que la tempé-
rature et la pression croissent simultanément, ce qui
n’est pas toujours le cas (figure 1).
Le métamorphisme se traduit aussi en termes de
zones, en ordre croissant de métamorphisme :
anchizone épizone mésozone catazone.
Sur le terrain, on observe, de l’épizone à la méso-
zone, la séquence minéralogique du gradient méta-
morphique croissant et, de la mésozone à la catazone,
des intrusions et un métamorphisme qui va conduire
les roches jusqu’à leur fusion.
Voici donc le programme qui nous a occupés les
deux premiers jours (figure 2) :
• 1. de l’épizone à la mésozone :
- les ardoisières de Travassac : quartzites et mica-
schistes à biotite,
- la vallée du Maumont Noir, Taupineries et Moulin
du Nègre : apparition de la chlorite, des biotites, des
grenats, et observation de l’isograde de la staurolite,
- la gare d’Aubazine : « gneiss gris du Bas Limou-
sin » ;
• 2. de la mésozone à la catazone :
- la carrière de Chambon, à Vergonzac,
- la carrière du tunnel de Bonnel,
- la carrière du tunnel de Cornil,
- la carrière du tunnel des Îles, près de Chameyrat.
De l’épizone à la mésozone
Les ardoisières de Travassac
(arrêt 1.1)
Dans la fraîcheur et le soleil matinal du Limousin,
nous visitons une carrière d’ardoise, très impres-
sionnante par son à-pic vertigineux. Les bancs d’ar-
doise alternent avec des bancs de quartzite en un pen-
dage vertical du plan de schistosité ; la carrière
montre d’immenses pans rocheux de quartzite dressés
qui correspondent à la roche stérile non extraite : les
« pans de Travassac » (figure 3).
Figure 3. Les impressionnants « pans de Travassac » sont des lames
de quartzite d’épaisseur plurimétrique qui se dressent jusqu’à des
dizaines de mètres au-dessus du plancher de la carrière, après
extraction des schistes ardoisiers. Les plans de schistosité des deux
roches ont été redressés verticalement par
les mouvements tectoniques hercyniens.
Ce sont des métasédiments (1) de la série de Don-
zenac, essentiellement des quartzites feldspathiques et
des micaschistes à biotite. À l’origine, il s’agit d’un
complexe volcano-détritique caractérisé par une
alternance de sédiments volcaniques acides, qui vont
donner des quartzites, et de sédiments argileux qui
donneront des argilites.
L’ardoise est une roche sombre à grains fins,
d’aspect satiné, de texture lépidoblastique (du gr.
lepidos : écailles, et blastos : bourgeon), avec des mi-
néraux brillants à peine visibles à l’œil nu dans les
plans de schistosité ; ce sont des micas blancs, comme
la séricite. Elle se débite en feuillets réguliers grâce
au clivage ardoisier parfait.
La carrière est toujours exploitée par la Société des
Ardoisières Bugeat. L’ardoise qui en est extraite,
exempte de pyrite, est une des plus résistante à
l’action du temps. Elle est toujours utilisée, en par-
ticulier dans le cadre de la restauration de monuments
historiques tels le Mont-Saint-Michel et la cathédrale
de Chartres.
Nous nous trouvons là à la limite anchizone-épizone
du métamorphisme du Bas Limousin, à la marge d’un
ancien bassin sédimentaire, et/ou d’effondrement,
continental. Les dépôts d’origine de projections vol-
caniques rhyodacitiques, alternées avec des dépôts de
sédiments terrigènes (surtout d’argile) ultérieurement
remaniés et mélangés, se sont mis en place entre –
470 et – 440 Ma (Ordovicien). Le processus mé-
tamorphique a commencé vers – 410 Ma (Dévonien,
début de l’orogenèse hercynienne). La schistosité est
datée d’environ – 400 Ma.

Saga Information – N° 286 – Avril 2009
16
Lors de la sédimentation, une transformation pure-
ment mécanique s’effectue, la diagenèse : les vases
accumulées sont compressées, l’eau qu’elles conte-
naient s’en échappe. Les fines particules qui les com-
posent sont ensuite aplaties et orientées selon un mê-
me plan – un premier plan de schistosité, stratigra-
phique (S0) – perpendiculairement à la contrainte de
la compression (figure 4).
La plaque océanique voisine est enfouie, par glisse-
ment d’ouest en est, entraînée par le manteau supé-
rieur lithosphérique, en subduction sous la plaque
continentale. Elle entraîne à sa suite une unité conti-
nentale, qui sera fortement écaillée et raccourcie, et
finira par former le « prisme d’accrétion ». Au cours
de son enfouissement, l’unité continentale écaillée
subit des plissements majeurs et une compression
considérable à l’origine d’une seconde schistosité
(S1).
Une transformation chimique se produit aussi du fait
des températures et de la pression. L’argile compres-
sée se transforme en schiste ardoisier. Les tufs rhyo-
dacitiques sont à l’origine des quartzites, des roches
sombres jamais litées, en bancs plurimétriques, avec
quartz abondant, plagioclase, mica noir et orthose.
Sites des Taupineries et du Moulin du Nègre,
dans la vallée du Maumont Noir
(arrêt 1.2)
En quittant Travassac, et suivant la vallée du Mau-
mont Noir à quelques kilomètres vers l’est, nous
entrons dans l’épizone. Ceci est révélé en observant
l’apparition de la chlorite dans les lames minces,
preuve du passage d’un seuil du gradient méta-
morphique (figures 5 et 6).
Figure 6. Dominique Rossier nous montre l’échantillon
correspondant à l’apparition de la staurolite
au lieu dit « Moulin du N ègre ».
Des affleurements, aux lieux-dits des Taupineries et
du Moulin du Nègre, nous signalent le passage de
l’isograde (2) du début de la mésozone, domaine de
stabilité de la staurolite. Le gradient métamorphique
franchit un seuil important en pression et température,
révélé par l’apparition des silicates d’alumine (depuis
la composition d’origine riche en argile, donc en
alumine et en fer) véritables géobaromètres et géo-
thermomètres du métamorphisme.
Maintenant, nous avons des indices sur la tem-
pérature et la pression (voir la figure 1).
Nous réalisons cinq prélèvements montrant l’ap-
parition progressive de minéraux du métamorphisme
(chlorite, biotites, grenats) et de l’isograde de la
staurolite (figure 7).
La gare d’Aubazine
(arrêt 1.3)
Les dessins et photos de cette série décrivent et tentent
d’interpréter la structure et la fabrique (3) du gneiss, dit
« gneiss gris du Bas Limousin » (figure 8), un
paragneiss (1) qui affleure à la gare d’Aubazine, sur la
rive droite de la Corrèze. L’échantillon qui a servi aux
observations a été prélevé derrière les maisons du
hameau, un peu avant la gare, juste après l’isograde de
la cyanite (figure 9). La séquence d’origine (pélites et
grauwackes) est chimiquement comparable à celle de
Travassac et du Maumont Noir.
Figure 8. (Arrêt 1.3). Cassure fraîche du « gneiss gris du Bas
Limousin ». Des feuillets quartzo-plagioclasiques alternent avec de
minces feuillets micacés, disposés suivant le plan de foliation.
Ici, la température et la pression ont augmenté et un
nouveau minéral apparaît : la cyanite (ou disthène),
minéral index important car excellent géobaromètre
(voir la figure 1).

Saga Information – N° 286 – Avril 2009
17
Figure 1. Diagramme pression/température.
Pour représenter de façon synthétique les minéraux qui apparaissent successivement dans une roche subissant
le métamorphisme, on utilise universellement un diagramme à deux dimensions, où les coordonnées sont la
pression (donc la profondeur) et la température. Ce diagramme a été établi pour une roche issue de sédiments
continentaux riches en argile : pélites, grauwackes, etc., et subissant des pressions et des températures
croissantes (au-dessus de 500 °C). Le taux de vapeur d’eau entrant dans la composition de la phase vapeur est
supposé élevé.
Sur le diagramme, les trois segments inclinés sur l’horizontale et convergeant vers un point triple (vers 5,5
kbar et 600 °C) délimitent les zones de stabilité des trois formes (« polymorphes ») remarquables du silicate
d’alumine pur et anhydre, minéral indicateur par excellence du degré du métamorphisme. Les polymorphes
sont représentés par leurs abréviations internationales : And pour l’andalousite, indicateur de basse pression,
donc de faible profondeur ; Sil pour la sillimanite, indicateur de températures basses à moyennes mais de
hautes pressions ; Ky pour la cyanite (ou disthène), indicateur de haute température, de la basse à la haute
pression.
Ces polymorphes se révèlent très utiles pour identifier les conditions physiques du métamorphisme subi par la
roche ; pour cette raison, on les appelle « minéraux index ».
Les autres segments de droite, quasi verticaux sur le diagramme, délimitent les domaines de températures et
de pressions d’apparition d’autres « minéraux index » et leurs domaines de stabilité. Segments et domaines
constituent ce qu’on appelle une « grille pétrogénétique ». Ces minéraux sont également des silicates
d’alumine, mais contenant du fer et du magnésium, et certains hydroxylés. Pour nos observations, le plus
remarquable est la staurolite, dont le domaine de stabilité est en grisé sur le diagramme. Ils sont signalés par
les abréviations conventionnelles : Chl : chlorite ; Bt : biotite ; Grt : grenat ; St : staurolite.
Les ronds portant un numéro sur le diagramme indiquent la position dans l’espace pression/température pour
les roches que nous avons récoltées lors des arrêts 1.2 (points 207 et 509 sur le diagramme) et 1.3 (512 sur le
diagramme) de notre sortie (se reporter à la carte géologique simplifiée ci-dessous).
Remarque : pour établir les grilles pétrogénétiques, on a reproduit en laboratoire, au cours de milliers
d’expériences couvrant tout l’espace pression/température, les roches échantillonnées par les géologues sur les
terrains métamorphiques, à partir de leurs constituants rassemblés dans les mêmes proportions.

Saga Information – N° 286 – Avril 2009
18
Figure 2. Carte géologique simplifiée montrant les arrêts. 1.1 : ardoisières de Travassac ; 1.2 : « Taupineries » et
« Moulin du N ègre », dans la vallée du Maumont N oir ; 1.3 : gare d’Aubazine.
Plus à l’est par rapport aux précédents sites, nous
nous rapprochons du cœur de l’antiforme de Tulle.
Une différenciation pétrographique apparaît entre les
feuillets schisteux. La roche acquiert une foliation (4)
métamorphique, et on passe du schiste au gneiss, en
lits d’une épaisseur bien modeste, quelques milli-
mètres seulement : les lits sombres à minéraux ferro-
magnésiens alternent avec les lits clairs quartzo-
feldspathiques où les grains de feldspaths sont bien
visibles (c’est cette structure qui permet de qualifier
cette roche de gneiss).
En termes de géochronologie, ce site est comparable
à celui du Maumont Noir (figure 10).
De la mésozone à la catazone.
Les intrusions
Les quatre sites suivants montrent le passage d’un
métamorphisme de degré moyen à celui d’un degré
fort conduisant à l’anatexie, phénomène de fusion
partielle de la roche.
Figure 10.
N os collègues
Françoise Larvor
(de dos) et Yves
Grimault
mesurant au
clinomètre la
direction et le
pendage du plan
de foliation sur
un affleurement
de leptynite
d’Aubazine, à
l’Abbaye-aux-
Dames.
(Photo Guy
Chantepie, GAGN ).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%