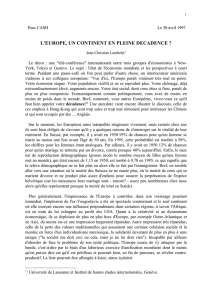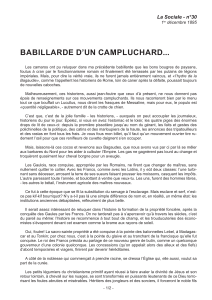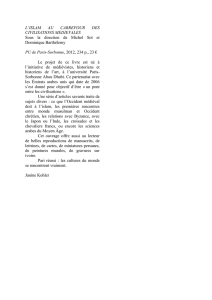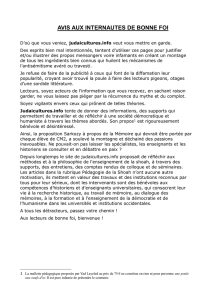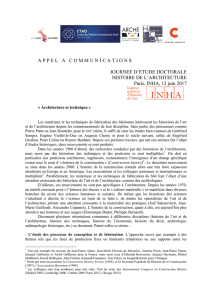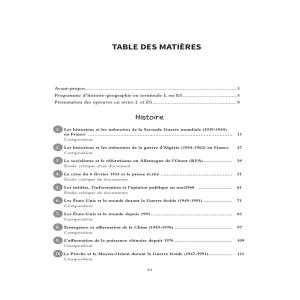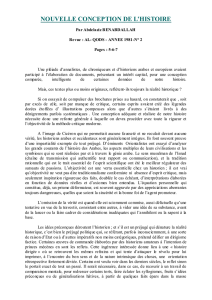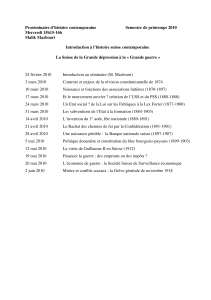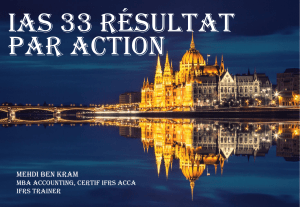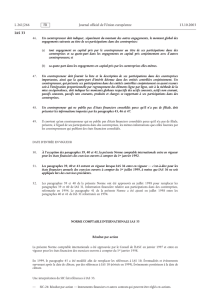Quelle place pour l`histoire des « gens ordinaires »

Elément de corrigé du sujet : quelle place pour l’histoire des «gens ordinaires » ?
« Flambeau. -Et nous, les petits, les obscurs, les sans-
grades
Nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades
Sans espoir de duchés ni de dotation ;
Nous qui marchions toujours et jamais n'avancions ;
Trop simples et trop gueux pour que l'espoir nous berne
De ce fameux bâton qu'on a dans sa giberne...
Edmond Rostand, l’Aiglon 1900
I. Une sensibilité «romantique » aux «oubliés »
€L’épuisement de la biographie des «grands hommes »
Le désenchantement des historiens envers les grands hommes est net : les historiens biographes ne sont plus des
admirateurs mais des démystificateurs (Charlemagne…) ; les grands hommes sont moins étudiés pour eux-mêmes que pour
ce qu’ils représentent aux yeux de leurs contemporains et de leurs successeurs. La question de leur rôle dans l’histoire est
renvoyée à des réponses de la complexité (l’Hitler de Kerschaw est tout à la fois produit de son temps et l’organisateur du
nazisme). Confrontés à la masse des biographies des grands hommes (120 000 biographies d’Hitler ont été écrites avant
celle de Kershaw), les biographes se sont tournés vers des personnages secondaires parfois pour échapper aux inévitables
débats dans lesquels l’historiographie a enfermé certains «grands hommes » ainsi Robespierre et Danton. Pierre Serna leur
préfère Antonnelle, un aristocrate révolutionnaire (qui n’a cependant rien de quelqu’un d’ordinaire…) qu’il présente comme
davantage représentatif du personnel politique de la Révolution. De ces «second rôles » aux anonymes de l’arrière plan il
n’y avait plus qu’un pas à franchir.
€qui fait l’histoire ?
Avec la Révolution française, le peuple entre dans l’histoire, il devient acteur : ainsi l’histoire contemporaine s’intéresse
particulièrement au peuple : le peuple anonyme qui fait masse lors des soulèvements et auquel Michelet consacre des pages
exaltées. La révolution industrielle et la première guerre mondiale contribuent à donner aux masses ce rôle d’acteur central
que le marxisme théorise. Si le XX° siècle est l’ère des masses, c’est d’abord du point de vue des historiens : Marc Bloch en
prit conscience dans l’horreur des tranchées. Il sembla vite aller de soi qu’étudier l’époque contemporaine revenait à
s’intéresser aux acteurs sociaux. Les sources d’ailleurs s’y prêtaient mieux que pour les autres périodes. Ainsi purent
s’épanouir une histoire des groupes sociaux (ouvriers, bourgeois) relayée par des histoires des femmes (Michelle Perrot
passa d’une thèse sur le mouvement ouvrier à l’histoire sociale des femmes).
Pour comprendre la Révolution il fallait aussi s’intéresser à l’émergence du peuple, du Tiers Etat de la Bourgeoisie dans la
période pré-révolutionnaire… l’histoire des prix (Labrousse) y conduisit. Et l’histoire sérielle des années 60 au début des
années 80 fut une histoire des anonymes : Pierre Goubert décrivait la France de Louis XIV en mettant l’accent sur les 20
millions de Français, l’histoire des mentalités voulait aussi être une histoire des anonymes. De même tout le premier volume
de l’œuvre de Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme, est une tentative pour faire l’histoire de ceux qui n’en ont pas,
de ceux pour qui le temps semble immobile et pour lesquels l’historien se fait anthropologue. L’exploration des sources
sérielles en histoire démographique (Dupaquier) fut complétée par exemple par l’apport des inventaires après décès
(François Lebrun pour l’Anjou du XVII° s) qui permettaient d’approcher la vie quotidienne
€La demande des professeurs
Privés de «grands hommes » à faire admirer, les professeurs d’histoire risquaient de présenter à leurs élèves une histoire
désincarnée, sèche voire ennuyeuse. Les quasi-personnages que sont les groupes sociaux, les classes, les Nations peuvent
apparaître comme dotés d’une intentionnalité qui enlève aux individus toute action sur le présent. La littérature offrait
parfois des ressources (Hugo) mais justement c’était de la littérature… Pire : les seuls individus qui demeurent visibles dans
les programmes d’histoire seraient les «monstres » (Napoléon, Hitler, Staline…) ou les hommes providentiels (de Périclès à
de Gaulle). La demande d’une histoire destinée à former des citoyens invite à montrer des hommes et des femmes auxquels
les élèves puissent s’identifier. La tendance scolaire à «partir de l’environnement de l’élève » invitait également à s’intéresser
aux anonymes.
II. une évolution en profondeur de l’histoire sociale
€L’épuisement d’une histoire sociale anonyme
Avec le déclin des grands modèles d’explication des sociétés (marxisme, structuralisme) l’histoire sociale s’est détournée
dans les années 80 des «moyennes » (selon le modèle Durkheim-Labrousse) pour s’intéresser d’une part aux exemples
(mettre de la vie dans les séries chiffrées) et d’autre part aux atypiques (expliquer les «exceptions » aux «règles » des
déterminismes sociaux). L’histoire sociale s’est détournée, en partie, de la description des conditions d’existence matérielle
des hommes en société, pour s’intéresser davantage aux «représentations » aux modes de pensée (cf Corbin). L’évolution
des sociétés occidentale vers toujours plus d’individualisme enfin contribue à une dévalorisation des collectifs dont les
historiens ne sont pas exempts.
€le développement de l’histoire sociale vers les exclus, les marges
Dans les années 70-80 les historiens se tournent vers les archives judiciaires (Arlette Farge) qui permettent d’explorer la
société par ses déviances (marginaux, délinquants, exclus) dont Michel Foucault a affirmé qu’ils constituent de bons points
d’observation des normes cachées (histoire de la folie à l’âge classique) et donc de la société toute entière. On le voit la
mutation de cette histoire sociale est profonde : elle concerne les sources (les sources non sérielles sont mobilisées) et les
approches : pour l’histoire sociale sérielle, l’étude des nombre permettait une approche directe, descriptive : le
comportement «ordinaire »était approché par la moyenne (ex : l’étude des comportements religieux et du déclin des
pratiques à partir du décompte des ventes de cierges par Michel Vovelle), la réalité d’une époque était approchée par l’étude

des comportements «moyens ». L’archive judiciaire, en individualisant les cas, modifie toute l’approche : les cas deviennent
des exemples que l’on espère pouvoir multiplier pour les rendre emblématiques des comportements des groupes sociaux en
les croisant avec des sources sérielles et des sources littéraires (ce qu’a fait par exemple Louis Chevalier dans «Classes
laborieuses, classes dangereuses »), ou bien le cas est étudié sous tous ses aspects selon la méthode «indiciaire » de la micro-
histoire (Ginzburg).
€construire une histoire sociale sur des bases nouvelles
Pour faire l’histoire de ceux qui n’en ont pas deux approches ont été développées qui ont modifié le rapport des
historiens à l’archive : la prosopographie et l’histoire orale. La première, issue de l’histoire ancienne (étude des cursus des
sénateurs romains par exemple), s’est diffusée à l’ensemble des études d’histoire sociale facilitée par le traitement
informatique des données. Elle allie la crédibilité des études sérielles et l’intérêt pour les individus. Elle permet le
changement d’échelle (Jacques Revel), l’ouvrage de Giovanni Lévy (le pouvoir au village) en est l’illustration la plus aboutie.
Ce changement d’échelle le conduit à s’intéresser alternativement au grand nombre (il étudie l’ensemble de la population du
village de Santena) à certaines familles dont les stratégies successorales lui paraissent emblématiques et à des individus
(notamment l’exorciste d’où part son enquête). Ainsi il contribue à renouveler la question des relations entre les évolutions
générales de la société (ici la centralisation du pouvoir) et les parcours des individus. Les «gens ordinaires » de Giovanni
Lévy ont une marge d’initiative, ils ne sont pas des représentants interchangeables d’un destin collectif qui les dépasse
(comme les 20 millions de Français de Goubert).
La démarche de l’histoire orale a contribué également à modifier la relation des historiens aux «gens ordinaires ».
Développée d’abord aux Etats-Unis (autour d’Allen Nevins dans les années 40) et accueillie avec une certaine méfiance en
France, elle s’est donné peu à peu des règles de recueil et de traitement des données (sous l’impulsion de Philippe Joutard
puis de Florence Descamps) et elle est devenu un outil très efficace d’approche des histoires des gens ordinaires en histoire
contemporaine essentiellement pour des raisons évidentes. Le recueil des témoignages des ouvriers migrants, celui des
ingénieurs engagés dans la modernisation de la France de l’après-guerre ont permis de sortir d’une histoire sociale qui
reposait sur des vues d’ensembles et gommait les échecs, les hésitations, les choix des individus. La confrontation des
sources orales et des sources écrites (documents institutionnels) permet ainsi d’accéder à une histoire moins linéaire, moins
universalisante. Ces évolutions de l’Histoire recoupent celles des sciences humaines, la sociologie notamment après s’être
très fortement centrée sur les études sérielles (selon le «paradigme durkheimien) s’est renouvelée par l’approche par les
«curricula » (voir par exemple l’ouvrage collectif dirigé par Pierre Bourdieu, la misère du monde).
III. Quelques limites quelques dangers
€La question des sources
C’est la question des sources qui a pendant longtemps fait considérer que les «gens ordinaires » n’ont pas d’histoire. La
problématique était du même ordre pour les esclaves de l’antiquité et pour les femmes dans l’histoire : ils n’apparaissent
dans les sources classiques que par le biais des discours des autres (souvent les dominants) sur eux : ce qui faussait bien
entendu le regard. L’apport de méthodes et de sources nouvelles ont en partie comblé cette lacune, totalement en histoire
contemporaine, partiellement pour les autres périodes. La source judiciaire (Farge, Ginzburg) est centrée sur l’exceptionnel,
l’atypique et tend à dresser un tableau des sociétés du passé où l’affrontement, la violence, l’exclusion occupent une part
sans doute surévaluée.
Lorsqu’A Corbin part à la recherche de Louis François Pinagot il constate l’absence de sources directe (son pari est
justement d’explorer la faisabilité d’une histoire sans source directe). Corbin ne fait pas la biographie de son sabotier
comme celle d’un «grand homme » bien documentée : il énonce des «possibles » «probables », il part le plus souvent de ce
que ses sources (par exemple les comptes-rendus des conseils municipaux) lui apprennent des conditions matérielle
d’existence à Origny le Butin et en déduit ce que devait être l’existence de son personnage. Corbin est lucide sur les limites
de l’exercice : s’il démontre qu’une histoire des anonymes est possible, il souligne qu’il s’agit d’une histoire sociale, Pinagot
ne l’intéresse finalement par pour lui-même mais pour son exemplarité.
€Une histoire qui se défie du politique ?
Lorsque les historiens marxistes s’intéressaient aux masses, aux classes sociales, c’était pour leur attribuer un rôle
politique (sans doute surévaluer), pour en faire des acteurs du changement, c'est-à-dire de l’histoire. A l’inverse l’histoire
immobile a insisté sur les déterminismes (structures, forces profondes) qui leur ôtait quasiment toute prise sur leurs vies.
Les approches contemporaines que nous avons évoquées tendent à établir la complexité de la relation individu-société. Mais
le changement d’échelle qu’elles imposent (histoire au «ras du sol » contribue à privilégier les évolutions locales, les micro-
évènements vécus et perçus par les individus au détriment des grands choix politiques qui interviennent comme des
perturbations météorologiques. Le politique n’occupant, objectivement, qu’une part très petite dans la vie des «gens
ordinaires », leur histoire risque de n’en traiter que de façon marginale, renvoyant à la société contemporaine un message
d’a-politisation des masses qui peut contredire l’exigence de formation à une citoyenneté engagée qui constitue une des
fonctions sociales de l’étude et de l’enseignement de l’histoire. Dans cet ordre d’idée, l’intérêt exclusif pour les «gens
ordinaires » peut contribuer renforcer bien des a priori sur les élites intellectuelles et politiques suspectes, forcément
suspectes quelles qu’elles soient. Au bout du compte, si l’on n’y prend garde, l’étude des gens ordinaires peut enfermer
l’historien dans celle d’un groupe particulier (avec lequel il a parfois une affinité personnelle qui lui a fait choisir ce terrain
d’étude) et aboutir à une histoire en miette, voire à une histoire communautariste.
Conclusion
1
/
2
100%