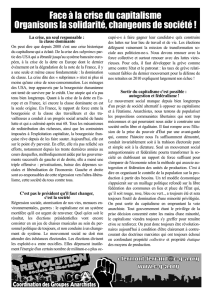Capitalisme et Humanisme: les faux frères

Capitalisme*et*Humanisme:*les*faux*frères*
!
!
!
"#$!%&'!()*+(,!%'!-.%&'!$.*%/0%!1%!23'0%!43/2%5/!6$5&*!1.5-'/5$7'89:!!
!
;'8<*54%!27%4'!1.500='%0!&34!28*7-/$%!%4!>301/0%!1%!$5!18<50'%?%4'5$%,!
@/&'%!5254'!-%!<34'!A/.7$!6054-*7'!'3/&!$%&!@3/0&!1%</7&!/4!<%/!<$/&!1%!274B'!
54&:!
C5!05173!18>7'%!$%!>/$$%'74!1%!-%''%!?5'748%!1%!18-%?>0%!D(E(!F!$%!-*G?5B%!
%&'!%4-30%!%4!<03B0%&&734,!$%!-50>/054'!<3/0&/7'!&34!5&-%4&734!&3/0437&%!H!
$5!<3?<%,!$%!?50-*8!7??3>7$7%0!0%<50'!1%!<$/&!>%$$%!H!$5!*5/&&%:!
I--%&&370%?%4',!154&!$5!0/>07A/%!8-343?7A/%,!34!54434-%!1%&!>84867-%&!
0%-301&!<3/0!$%&!>54A/%&!&'50&!1/!JIJK(,!/4!7427'8!<3$7'7A/%!1%!
-70-34&'54-%!&%!-03L54'!5/'307&8!H!<08-7&%0!A/%!$5!0%<07&%!%&'!$H,!$%!<$/&!4370!
1%!$5!-07&%!1%007M0%!43/&,!%'!A/.7$!&/667'!1%!-0370%!%4!1%&!@3/0&!?%7$$%/0&!A/7,!
-.%&'!-%0'574,!6747034'!>7%4!<50!50072%0,!<3/0!<%/!A/%!$.34!<03$34B%!&%&!
634-'734&!5/N!<03-*574%&!8$%-'734&O!
!
;'8<*54%!4.8-3/'%!18@H!<$/&:!J%!?341%!A/.34!$/7!18-07'!H!?37410%!6057&!'3/&!
$%&!@3/0&!154&!$%&!?8175&!4%!-300%&<341!186747'72%?%4'!<5&!H!-%$/7!154&!
$%A/%$!7$!%&&57%!1%!&/02720%!1%</7&!<$/&7%/0&!?37&:!P3/0'54',!$%!18-30!%&'!
0%&<%-'8!F!$.%4'0%<07&%!154&!$5A/%$$%!7$!'05257$$%!B5B4%!>%5/-3/<!1.50B%4'!%'!
&%!68$7-7'%!1%!&/0<%0630?%0!&%&!3>@%-'76&!H!-*5A/%!<08&%4'5'734!1%!&%&!
08&/$'5'&!5/N!5-'7344570%&:!;'8<*54%!L!-34'07>/%!A/3'717%44%?%4',!<0%&A/%!
'3/&!$%&!&370&!%'!-%0'574&!1%!&%&!Q%%RS%41&:!T57&!8'054B%?%4',!7$!5!$%!
&%4'7?%4'!1.%N7&'%0!1%!?374&!%4!?374&!154&!-%''%!%4'0%<07&%!H!$5A/%$$%!7$!5!
<3/0'54'!'54'!13448!F!7$!5!-*54B8!1%!<3&'%!3/!1%!?8'7%0!'3/&!$%&!+(!?37&!%4!
?3L%44%,!K!637&!1%!08B734,!&34!-34@374'!<%0154'!&34!%?<$37!H!-*5A/%!
18?845B%?%4'!%'!4.5L54'!</!%4!0%'03/2%0!/4!$30&!1/!1%047%0:!C5!&7'/5'734!
67454-7M0%!1/!?845B%!&.8'54'!1%!657'!<08-507&8%,!;'8<*54%!5!0%13/>$8!%4-30%!
1.%6630'&,!%&<8054'!1%!$5!0%-34457&&54-%,!/4%!<03?3'734,!/4!@/&'%!0%'3/0!H!$5!
*5/'%/0!1%!&34!742%&'7&&%?%4':!T57&!434,!07%4O!!
!
U/&A/.H!-%'!%4'0%'7%4!*7%0!5<0M&S?717!52%-!-%''%!*78050-*7%!A/7!$%!?8<07&%,!%'!
$30&!1/A/%$!34!$/7!5!657'!0%?50A/%0!A/.7$!?54A/57'!1%!1L45?7&?%,!%'!A/.7$!
8'57'!/4!60%74!H!$.5''%74'%!1%&!3>@%-'76&!-3$$%-'76&!1%!&34!&%027-%:!P70%,!7$!
-3?<0%41057'!$%&!&7'/5'734&!?374&!05<71%?%4'!A/%!&%&!-3$$MB/%&,!-%!A/7!
<3&%057'!A/%&'734!A/54'!H!&34!%?<$3L5>7$7'8:!;'8<*54%!5257'!H!-%!?3?%4'!
<08-7&!657$$7!&%!&%4'70!?5$!%'!&.8'57'!086/B78!154&!$%&!'37$%''%&!1%!&34!8'5B%,!$%!
'%?<&!1%!0%<0%410%!&%&!%&<07'&:!V4!0%4'054'!-*%W!$/7,!7$!&.8'57'!%6630-8!1%!

1344%0!$%!-*54B%!%4!4%!$57&&54'!07%4!<505X'0%!H!&34!8<3/&%!%'!H!&%&!%4654'&,!
?57&!A/%$A/%!-*3&%!&.8'57'!>07&8!5/!<$/&!<036341!1%!$/7S?=?%:!
!
;'8<*54%!18<3&%!&/0!$%!&7MB%!5254'!1037'!1%!&5!237'/0%!$5!$%''0%!A/.7$!5!
0817B8%!<%4154'!$5!4/7':!I/!?374&,!34!4%!05-34'%05!<5&!4.7?<30'%!A/37!H!
<3&'%07307!&/0!$%&!057&34&!1%!&34!18<50'!F!7$!5!-344/!-%$5!<08-81%??%4',!
$30&A/%!1.5/'0%&!-3$$MB/%&!34'!657'!$%!-*37N!1%!<50'70,!0%6/&54'!1%!&3/66070!
15254'5B%!H!$%/0!'05257$:!C.%4'0%<07&%!5257'!?7&!5/!<374'!/4%!&'05'8B7%!1%!
-3??/47-5'734!27&54'!H!%N<$7A/%0!$5!?/$'7S-5/&5$7'8!1%!$%/0!&3/66054-%,!52%-!
$.74-34'3/045>$%!<374'!-3??/4!F!$%&!057&34&!1%!$%/0!&/7-71%!0%$%257%4'!
%N-$/&72%?%4'!1/!13?574%!1%!$%/0!27%!<0728%,!$5!*78050-*7%!0%-*%0-*54'!$%!
1813/54%?%4'!7??8175':!I2%-!-%''%!$%''0%,!$%!&'05'5BM?%!4%!<3/005!<5&!
634-'7344%0!%'!;'8<*54%!5/05!$%!&%4'7?%4'!1.52370!Y/208!/4%!1%047M0%!637&!
154&!$.74'80='!-3$$%-'76:!
C5!>07&%!605X-*%!1/!?5'74!B$7&&%!&/0!&34!27&5B%:!Z4%!8'054B%!&80847'8!
$.%425*7',!7$!4.8<03/2%!5/-/4%!-0574'%,!?57&!/4%!630?715>$%!18$72054-%,!5$30&!
A/.7$!>5&-/$%!2%0&!&5!1%&'748%O!
!
;'8<*54%!0%@374'!$%&!&747&'0%&!&'5'7&'7A/%&!1%&!&/7-71%&!154&!&34!%4'0%<07&%!F!
D[!<3/0!-%''%!&%/$%!5448%!D(E(,!&37'!/4!'3/'%&!$%&!1%/N!&%?574%&,!%4!630'%!
<03B0%&&734!1%</7&!'037&!54&:!V4!\054-%,!$%&!<5'*3$3B7%&!<&L-*3&3-75$%&,!
'%$$%&!A/%!$5!18<0%&&734!3/!$.54N78'8!&.74&-072%4'!5/!<0%?7%0!054B!1%&!
?5$517%&!<036%&&7344%$$%&,!&%$34!/4!05<<30'!0%41/!</>$7-!%4!D((]!%'!
<30'54'!&/0!$%&!-34&/$'5'734&!%4!D((^!5/<0M&!1%!?81%-74&!%N<%0'&!%4!&54'8!
1/!'05257$:!P&L-*75'0%!%'!<&L-*545$L&'%,!'7'/$570%!1%!$5!-*570%!1%!
<&L-*545$L&%S&54'8S'05257$!5/!J34&%025'370%!45'7345$!1%&!50'&!%'!?8'7%0&,!
J*07&'3<*%!_%@3/0&!<374'%!1/!137B'!$.74'031/-'734!1%!43/2%$$%&!630?%&!
1.30B547&5'734!1/!'05257$!F!&7!$.34!5&&3-7%!H!$.823$/'734!/4%!&54-'734,!>34/&!
3/!<07?%,!3/!H!$.742%0&%!/4%!&54-'734!48B5'72%,!$.823$/'734!&%!'054&630?%!%4!
/4!&L&'M?%!1%!?%45-%,!-%!A/7!?%'!$%&!<%0&344%&!%4!-34-/00%4-%:!P%/!H!<%/,!
$%!0%&<%-'!%'!$5!-346754-%!17&<5057&&%4'!%',!%4!A/%$A/%&!'%?<&,!34!5>3/'7'!H!
/4%!18&'0/-'/05'734!1/!2720%S%4&%?>$%:!J%''%!<%0'%!1%!-33<805'734!-08%!1%&!
1L&634-'7344%?%4'&!1/!657'!A/%!$%&!B%4&!4%!-3??/47A/%4'!<$/&:!P3/0!
-3007B%0!-%$5,!7$!65/'!&.74'80%&&%0!5/!'05257$!-3$$%-'76:!
P3/0!U%54SJ$5/1%!_%$B%4%&,!_70%-'%/0!`84805$!1%!a%-*43$3B75,!-5>74%'!
&<8-75$7&8!%4!825$/5'734!%'!%4!<082%4'734!1%&!07&A/%&!<036%&&7344%$&,!7$!
%N7&'%!1%&!&'5'7&'7A/%&!A/7!634'!8'5'!1%!EE(((!&/7-71%&!<50!54!%4!\054-%,!
134'!b((!1.307B74%!<036%&&7344%$$%,!?57&!-%&!-*7660%&!&34'!$50B%?%4'!
?74308&:!c%5/-3/<!1.5--71%4'&!1/!'05257$!&34'!%4!657'!1%&!&/7-71%&!18B/7&8&,!
%'!>34!43?>0%!1%!&/7-71%&!<036%&&7344%$&!34'!$7%/!%4!1%*30&!1%!$.%4'0%<07&%:!
#$!&%057'!<$/&!@/&'%!1%!<50$%0!1.5/!?374&!E(((!&/7-71%&!1.307B74%!

<036%&&7344%$$%,!52%-!43'5??%4'!$%&!d!8-3S&/7-71%&!e!<0323A/8&!<50!$%&!
$7-%4-7%?%4'&,!%'!134'!34!<50$%!'03<!<%/:!
!
J3??%4'!-%'!7??%4&%!18&5&'0%!*/?574!<%/'S7$!-34'74/%0!1%!&%0270!$%!&%/$!
&L&'M?%!A/7!57'!18?34'08,!H!'052%0&!$.f7&'370%,!&5!-5<5-7'8!H!B8480%0!1%!$5!
07-*%&&%!&/0!/4%!>5&%!<80%44%!F!$%!-5<7'5$7&?%!g!h%B50134&!A/%$A/%!<%/!%4!
5007M0%O!
!
_%</7&!$%!i#iM?%!&7M-$%,!$5!A/%&'734!1/!-3??%4-%?%4'!1%!$.*7&'370%!1/!
-5<7'5$7&?%,!1%!&%&!307B74%&,!1%!&5!-34&7&'54-%!%'!&/0'3/'!1%!&34!823$/'734!
%&'!$5!&3/0-%!1%!18>5'&!&3-73$3B7A/%&,!8-343?7A/%&!%'!*7&'307A/%&!?5@%/0&:!
C%!&/@%'!&3/$M2%!1%!43?>0%/&%&!<3$8?7A/%&!%'!-346034'5'734&!%4'0%!$%&!
B0541&!-3/054'&!<3$7'7A/%&!%'!8-343?7A/%&!F!7?<8075$7&?%,!-3$3475$7&?%,!
748B5$7'8&,!-07&%&!8-343?7A/%&,!%N<$37'5'734,!?57&!5/&&7!18?3-05'7%,!$7>%0'8,!
182%$3<<%?%4',!07-*%&&%!%'!5>34154-%:!
;%$34!\%04541!c05/1%$,!*7&'307%4!6054j57&!1/!&7M-$%!1%047%0,!%'!5/'%/0!1%!
d!C5!_L45?7A/%!1/!-5<7'5$7&?%!e!%4!E])b,!$%!-5<7'5$7&?%!'03/2%!&%&!
<0%?7M0%&!05-74%&!54-7%44%&!%'!<0%&'7B7%/&%&!154&!$%!05L344%?%4'!1%&!
B0541%&!-7'8&SV'5'&!?50-*541%&!kl%47&%,!I42%0&,!`=4%&,!I?&'%015?m,!?57&!
1./4%!5?<$7'/1%!0%$5'72%?%4'!?31%&'%:!
_M&!$%!T3L%4SIB%,!34!'03/2%!$%&!<0%?7M0%&!?5476%&'5'734&!1/!-5<7'5$7&?%!
-3??%0-75$!%4!#'5$7%!%'!5/N!P5L&Sc5&:!C%!-3??%0-%!?507'7?%!52%-!$.n07%4'!5!
%407-*7!$%&!-7'8&!7'5$7%44%&!H!$5!&/7'%!1%&!-037&51%&,!'5417&!A/%!$%&!P5L&Sc5&,!H!
$.%?>3/-*/0%!1/!h*74,!634'!$%!$7%4!%4'0%!$.#'5$7%!%'!$.V/03<%!1/!o301:!_54&!$%&!
B0541%&!-7'8&,!$%&!?50-*541&!1%!105<&!%'!1%!&37%07%&!513<'%4'!1%&!?8'*31%&!
1%!B%&'734!-5<7'5$7&'%&:!#$&!%66%-'/%4'!1%&!2%4'%&!%4!B03&,!8'5>$7&&%4'!1%&!
-3?<'370&!%'!2%41%4'!$%/0&!<031/7'&!154&!$.%4&%?>$%!1%&!B0541%&!6370%&!
%/03<8%44%&:!#$&!&%!63/047&&%4'!%4!?5'7M0%!<0%?7M0%!5/&&7!>7%4!%4!V/03<%!
A/.5/!C%254':!_54&!-%''%!8<3A/%!'03/>$8%!1/!T3L%4SIB%,!7$&!0MB$%4'!$%/0&!
<57%?%4'&!<50!$%''0%&!1%!-*54B%,!?374&!154B%0%/&%&!A/%!$%!'054&<30'!1%!
?8'5/N!<08-7%/N:!J.%&'!134-!$3B7A/%?%4'!A/%!&%!182%$3<<%4',!%4!<505$$M$%!
1/!-5<7'5$7&?%!-3??%0-75$,!$%&!<0%?7M0%&!5-'727'8&!>54-570%&!1/!-5<7'5$7&?%!
67454-7%0!F!18<G'&,!<0='&!&/0!B5B%,!$%''0%!1%!-*54B%,!5&&/054-%!<3/0!$%&!
45270%&:!
!
J%&!-5<7'5$7&'%&!&.%407-*7&&%4'!&7!>7%4!A/.7$&!8'%41%4'!$%/0!%?<07&%!
8-343?7A/%!&/0!$.%4&%?>$%!1%!$.n--71%4'!-*08'7%4,!-0854'!574&7!-%!A/%!
\%04541!c05/1%$!5<<%$$%!/4%!d!8-343?7%S?341%!e:!_54&!&34!545$L&%,!7$!
17&'74B/%!$.!d!8-343?7%!1%!?50-*8!e!1/!-5<7'5$7&?%,!-%!1%047%0!-34&'7'/54'!
/4%!&30'%!1%!d!-34'0%S?50-*8!e:!;%$34!$/7,!$.8-343?7%!1%!?50-*8!k-.%&'!H!170%!
$.8-343?7%!$3-5$%!H!-%''%!8<3A/%m!%&'!13?748%!<50!$%&!0MB$%&!%'!$%&!8-*54B%&!
$3L5/N,!<50-%!A/%!&3/?7&%!H!$5!-34-/00%4-%!%'!H!/4%!0%$5'72%!'054&<50%4-%,!

$%!-5<7'5$7&?%!'%4'54'!A/54'!H!$/7!1%!$5!6/70!154&!$%!-3??%0-%!$374'574!5674!
1%!&.566054-*70!1%&!0MB$%&!%'!1%!182%$3<<%0!1%&!8-*54B%&!748B5/N!-3??%!
43/2%$$%&!&3/0-%&!1.%407-*7&&%?%4':!
!
Z4!<%/!<$/&!'501,!5/!il%!&7M-$%,!$5!?7&%!5/!<374'!1%!$.7?<07?%07%!H!
-505-'M0%&!?3>7$%&!<50!`/'%4>%0B!54434-%!$%!6/'/0!8-343?7A/%!1/!?341%!
3--71%4'5$:!;3/-7%/N!1%!<08&%02%0!5/'54'!A/.7$!&%!<%/'!$%&!&%-0%'&!1%!&%&!
0%-*%0-*%&,!-34'0574'!H!1%&!%?<0/4'&!?348'570%&!7?<30'54'&,!7$!%&'!%4!
A/%$A/%!&30'%!$.50-*8'L<%!1%&!6/'/0&!-5<7'5$7&'%&:!;34!3>@%-'76!%&'!1%!
08<3410%!H!/4%!1%?541%!74&5'7&657'%!F!$5!1%?541%!1%!-/$'/0%!1%&!%&<07'&!1%!
?374&!%4!?374&!545$<*5>M'%&!1%!$5!h%457&&54-%:!I/!>%&374!1%!</>$7-5'734&!
H!B0541%!8-*%$$%!1%!$720%&!?5@%/0&,!25!05<71%?%4'!&/720%!$5!1%?541%!1./4%!
<031/-'734!<$/&!172%0&7678%:!C%!43/2%5/!&L&'M?%!'%-*47A/%!A/7!&%!?%'!%4!
<$5-%!H!$5!h%457&&54-%!<%0?%'!$.8?%0B%4-%!1%!-%0'574&!<074-7<%&!1/!
-5<7'5$7&?%!?31%04%!-3??%!$.5?8$7305'734!1%!$5!<031/-'727'8,!$.8-343?7%!
1%!?574!1.Y/20%,!$.5/B?%4'5'734!1%!$5!<031/-'734!%4!23$/?%!%'!&5!
172%0&767-5'734,!3/!%4-30%!$.742%&'7&&%?%4':!#$!&.5<</7%!&/0!A/%$A/%&!
744325'734&!1%!0/<'/0%!-3??%!$%!*5/'!63/04%5/,!$.7?<07?%07%,!$%!&L&'M?%!
>7%$$%S?5472%$$%,!$5!?34'8%!%4!</7&&54-%!1%&!B0541&!&%-'%/0&!741/&'07%$&,!
'%$&!A/%!$5!?8'5$$/0B7%!%'!$.%N<$37'5'734!?747M0%,!%'!$./'7$7&5'734!-3/054'%!
1./4%!&3/0-%!1.84%0B7%!F!$.*L105/$7A/%:!J%!&L&'M?%!<%0&7&'%05!@/&A/.5/!
?7$7%/!1/!il###%!&7M-$%!%'!%4'0574%05!$.513<'734!1./4!&L&'M?%!&3-75$!
-300%&<34154'!<3/0!='0%!5/!6745$!H!$5!637&!$%!'%00%5/!1./4!-5<7'5$7&?%!
457&&54'!%'!$%!'3?>%5/!1/!08B7?%!68315$!A/7!4.5/05!<5&!&/!&.74&-070%!154&!
-%''%!?/'5'734!%4!<036341%/0:!
!
I/!il#%!&7M-$%,!$5!<%4&8%!8-343?7A/%!4.%&'!<$/&!13?748%!<50!$%&!
'*83$3B7%4&,!?57&!<50!1%&!<%4&%/0&!$5p-&!A/7!&%!&3/-7%4'!%4!<0%?7%0!$7%/!1%!
$5!</7&&54-%!1%!$.V'5'!F!$%&!?%0-54'7$7&'%&:!I674!1.5&&/0%0!$.%N<54&734!1%!$5!
07-*%&&%!1/!P074-%,!$%&!25$%/0&!0%$7B7%/&%&!&34'!3/>$78%&:!P%/!7?<30'%!A/%!
$./&/0%!&37'!/4!<8-*8!3/!434,!$%&!B3/2%0454'&!4%!&%!&3/-7%4'!<$/&!A/%!'%$$%!
3/!'%$$%!<3$7'7A/%!-3??%0-75$%!4%!&37'!<5&!-*08'7%44%!F!&%/$%!-3?<'%!$5!
057&34!1.V'5':!c7%4!A/%!-%''%!<%4&8%!4%!&37'!<5&!-%$$%!1/!-5<7'5$7&?%,!
</7&A/.%$$%!4%!&%!&3/-7%!A/%!1%!$.7?<30'54-%!1%!$5!</7&&54-%!1%!$.V'5'!%'!434!
1/!182%$3<<%?%4'!1%!$5!07-*%&&%!<0728%,!%$$%!-34'07>/%!?5$B08!'3/'!H!
8$7?74%0!$%&!25$%/0&!0%$7B7%/&%&,!%'!<$/&!'501!H!<08<50%0!$%&!823$/'734&!
6/'/0%&:!
!
I/!il##%!&7M-$%,!$5!f3$$541%!5-A/7%0'!1.7?<30'54'&!-3?<'370&!%4!#41%!%'!
182%$3<<%!$%!-3??%0-%!1%&!8<7-%&!%'!1/!<3720%:!V$$%!&.8'5>$7'!5/!U5<34!%'!
-3??%0-%!52%-!$5!J*74%:!V$$%!1%27%4'!$%!43/2%5/!-%4'0%!1%!$.!d!8-343?7%S
?341%!e!-*M0%!H!\%04541!c05/1%$:!V4!E[(D,!%$$%!6341%!$5!<0%?7M0%!

J3?<5B47%!1%&!#41%&!307%4'5$%&!F!-.%&'!$5!<0%?7M0%!B0541%!&3-78'8!<50!
5-'734&,!134'!$%&!17271%41%&!&.8$%257%4'!&3/2%4'!H!Eb,!2370%!Dbq:!_%!+E((!
6$3074&,!$%&!5-'734&!B07?<M0%4'!H!E^(((!6$3074&!H!$5!674!1/!&7M-$%:!V$$%&!8'57%4'!
&3/?7&%&!H!1.74-%&&54'%&!&<8-/$5'734&,!5$7?%4'8%&!<50!$%&!0/?%/0&!$%&!<$/&!
7463418%&,!2370%!1%&!-5?<5B4%&!1%!18&74630?5'734!30B547&8%&:!C5!
J3?<5B47%!8?%'!5/&&7!1%&!3>$7B5'734&!%'!$%!?31M$%!74&<70%!$5!-085'734!1%!
-3?<5B47%&!154&!$.741/&'07%!?8'5$$/0B7A/%,!'%N'7$%,!<5<7%0,!%'-:!
P505$$M$%?%4',!$.566$/N!1.30!1%</7&!$%&!-3$347%&!1.I?807A/%!<%0?%'!/4%!
&'7?/$5'734!1%&!8-*54B%&,!/4!<%06%-'7344%?%4'!1%&!?8'*31%&!1%!<57%?%4'!
%'!1%&!'%-*47A/%&!?348'570%&:!C%&!<0%?7%0&!>7$$%'&!5<<5057&&%4':!
T57&!$5!f3$$541%!-3445X'!8B5$%?%4'!$5!<0%?7M0%!>/$$%!&<8-/$5'72%!1%!
$.f7&'370%!F!$5!a/$7<3?547%:!l%0&!E[+(,!$%!<07N!1%&!'/$7<%&!&.%423$%!
$7''805$%?%4',!$.37B434!5''%7B454'!<50637&!$%!<07N!1./4%!?57&34!>3/0B%37&%:!
C%!&%/7$!1%!$.7005'7345$7'8!8'54'!5''%74',!$%!<0%?7%0!R05-*!1%!$.f7&'370%!&%!
<031/7&7':!
!
Z4!<%/!<$/&!'501,!2%0&!$5!674!1/!il###%!&7M-$%,!&/7'%!5/N!?3/2%?%4'&!
0823$/'7344570%&!1%!$5!-5<7'5$%,!$%&!-*r'%5/N!1%&!-5?<5B4%&!&34'!5&&57$$7&!
1M&!$5!674!@/7$$%'!E^)]!<50!$%&!<5L&54&!A/7!-34'%&'%4'!$5!<03<078'8!
&%7B4%/075$%:!_54&!$5!4/7'!1/!K!53s'!E^)],!$%&!<0727$MB%&!1%!$5!43>$%&&%!&34'!
5>3$7&!%'!$5!<03<078'8!634-7M0%!%&'!1M&!$30&!3/2%0'%!H!$5!>3/0B%37&7%:!V4674,!$%!
D[!53s',!$5!<03<078'8!<0728%!%&',!d!&3/&!$%&!5/&<7-%&!1%!$.V'0%!&/<0=?%!e,!
0%-344/%!154&!$5!_8-$505'734!1%&!1037'&!1%!$.*3??%!%'!1/!-7'3L%4!-3??%!
/4!1037'!745$7845>$%:!C5!-34&'7'/'734!1/!?50-*8!1/!'05257$!%'!$5!$7>%0'8!1%&!
-5<7'5/N!%&'!<%0?7&%!%4!@/74!E^]E!<50!$5!C37!C%!J*5<%$7%0,!$5A/%$$%!74'%017'!
154&!$%!?=?%!'%?<&!'3/'%!$7>%0'8!1.5&&3-75'734,!-.%&'SHS170%!&L417-5'&!%'!
B0M2%&:!
!
C%!i#i%!&7M-$%!&344%!$.52M4%?%4'!1%!$5!0823$/'734!741/&'07%$$%:!C%&!
<031/-'734&!1%!<$/&!%4!<$/&!7?<30'54'%&!%4!23$/?%,!%'!$%&!<031/7'&!1%!<$/&!
%4!<$/&!-3?<$%N%&,!48-%&&7'%4'!1%&!742%&'7&&%?%4'&!1%!<$/&!%4!<$/&!B0541&:!
J.%&'!$%!-5&!154&!$.741/&'07%!457&&54'%,!?57&!5/&&7!154&!$.5B07-/$'/0%!3t!1%!
B03&&%&!?5-*74%&!k'%$$%&!$%&!?37&&344%/&%&!>5''%/&%&!1M&!E)+Km!634'!$%/0!
5<<507'734:!C.8-50'!-037&&54'!%4'0%!$%!-3s'!1%!-%&!?5-*74%&!%'!$%&!&5$570%&,!
574&7!A/%!$5!$7?7'5'734!1%&!>7%4&!-3??/4&!%'!$5!1/0%'8!1/!'05257$,!
-34'07>/%4'!H!&%B?%4'%0!$5!&3-78'8!%4!1%/N!B03/<%&!>7%4!17&'74-'&!F!$%&!
<03<078'570%&!1/!-5<7'5$!1./4%!<50',!%'!-%/N!A/%!T50N!5<<%$$%05!<$/&!'501!$%&!
d!<03$8'570%&!e!1.5/'0%!<50':!C%&!/&74%&!&%!182%$3<<%4',!$%&!<5L&54&!A/7''%4'!
$%/0&!-5?<5B4%&!5674!1%!0%@37410%!$%&!27$$%&!%'!2%410%!$%/0!630-%!1%!'05257$!
154&!$.741/&'07%:!V4!$.%&<5-%!1./4!&7M-$%,!$%!'073?<*%!1/!-5<7'5$7&?%!
741/&'07%$!5!'054&630?8!/4%!&3-78'8!'0517'7344%$$%,!0/05$%!%'!5B07-3$%,!%4!/4%!
&3-78'8!/0>574%!%'!741/&'07%$$%:!C.%N31%!0/05$,!-3?>748!H!$.%N<$3&734!
 6
6
 7
7
1
/
7
100%