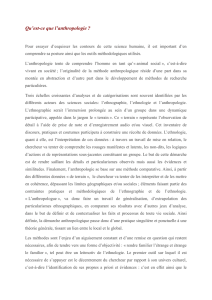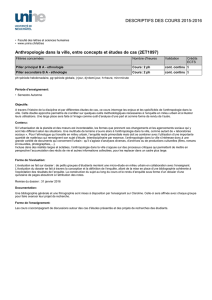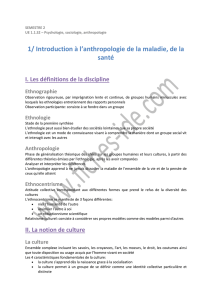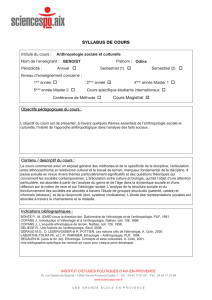Workshop Titre : Anthropologie chez soi, ethnologie du

Workshop Titre : Anthropologie chez soi, ethnologie du proche. Enjeux liés à la
recherche et l’application
Organisateurs
Dr Fatoumata Ouattara, anthropologue, IRD, Marseille
Prof Mamadou Diawara, anthropologue, Université Goethe de Francfort
Abstrait
Historiquement, l’ethnologie et l’anthropologie sont des disciplines pratiquées par des cher-
cheurs extérieurs aux sociétés étudiées. En outre, la colonisation a favorisé la construction
d’un discours du savoir anthropologique reposant sur l’idée du grand partage érigeant un
« nous » et les « autres » qui n’a certainement pas favorisé un débat explicite sur les modalités
de la recherche dans des contextes de proximité.
De ces qualifications anglophones (Indigenous anthropology, insider anthropology, anthro-
pology at home, native anthropology…) à ses dénominations françaises (ethnographie chez
soi, endo-ethnologie, ethnologie du présent…), l’expression générique « anthropologie chez
soi » renvoie à des rapports de proximité variés d’ethnologues et d’anthropologues à leurs
terrains d’enquête.
Paradoxalement, alors que les questions relatives à la pratique de l’anthropologie chez soi
structurent implicitement et explicitement les rapports de collaborations entre chercheurs du
Nord et du Sud, peu d’espaces d’échanges scientifiques y sont consacrés. Il s’avère donc
nécessaire de lever le voile sur cette discrétion sur les conditions méthodologiques et
épistémologiques de production du savoir. La rupture avec cette discrétion s’avère plus
pressante dans la mesure où de nos jours toute une génération d’anthropologues nationaux
combinent à la fois des formes de familiarité et d’étrangéité à leurs terrains.
Notons que la proximité s’inscrit sur des registres forts différents. Une proximité à géométrie
tellement variable (appartenance ethnique, nationale, sociale, statutaire…) que l’on peut aisé-
ment convenir que « le parcours de parcours, qui postule au départ qu’il y a du même chez
l’autre, aboutit à un constat que lui imposent ses nouveaux terrains (ceux de l’ethnologie à
domicile) : il y a de l’autre dans le même » (Augé). En pratique, le chercheur ne s’implique
pas dans l’ensemble d’une société, son implication, voire son « enclicage » relève de certains
réseaux sociaux et pas d’autres. Dans une perspective de réflexivité, la proximité du chercheur
à un réseau social de sa population d’enquête pose des enjeux méthodologiques tout au long
du processus de production de données.
Les expériences de familiarité due à l’appartenance à un groupe d’enquête ne concernent pas
que les chercheurs africains francophones. De l’Asie à l’Amérique latine en passant par
l’Europe, les expériences des chercheurs seront considérées aussi bien dans leur degré de
proximité (ethnie, nationalité, sexe, profession…) que dans leurs variétés géographiques.
Prendre le temps d’échanges consacrés à la pratique de l’anthropologie dans des conditions de
proximité amène à revenir sur des questions d’intersubjectivité. Cependant le défi ici consiste
à faire de cette dimension intersubjective une condition de la production des données et de la
construction du texte produit. Nous sommes donc au cœur d’une dynamique réflexive et
constructive.
Faire du terrain dans la proximité … une épistémologie pratique
L’enquête de terrain est la colonne vertébrale de l’anthropologie. Un des objectifs consistera à
orienter les échanges sur l’usage des outils en situation d’enquête de terrain dans des situa-
tions où la singularité du chercheur se pose dans sa proximité à ses interlocuteurs. Les enjeux
posés par l’usage des outils de l’enquête de terrain sont des clés épistémologiques que soulève

la proximité du chercheur à son terrain. Comment rendre compte des expériences
d’observation participante ? Entre observation et participation, il y a bien plus qu’un pas.
L’observation et la participation impliquent des interrelations, des négociations sur les condi-
tions de la conduite de la recherche et de la participation. Comment poser, penser les
questions de proximité dans des perspectives de rigueur méthodologique ? Quelles sont les
modalités de « manipulation » de l’entretien ? Faire de l’épistémologie pratique en l’articulant
à des expériences de terrains, des moments de production des données constitue un des
objectifs de ce colloque.
Politiques d’engagement de l’anthropologie chez soi
La question de l’engagement de l’anthropologie en contextes de développement et de
changement social a été posée avec acuité. Les L’objectif consiste à porter des réflexions
épistémologiques et méthodologiques sur les travaux de chercheurs de statuts variés (séniors,
jeunes chercheurs, doctorants, étudiants) auxquels est attribuée l’étiquette d’anthropologie
chez soi dès lors que de telles recherches sont confrontées aux questions de changement social
et de développement. On peut d’ailleurs à juste raison poser la question sur la place du
chercheur dans le dispositif d’aide au développement. Dans une autre posture, celle du
chercheur comme un « intermédiaire professionnel », quelle est sa place dans des actions de
recherche-action qui dépendent du système d’aide au développement ? Comment se pose
l’accessibilité/l’inaccessibilité aux terrains par des chercheurs qui sont « étiquetés » par leur
proximité aux terrains qu’ils tentent d’investiguer ? Quels sont les enjeux soulevés par la
restitution des travaux dès lors qu’il s’agit d’une anthropologie conduite dans une certaine
proximité en amont de l’enquête ?
Date et lieu
Novembre 2016 (à annocé), Ouagadougou, Burkina Faso
1
/
2
100%