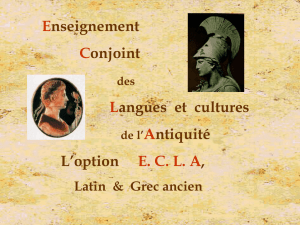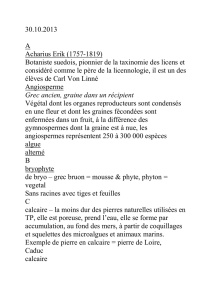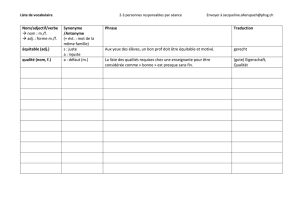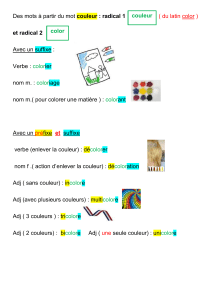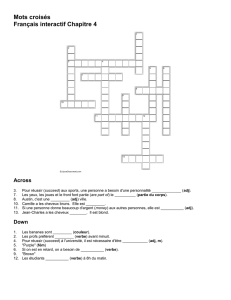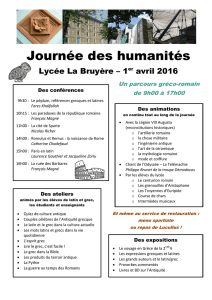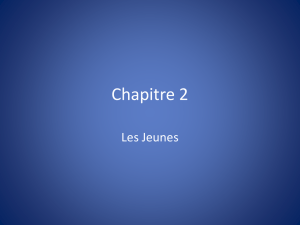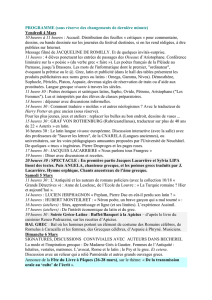végétaux ligneux d`ornement - Jean


versant ou d’un cours d’eau dont la pente est
contraire à l’inclinaison des couches.
ANAÉROBIE adj. et n.m Du préfixe grec a, pri-
vatif, aêr, air et bios, vie. Qualifie un micro-orga-
nisme ne pouvant vivre qu’à l’abri de l’air. Ex. :
certaines bactéries du sol. Opp. : aérobie.
ANALEMMATIQUE adj. D’
analemme
, figure
en 8, tracée par les différentes positions du soleil
au cours d’une année calendaire. Qualifie un
cadran solaire à style mobile et vertical, utili-
sant la représentation de la sphère terrestre sur
une surface plane horizontale. Le plus souvent
il s’agit d’un cadran tracé au sol dans lequel
l’observateur devient lui-même le style, en se
tenant bien droit sur un point déterminé. Ainsi,
sa propre ombre indique l’heure. De tels cadrans
sont visibles dans différents jardins comme
celui du Rocher des Doms à Avignon (Vaucluse),
ceux de Viels-Maisons (Aisne)ou encore au parc
de la Colombière à Dijon (Côte-d’Or).
ANALYSE DU SOL n.f. Opération consistant à
déterminer les principaux caractères physico-
chimiques et biologiques d’un échantillon de
terre (pH, identification et évaluation des
constituants et des fertilisants…). L’analyse du
sol s’effectue au moyen de kits colorimétriques
pour une simple connaissance de la nature du
sol ou plus sérieusement dans un laboratoire
compétent.
ANAPHASE n.f. Troisième phase de la mitose
cellulaire ; les deux chromatides* de chaque
chromosome* se séparent.
ANASTOMOSE n.f. Du grec anatomôsis, union
de deux bouches. Accolement de deux élé-
ments végétaux : on parle de l’anastomose des
nervures d’une feuille.
ANCELLEn.f. Du latin axiculus, petite planchette.
Nom donné à un petit bardeau*.
ANCRAGE n.m. 1. Dispositif d’amarrage de la
motte des arbres transplantés. 2. Dispositif
d’amarres d’un palissage. 3. En génie civil et
en construction, dispositif de maintien perma-
nent par ouvrages de soutènement en terrains
difficiles.
ANCRE n.f. 1. Pièce de fer forgé qui peut revêtir
diverses formes (S, X, Y…) et qui sert à relier, aux
extrémités d’une tige dite tirant, deux éléments
de construction ou deux murets, afin d’en
empêcher l’écartement. 2. Tige métallique
munie d’un œillet et d’un disque d’ancrage à
chacune de ses extrémités et servant d’amarres
à un système de palissage.
ANDAINn.m. Du latin ambitus, circuit. 1. Herbe
coupée rejetée sur le côté lors du passage d’une
faucheuse ou d’une tondeuse. 2. En sylvicul-
ture, désigne l’alignement régulier constitué
de branchages et de menu bois formé à l’oc-
casion d’une coupe. 3. En horticulture, partie
du compost en voie de formation.
ANDÉSITE n.f. De la Cordillère des Andes. Roche
magmatique noire ou grise, souvent vacuo-
laire ayant notamment servi à la construction
de nombreuses maisons dans le Puy-de-
Dôme.
ANDO, Tadao (né en 1941) Architecte japonais
reconnu pour sa maîtrise des espaces et la prise
en compte de l’environnement dans ses pro-
jets. L’eau occupe une place de choix dans ses
aménagements. Ses bâtiments sont, quant à
eux, dessinés avec des lignes très épurées.
Tadao Ando est le seul architecte à avoir gagné
les quatre prix les plus prestigieux dans son
art : le Pritzker, le Carlsberg, le Præmium Impe-
riale et le prix de Kyôto. Ses réalisations sont
souvent liées au paysage comme Yumebutazi
(« scène pour les rêves ») à Higashiura, où se
remarque un sol incrusté de milliers de
coquilles Saint-Jacques et une étonnante cas-
cade de jardinières. D’autres œuvres sont tout
aussi inventives comme le musée du bois à
Mikata-Gun, Hyogo (Japon) ou le pavillon japo-
nais de l’exposition universelle de Séville
(Espagne) en 1992. Tadao Ando a été l’auteur
du projet de la Fondation d’art contemporain
Pinault ayant avorté sur l’île Seguin à Bou-
logne-Billancourt (Hauts-de-Seine). À la fin des
années 1980, il devient professeur dans plu-
sieurs universités américaines.
ANDRÉ, Édouard François (1840-1911) Issu
d’une famille d’horticulteurs, Édouard André,
passionné par le monde végétal, entra après
de brillantes études dans le Service des
Promenades et Parcs de la Ville de Paris, où
Alphand* remarqua son jeune talent. André
créa ou aménagea dans sa carrière de nom-
breux parcs et jardins tant en France (Buttes-
Chaumont*, Roseraie de l’Haÿ*…) qu’en
Europe où sa renommée l’amena rapidement
à travailler : Kasteel Twickel en Hollande
(1 900), Palanga en Russie (fin xixe), Shefton
Park à Liverpool… Il fut l’un des premiers à
introduire des essences exotiques dans les
plantations classiques de l’époque. Il fut éga-
lement le précurseur des grands effets com-
posites qu’il appela « style mixte » né des
conceptions ordonnées du jardin à la fran-
çaise et de celles, libres, du jardin paysager.
Auteur de nombreux ouvrages (dont un
guide : Les Jardins de Paris daté de 1867),
Édouard André livre dans son Traité général
de la composition des parcs et jardins de 1879
ses conseils sur l’interprétation du style pay-
sager anglais du xviiiesiècle dont il critique
le manque paradoxal de naturel.
a
ANA
34

ANET, Jardins du château d’ – (Eure-et-Loir,
France) C’est en gage d’amour qu’Henri II fit
reconstruire la demeure ancestrale dont Diane
de Poitiers sa maîtresse avait hérité. Philibert
Delorme* conduisit l’édification de ce chef-
d’œuvre de la Renaissance à partir de 1547. Bien
que manifestement inspirée de l’Italie, cette
œuvre marqua le début de l’interprétation à
la française de la Renaissance italienne ; pour
la première fois en France, l’élément architec-
tural se mêlait harmonieusement au traite-
ment des jardins. Bien qu’ayant connu de nom-
breuses vicissitudes, ce domaine conserve
encore des traces de ses splendeurs passées :
l’escalier à double hémicycle qui mène au petit
jardin Renaissance, le cryptoportique* et son
vaste bassin de marbre où le soir venu Diane
se baignait, le superbe canal que Le Nôtre* mit
au centre de sa composition lorsqu’il redes-
sina le parc. (V. ill. page suivante.)
Angio- Préfixe dérivé du grec aggeion, vaisseau,
capsule.
ANGIOSPERMES adj. et n.f.pl. Du grec aggeion,
capsule et sperma, germe. En botanique, sous-
embranchement des plantes à fleurs ou pha-
nérogames*. Regroupe les végétaux dont les
graines sont enfermées dans des fruits clos et
comprend deux classes : les monocotylédones*
et les dicotylédones*; constituent l’immense
majorité des espèces végétales représentées
à l’échelle du globe. Opp. : gymnospermes* qui,
eux, produisent des graines nues.
Andro- Préfixe dérivé du grec andros, homme.
ANDROCÉE n.f. Du grec andros, mâle et oikia,
maison. Ensemble des organes mâles d’une
fleur.
ANDROGYNEadj. Du grec andros, mâle et gynê,
femme. Se dit d’une plante dont l’inflorescence
réunit à la fois les fleurs mâles et les fleurs
femelles. Ex. : épi des laiches (
Carex
).
ANDROMÈDE Selon la mythologie grecque,
Cassiopée, la mère de cette jeune fille d’une
grande beauté eut tort de la comparer aux non
moins splendides Néréides*. Pour la punir de
tant d’outrecuidance, Poséidon*, l’époux de
l’une des insultées, envoya un monstre gigan-
tesque dévaster le pays et dévorer la belle atta-
chée à un rocher. La légende eut connu une
bien triste fin si le héros Persée, monté sur
Pégase, n’était venu la délivrer avant de faire
d’elle son épouse. Certains auteurs voient en
ce récit une probable allusion aux exactions
des pirates de la Méditerranée qui n’épar-
gnaient personne, pas même d’innocentes
créatures…
ANDRON n.m. Du grec andros, mâle. Première
des deux divisions principales du plan d’une
maison grecque ; elle était exclusivement réser-
vée aux hommes, d’où son nom.
ANDROUET DU CERCEAU Voir Du Cerceau.
ANDUZE, Bambouseraie d’ – Voir Prafrance.
ANDUZE, Vase d’– n.m. Grand vase vernissé
robuste au pied mouluré, un ornement privi-
légié des parcs et jardins européens. Il est fabri-
qué dès le xviiesiècle à Anduze (Gard), demeu-
rant toujours un grand centre de production.
Il se reconnaît à ses guirlandes, écussons et
cartouches typiques. Son vernissage au sul-
fure de plomb et aux oxydes de cuivre et de
manganèse lui confère ses couleurs tradition-
nelles. Selon la légende, un potier se rendant
à la foire de Beaucaire (Gard), où il est séduit
par la beauté d’un vase Médicis*, décide alors
de copier l’objet en l’adaptant à la technique
locale, en l’ornant d’une guirlande et d’un car-
touche portant son nom.
Anémo- Préfixe dérivé du grec anemos, vent.
ANÉMOCHORE adj. Du grec anemos, vent et
chôrein, disséminer. Se dit d’une plante dont
les semences sont adaptées à la dispersion par
le vent. Ex. : disamares* des érables, graines
des saules.
ANÉMOMÈTRE n.m. Du grec anemos, vent et
metron, mesure. Instrument servant en météo-
rologie à mesurer la vitesse du vent.
ANÉMOPHILE adj. Du grec anemos, vent et
philos, ami. Se dit d’une espèce végétale lorsque
sa pollinisation est assurée par le vent ; quali-
fie la pollinisation elle-même.
a
ANG
35
Jardins du château d’Anet

a
APP
40
A
J
QH
L
P
1
1
2
3
4
2
Appareillage de la pierre
1. Panneresse
2. Parpaing (boutisse parpaigne)
3. Boutisse
4. Carreau
PFace de parement
LFace de lit, ou lit de pose
AFace de lit, ou lit d’attente
JFace de joint
DFace de derrière
QQueue
HHauteur d’assise
Appareils
Abouts, angles et jonctions de murs
à assises réglées à assises irrégulières réglées alterné
en boutisses opus incertum mixte à mosaïque brouillée
mosaïque moderne
harpage de tête harpage en besace harpage à décrochements harpage d’angle avec
arrachements d’attente
polygonal à décrochements réticulé
chaîne verticale en pierre
harpage de refend
en jambe étrière

coup bénéficier toute la pousse qui y gagne en
vigueur. Syn. : tire-sève.
APPENDICE n.m. Du latin appendix, supplé-
ment. En botanique, certaines parties sem-
blant être ajoutées à un organe végétal et le
prolongeant.
APPENDICULÉ adj. Se dit d’un organe végétal
pourvu d’un ou plusieurs appendices*.
APPENTIS n.m. Du latin appendere, suspendre.
En architecture, petit toit à une seule pente
prenant appui sur un mur d’un côté et soutenu
par des poteaux de l’autre. Par extension, nom
donné à un bâtiment couvert d’un tel toit.
APPRÊT n.m. Du latin praesto, à portée, prêt.
1. Dans un sens large, toute opération visant à
modifier la nature ou l’apparence de certains
matériaux pour les destiner à une fonction par-
ticulière ou pour les embellir. 2. Matière ou
substance dont on enduit un support avant
l’application d’une couche de peinture. 3. Pein-
ture employée pour combler les irrégularités
d’un support afin d’obtenir une surface lisse.
APPRIMÉadj. Du latin ad, près de et primere, pres-
ser. Se dit en botanique d’un organe appliqué
contre un autre sans en être vraiment solidaire.
APPUI n.m. 1. En maçonnerie, partie en béton
armé qui couronne l’allège* d’une fenêtre ; a
pour fonction de rejeter les eaux de pluie vers
l’extérieur. 2. Un point d’appui désigne, dans
une construction, le point sur lequel porte une
poutre, un linteau, etc.
APREMONT, Parc floral d’ – (Cher, France)
Situé près de Nevers et jouxtant un château
du xvesiècle, le parc floral d’Apremont, créé à
partir de 1971, est avec le parc floral des Mou-
tiers*, le seul jardin ouvert au public qui, en
France, participe de l’esprit de Gertrude Jekyll*.
Les bordures de plantes vivaces aux couleurs
contrastées y ont en effet une place de choix ;
Sissinghurst*, œuvre de sa disciple Vita Sack-
ville-West*, a pour sa part inspiré le jardin blanc
qui attire dès l’entrée le regard du visiteur.
À noter également la pergola inondée de
plantes grimpantes qui traverse tout le parc et
offre, au printemps, le spectacle de ses arceaux
colorés. Les fabriques (« pont chinois », le
« pavillon turc » et le « belvédère » de style néo-
classique russe) constituent un des atouts de
ce parc floral. Évoquant d’autres civilisations,
elles ont été réalisées dans l’esprit de celles des
parcs du xviiiesiècle à partir de 1985. Elles sont
dues au peintre-architecte d’origine russe,
Alexandre Sérébriakoff*. La façon dont ce parc
s’inscrit harmonieusement dans l’ensemble
d’un village lui-même abondamment fleuri
contribue grandement à son originalité.
APTÈRE adj. Du préfixe grec a-, privatif et de
pteron, aile. Qualifie un insecte dépourvu
d’ailes ; par extension, se dit en architecture
d’un édifice ne présentant pas de colonnes sur
ses faces latérales. S’applique enfin à une repré-
sentation allégorique privée d’ailes.
Aqua- Préfixe dérivé du latin aqua, eau.
AQUATIQUE adj. Du latin aqua, eau. Au sens
strict, désigne les plantes vivant entièrement
immergées dans l’eau (ex. : Ceratophyllum ou
cornifle, Myriophyllum ou myriophylle…)mais
ce terme s’applique plus largement aux espèces
flottantes (ex. : Nymphea ou nénuphar) ou
encore à celles qui croissent dans l’eau avec leur
appareil végétatif et floral immergé (Nelumbo
ou lotus) ou encore à celles qui vivent au bord
de l’eau avec des racines plus ou moins immer-
gées (ex. : Sagittaria ou sagittaire, Hippuris ou
pesse d’eau…). Les plantes aquatiques appor-
tent l’oxygène nécessaire à la vie immergée et
participent à la fixation des berges.
AQUEDUC n.m. Du latin aquae ductus, conduit
d’eau. Canal artificiel aérien ou souterrain qui
assurait dans l’Antiquité la conduction de
l’eau ; en général, haute structure soutenue
par des arches. Destinée à l’irrigation des jar-
dins et des cultures, cette eau participait éga-
lement à la salubrité des agglomérations tout
en contribuant à leur esthétique par la mise
en œuvre de jets d’eau et de fontaines. Les
Romains réalisèrent les plus spectaculaires
de ces aménagements.
a
AQU
41
Appareillage de la brique Appareils de murs de 22 cm
appareil français (ou flamand) appareil anglais (ou hollandais) alterné simple
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%