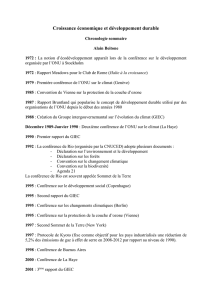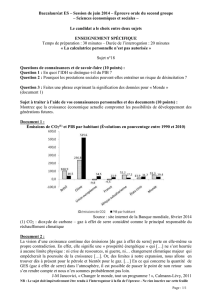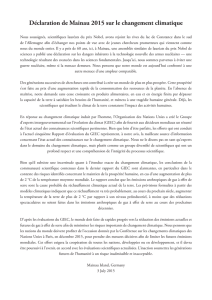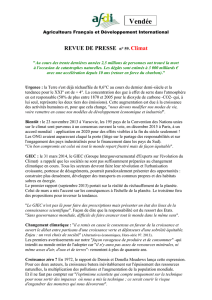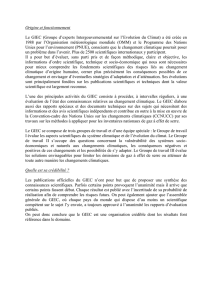Chapitre 1 - Réseau Action Climat

1 / 520
I. La construction sociale du problème
Le changement climatique est un problème socialement construit, et ceci à plus d'un titre.
C'est l'activité humaine qui est la cause de ce risque, tout d'abord – ou, plus exactement, ce sont différentes
sociétés qui en sont la cause, et ceci à des titres différents. Ce sont les sociétés qui l'observent, ensuite, et qui
observent aussi qui est responsable de telle ou telle quantité d'émissions. Ce sont les sociétés qui vont y faire
face et qui auront à le résoudre, enfin, et là aussi toutes ne sont pas également armées. Et le changement
climatique n'est que l'un des aspects de la crise environnementale dans laquelle sont entrées nos sociétés.
Tous ces aspects ont des liens multiples avec la question de la justice : quelle est la légitimité de telle ou telle
activité humaine au regard de ses résultats sur le milieu naturel ou sur d'autres êtres humains ? Telle ou telle
activité contribue-t-elle à produire plutôt des biens ou des maux ? Qui en décide ? Qui en bénéficie et qui les
subit ? Comment disposer d'une représentation adéquate du comportement des entités en jeu et de leurs
interactions pour pouvoir anticiper les conséquences de l'action ? Qu'est-ce que la nature, quel rôle a-t-elle ? Qui
sont ces Etats qui négocient pour réduire leurs émissions ? Comment s'accorder sur la qualification des entités et
des critères d'équité pertinents et déterminer ce que pourrait être une répartition juste des biens et des maux ?
La question de la justice dans la crise environnementale, et dans le cas du changement climatique en
particulier, ne s'inscrit pas dans un espace social vierge de tout présupposé. Il est impossible de comprendre ce
qui se joue actuellement sans faire un effort pour retracer les filiations, tant pour ce qui est des pratiques qu'en
ce qui concerne les concepts par lesquels nous pensons notre société et notre action dans leur monde.
L'environnement ne se dégrade pas tout seul : ce sont bien des êtres humains qui le dégradent, et certains y
contribuent davantage que d'autres. Les êtres humains agissant ainsi sont animés de motivations qu'il convient
d'élucider.
On peut aussi être surpris en constatant que l'idée de l'éventualité d'une modification anthropique du climat
est vieille de quasiment deux siècles, précédant de beaucoup la construction internationale du problème du
changement climatique. La capacité de comprendre ne suffit donc pas : il faut aussi que s'y ajoute l'intérêt, et
ici, il sera dicté par le risque, qui suscite une in-quiétude. Pourquoi nul ne s’est-il réellement intéressé à la
question jusqu’ici, alors qu'il existait dès le XIXe siècle des présomptions suffisantes pour justifier des
investigations plus poussées1 ? Interrogeons-nous également sur l'identité du sujet qui porte ces raisons : s'agit-il
d'un citoyen, d'une autorité, d'une nation, d'un Etat ? Et de quel citoyen, quelle nation, quel Etat ? Quelle est cette
chose désignée par le concept d'environnement ? Est-elle naturelle, artificielle ?
On ne peut utiliser de concept de manière innocente. Tout ce que l'on peut faire, c'est tenter d'expliciter le
sens qu'on y voit et y trouve. Nous allons donc nous efforcer ici de retrouver quelques repères dans les
méandres des filiations, et de proposer une lecture de la construction sociale de la crise environnementale, en
suivant plus particulièrement le cas du changement climatique. Nous cherchons ainsi à aboutir à un état des lieux
beaucoup plus complet que celui établi en première partie de ce chapitre, fournissant les éclairages nécessaires
à la compréhension du contexte dans lequel se pose la question de la justice.
Nous allons plus particulièrement retracer l'évolution et la construction des trois thèmes centraux pour notre
analyse :
1 S. Arrhénius, On influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground, in Philos.
Mag. S., 1896, Vol 41, no. 251, pp. 237-276.

2 / 520
- le thème de la justice, bien sûr, qui reste toujours lié aux aspects évoqués en introduction : définition des
biens et maux à répartir, définition des acteurs et des critères d'équité pertinents, des institutions capables de les
répartir etc.
- le thème de la nature, qui joue un rôle fondamental dans la crise environnementale,
- le thème des relations internationales, qu'il serait plus adéquat de considérer comme des relations inter-
sociétales se présentant aujourd'hui essentiellement comme des relations commerciales et des relations inter-
étatiques.

3 / 520
1. Le changement climatique : état des lieux
Nous allons commencer par dresser un état des lieux.
Qu'est-ce que le changement climatique ? A quoi est-il du ? Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre ? Ceci a-t-il
quelque chose à voir avec la couche d'ozone ? Peut-on prévoir le climat futur ? Toutes ces questions, et bien
d'autres, sont au cœur du problème. L'objet de ce chapitre est de faire un état de la question du changement
climatique tel qu'il se présente actuellement dans le consensus des experts. C'est l'état des lieux d'un problème
social, d'un problème rencontré par les sociétés humaines dans leur activité et tel qu'il apparaît dans le débat qui
a lieu entre les parties prenantes. Il y a un changement climatique qui est posé comme un problème, et il y a un
accord minimal autour d'un certain nombre de repères balisant le débat.
Ce chapitre présente l'ensemble de ces repères qui sont considérés comme des faits par les experts. Ensuite,
tout n'est que problèmes. Ce chapitre est donc notre point de départ. Tout l'enjeu ensuite sera de dérouler et
d'expliquer l'arrière-plan conceptuel sur le fond duquel s'expose cet état des lieux, pour aboutir à quelque chose
de plus satisfaisant. Nous serons donc amenés dans les chapitres suivants à analyser et problématiser bon
nombre de concepts et objets qui sont ici simplement présentés comme des faits.
1. Le forçage anthropique de l'effet de serre
Il faut tout d'abord distinguer la notion de « climat » de celle du « temps qu'il fait ». Le temps qu'il fait se
réfère à l'état climatique perçu d'une manière localisée, anthropocentrée, en un lieu donné : le « beau » ou le
« mauvais » temps. Le climat par contre désigne l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent
l'état moyen de l'atmosphère. Le climat est donc envisagé non pas pour l'Homme, mais pour lui-même, de
manière objective. Le temps qu'il fait est la perception subjective et passagère d'un état du climat en un lieu
donné. Il peut donc donner des indications sur l'histoire du climat, mais avec un degré de fiabilité assez faible et
très variable. E. Le Roy Ladurie s'est par exemple appuyé sur les dates des vendanges au Moyen-Age, comme
indice pour reconstituer le climat autour de l'an mil2. Le climat, lui, met en oeuvre des facteurs physiques,
chimiques et biologiques qui ne dépendent pas de la subjectivité de l'observateur.
Il y a ensuite deux utilisations différentes du concept de changement climatique. Pour les climatologues, le
concept de changement climatique se réfère à toute évolution du climat, qu'elle soit ou non due à l'activité
humaine. Par contre, dans le cadre des négociations internationales ce concept désigne exclusivement la partie
de l'évolution climatique dont l'activité humaine porte la responsabilité. Nous utiliserons le concept uniquement
dans ce second sens, suivant en cela l'usage le plus commun.
i - Qu'est-ce que l'effet de serre ?
La Terre est une planète qui a la particularité d'être pourvue d’une atmosphère.
Cette atmosphère a une composition homogène, précise et stable dans le temps : 78% d'azote et 21%
d’oxygène environ, à quoi s'ajoutent des gaz présents en faible proportion dits gaz traces. Parmi ces gaz traces,
on trouve des gaz dont l’une des propriétés est de piéger l'énergie solaire. Agissant comme une sorte de
couverture globale, ces gaz induisent un effet de serre naturel par lequel la température terrestre est accrue de
33°, permettant d'arriver à une température moyenne terrestre de +15°C, au lieu de –18°C. Cet effet de serre
naturel est l’une des conditions de possibilité de la vie, puisqu'il n'y a pas de vie si l'eau reste gelée, au moins
pour ce qui est des formes de vie connues. Les gaz à effet de serre sont en proportion suffisante pour que la
2 E. Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mil, Paris : Flammarion, Champs, 1983. 2 volumes.

4 / 520
température terrestre moyenne reste comprise dans les limites connues de tolérance de la vie. Sur Vénus, par
exemple, un taux plus important de gaz à effet de serre contribue à maintenir une température moyenne de
250°C, rendant toute forme de vie connue impossible.
Figure 1 : L'effet de serre (Source : UNEP/ La voie verte 20003).
La planète Terre reçoit du soleil une énergie moyenne de 342 watts par mètre carré. Un tiers de cette
énergie est ré émis directement dans l'espace, et les deux tiers restants sont absorbés par différents éléments
terrestres (eau, sols, nuages, atmosphère) avant d'être ré-émis plus tard dans l'espace sous forme de
rayonnement infrarouge. Le décalage temporel entre l'énergie reçue et l'énergie ré-émise correspond à la
circulation terrestre de l'énergie solaire, le soleil étant le moteur principal des mouvements de matière et
d'énergie dans la biosphère, et donc le moteur principal des écosystèmes. La biosphère est la région de la
planète qui renferme l'ensemble des êtres vivants et dans laquelle la vie est possible en permanence4.
Certains auteurs donnent une définition plus étendue, incluant les zones dans lesquelles la vie n'est pas possible
mais dans lesquelles transitent des éléments nécessaires à la vie. Ces éléments sont qualifiés de biogènes ou de
biotiques. C'est par exemple le cas d'une partie de l'atmosphère. Les gaz qui absorbent les rayonnements
infrarouges et provoquent l'effet de serre sont dits gaz à effets de serre.
Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont : le dioxyde de carbone CO2, la vapeur d'eau (H2O), le
méthane (CH4), le protoxyde d'azote (NO2) et les gaz artificiels de la famille des composés chlorés (CFC,
HCFC, etc.), qui sont par ailleurs des gaz destructeurs de la couche d'ozone. Ces GES ne contribuent pas tous
de la même façon à l'effet de serre. Leur contribution relative peut être indiquée par un indicateur appelé
« pouvoir de réchauffement global » (PRG), qui est calculé en fonction des deux paramètres principaux qui
entrent en ligne de compte : la quantité d'énergie qu'une molécule d'un gaz déterminé peut intercepter, et la
durée de résidence de cette molécule dans l'atmosphère. Le tableau ci-dessous se lit de la manière suivante : 1
kg méthane a un pouvoir de réchauffement de l'atmosphère équivalent à 21 kg de CO2. La durée de résidence
est donnée à titre indicatif.
3 Consulté le 25/10/2000. Adresse internet : URL : http://www.ec.gc.ca/climate/primer
4 Cité in F. Ramade, Eléments d'écologie, Paris : Ediscience International, 1994.

5 / 520
Gaz Durée de résidence (années)
PRG
Dioxyde de carbone (CO2) 100 à 200 1
Méthane (CH4) 15 21
Protoxyde d'azote (NO2) 120 310
HCFC-22 12 1,300
CF4 50 000 6500
SF6 3 200 23,900
CFC-12 102 6500
Tableau 1 : Le pouvoir de réchauffement global de différents gaz à effet de serre (Source : GIEC 1995).
L'indice PRG, établi sur la durée de résidence et la puissance d'absorption des différents gaz, est un peu
arbitraire : les deux grandeurs physiques ne sont pas comparables. De plus, il néglige certains aspects tels que
les effets chimiques secondaires, et qu'il repose sur des données incertaines. Cet indicateur approximatif et
simplifié n'est sans doute pas très rigoureux au point de vue scientifique, mais il a l'immense avantage de
permettre de comparer directement la culpabilité relative de chaque gaz5. Les décideurs disposent ainsi d'un outil
pour établir des priorités sans avoir à se convertir en climatologues.
ii - Qu'est-ce que le système climatique ?
Le climat est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui ont lieu dans l'atmosphère, mais les
déterminants du climat ne se réduisent pas aux éléments présents dans l'atmosphère. Le soleil, les océans, la
biosphère etc. jouent eux aussi un rôle.
Ni l'atmosphère ni la biosphère ne sont des systèmes inertes et stables. Ces éléments sont au contraire
composés de régulations cycliques et évolutives. Le système climatique peut être décrit en première
approximation comme un système thermodynamique non-linéaire. La non-linéarité signifie qu'à l'évolution
progressive d'un facteur le système ne réagit pas forcément par une évolution linéaire. Prenons l'exemple de
l'eau s'écoulant par l'orifice d'un robinet. Lorsque le robinet est peu ouvert, le fluide s'écoule d'une manière
régulière : c'est le régime laminaire. Quand on ouvre le robinet en grand, alors l'eau s'écoule d'une manière
désordonnée : c'est le régime turbulent. Aussi lentement que l'on ferme le robinet, le passage de l'un à l'autre
régime est toujours brutal. Le système est dit non-linéaire parce que quelle que soit la vitesse d'évolution de la
commande (le robinet), la réponse est toujours brutale : le changement de régime n'est pas ralenti parce que la
commande est ralentie. Ce qui importe alors est le seuil au-delà duquel il y a basculement dans un régime ou un
autre, chaque état étant stable à sa manière.
De la même façon, l'atmosphère et les courants océaniques sont maintenus en mouvement par des
déséquilibres successifs. Ainsi, la rencontre entre un front d'air chaud et un front d'air froid provoque une brutale
condensation de la vapeur d'eau, qui est ainsi précipitée au sol sous forme de pluie. De même, le fameux
anticyclone6 des Açores n'est pas un anticyclone, mais un flux d'anticyclones en provenance du pôle Nord7, tous
les 3 ou 4 jours.
5 P. Roqueplo, Climats sous surveillance, Paris : Economica, 1993, pp. 196-229.
6 Un anticyclone est une zone de hautes pressions d'air froid.
7 Y. Lenoir, Effet de serre, changements climatiques, Intervention au Collège des Hautes Etudes de
l'Environnement – Jeudi 11 Janvier 2001.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%