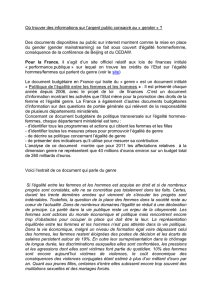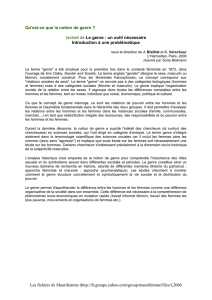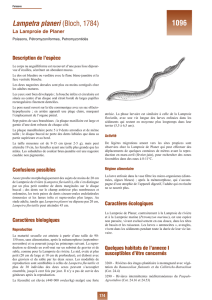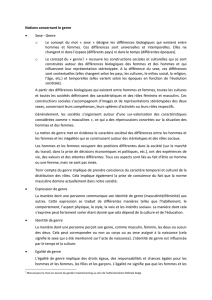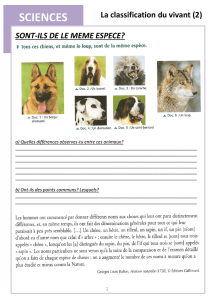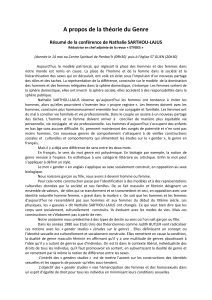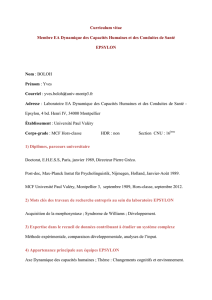Les notions de personne humaine et de Gender

1
Les notions de personne humaine et de Gender !
Cette présentation se veut assez brève, pour laisser plus de latitude à M. Boyancé, dont le
corps de l’intervention concerne plus directement notre préoccupation d’aujourd’hui. Toutefois, une
précision de termes nous a semblé nécessaire entre le Genre et la personne. Avec cette affirmation
du Dr Harry Benjamin, glanée sur la nouvelle référence universelle Wikipédia, vous allez
tout de suite comprendre l’enjeu.
« Le sexe, c'est ce que l'on voit, le genre, c'est ce que l'on ressent
1
».
Autant dire qu’avec une telle définition, se fonder sur des arguments objectifs et
tangibles, risque d’être relativement ardu. Un peu plus précise, pour Christine Delphy,
toujours sur la même référence universelle « Le genre, c'est ce que l'on pourrait appeler le "sexe
social"
2
» Et effectivement, dans l’idée de la théorie du Gender, il y a de cela. Vous souffrirez que
j’emploie le terme anglais, non pas parce que c’est l’expression consacrée, ni parce que les tenants
francophones du Gender, nous expliquent que le terme anglais ‘sex’ a un champ lexical trop réduit
pour traduire la véritable notion de sexe, mais simplement pour distinguer le mot genre de la théorie
actuelle qui porte son nom.
I- La notion de genre
Prenons justement le temps de revenir à l’étymologie. En latin, genus, signifie, sorte, espèce,
race. C’est donc avant tout une classification de groupe et bien souvent de sous ensemble. Ainsi le
genre est-il le sixième rang principal dans la classification classique des espèces. Le genre humain
n’est autre que le regroupement de l’espèce humaine. Toutes autres distinctions confondues,
l’espèce humaine est elle-même subdivisée en deux autres classes que l’on a appelées également
genre. Le genre masculin et féminin classe donc les représentants de l’espèce humaine en fonction
de leur sexe. C’est une classification comme une autre, pourrait-on dire, mais pourtant, de cette
classification dépend le renouvellement de l’espèce humaine, comme de l’immense majorité des
espèces animales.
Le genre, prit dans son acception la plus banale est donc un classement séparant hommes et
femmes en deux catégories distinctes en fonction du sexe. De tout temps et pour toute espèce, du
reste, il s’agissait du sexe biologique, bref du sexe.
Passons sur l’historique de l’émergence de la théorie du Gender déjà abordé en ouverture de
ces journées et arrivons à sa conclusion. Le genre est bien une distinction de sexe, mais il ne peut
s’agir du sexe biologique, ce qui serait une injustice. Il s’agit du sexe putatif, c’est-à-dire de celui que
l’on pense avoir, psychiquement, au-delà de la réalité biologique que l’on peut donc, du reste
changer. C’est le sexe social, celui que l’on se choisit et qui donc va nous poser dans la société.
Tout l’enjeu du débat autour du genre est donc de savoir s’il est biologique ou social.
C’est pourquoi, l’essentiel de la discussion sur la théorie du gender n’est pas anthropologique, mais
sociologique et déborde donc largement la théorie elle-même. Au fond, la problématique, et la
1
Wikipédia, article ‘genre (science sociale)’
2
Id.

2
véritable question est celle du lien entre nature et culture et, au-delà, se pose donc la question du
lien de l’homme à la nature.
La culture véhiculée depuis l’origine (car aucun historien n’a démontré le contraire) sur le
genre comme sexe biologique est-elle conforme à la nature humaine ? Si oui il n’y a pas de raison de
changer le concept de genre. Si non, il faut émanciper l’être humain de cette vieille culture qui
l’étouffe.
Mais pour les tenants du Gender, la chose ne s’arrête pas là et ce n’est pas la moindre des
difficultés pour nous. Si la nature est conforme à la culture plurimillénaire, il appartient à l’homme
moderne de se libérer des contraintes de la nature. C’est un signe de progrès. D’un côté la nature est
invoquée pour justifier de lutter contre cette chape de plomb surannée, de l’autre la culture, comme
sans cesse en évolution, est prise à témoin pour lutter contre la nature.
La notion de genre est, en fait, une notion subjective et relative. Il appartient à chacun
d’accepter ou non de correspondre au genre biologique qui est le sien. C’est bien ce que l’on ressent,
comme le disait plus haut le Dc Benjamin.
L’enjeu du débat est donc bien de savoir si la personne humaine peut s’épanouir en dehors
de la nature.
Cela suppose une question préalable qui, elle, ne peut être subjective. Qu’est ce qui épanouit
la personne humaine ? Question soutendue par une autre : qu’est-ce que la personne humaine ?
II la notion de personne humaine
Et la question n’est pas anodine, car elle touche au plus intime de chacun. Au fond, dans la
perspective du genre, la question est la suivante : est-ce que ce que je ressens est conforme à ce que
je suis ? Or il peut y avoir une distance assez importante entre ce que je suis et ce que crois être. Et
cette distance peut s’avérer être un choc psychologique insurmontable. Choc qui explique la volonté
de déconnecter la nature de la culture, la réalité biologique, du vécu psychologique. Choc qui rend le
dialogue bien difficile.
De fait, en approchant un peu la notion de genre, nous avons pu nous rendre compte que
nous nous situions à un niveau différent de celui de la personne. La notion de genre est aujourd’hui
psychologique et sociale, tandis que la notion de personne est anthropologique et transcendante.
Vouloir comparer les deux relève donc de l’amalgame. En étudiant les thèses du gender
studies, le fond de cet amalgame ressort assez clairement. L’idée est de brouiller la notion de
personne, de la relativiser et par la même de la rendre secondaire. C’est que, de fait, la notion de
personne n’est ni simple ni claire en soi. Elle l’est encore moins sans la référence à la transcendance
divine.
Permettez-moi ici de citer l’excellent résumé de Damien Warry, dans le cadre du séminaire
interdisciplinaire de bioéthique 2006/7
« Le mot même de personne (ou hypostase) ne se trouve pas dans la Bible. Il nous paraît alors
méthode obvie d'essayer de définir l'origine de cette notion, de tracer un aperçu des trois grandes
compréhensions de cette notion, puis de frayer une voie vers notre propre compréhension de la
personne.

3
D'après le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale citant A.Rorty
3
, le mot de personae
émane de deux sources principales: le théâtre (les masques sont des personae) et la loi (surtout de par
la notion de responsabilité légale)
4
. La personne serait un centre unifié de choix et d'action, ayant
pour résultante la notion de liberté et de responsabilité. Nietzsche lui, récuse qu'il existe « un centre
unifié de choix et d'actions » et préfère le terme d'identité morale au terme de personne. M.
Nédoncelle précisera que la persona désigne d'abord le masque, puis l'acteur, puis le rôle pour enfin
s'appliquer au rôle que l'on joue dans la vie
5
. Duquoc, lui, note que la notion de personne dans la loi
vient des Romains et la notion de personne dans le théâtre vient des Grecs, mais que dans la
civilisation gréco-romaine l'on n’a pas abouti à la dignité de tout individu égale en droit
6
.
Nous en venons à penser que cet axiome personne-dignité ne peut être mis en valeur qu'avec
la notion vétérotestamentaire d'un Dieu unique. En effet, la fraternité universelle est la conséquence
de l'unique Dieu créateur. Bien que la notion de dignité de l'homme soit mise en valeur par le
judaïsme (cela notamment par le concept d'image de Dieu en Genèse 1) la notion de personne
n'émergeant que dans la civilisation gréco-romaine, devra être développée dans le Christianisme.
Ainsi, le Christianisme s'appuiera sur l'Ancien Testament et sur le vocabulaire de la langue
grecque pour proposer une définition de l'hypostase. Cette notion va se développer dans un premier
temps grâce à la réflexion christologique. C'est avec le concile de Chalcédoine que le concept
ontologique d'hypostase prendra forme.
Suite à cela, la notion de personne prendra divers chemins: S. Thomas, à la suite de longs
débats chez les scolastiques va prendre une option que l'on appellera ontologique. Les philosophes,
par l'intermédiaire de Kant principalement, vont prendre une option que l'on appellera
phénoménologique. Dans une approche plus contemporaine, certains vont opter pour une vision
relationnelle de la notion de personne. »
Marcel Mauss, considéré comme le père de l’anthropologie française, ajoute pour sa part :
« Au contraire des Hindous et des Chinois, les Romains, les Latins pour mieux dire, semblent être
ceux qui ont partiellement établi la notion de personne, dont le nom est resté exactement le mot
latin. [...] La "personne" est plus qu'un fait d'organisation, plus qu'un nom ou un droit à un
personnage et un masque rituel, elle est un fait fondamental du droit. En droit, disent les juristes : il
n'y a que les personae, les res, et les actiones : ce principe gouverne encore les divisions de nos
codes. Mais cet aboutissement est le fait d'une évolution spéciale au droit Romain. [...]
Ce sont les chrétiens qui ont fait de la personne morale une entité métaphysique après en avoir
senti la force religieuse. Notre notion à nous de personne humaine est encore fondamentalement la
notion chrétienne [...].
La notion de personne devait encore subir une autre transformation pour devenir ce qu'elle
est devenue voici moins d'un siècle et demi, la catégorie du moi. Loin d'être l'idée primordiale, innée,
clairement inscrite depuis Adam au plus profond de notre être, voici qu'elle continue, presque de
3
Dictionnaire d'Ethique et de Philosophie morale, sous la direction de M. CANTO-SPERBER, P.U.F, Paris, 1996,p.
691-697. Il nous semble important de noter que la suite de l'article est teinté d'un accent hégélien évident
mettant en avant les personnalités institutionnelles plutôt qu'individuelles.
4
A RORTY ajoute: « Un être humain donnée peut donc avoir toute une série de personae dont chacune est un
locus de responsabilité. »
5
M. NEDONCELLE, Les deux passés et le problème de l'histoire, dans Explorations personnalistes, Paris, 1970,
p.111-123
6
DUQUOC, Lumière et vie

4
notre temps, lentement à s'édifier, à se clarifier, à se spécifier, à s'identifier avec la connaissance de
soi, avec la conscience psychologique.
7
»
De là nous comprenons mieux le glissement de la personne au genre comme sexe social.
Si pour le chrétien, la notion de personne est une évidence indiscutable, elle ne va donc pas
de soi. Et ce pour la simple raison qu’elle repose sur la transcendance divine et l’image de Dieu. Mais
cette notion même de personne en relation à Dieu est contestée, puisque d’aucun mettent en avant
que si cette notion est partagée avec Dieu, elle ne fait donc pas parti de ce qui est propre à l’homme.
Or c’est bien ce qui fonde la dignité intrinsèque de la personne humaine. Faire, comme
Locke, de l’union personne/homme, une faute morale et juridique, c’est la conséquence logique
d’une telle dissociation. Si l’homme est personne seulement lorsqu’il est libre et conscient de ses
actes, lorsqu’il a conscience de lui-même, alors de fait, la personne humaine exclut les handicapés,
les séniles, les embryons, les enfants en bas âges et même tout homme qui agit sans savoir. Dès lors,
la notion de personne humaine ne peut plus être un critère moral et juridique et donc pas d’avantage
un critère fondateur de vie en société. La personne humaine devient relative et discursive.
La difficulté du débat sur le Gender repose au fond, sur le relativisme de la personne
humaine, devenu, conscience de soi. Cette hypertrophie du moi, fait déchoir l’homme de la
personne à l’individu, c’est-à-dire, la plus petite réduction possible de l’espèce humaine, sans lien
intrinsèque avec l’autre, puisque la conscience de soi est nécessairement subjective. La vie en
société, fondée sur la dignité de la personne humaine, en théorie, repose en réalité sur la conscience
que l’individu a de lui-même et de ses besoins. Or cette conscience n’est pas nécessairement
conforme à la réalité. Ainsi, la réalité biologique du sexe, peut ne pas être conforme au sexe social
qui est la conscience que l’individu a de sa sexualité.
Ce n’est pas un hasard, si la notion de personne humaine est née dans le contexte judéo-
chrétien. Seule l’image de Dieu peut garantir la dignité intangible et intrinsèque de la personne
humaine, parce qu’il entre dans la notion de personne humaine, la participation (en ressemblance et
en acte) à la personne divine. La notion de personne humaine, telle que l’entendent les chrétiens est
bien métaphysique et transcendante, tandis que la notion moderne est juridique et psychologique.
Conclusion
Aussi, en dehors de la foi, il semble bien que seule l’intuition de la grandeur de l’homme,
peut constituer un rempart et un fondement pour comprendre et accepter que la personne humaine
assume tout l’homme et tout homme à tout instant. C’est bien le drame de l’humanisme athée. En
enfermant l’homme dans ses limites matérielles, il le condamne à s’abaisser, en lui fermant cette
ouverture vers le haut. L’homme est infiniment plus que ce qu’il donne à voir. Et c’est dans cet
infiniment plus que s’exprime le mieux la personne, car l’homme est ontologiquement une personne
qui pose des actes. Mais ces actes sont extrinsèques à l’homme et le mettent par là-même en
relation à ce qui est déjà hors de lui-même, en faisant, à l’image de la Trinité, un être de relation, ce
qui est constitutif de lui-même. En outre, la réalité des actes extrinsèques dépasse leur simple
réalisation matérielle, puisque l’homme est capable de les interpréter de différentes manières ou
d’appréhender le réel en fonction de phénomènes divers qui, même irréels, deviennent une réalité
dans la mesure où ils entrent en considération dans la délibération ou le jugement. Ainsi plus large
que l’homme de Locke, la personne comprend également cet aspect phénoménologique.
7
Marcel MAUSS, La notion de Personne, celle de "moi", in Sociologie et Anthropologie, P.U.F., pp. 351, 357, 359

5
Cyril Brun, directeur de l’OSP
1
/
5
100%