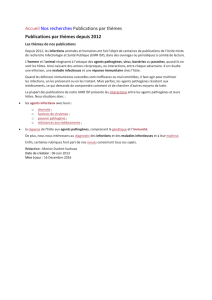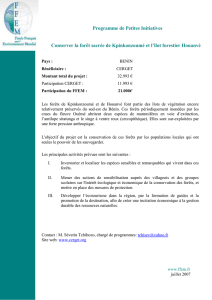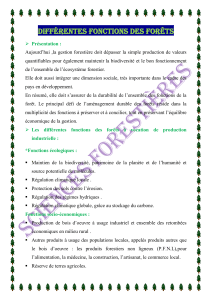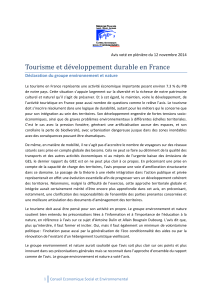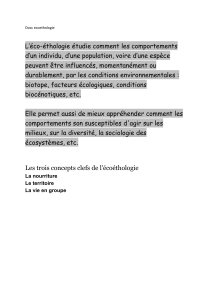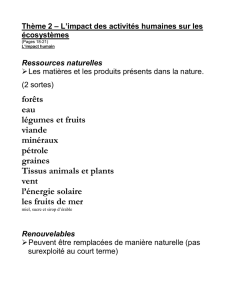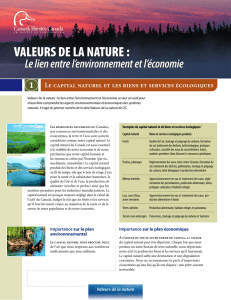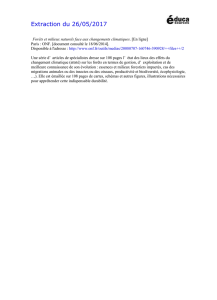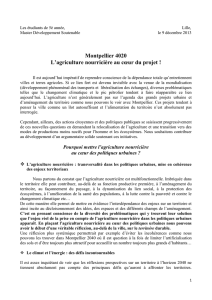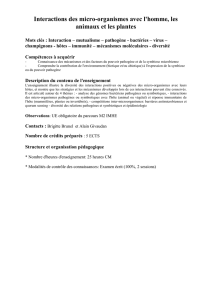Artificialisation du vivant : histoire, processus et conséquences

Artificialisation du vivant : histoire, processus et conséquences
Hervé Richard,Pierre-Marie Badot, Jean-François Viel
CNRS-Université de Franche-Comté/ UMR 6249 Chrono-environnement, Besançon,
nov. 2008
De la domestication à l’artificialisation du vivant
Depuis que l’Homme est passé du statut de prédateur à celui de producteur, la
domestication et la mise en valeur des systèmes écologiques contribuent inexorablement à
façonner la culture, l’économie, l’organisation sociale, les paysages et l’image d’un territoire.
Les écosystèmes résultant de ce processus de transformation s’appuient sur un contexte
géologique et biologique qui a été lentement domestiqué puis artificialisé pour l’adapter aux
besoins multiples de sociétés variées.
Cette évolution est longue et complexe. Les premiers systèmes agro-forestiers
néolithiques d’abattis-brûlis perdurent pendant plusieurs millénaires, mitage de petites
clairières au milieu de forêts dont la diversité n’est que le fruit de dynamiques internes qui
viennent se surajouter aux conséquences à long terme de changements globaux affectant
les conditions climatiques et édaphiques. Ces proto-agriculteurs resteront largement
dépendants de cette nature qu’ils transforment, qu’ils subissent parfois, mais qui reste, par la
chasse, la pèche et la cueillette, un complément indispensable et longtemps inépuisable.
Pourtant, dès ces premiers balbutiements agricoles, par un processus lent de contacts, de
diffusions et d’adoptions temporaires de nouvelles techniques, jalonné de périodes fastes et
malgré d’inévitables échecs, la domestication des milieux naturels est en marche. Très
lentement, de génération en génération, les jachères, l’introduction de l’araire et la
systématisation des cultures attelées, l’introduction du métal transforment graduellement
l’environnement des sociétés humaines successives. Les petites clairières originelles
s’agrandissent jusqu’à se fondre les unes aux autres. Les écosystèmes se diversifient. La
population humaine augmente. Les sociétés se hiérarchisent. De véritables stratégies
territoriales sont élaborées. Puis les attelages se font plus lourds et les jachères sont
abandonnées. Enfin, l’agriculture est mécanisée, chimisée, automatisée. L’artificialisation du
vivant est alors quasi universelle.
Cette longue évolution, engagée il y a environ dix millénaires dans des contextes
environnementaux très variés, n’est pourtant pas régulièrement croissante, depuis un état
strictement conditionné par les seules contraintes naturelles jusqu’à l’aspect uniformément
anthropisé actuel. Le temps des clairières concerne la majeure partie de cette évolution qui
voit se succéder emprises et déprises agricoles, mais aussi transformations des pratiques et
changements de productions. L’origine de ces mutations est souvent multiple associant des
causes naturelles (comme les crises climatiques), des processus directement liés à une
exploitation irraisonnée des terres (érosion et épuisement des sols) à des événements socio-
économiques (guerres, épidémies, crises ou au contraire embellies financières). Ces phases
successives de changements, d’adaptations et de reconversions agricoles sont les vecteurs
essentiels de la structuration des paysages actuels. L'artificialisation fragmente le paysage et

contribue à l'isolement d'espèces, de populations, et peut conduire à la disparition des
habitats.
A l’exemple de l’Europe, l'épaisse forêt qui couvrait une grande partie de l’espace n'a
pas entravé cet essor d’activités agricoles et l’exploitation des potentialités du sol et du sous-
sol. Si au cours des derniers millénaires des périodes de déprises ou de reculs des activités
agricoles sont perçues, c'est plus le résultat de processus économiques, politiques et
sociaux que la conséquence directe de dégradations climatiques qui devaient pourtant être
vivement ressenties dans ces zones de moyenne montagne, de haute latitude et de limite de
zones arides. L’équilibre qui a longtemps persisté entre espaces agropastoraux et forestiers
bascule à l’aube de l’an Mil. Les innovations technologiques, les rendements agricoles plus
importants qui en découlent et l’essor démographique aidant, l’homme s'affranchit totalement
des contraintes liées à son environnement.
Ces processus de domestication puis d’artificialisation du vivant s’inscrivent dans des
échelles de temps et d’espace extrêmement variées. Tous ne peuvent être abordés avec la
même résolution et les mêmes méthodes. L’étude temporalisée des modalités de diffusion
des populations, des techniques et des connaissances, de leurs ruptures et de leurs
accélérations, est un élément essentiel de compréhension des systèmes naturels et
anthropiques actuels.
Dans ce sens, de nombreuses pistes doivent encore être explorés :
‐ il faut d’abord pousser encore plus loin la description des groupements végétaux
passés : quels types de forêts, quelles cultures, quelles surfaces emblavées, cultivées,
pâturées ? Quelles pratiques agricoles ?
‐ une attention particulière doit être portée sur les phases de conquête, d’équilibre et
de rupture des fronts pionniers agricoles passés et actuels ;
‐ les phases d’emprises et déprises agricoles, les changements de productions doivent
être abordées dans la longue durée ;
‐ l’analyse des changements climatiques entreprise depuis de nombreuses années doit
se rapprocher encore des études concernant l’évolution des populations humaines pour
mesurer le poids exact du climat dans le dynamisme des sociétés agricoles et élaborer des
modèles prédictifs ;
‐ l’analyse des évolutions spatiales de la production, de la consommation des
matériaux et objets manufacturés sur la longue durée doit être généralisée ; les
conséquences environnementales de ces productions doivent être mieux évaluées ;
‐ des recherches et des observatoires de la dynamique subactuelle de la faune et la
flore, couvrant les tout derniers siècles, fourniront la matière à des études de dynamique des
populations animales et végétales ;
‐ le rôle des structures spatiales des paysages dans la diffusion de l’agriculture devra
être abordé par des outils spécifiques de modélisation qui pourraient être partagés entre les
différentes approches.
Artificialisation des écosystèmes actuels
Les modifications induites par les activités humaines conduisent à la création de
milieux artificialisés par transformation, appauvrissement ou destruction des milieux naturels.
L'artificialisation touche les territoires et les sols, les systèmes écologiques et les
communautés qu'ils abritent, elle concerne alors l'ensemble des espèces vivantes.

L'artificialisation croissante - et pour partie irréversible - des systèmes écologiques constitue
depuis un demi-siècle une source majeure de préoccupations pour les populations et les
pouvoirs publics. Depuis plusieurs décennies, les autorités nationales et internationales
(Water Framework Directive, REACH…) ont élaboré et mis en oeuvre avec plus ou moins
de succès des politiques actives pour répondre aux grands enjeux sociétaux liés à ces
processus et à leurs conséquences.
L’artificialisation exerce de nombreux effets délétères. Elle diminue ou annule le
potentiel agricole des sols. Elle affecte fortement leur biodiversité. Elle cause la perte de la
fonction de régulation des précipitations et elle empêche les sols de jouer leur rôle épurateur.
Le développement des surfaces artificialisées réduit l’espace de vie de nombreuses
espèces, jusqu’à souvent les faire disparaître.
La croissance des zones aménagées par l'homme constitue une menace pour le sol
qui est une ressource non renouvelable à l'échelle humaine. Les politiques d’aménagement
du territoire, en particulier dans les zones périurbaines, devraient tenir compte, lors de
l’élaboration des documents d’urbanisme, de l’aptitude des sols à remplir certaines fonctions
économiques ou écologiques. De 1990 à 2000, dans 23 pays de l’Union Européenne, 48 %
des terres qui ont été artificialisées étaient des terres arables ou occupées par des cultures
permanentes.
Les enjeux attachés à la conservation des milieux non artificialisés, en particulier vis-à-
vis de la pression urbaine sont des enjeux majeurs. Cependant, la conservation ne peut être
érigée en principe absolu car cela reviendrait à dénier toute possibilité de développement
ultérieur. Toute action humaine se traduit par un compromis entre des bénéfices attendus à
l'échelle des sociétés humaines et des coûts environnementaux. Une des difficultés
principales pour définir l'équitabilité d'un tel compromis réside dans l'identification du plus ou
moins grand "intérêt", de la plus ou moins grande "qualité", de la plus ou moins grande
"importance" des milieux notamment en ce qui concerne leur implication dans le maintien
des équilibres globaux, régionaux ou locaux. L'intérêt des milieux peu ou très peu
artificialisés n'est pas uniquement lié à leur possible mise en valeur sylvicole ou agricole. Ils
jouent un rôle clé dans le maintien de nombreux écosystèmes, eux mêmes indispensables à
la survie de l'espèce humaine.
Avant toute décision d'aménagement, avant toute implantation ou mise en œuvre d'une
nouvelle activité humaine, il est impératif (i) d'identifier les fonctions qui sont actuellement
remplies par les milieux qui seront soumis à artificialisation et (ii) d'évaluer les conséquences
des modifications induites sur ces milieux en termes de fonctionnement systémique à toutes
les échelles spatiale et temporelle, et à tous les niveaux d'organisation biologique. Fournir
les outils objectifs permettant d'évaluer "la qualité" ou "l'importance" des milieux "naturels",
autrement dit les fonctions qu’ils sont aptes à remplir aujourd’hui ou dans le futur constitue
l'un des principaux challenges de l'écologie systémique et fonctionnelle. Ces questions
dépassent bien sûr le strict cadre scientifique et sont au cœur des choix de société. Dans
quel univers souhaitons-nous vivre ?
L'artificialisation des territoires
L'intensité de l'artificialisation des territoires est très variable d'un milieu à l'autre. Il peut
être utile de distinguer des milieux très fortement artificialisés (i.e. espaces urbanisés), de
milieux moyennement artificialisés (i.e. espaces agricoles, forêts exploitées) et de milieux

très peu artificialisés (i.e. forêts primaires, fonds océaniques, certains milieux marins,
déserts…). La nomenclature européenne d’occupation du sol Corine Land Cover permet de
distinguer des territoires artificialisés d'autres types d'occupation du sol, tels que les
territoires agricoles, les forêts et les milieux semi-naturels, les zones humides et les surfaces
en eau.
Indépendamment des zones répertoriées comme terrritoires artificialisés dans Corine
Land Cover, la très grande majorité des milieux est à l'heure actuelle exposée à l'impact des
activités humaines : d'un point de vue écologique, ces milieux peuvent aussi être considérés
comme artificialisés. Ainsi, des territoires exempts de présence humaine ou très éloignées
de toute activité humaine sont néanmoins l'objet d'une artificialisation (écosystèmes
antarctiques contaminés par le mercure, les retombées de radioéléments consécutives aux
tirs d'armes nucléaires atmosphériques…).
Artificialisation directe - artificialisation indirecte
L'artificialisation directe des sols agricoles est plus ou moins intense selon l'intensité
des cultures et le type de pratiques culturales qui y ont été ou sont effectuées. Le travail
mécanique, l'irrigation, l'apport d'engrais et de matières fertilisantes, les traitements
chimiques (pesticides, chélateurs, rétenteurs d'eau…), l'introduction d'organismes
génétiquement modifiés (que ce soit par les techniques classiques de l'amélioration des
plantes, l'irradiation ou le génie biomoléculaire), la contamination par des déchets liés aux
pratiques agricoles (hydrocarbures, matières plastiques faiblement bio-dégradables,
épandages de boues urbaines ou industrielles) modifient profondément et durablement le
fonctionnement des sols et bouleversent souvent de manière drastique les communautés qui
y vivent.
Les sols subissent également une artificialisation indirecte en raison de contaminations
diffuses consécutives à divers processus tels qu'un assainissement non maîtrisé, des
pollutions atmosphériques à longue distance (métaux lourds, polluants organiques
persistants…), la remise en suspension et le transport à longue distance de produits
phytosanitaires dans certaines conditions météorologiques défavorables, la proximité
d'activités fortement polluantes (industries, agglomérations, infrastructures de transport).
Réversibilité - irréversibilité de l'artificialisation
Que l'artificialisation ait été volontaire ou qu'elle soit une conséquence indirecte et
involontaire des activités humaines n'a somme toute que fort peu d'importance en ce qui
concerne l'étude des processus à l'œuvre et la gestion environnementale ultérieure de ces
territoires. Un point crucial réside en revanche dans une bonne appréciation de la résilience
des systèmes perturbés, qui conditionne le caractère réversible ou non de l'artificialisation.
L’urbanisation ou l'aménagement de grandes infrastructures de transport ou industrielles
peuvent être considérés comme des processus d'artificialisation irréversible à l'échelle
humaine, car ils stérilisent les sols de façon irrémédiable. Une mise en valeur agricole
"douce", impliquant de faibles quantités d'intrants constitue à l'opposé une artificialisation
réversible des milieux qui pourront le cas échéant retrouver un caractère moins anthropisé.

L'agriculture occupe environ la moitié de la surface terrestre et utilise près des deux
tiers de la ressource en eau. Une attention particulière devrait permettre de reconstituer
l’histoire des masses d’eau. Il faudra estimer l’impact de la gestion de l’eau sur la
construction de l’espace, prévoir l’évolution des hydrosystèmes au cours du temps, évaluer
le degré du risque engendré par ces transformations.
Des modalités et des conséquences multiples
La diversité des processus impliqués par l’artificialisation des systèmes écologiques, la
multiplicité de leurs impacts avérés ou potentiels sur la santé humaine ainsi que sur les
systèmes écologiques, la complexité et l'interconnexion des problèmes ainsi posés, la
variété des dangers qu’ils représentent nécessitent la mise en place d'approches intégrées
prenant en compte :
(i) les différents niveaux d'organisation biologiques (cellule, individu, population,
communauté…) et/ou mésologiques (compartiments du milieu, typologie des contraintes…),
(ii) les différentes échelles spatiales (globale, régionale, locale et infra-locale) et
(iii) les échelles temporelles (des phénomènes usuellement considérés comme
"instantanés" à ceux se déroulant aux durées géologiques).
Cette diversité, cette multiplicité d’échelles et cette complexité imposent de recourir à
des approches interdisciplinaires, seules susceptibles de présenter une réelle valeur
heuristique.
A l'échelle globale, les différents biomes ne sont pas impactés avec la même intensité
et la distribution spatiale de l'artificialisation correspond pour partie à la plus ou moins grande
densité des populations humaines. Dans le même temps, certains processus sont
indépendants de la distribution spatiale des activités humaines et se manifestent à une
échelle globale, changement climatique, pollution atmosphérique, contaminations des
océans par le mercure…
L'artificialisation biologique : un nouveau défi
La maîtrise de l'énergie associée à la maîtrise des matériaux a provoqué au cours des
deux derniers siècles une artificialisation "physique" puis "chimique" des écosystèmes.
Depuis quelques décennies, le formidable essor des bio-technologies - médecine incluse -
confère à l'espèce humaine un pouvoir sans précédent sur les flux d'informations
biologiques. Les populations et les systèmes écologiques sont depuis lors soumis à une
artificialisation "biologique". La nouveauté réside surtout dans une augmentation
extraordinaire de l'efficacité des techniques disponibles qui tendent à autoriser une
description quasi exhaustive des flux d'informations biologiques au sein des systèmes
vivants, ce qui secondairement permet leur manipulation et leur contrôle. Les conséquences
potentielles de ces bouleversements sont sans précédent.
Des systèmes en équilibre dynamique instable
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%