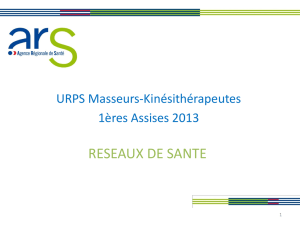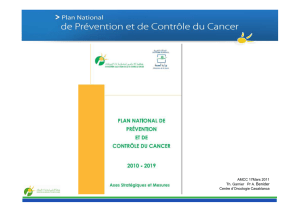Centre de formation à l`Ecoute, à l`Accompagnement et au Bien

- 2 -
NOS OBJECTIFS
L'ASBL SARAH propose des journées de formation et de perfectionnement à l’Ecoute, à
l’Accompagnement et au Bien-être à tous ceux qui sont convaincus de l'urgence d'humaniser
les relations entre malades, soignants et familles. D’autre part, au programme aussi de
nombreuses formations sur la Communication et le Bien-être personnel et professionnel,
visant la qualité des relations humaines, au sein d’une équipe de travail ou à titre privé.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Bernadette WOUTERS Infirmière, Enseignante
Vice Président : Gérard DRUGMAND Infirmier
Trésorière : Corinne DUVIVIER Expert Comptable
Administrateur : Berthe GENARD Infirmière
Administrateur : Muriel MAGHE Psychologue
L’EQUIPE SARAH
Bernadette WOUTERS Programme et contenu des formations
Elena CECCARINI Coordinatrice des formations chez SARAH et en Institutions
Catherine LEFEVRE Secrétaire - Inscriptions aux formations SARAH
Sylvie MARTIN Secrétaire - Facturation
CONTACTS
La permanence du secrétariat de l'ASBL SARAH est assurée toute l’année, y compris durant les
vacances et congés scolaires, suivant l’horaire ci-après :
lundi, mardi et jeudi : de 09h00 à 16h30 – mercredi et vendredi : de 09h00 à 12h00
En dehors de ces heures, vos appels sont enregistrés.
Nous y donnons suite, ainsi qu’à vos courriels, dans les plus brefs délais.
INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Via notre site internet : www.sarahformations.be
Vous y trouverez l’agenda chronologique de toutes nos formations et le feuillet
descriptif pour chacune d’elles (pour consultation et impression).
La réservation de votre participation est confirmée via mail par SARAH
et l’inscription est définitive après paiement de la facture
Veuillez svp indiquer en communication de votre paiement le n° de la facture.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont attribuées par ordre d'arrivée.
Un prix spécial est accordé aux étudiants, sur présentation de la carte d’étudiant.
LA BROCHURE SARAH
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre brochure, si vous préférez un envoi par mail ou si vos
coordonnées sont incorrectes, n’hésitez pas à nous le signaler au 071/37.49.32 ou par

- 3 -
IN MEMORIAM
Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs
Nous avons accompli tant de choses ensemble
Et voilà que maintenant tu nous quittes
Ton rire, ton sourire seront souvenirs
Pour toujours tu seras dans nos cœurs
Le souffle du vent t’a emportée dans les bras de la Lumière
Le ciel est à toi et tu parles désormais aux étoiles
Tu es partie vers l’univers mais tu seras toujours dans nos pensées
Notre affection, notre amitié, notre espérance ne s’éteindront pas
Il y a tant de moments encore que nous aurions voulu partager avec toi …
Mais voici que nous devons te dire AU REVOIR ….
Christiane Wéry
Infirmière ISPPC,
Chef de service Gériatrie
Membre fondateur et
Vice-présidente de l’ASBL SARAH pendant 20 ans
Active dans plusieurs associations professionnelles
L’ASBL SARAH présente
ses plus sincères condoléances
à toute sa famille, ses proches et ses amis

- 4 -
L’ACTU SARAH
Source : Google
L’ASBL SARAH et ses partenaires
L’ASBL SARAH est heureuse
de collaborer avec divers partenaires
tels que :
- l’APEF,
- FE.BI,
- Le Fonds social des Maisons de Repos et
des Maisons de Repos et de Soins privés,
- Les plateformes de Soins Palliatifs,
- De nombreux CPAS,
- Des Mutualités,
- Des hôpitaux,
- Des écoles,
- Des Institutions, Maisons de Repos,
Maisons de Repos et de Soins
- …
L’ASBL SARAH les remercie
pour leur contribution
et leur riche collaboration.
Nos meilleurs vœux pour l’an neuf
Toute l’équipe de l’ASBL SARAH
vous souhaite
une très heureuse année 2017.
Nous espérons qu’elle vous apportera
santé, bonheur,
les 1001 joies de la vie au quotidien
et la réalisation de vos vœux les plus chers.
MERCI AUX DONATEURS
Toute l’équipe de l’ASBL SARAH
remercie vivement et très
chaleureusement ses donateurs.
Leur soutien, tant moral que financier,
nous est très précieux.

- 5 -
Des nouvelles du Québec
Les centres de soins palliatifs : l'ultime accompagnement
Maryse Dubé
Le premier centre de soins palliatifs a
été inauguré à Londres en 1960;
Montréal suivra en 1974 à l’Hôpital
Royal Victoria. Depuis plus de trente
ans, on a vu les centres de soins
palliatifs se multiplier un peu partout au
Québec. Certains sont logés dans une
section spécifique d’un hôpital ou d’un
CHSLD(1), d’autres ont pignon sur rue et
ont généralement des ententes avec des
organismes de santé.
Ces centres ont pour mandat
d’accompagner les personnes qui vont
mourir en exerçant un contrôle sur la
douleur, de manière à ce qu’elles
puissent vivre leurs derniers jours en
compagnie de leurs proches, dans
un environnement apaisant et
respectueux des émotions qui
surgissent.
Le personnel infirmier et les bénévoles
sont en étroite collaboration avec la
famille afin de s’assurer qu’il y ait le
moins de souffrance possible. C’est un
accompa-gnement qui se fait en équipe,
afin que le passage de la vie à la mort ne
soit pas traumatisant. Quand
on constate que le malade bouge plus
qu’à l’ordinaire, que son comportement
est inhabituel, qu’il semble incon-
fortable ou impatient, on est en droit de
croire que les médicaments ne font plus
effet. Les doses sont alors ajustées en
conséquence.
C’est important non seulement pour la
personne en fin de vie, mais aussi pour
les proches qui souffrent devant la
douleur de celle-ci.
Il n’y pas d’heures de visites dans les
centres de soins palliatifs. Les chambres
sont aménagées pour accueillir un
conjoint, un parent, ou un ami jour et
nuit. Habituellement, un petit salon est
disponible pour les visiteurs, ainsi
qu’une cuisinette pour les repas. Les
gens peuvent même apporter et
réfrigérer les plats favoris de l’être cher,
dans le but de les lui servir au moment
opportun.
Afin de soutenir ces organisations, il
existe une association qui regroupe plus
de 1200 membres comprenant des
professionnels et des bénévoles(2).
C’est beaucoup de monde pour une
tâche qui semble a priori rébarbative.
Sachant que cela implique de côtoyer
la tristesse et parfois même la colère
que suscite une mort imminente, quel
profil doit-on avoir pour être bénévole
auprès des mourants? Faut-il s’être
endurci à la souffrance d’autrui? Avoir
un vécu de deuil significatif? Être soi-
même un « ressuscité » qui a vu la mort
de près? Monsieur Gilles Cardinal,
président du conseil d’administration de
la coopérative Maska à Saint-Hyacinthe,
est lui-même bénévole depuis huit ans
pour un centre de soins palliatifs Les
Amis du Crépuscule(3). Il a
généreusement accepté de nous
rencontrer pour répondre à quelques
questions.
De prime abord, Monsieur Cardinal est
un homme paisible et serein. En sa
présence, on se sent bien. Son calme est
contagieux et, à l’écouter parler, on
comprend rapidement qu’il a le cœur à
la bonne place. Déjà, c’est plus qu’il n’en
faut pour y voir un modèle type de ceux
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%