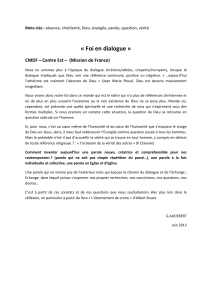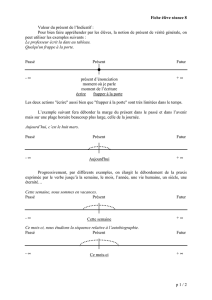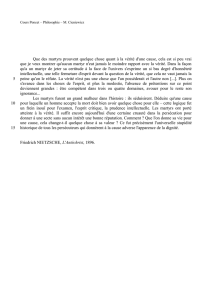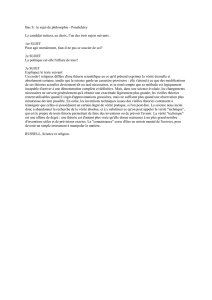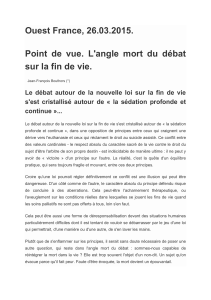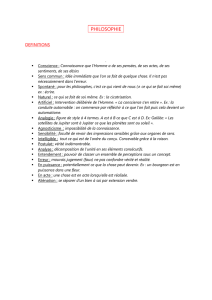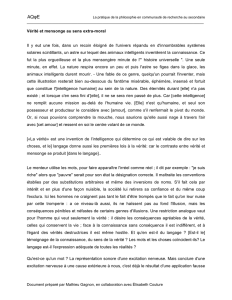Quelle vérité pour quelle prise en charge

Quelle vérité pour quelle prise en charge ?
Extrait du site de la Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon
http://www.croix-saint-simon.org
Quelle vérité pour quelle prise
en charge ?
- Formation et Recherche - Centre De Ressources National soins palliatifs François-Xavier
Bagnoud - Information et Documentation - Produits documentaires - Synthèses documentaires
-
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon
Tous droits réservés
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 1/7

Quelle vérité pour quelle prise en charge ?
"Personne ne peut regarder sa mort ni le soleil en face très longtemps"
La Rochefoucauld
"Vous connaà®trez la vérité et la vérité vous affranchira"
Jean 8 : 32
"Dire la vérité au malade". Qu'en est-il de cette affirmation qui se transforme d'emblée en questionnement du fait
même des notions qu'elle induit :
"dire" : l'annonce,
"la vérité", quelle vérité ? Celle qu'instaure la déontologie, les textes, celle qu'espère le patient alors qu'il s'agit ici
souvent de vérité-mauvaises nouvelles (d'ailleurs les anglo-saxons disent plutôt " annoncer de mauvaises
nouvelles").
Strobel (1) et Schaerer (2) rappellent que " le contenu de la vérité est riche de multiples informations qui constituent
chacune une partie d'un tout : la vérité quant au diagnostic en est l'un des éléments, celle qui concerne le pronostic
en est un autre, l'annonce de la mort à venir en est un troisième La vérité, c'est ce que va vivre la personne malade ,
comment se représente-t-elle sa maladie . ? Que vit-elle comme pertes ? Quelles sont les difficultés
rencontrées ?mais aussi parfois - pourquoi l'exclure ? les découvertes, la maturation. Il ne faut pas oublier que la
formulation d'une vérité n'est pas seulement un savoir sur une réalité mais elle contribue à créer cette réalité
aujourd'hui et demain ".Cadart (3) Il en découle aussi des positions, qui s peuvent sembler parfois, sinon en
contradiction, tout au moins obéissant néanmoins à des logiques différentes. Celle des textes déontologiques, le
positionnement éthique, celle des soignants, celle du patient et de ses proches peuvent s'harmoniser, se compléter
en vue d'établir un " climat de vérité, une ambiance de vérité " comme le préconise Mihoubi-Culand (4)
Cette synthèse abordera la littérature sur ce sujet de quatre points de vue :
• l'aspect déontologique
• les dimensions psychologiques concernant le patient et ses proches
• le rôle des soignants
• la dimension éthique
1. Du côté de la déontologie : que disent les textes ?
Dans le Code de déontologie médicale (5) ,
l'énoncé de la règle d'information au malade s'appuie sur l'article 35 aux termes duquel " le médecin doit à la
personne qu'il examine, qu'il soigne, qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les i
nvestigations et les soins qu'il lui propose. "
Le deuxième paragraphe de l'article temporise l'injonction en autorisant , " pour des raisons légitimes et dans son
intérêt ", à tenir un malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave notamment d'un pronostic fatal
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 2/7

Quelle vérité pour quelle prise en charge ?
Cet article 35 appuie une certaine transformation de la mentalité médicale qui évolue d'un paternalisme bienveillant
à une plus grande autonomie du patient qui devient ainsi interlocuteur et acteur de soin. Huerre '(6) rappelle la
tradition ancrée de protection du patient à qui l'on cache les mauvaises nouvelles depuis Hippocrate ("Primum non
nocere") jusqu'aux propos plus récent ;, du président de l'Ordre des médecins L. Portes en 1950, " Tout patient est et
doit être pour le médecin comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper - un enfant à consoler - non à
abuser - un enfant à sauver ou simplement guérir "
Si l'article 35 est un cadre qui contribue à faire avancer les pratiques, il reste pour les praticiens parfois trop vague,
trop large. Aussi l'ANAES (7) , Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a été saisie par son Comité
scientifique en vue d'élaborer des recommandations sur le thème de l'information qu'il convient aux médecins de
donner à leur patient. Outre l'élaboration de recommandations, le rapport rédigé par une juriste, le Professeur
Dominique Thouvenin précise certaines notions de l'article 35 :"une information loyale est une information honnête,
une information claire est une information intelligible, facile à comprendre " une information appropriée est une
information adaptée à la situation propre à la personne soignée."
Le rapporteur rappelle aussi les différents arrêts de jurisprudence rendus par les Cours de cassation et notamment
l'arrêt Hédreul qui fixent une " limitation thérapeutique de l'information " Cet arrêt est par ailleurs analysé par Sargos
(9) et Labrousse-Briou (8), en ces termes," la jurisprudence affine et perfectionne le cadre de l'obligation
d'information ". Sept décisions de la Cour de cassation sont citées en bibliographie dont deux décisions précisent
que le médecin n'est pas dispensé de son obligation d'information sur des risques graves de caractère exceptionnel
... ainsi" l'obligation d'informer sur les risques exceptionnels obligera le médecin à s'informer sur le dernier état des
connaissances scientifiques des risques. " Fabre-Magnan, elle aussi juriste (9, p.10) observe que les médecins
devraient se rassurer face à l'obligation d'informer considérant que c'est une façon d'alléger la responsabilité
juridique du médecin. Il n'est alors que responsable de ses propres fautes.
Les six recommandations émises par le groupe de travail de l'ANAES précisant l'article sont les suivantes (7, p.
54-57)
• Fixer un contenu à l'information à donner au patient
• Garantir aux patients des informations validées
• Réfléchir à la manière de préserver les risques et à leur prise en charge (risque qui fait partie intégrante des
soins
• Veiller à la compréhension de l'information par les patients
• Veiller à ce que les documents d'information aient une fonction strictement informative
• Veiller à ce que l'information soit intégré comme un élément du système de soins
2. Du côté du patient et de ses proches : aspects psychologiques
Dans le n° spécial de Laà«nnec (9, p.14), Anne Jourdan, ancienne malade témoigne. Quand on lui apprend qu'elle
présente une "gammapathie au niveau du manubrium sternal", elle s'indigne : "Fichtre ! Bien sûr, l'information était
donnée mais elle ne l'était pas vraiment puisqu'on craignait d'appeler les choses par leur nom." Par ailleurs, dans un
roman-témoignage, Claude Roy (10) interroge " On doit la vérité à autrui ? Dire la vérité est un devoir ? Il faut
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 3/7

Quelle vérité pour quelle prise en charge ?
d'abord être certain de la connaà®tre, cette vérité...Si la révélation à un malade de la gravité de son état aggrave
encore celui-ci ; impose au patient une souffrance morale qui l'affaiblit davantage, n'aide en rien à le soigner et à le
guérir, mais au contraire l'enfonce, il est évidemment criminel de lui asséner la vérité "
Dans une revue de la littérature, Girgis et Sanson-Fisher (11) rapportent les résultats d'études australiennes ; ils
montrent que les médecins sous-estiment la volonté des patients d'être informés. Pour la plupart, ils souhaitent l'être
et le plus tôt possible dans le déroulement de leur maladie. Le fait de ne pas être informé serait un facteur aggravant
de la maladie.
Ainsi la loi oblige l'information aux malades, ceux-ci souhaitent savoir, mais se posent quand même la question de
l'effet de l'annonce. Ainsi dans le contexte de la pathologie du sida, Thomé-Renault (12) souligne le "traumatisme de
la mort annoncée". Elle précise que l'annonce de la maladie grave (diagnostic) et/ou de la mort prochaine (pronostic)
renvoie à des "traumas anciens"
Ces réserves de dire la vérité " au regard de l'histoire du patient, sont soulignées par les psychologues ou
psychanalystes intervenant auprès de patients atteints de maladies graves ou en fin de vie Ruszniewski (13)
recommande une " vérité au pas à pas, respectueuse des mécanismes d'adaptation de chacun et d'un temps
d'intégration indispensable mais toujours modulable au regard de l'histoire et de la personnalité de tous les
protagonistes". La relation soignant-soigné autour de la vérité sera ainsi " susceptible d'engendrer un échange
authentique et équitable au plus proche de la réalité psychique du patient.
Ce qui peut entraà®ner que, dans certains cas, reprenant une formule de Prévert : "des simulacres [.... seront] plus
indispensables que le pain " Ruszniewski (13, p. 65) établit un distinguo entre la " vérité intégrée " et la " vérité
énoncée ".
La " vérité énoncée " étant de l'ordre du dire, du dire la vérité.
La " vérité intégrée " se situe au-delà du dire ou du non-dire
Plutôt qu'une vérité médicalisée, il s'agit là de respecter la demande du malade qui attend une " relation de vérité "
La mise en perspective de la notion d'accompagnement par La Genardière (14) temporise le débat opposant les
partisans de la vérité et ceux du mensonge. Dans cet accompagnement, les partenaires soignant et soigné sont en
mouvement, au rythme du mourant. Ils ont cette" mobilité psychique " qui suppose que " les dires se modulent aussi
bien par rapport au cheminement du patient que les uns par rapport aux autres. "
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 4/7

Quelle vérité pour quelle prise en charge ?
3. Le rôle du soignant
Pour communiquer les "mauvaises nouvelles ", le soignant se positionne plutôt face au désir d'information du patient
que du côté de son obligation d'informer. Ruszniewski (15) insiste sur le nécessaire" décodage " entre " le dit et le
non-dit " afin de " respecter les défenses de chacun" : ces mécanismes " qui, s'instaurent à notre insu...et qui ont
pour but de réduire les tensions et l'angoisse, et s'exacerbent dans des situations de crise et d'appréhension
extrêmes" dont bien sûr la maladie grave et l'approche de la mort.
Issu du champ théorique psychanalytique, Lhote (16) rappelle que la notion de "mécanisme de défense" devient "
essentielle pour la compréhension du psychisme (entre 1991 et 1995, plus de mille publications sont parues aux
Etats-Unis sur ce thème). Vaillant (17) précise :qu' "Il est temps que le moi et ses défenses soient vus comme des
facettes de la réalité psychobiologique et non pas comme des objets du culte psychanalytique."
Pour Lhote,(18), il s'agit de " prendre en compte ces constructions d'adaptation des malades graves " afin " de ne
pas les laisser dans une ignorance régressive " un parler vrai est nécessaire ; d'autant qu'en face ou à côté, les
soignants eux-mêmes ont la nécessité de construire leurs propres modes d'adaptation. " L'idéal serait un ajustement
des mécanismes de défense de chacun " qui permettrait une réelle relation de vérité "
Dans une conférence prononcée en 1991 dont l' objectif est de démontrer que la demande d'euthanasie provient
d'un défaut de communication Goldenberg (18) se positionne sur la "soi-disant vérité". "La communication des
informations en apparence les plus objectives, voire les plus scientifiques se heurte aux différents filtres que la
situation - la maladie, la présence menaçante de la mort, l'angoisse, etc. - interpose entre les protagonistes."
Le patient se trouve "aux prises avec le paradoxe suivant : il aimerait ne pas savoir ce qui lui arrive pour préserver
l'espoir d'un avenir possible et pour prolonger le passé, mais en même temps, il aspire à apprendre la vérité pour
échapper au doute angoissant et pouvoir organiser sa lutte contre la maladie."
Parmi les mauvaises nouvelles, Schaerer (19) considère que l'annonce de la mort à un patient est " une violence
insupportable " Face à cet insupportable, des soignants proposent des recommandations pour annoncer de
mauvaises nouvelles. C'est notamment la démarche de Buckman (21). Après avoir défini la " mauvaise nouvelle "
comme toute nouvelle qui modifie radicalement et négativement l'idée que se fait le patient de son avenir" il constate
que néanmoins 50 à 70 % des patients souhaitent savoir ce qui concerne leur maladie.
Il met en garde sur la " pharmacologie propre de la vérité qui à dose trop faible peut ne pas avoir d'effet et à doses
excessives, peut provoquer des symptômes inquiétants " aussi propose-t-il un protocole d'annonce en six étapes :
Copyright © Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon 5/7
 6
6
 7
7
1
/
7
100%