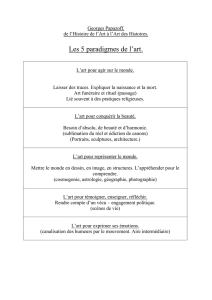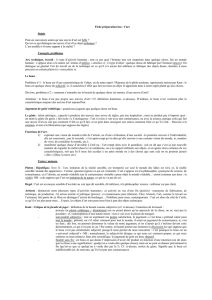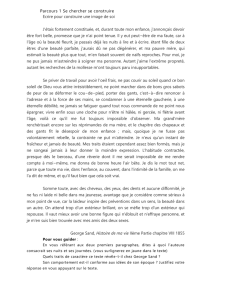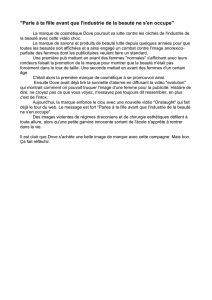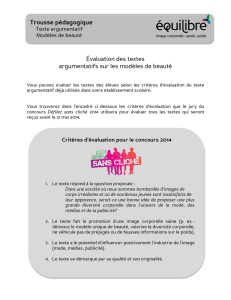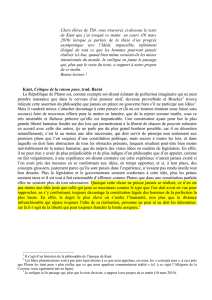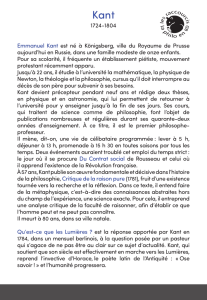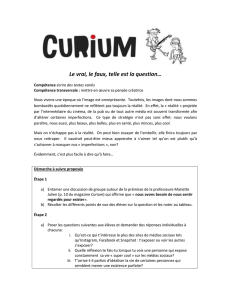Pascal DAVID La dimension synagogique du beau

21
Les Cahiers du CEIMA, 7
Pascal David
La dimension synagogique du beau
«Tout a peut-être commencé par la beauté»: tel est l’intitulé (donné
à titre posthume) de l’un des trois volumes des Écrits sur l’art de Jean-Marie
Pontévia, dont il est permis de regretter que la diusion demeure aujourd’hui
encore par trop condentielle1. Notre propos, purement introductif, n’aura
pour ambition que d’interroger cet hypothétique commencement, de clarier
certaines notions, d’ouvrir quelques pistes et de dégager certains enjeux.
C’est la question du Beau qui nous rassemble aujourd’hui, et qui nous
rassemble non seulement comme est susceptible de rassembler le thème d’un
séminaire interdisciplinaire, mais bien ce qui nous rassemble dans la mesure
où c’est la dimension même du beau qui consiste à rassembler. Le Beau nous
a toujours déjà rassemblés, avant même que nous ayons songé à nous assem-
bler pour en parler. «Dans nos ténèbres», a pu dire le poète René Char,
celles qu’éclaire un tableau de «Georges de La Tour qui maîtrisa les ténèbres
hitlériennes avec un dialogue d’êtres humains» – «il n’y a pas une place pour
la Beauté. Toute la place est pour la Beauté»2. D’où le terme «synagogique»
pour dire cette dimension comme telle, du grec synagogè emprunté à Platon:
rassemblement à la mesure d’une communauté, voire avant-goût ou préliba-
tion de l’éternité dans ce qu’un poète anglais, Keats, a pu appeler en un vers
célèbre a joy for ever. À la mesure d’une communauté, bien plutôt que d’une
société, au sens de la distinction établie par la sociologie allemande, à savoir:
ce qui réunit les hommes malgré tout ce qui les sépare, et non ce qui sépare
les hommes malgré tout ce qui les réunit.
Arrêtons-nous un instant, pour commencer, sur la diversité des sens,
la polysémie de ce que nous appelons «beau», vu que ce terme français a
recueilli et absorbé, mais aussi amalgamé une pluralité de signications. Le
latin dispose d’un riche vocabulaire pour dire le beau. Il y a bien sûr:
– bellus, d’où vient notre mot français « beau », diminutif familier de
bonus («bon»), qui n’est pas le sens le plus élevé. Il signie en latin
classique: «joli, gracieux» en parlant des femmes et des enfants; ironi-
quement, en parlant des hommes, «mignons».

22
Pascal David
Les Cahiers du CEIMA, 7
– pulcher, sans doute le terme le plus proche de ce que nous appelons
«beau» dans toute sa plénitude de sens. D’où pulchritudo, la beauté.
– formosus (d’où l’italien formoso, l’espagnol hermoso, le roumain frumos)
dit la beauté physique pour autant qu’elle est liée à une forme, ou plutôt
à ce que les Latins appellent forma, le contraire du diorme, indissocia-
blement forme et beauté. Forma n’est pas la forme, mais la belle forme,
ou encore la forme en tant que nécessairement belle. On songe au frag-
ment posthume de Nietzsche: «On est artiste à condition de ressentir
comme contenu, comme la chose même, ce que les non-artistes appellent
la forme»3. C’est là le trait apollinien de Nietzsche, complémentaire de
la dimension dionysiaque qu’il nira par juger, chez Wagner, envahis-
sante.
– decorus, enn: ce qui est convenable, décent. Sous cet aspect, le beau est
lié à ce que Diderot appellera «la perception des rapports».
Nous avons donc quatre directions distinctes signalées par les adjec-
tifs bellus, pulcher, formosus, decorus. Tout cela se rassemble plus ou
moins confusément dans ce qu’en français nous appelons «beau».
*
«Beauté, mon beau souci» (1920), dit un titre de Valery Larbaud en
écho à Malherbe. Ce «beau souci» s’appelle encore philosophie, foncièrement
synonyme, du moins dans le monde antique (de Platon à saint Augustin) de
philocalie, ou amour du beau. Dans l’un de ses premiers écrits, le Contra Aca-
demicos, saint Augustin dit en eet:
… philocalie et philosophie sont presque synonymes et elles tiennent à
passer pour être de la même famille, comme elles le sont en eet. Car
qu’est-ce que la philosophie? L’amour de la sagesse. Qu’est-ce que la phi-
localie? L’amour de la beauté (amor pulchritudinis). (Informe-toi auprès
des Grecs). Qu’est-ce donc que la sagesse? N’est-ce pas la vraie beauté?
Philosophie et philocalie sont donc sœurs, elles sont lles du même père.4
Était-ce là aller trop loin, porté par une fougue juvénile? Non, c’était ne
pas aller assez loin. Saint Augustin reviendra plus tard sur ce passage, dans le
cadre de ses Retractationes:
Philocalie et philosophie ne sont, dans les réalités incorporelles et
suprêmes, qu’une seule et même chose et ne peuvent aucunement être
sœurs.5

La dimension synagogique du beau
23
Les Cahiers du CEIMA, 7
Il reste toutefois à déterminer quel est ce beau qui à ce point interpelle,
ou encore de quelle façon demande à être entendue la beauté pour qu’elle soit
à même, selon le mot de Dostoïevski, de «sauver le monde».
An d’y voir plus clair et d’entrer plus avant dans cette dimension, sans
doute faut-il partir de là où nous (en) sommes, de la manière de se rapporter
au beau qui prévaut aujourd’hui. Du beau, on dit volontiers qu’il est relatif,
voire «très relatif», ce qui revient à clore la discussion avant même de l’avoir
ouverte et même à couper court à la discussion au lieu de consentir à l’enga-
ger – sauf si l’on entend simplement par là souligner, à juste titre, une cer-
taine historicité des critères et des canons de la beauté, ce qu’illustre fort bien
la gurine en ivoire de mammouth découverte en 1922 en Haute-Garonne
et répertoriée sous le nom de «Vénus de Lespugue». Face à cette célèbre
représentation féminine préhistorique, qui daterait d’environ 25000 ans av.
J.-C., on peut en eet se demander si tout n’aurait pas, en eet, «commencé
par la beauté», comme on peut être ému par ce vestige d’une époque si loin-
taine qui à sa façon atteste que, dès qu’il y a de l’humain, il y a du beau. Que
l’humain se rapporte au beau de façon immémoriale. Il n’en reste pas moins
que si nous ne pouvons qu’être en admiration devant cette gure aux formes
opulentes, aux seins et aux fesses très volumineux, pratiquement sphériques,
qui, à bien y regarder, s’inscrit en deux losanges, celui du contour général
externe et celui du volume central qui regroupe les seins et le ventre, elle ne
correspond guère aux actuels canons de la beauté féminine – à supposer que
le sculpteur de l’époque ait voulu la faire correspondre aux canons alors en
vigueur de la beauté féminine, à supposer encore l’existence en tout temps
et en tout lieu de «canons de la beauté féminine» – deux suppositions aussi
naïves peut-être l’une que l’autre – et à supposer enn que la gurine nous
montre une mortelle plutôt que, par exemple, une déesse de la fécondité8.
Que le beau soit relatif, c’est donc là sans doute une conviction
aujourd’hui assez répandue, une «conviction» en eet, au sens du commen-
taire que Paul Valéry a donné de ce mot: «Mot qui permet de mettre, avec
une bonne conscience, le ton de la force au service de l’incertitude9». Dire
le beau relatif revient d’une façon à peine déguisée à le dire au fond inexis-
tant, à le faire basculer dans le non-être. Or le beau, tout simplement, est. Il
est, quand bien même il demeurerait empiriquement inassignable de manière
parfaitement consensuelle. Le beau est, avant même d’être dit relatif ou non
– il est, il déploie son être à la mesure d’un certain rayonnement, d’un cer-
tain resplendissement, en brillant de tout son éclat. C’est le sens en anglais
de l’adjectif sheen, «luisant, brillant», auquel correspond l’allemand schön,
«beau». Cet être du beau est même ce qui a tenu en haleine la pensée et
l’art grecs antiques, le monde grec antique pour autant qu’il a entendu fon-
der un «empire du beau». Aucune esthétique – puisque telle est aujourd’hui

24
Pascal David
Les Cahiers du CEIMA, 7
l’appellation contrôlée de la réexion sur le beau – ne saurait faire l’écono-
mie d’un salutaire détour par la Grèce antique, nous ramenant à ce que Jan
Patočka a appelé «la genèse de la réexion européenne sur le beau dans la
Grèce antique». Ce titre est aussi une thèse: la réexion européenne sur le
beau trouve sa genèse dans la Grèce antique. Car c’est sous l’angle de la beauté
que les Grecs éprouvèrent le monde – le kosmos dont le nom indique aussi
la beauté ou la parure, le «cosmique» mais aussi le «cosmétique», qui ne
relevait pas encore alors d’une industrie. Lorsque ucydide, dans l’éloge
funèbre prononcé par Périclès dans La Guerre du Péloponnèse (II, 40), cherche
à dire qui sont les Grecs, ce que c’est qu’«helléniser», il dit: philokaloumen,
«nous aimons le beau». «Le stade de la conscience grecque est le stade de la
beauté», dira Hegel.
Le beau n’est pas toutefois pour Platon ou, plus largement, entendu au
sens grec, ce qui (me) plaît mais ce qui est véritablement en son pur resplen-
dissement, c’est le vrai dans toute sa splendeur et ce que Platon appelle son
«éroticité», son irrésistible pouvoir d’attirance11. Le beau est plénitude onto-
logique, le laid, décience ontologique. Être beau, c’est être, et être, c’est être
beau12. En tant qu’il est convertible avec l’être, le beau (pulchrum) est ce que
l’on appellera ultérieurement un transcendantal. Le beau est donc en quelque
sorte l’étant au comble de son apparition et dans la nudité éblouissante de
son éclat, non pas en tant qu’il «se trouve là», mais dans le déploiement
même de sa présence au sens où l’on dit d’une actrice qu’elle a une «pré-
sence». Le beau est tout simplement l’éclat de la présence, son aura. Cette
étrange lumière comme venue d’ailleurs qui irradie de tout ce qui est beau,
Platon l’appelle l’Idée, cette Idée dans la lumière de laquelle seulement chaque
eur est une eur, même si l’idée de eur est «l’absente de tout bouquet»
(Mallarmé). Et comme en écho Valéry: «L’idée fait entrer dans ce qui est le
levain de ce qui n’est pas…»13. Le Beau ainsi entendu à partir de l’Idée du
beau brille en tout ce qui est beau, en tout ce qui nous ore le spectacle de
sa beauté en venant captiver notre attention, mais s’il y brille, c’est par son
absence. Aussi la confusion est-elle souvent entretenue entre ce qui est beau et
ce qu’est le beau. Le beau, tel que Kant le dénira bien plus tard selon l’un de
ses quatre moments constitutifs, en l’occurrence la quantité, est «ce qui plaît
universellement sans concept»: le beau ne serait pas moins tel, du moins aux
yeux de Kant, quand bien même rien ne se rencontrerait au monde dont on
pût dire que cela plaît universellement sans concept. À la question posée par
Socrate de savoir ce qu’est le beau, Hippias répond en énumérant ce qui est
beau: une belle marmite, une belle jument, une belle jeune lle15. Ce qui est
répondre à côté, la question socratique (ou platonicienne) visant plutôt ce
par quoi ou en vertu de quoi les choses belles sont belles, ce dont elles «par-
ticipent» et qui s’appelle précisément: le Beau (to kalon – sous-titre de deux

La dimension synagogique du beau
25
Les Cahiers du CEIMA, 7
dialogues de Platon, Hippias majeur et Phèdre). C’est par le Beau (cela se dit
en grec au datif) que les belles choses sont belles. L’élan qui nous porte vers le
Beau en répondant à son pouvoir d’interpellation a en ce sens toujours déjà
passé outre les belles choses en remontant à leur provenance, au-delà d’elles, il
est déjà métaphysique.
*
C’est sans doute au e siècle français que reviendra le douteux privi-
lège d’avoir fait descendre le beau de telles hauteurs métaphysiques, de l’en
avoir fait dégringoler avec pour seule arme la dérision. C’est la faute à Vol-
taire, à l’article «Beau, beauté» de son Dictionnaire philosophique (d’abord
édité à Genève en 1764 sous le titre de Dictionnaire philosophique portatif),
qui débute ainsi:
Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le to
kalon. Il vous répondra que c’est sa femelle avec deux gros yeux ronds
sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos
brun.
On pourrait certes ne voir là que la reprise d’un topos, d’un «lieu com-
mun» philosophico-littéraire qui pourrait se recommander de Xénocrate ou
d’Épicharme, ou encore de La Fontaine faisant dire à l’Ours, dans sa fable Les
compagnons d’Ulysse: «Je me rapporte à une Ourse mes amours» (construc-
tion qu’il faut sans doute comprendre comme un double accusatif latinisant)
– comme le crapaud de Voltaire se rapporte les siennes à sa crapaude. C’est
là le beau au sens que nous avons déjà rencontré du convenable, du décent,
du proportionné, ce que le grec appelle prepon et le latin decorus. Mais il est
permis de se demander en outre si l’usage que fait Voltaire de ce lieu com-
mun ne vise pas à enfoncer le beau, à en récuser la dimension spéciquement
humaine. Lorsque se trouve niée d’emblée la dimension spéciquement
humaine du beau, c’est le ciment de la communauté humaine qui se ssure
et se disloque, en sorte que le racisme n’est jamais loin. Nier la dimension
spéciquement humaine du beau, c’est d’une part animaliser l’homme en
rabattant le beau sur l’agréable, et c’est d’autre part accentuer ce qui sépare
les hommes (peuples, races, époques, etc.) au détriment de ce qui les réunit
en une commune humanité. Voltaire passe ainsi directement du crapaud au
nègre de Guinée:
Interrogez un nègre de Guinée; le beau est pour lui une peau noire, hui-
leuse, des yeux enfoncés, un nez épaté.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%