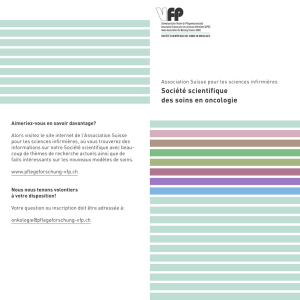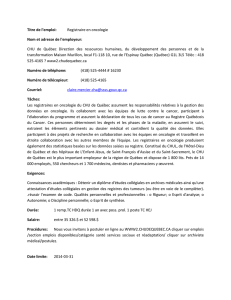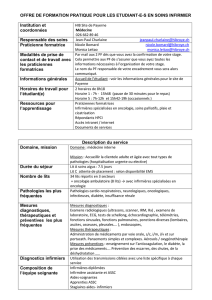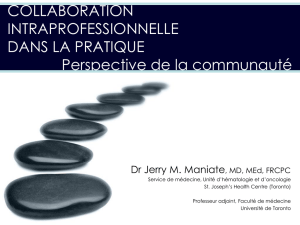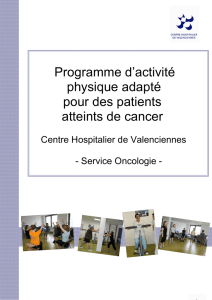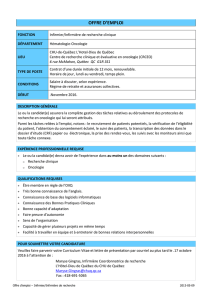Principaux domaines d`exercice et compétences associées des

CONJ • RCSIO Winter/Hiver 2013 53
par Sandra Cook, Lise Fillion, Margaret Fitch, Anne-Marie
Veillette, Tanya Matheson, Michèle Aubin, Marie de Serres,
Richard Doll et François Rainville
Abrégé
Fillion et ses collaborateurs (2012) ont récemment conçu un cadre
conceptuel pour les navigateurs professionnels en oncologie décri-
vant les principales fonctions de la navigation professionnelle en
oncologie.
Objectif : Cette étude se fonde sur ce cadre pour définir les princi-
paux domaines d’exercice et les compétences associées des naviga-
teurs professionnels en oncologie.
Méthodes : L’étude a fait appel aux méthodes suivantes : revue de la
littérature, schématisation des fonctions liées à la navigation au vu
des normes et compétences de pratique, et validation de ce processus
de schématisation auprès de navigateurs professionnels, de leurs ges-
tionnaires et de spécialistes des soins infirmiers et comparaison des
rôles dans des programmes de navigation similaires.
Constats : Les compétences associées ont été reliées aux trois princi-
paux domaines d’exercice dégagés à savoir : 1) fournir de l’informa-
tion et de l’éducation; 2) dispenser des soins de soutien et un appui
émotionnel; 3) faciliter la coordination et la continuité des soins.
Conclusion : Les navigateurs en oncologie occupent une position pri-
vilégiée pour améliorer l’empowerment du patient et de sa famille
ainsi que la continuité des soins.
Implications : Il s’agit d’un pas important dans l’avancement du
rôle des infirmières en oncologie occupant des postes de naviga-
teurs et dans le dégagement de domaines exigeant de nouvelles
recherches.
Mots clés: navigation des patients; navigateurs professionnels;
intervenant-pivot en oncologie; infirmière pivot en oncologie;
normes de compétence; empowerment; continuité des soins; coor-
dination des soins; soins de soutien, soins en collaboration, infir-
mière spécialisée, domaines de la pratique, principaux domaines
d’exercice
Le rôle d’intervenant-pivot s’est largement répandu en tant que
moyen d’amélioration de la coordination et de la continuité des
soins et de rehaussement de l’empowerment du patient et de sa
famille (Cancer Care Nova Scotia, 2004; Fillion et al., 2006, 2009;
Doll et al., 2005; Melinyshyn & Wintonic, 2006). Toutefois, le rôle
d’intervenant-pivot manque de clarté et son implantation variait
grandement en fonction du milieu de soins et des ressources dis-
ponibles. Fillion et ses collaborateurs (2012) ont conçu un cadre
conceptuel pour la navigation professionnelle en oncologie et ont
décrit les fonctions et processus clés qui permettent d’améliorer la
continuité des soins ainsi que l’empowerment du patient et de sa
famille. Afin d’approfondir les travaux liés à ce cadre, ils ont étu-
dié deux modèles bien établis de navigation professionnelle diri-
gée par les infirmières, au Québec et en Nouvelle-Écosse, en vue de
cerner les principaux domaines d’exercice et les compétences asso-
ciées permettant d’assurer la continuité des soins et l’empowerment
du patient. Dans ces deux programmes, la navigation en oncologie
est fournie par des infirmières spécialisées en oncologie qui font le
dépistage, l’évaluation des patients, effectuent les interventions et
Principaux domaines d’exercice et compétences
associées des infirmières œuvrant à titre de
navigateurs professionnels en oncologie
Au sujet des auteurs
Sandra Cook, inf., B.A., H.S.M., Gestionnaire, Patient
Navigation and Surgical Oncology Network, Cancer
Care Nova Scotia
Lise Fillion, inf., Ph.D. (Psychologie), Professeure,
Faculté des sciences infirmières, Université Laval,
Centre de recherche en cancérologie de l’Université
Laval, Hôtel-Dieu de Québec
Margaret Fitch, inf., Ph.D., Chef, Soins infirmiers
en oncologie, Directrice, Programme de soutien au
patient et à la famille, Centre de cancérologie Odette,
Centre des sciences de la santé Sunnybrook
Anne-Marie Veillette, M.A., Coordonnatrice de la
recherche, Centre de recherche en cancérologie de
l’Université Laval, Hôtel-Dieu de Québec
Tanya Matheson, B.Sc., Associée de recherche, Cancer
Care Nova Scotia
Michèle Aubin, M.D., Ph.D., FCFP, CCMF, Directrice,
Soins palliatifs, Université Laval, Faculté de médecine,
Université Laval, Unité de médecine familiale - Laval,
CSSS Vieille-Capitale
Marie de Serres, inf., M.Sc., Infirmière clinicienne
spécialisée, CSIO(C), CHUQ, Hôtel-Dieu de Québec
Richard Doll, M.S.S., M.Sc., Directeur, Centre de
recherche socio-comportementale, et Responsable
provincial, Réadaptation oncologique, BC Cancer
Agency
François Rainville, M.S.S., CHUQ, Centre de recherche
en cancérologie de l’Université Laval, Hôtel-Dieu de
Québec
Toute correspondance se rapportant à cet article doit être
adressée à Sandra Cook, inf., B.A., H.S.M., Gestionnaire, Patient
Navigation and Surgical Oncology Network, Cancer Care Nova
Scotia, téléphone: 902 473 3675, [email protected]
Cette recherche a été financée par les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) et le Partenariat canadien contre
le cancer, Groupe d’action pour l’expérience globale du cancer
(CPACC-CJAG, selon l’acronyme anglais).
doi:10.5737/1181912x2315362

54 CONJ • RCSIO Winter/Hiver 2013
évaluent les besoins cliniques et les besoins en soins de soutien tout
au long de l’expérience du cancer et ce, en collaboration avec une
équipe interdisciplinaire.
Aux fins de la présente étude, la navigation peut être définie
comme étant un processus proactif et intentionnel de collaboration
entre une personne et sa famille et l’équipe de soins interdiscipli-
naire visant à leur fournir des interventions cliniques, de l’éduca-
tion, du soutien affectif et du soutien logistique afin de les aider à
négocier des traitements et des services et à surmonter les obstacles
éventuels tout au long de l’expérience globale du cancer (Partenariat
canadien contre le cancer, 2010).
Contexte
Le concept d’intervenant-pivot en oncologie est né de la déter-
mination des défis auxquels les patients et leurs proches faisaient
face dans un système fort complexe. La plupart des soins et des
traitements contre le cancer sont dispensés dans des milieux ambu-
latoires exigeant des patients et de leurs proches qu’ils fassent les
adaptations quotidiennes nécessaires pour composer avec le cancer
dans leurs propres foyers et communautés. Beaucoup ont du mal à
trouver leur chemin au sein du système et à obtenir le soutien dont
ils ont besoin pour surmonter les défis physiques, sociaux, affectifs,
psychologiques, informationnels, spirituels et pratiques associés à
un diagnostic de cancer (Fitch, 2008). Le système de lutte contre le
cancer lui-même est également complexe et il n’est pas rare que les
patients doivent consulter un grand nombre de professionnels de la
santé œuvrant dans de multiples services et secteurs des soins de
santé. De plus, les traitements du cancer contemporains combinant
plusieurs modalités requièrent une multiplicité de traitements éche-
lonnés sur une période de temps prolongée. Du fait de ces expé-
riences, les patients atteints de cancer courent un plus haut risque
de morbidité psychosociale et de fragmentation des soins (Bultz &
Carlson, 2005).
La complexité des besoins des patients atteints de cancer exige
de la part du système de soins de santé des réponses qui soient
judicieusement planifiées et coordonnées afin que le système
de lutte contre le cancer ne vienne pas amplifier le fardeau et la
détresse déjà éprouvés par les personnes faisant face au cancer.
Dans ce contexte, la facilitation de la coordination et de la conti-
nuité des soins et la fourniture de soutien affectif et d’éducation
deviennent des composantes importantes des soins centrés sur la
personne. Un des objectifs du Partenariat canadien contre le can-
cer (PCCC) est de faire en sorte que le système de lutte contre le
cancer prenne le virage des soins centrés sur la personne en met-
tant en œuvre un processus coordonné qui répond à la gamme com-
plète des besoins de l’ensemble des Canadiens touchés et de leurs
proches et ce, dans toutes les étapes de leur expérience globale du
cancer. Le Groupe d’action pour l’expérience globale du cancer (du
PCCC) a fait la promotion d’initiatives de navigation en oncologie à
titre d’approche novatrice visant à améliorer la continuité des soins
et à fournir aux personnes touchées le soutien dont elles ont besoin
tout au long de leur expérience globale du cancer (Partenariat cana-
dien contre le cancer, 2010).
Les débuts
Durant les premières années du nouveau siècle, l’implantation de
modèles de gestion de cas clinique et de navigation professionnelle
menés par des infirmières en oncologie a été proposée sur la scène
nationale (Farber, Deschamps & Cameron, 2002) et internationale
(Freeman, 2006; Corner, 2003) à titre de norme de soins et de solu-
tion éventuelle à l’amélioration de l’accès aux soins de soutien. Un
des premiers modèles canadiens de navigation professionnelle en
oncologie a été implanté en Nouvelle-Écosse en 2001 en tant qu’ap-
proche de gestion des soins centrée sur les clients et axée sur les
résultats pour ces derniers afin d’aider les patients, leurs proches,
les professionnels de la santé et les chefs de file des soins de santé
à composer plus efficacement avec le cancer et le système de lutte
contre le cancer. Les principaux constats de l’évaluation de ce pro-
gramme ont confirmé que la navigation en oncologie était perçue
comme une source de soutien importante pour les patients et leurs
proches confrontés par le bouleversement affectif, les besoins d’in-
formation et les défis logistiques liés à un diagnostic de cancer. Un
constat clé de l’évaluation était que la navigation professionnelle
en oncologie avait rehaussé la qualité et l’uniformité des soins aux
personnes atteintes de cancer et avait favorisé la collaboration et la
communication entre les divers professionnels de la santé, ce qui
avait réduit le chevauchement des services et avait amélioré l’effica-
cité des soins (Cancer Care Nova Scotia, 2004).
Dans un même temps, la stratégie de lutte contre le cancer du
gouvernement du Québec donnait son appui aux infirmières pivots
en oncologie (IPO) en tant qu’infirmières-ressources qui accom-
pagnent les patients et leurs proches dès le diagnostic. Les IPO ont
quatre fonctions principales : évaluer et gérer les besoins, ensei-
gner et fournir de l’information, fournir du soutien psychosocial et
enfin, coordonner les soins en en assurant la continuité (De Serres
& Beauchesne, 2000). Des études réalisées par Fillion et ses colla-
borateurs (2006, 2009) et Plante (2004) ont conclu que le rôle et les
fonctions de l’IPO facilitaient efficacement l’adaptation des patients
au cancer.
Au Canada et aux États-Unis, des études antérieures ont montré
que les patients qui ont accès à un soutien en matière de navigation
sont plus susceptibles de : (1) comprendre leur plan de traitement;
(2) accéder aux services dont ils ont besoin; (3) s’adapter à leur
maladie; (4) être mieux préparés en vue des consultations et trai-
tements (Cancer Care Nova Scotia, 2004; Fillion et al., 2006, 2009;
Freeman, 2006).
Navigateurs professionnels en oncologie
Au Canada, la navigation professionnelle est effectuée par des
prestataires de soins salariés, habituellement des infirmières ou des
travailleurs sociaux, œuvrant dans un éventail de milieux (Pedersen
& Hack, 2010). Les navigateurs professionnels œuvrent auprès des
patients et de leurs proches à de nombreux points de la trajectoire du
cancer et leur procurent un unique point de contact en faisant le lien
entre les patients et leurs proches, d’une part, et l’équipe interdisci-
plinaire, le centre de cancérologie et les organismes communautaires,
d’autre part. Les programmes de navigation de Nouvelle-Écosse et du
Québec font appel à des infirmières spécialisées en oncologie, c’est-
à-dire à des infirmières autorisées possédant des connaissances et
des aptitudes avancées en oncologie. Les infirmières spécialisées en
oncologie suivent un programme de formation officiel et détiennent
des qualifications en soins infirmiers en oncologie reconnues à
l’échelle nationale (Association canadienne des infirmières en onco-
logie, 2006). Les deux provinces fournissent aux navigateurs orienta-
tion, formation continue et soutien.
En Australie, les coordonnateurs de soins liés au cancer rem-
plissent un rôle fort similaire, puisqu’ils travaillent avec les patients
et leur famille pour évaluer l’éventail de leurs besoins, élaborent le
plan de soin et en assurent le suivi, coordonnent les soins et les ser-
vices et fournissent du soutien psychosocial tout au long de la tra-
jectoire du cancer. Ce rôle est également rempli par des infirmières
ayant obtenu un diplôme d’études supérieures et possédant au
moins cinq ans d’expérience en oncologie (Cancer Nurse Society of
Australia, 2008). Tout comme les modèles canadiens de navigation
professionnelle, le rôle met l’accent sur l’éducation des patients, sur
l’évaluation, sur le soutien psychosocial et sur la coordination des
soins en collaboration avec une équipe interdisciplinaire.
Jusqu’à présent, personne n’a décrit les principaux domaines
d’exercice des navigateurs professionnels du Canada. La détermina-
tion des normes en matière d’aptitudes et du soutien pédagogique
exigé pour développer et maintenir les aptitudes à exercer dans ce
domaine constituent des étapes importantes du développement du
doi:10.5737/1181912x2315362

CONJ • RCSIO Winter/Hiver 2013 55
rôle afin qu’il atteigne son plein potentiel et qu’il optimise les résul-
tats pour les patients. Comme Corner (2003) l’a fait remarquer, ce
n’est pas la désignation des infirmières en oncologie qui fait la dif-
férence mais les interventions et les aptitudes qu’elles ont acquises,
lesquelles se traduisent par de meilleurs résultats pour les patients.
Le cadre conceptuel pour la navigation en oncologie
Un cadre conceptuel bidimensionnel élaboré pour la navigation
en oncologie par Fillion et ses collaborateurs (2012) indique que
le rôle du navigateur professionnel facilite la continuité des soins
et promeut l’empowerment du patient et de sa famille. La pre-
mière dimension, faciliter la continuité des soins, comprend trois
concepts concernant le système de soins de santé : l’information,
la gestion et la continuité relationnelle. Il y a continuité des soins
lorsque l’expérience de soins paraît cohérente et interconnectée aux
yeux du patient, de sa famille et des prestataires de soins. La deu-
xième dimension, l’empowerment du patient et de sa famille inclut
également trois concepts clés : le coping actif, l’auto-prise en charge
et les soins de soutien. Cette dimension décrit les interventions qui
placent le patient et sa famille au centre des soins. Le cadre dégage
également un ensemble de fonctions cliniques au sein de chacun
des six concepts. Ces descriptions ont permis aux auteurs de sché-
matiser les fonctions en regard de divers documents sur les aptitu-
des des infirmières spécialisées en oncologie.
Cette étude avait pour but de cerner les principaux domaines
d’exercice et les aptitudes associées des navigateurs profession-
nels en oncologie qui font partie intégrante de l’optimisation de
l’empowerment du patient et de sa famille et de la facilitation de la
continuité des soins. Ces domaines d’exercice fondamentaux et ces
normes de compétences s’adressent aux navigateurs en oncologie
œuvrant dans un modèle de soins reflétant un soutien continu aux
patients et à leurs proches et ce, dans l’ensemble de la trajectoire
du cancer.
Méthodologie
L’étude a fait appel aux méthodes suivantes : revue de la littéra-
ture, schématisation des concepts et fonctions liés à la navigation
au regard des normes et compétences de pratique, et comparaison
des rôles dans deux programmes de navigation australiens bien
documentés et enfin, processus de validation.
Le devis de l’étude prévoyait les cinq étapes suivantes :
1. Déterminer un vaste ensemble de domaines et de compétences
de pratique qui reflètent la capacité du navigateur en oncologie à
rehausser la continuité des soins et l’empowerment du patient et
de sa famille
2. Schématiser les concepts et les fonctions décrites par Fillion et
ses collaborateurs (2012) dans leur cadre de navigation en onco-
logie en regard d’un document sur les normes de pratique et les
compétences concernant les infirmières spécialisées en oncolo-
gie du Canada
3. Valider les résultats auprès de navigateurs professionnels du
Canada, leurs gestionnaires et des spécialistes des soins infir-
miers et de l’oncologie psychosociale
4. Transformer les normes de pratique et compétences en
domaines d’exercice principaux
5. Comparer les résultats à deux modèles australiens bien établis.
On a d’abord effectué une revue de la littérature afin de déga-
ger les domaines de pratique et les normes de compétence relatifs
aux navigateurs professionnels. Des recherches ont été effectuées
dans les bases de données PubMed, CINAHL, EMBASE et PsycINFO
afin d’y repérer des études pertinentes publiées en anglais jusqu’au
31 décembre 2009. On y a inclus les rôles ayant un champ d’exer-
cice comparable (p. ex. intervenants-pivots en oncologie, coordon-
nateurs de cas, navigatrices/éducatrices spécialisées en cancer
du sein). Des recherches ont ensuite été faites dans les listes de
référence d’articles pertinents ainsi qu’une recension de la biblio-
thèque des auteurs à la recherche d’articles sur les programmes de
navigation et des recherches sur Internet en vue de repérer les orga-
nisations professionnelles liées à l’oncologie. Ce processus a per-
mis de trouver quatre documents clés décrivant les compétences
reliées aux rôles sanitaires professionnels s’appliquant aux fonc-
tions de navigation décrites dans le cadre de navigation de Fillion
et de ses collaborateurs (2012) (National Breast Cancer Centre,
2005; Association canadienne des infirmières en oncologie, 2006;
Oncology Nursing Society, 2007; Affara, 2009).
Les compétences décrites dans ces documents ont ensuite été
schématisées en fonction des six concepts avancées par Fillion et
ses collaborateurs (2012) dans le cadre sur les intervenants-pivots
professionnels. Le processus de schématisation a permis de cerner
des compétences congruentes ainsi que des lacunes où certaines
compétences sont particulières aux seuls navigateurs profession-
nels en oncologie.
Étant donné que le cadre de navigation professionnelle a été éla-
boré dans un contexte canadien concernant les intervenants pivots
en cancérologie (IPC) de Nouvelle-Écosse et les infirmières pivots
en oncologie (IPO) du Québec, ces deux programmes utilisant un
modèle qui fait appel à des infirmières de formation supérieure et
recevant une composante majeure de leur formation initiale par
le biais de l’Association canadienne des infirmières en oncologie
(ACIO), un second processus de schématisation détaillé a été réa-
lisé au moyen des Normes de pratique et compétences pour l’infir-
mière spécialisée en oncologie de l’ACIO (Association canadienne
des infirmières en oncologie, 2006). Ces travaux ont été menés par
une équipe de 2 expertes du Québec et de 2 expertes de la Nouvelle-
Écosse. Par conséquent, les domaines de pratique et les compé-
tences clés ont été dégagés et décrits pour chacun des six concepts
et fonctions au sein du cadre de navigation professionnelle.
Troisièmement, les domaines de pratique et les normes de com-
pétence dégagés grâce au processus de schématisation ont été
présentés à des fins de discussion et d’examen dans le cadre d’un
atelier d’une journée. Les participants comprenaient des naviga-
teurs professionnels (n = 14) provenant de trois provinces de l’Est
canadien et d’experts (n = 3) œuvrant au sein de programmes de
navigation du Canada (un expert appartenait au PCCC, un gestion-
naire représentait Cancer Care Nova Scotia et la dernière était une
infirmière clinicienne spécialisée). Ceci a produit un vaste ensemble
de grands domaines de pratique articulés pour les navigateurs pro-
fessionnels en oncologie qui a servi à orienter le développement des
principaux domaines d’exercice à travers les étapes suivantes.
Quatrièmement, les divers domaines de pratique et compétences
de l’ACIO ont été examinés et regroupés en 3 domaines d’exercice
principaux, au cours du même atelier d’une journée. La définition
ainsi peaufinée des principaux domaines d’exercice a alors été mise
en relation avec les normes de pratique et compétences de l’ACIO
mentionnées ci-dessus. Afin de valider davantage le processus, l’ex-
perte (l’infirmière clinicienne spécialisée) connaissant bien le rôle de
navigation et les compétences de l’ACIO a passé en revue le cadre
de navigation en oncologie et a indiqué les fonctions abordées par
les normes et les compétences de l’ACIO (Association canadienne
des infirmières en oncologie, 2006).
Lors de la cinquième et dernière étape, qui visait à valider plus
avant les principaux domaines d’exercice et les compétences asso-
ciées des navigateurs, on a comparé deux programmes similaires
d’Australie qui incorporaient des fonctions de navigation. Les com-
pétences des specialist breast nurses (National Breast Cancer Centre,
2005) [que l’on appellera ci-après « infirmières spécialisées en can-
cer du sein »] ainsi que le rôle et le champ de pratique des cancer
care coordinators (Cancer Nurses Society of Australia, 2008) [que
l’on appellera ci-après « coordonnateurs de soins liés au cancer »]
ont été comparés et mis en relation avec le modèle de navigation
professionnelle du Canada.
doi:10.5737/1181912x2315362

56 CONJ • RCSIO Winter/Hiver 2013
Tableau 1 : Cadre de la navigation en oncologie, domaines de pratique et compétences associées de l’ACIO/CANO
Dimension 1 : Facilitation de la continuité des soins
(Les soins sont perçus par le patient comme étant cohérents et interconnectés)
CONCEPTS FONCTIONS CLÉS Domaines de pratique de
l’ACIO*
Compétences associées
Continuité
informationnelle
Utilisation de
l’information axée
sur la maladie ou
sur la personne
an de rendre les
soins actuels plus
pertinents pour
chaque individu.
L’information
permet d’établir
des liens entre les
soins prodigués
par différents
fournisseurs et
entre différents
évènements de
santé (Haggerty et
al., 2003).
• Avoir accès à de l’information de haut niveau sur les
patients atteints de cancer et sur leurs soins, et bien
la comprendre
• Fournir en temps opportun des informations et
conseils personnalisés à l’équipe interdisciplinaire et
aux patients atteints de cancer (information axée sur
le patient)
• Collaborer étroitement avec l’équipe interdisciplinaire
an d’améliorer la continuité de l’information et de la
connaissance qu’elle a des besoins des proches et
des patients et des changements qu’ils vivent
• Utiliser des outils et stratégies de communication an
de rehausser la continuité de l’information
Domaine de pratique 5
Facilitation de la continuité
des soins/Savoir naviguer
dans le système
Encourager et faciliter la
continuité des soins dans
l’ensemble des milieux de
soins et entre les prestataires
de soins en partageant
l’information relative à la
situation, au plan de soins et
aux buts actuels du patient/
de la famille. Aider le patient/
la famille à naviguer dans
le système des soins de
santé en acquérant une
bonne compréhension de
sa structure, du système
proprement dit et de son
processus et en leur
fournissant les stratégies qui
leur permettront de fonctionner
au sein de ce système.
Promouvoir une approche de collaboration en
aidant le patient/sa famille et les professionnels
de la santé à travailler en équipe
- Être le vecteur de transmission de l’information
entre le patient et l’équipe de soins
- Servir de lien entre le système de lutte contre le
cancer et les ressources communautaires
- Dépasser l’information de nature médicale pour
inclure les valeurs, les préférences et le contexte
social des patients
- Partager l’information sur les besoins changeants
des patients à mesure qu’ils cheminent le long
du continuum de la maladie
- Fournir de l’information aux patients et à leurs
proches tout au long du continuum de la maladie,
à mesure des passages et des changements en
matière d’objectifs des soins
Continuité de la
gestion
Une approche
cohérente et
congruente en
matière de gestion
du cancer qui
répond aux besoins
changeants des
patients. Confère
un sentiment de
prévisibilité et de
sécurité par rapport
aux soins futurs,
à la fois pour les
patients et pour
les fournisseurs
(Haggerty et al.,
2003).
• Réaliser un dépistage et une évaluation (initiale et
continue) approfondis des besoins et des ressources
• Rapprocher les besoins non satisfaits des services
et des ressources disponibles et des systèmes
de soutien offerts dans l’organisme de soins en
cancérologie et dans la communauté
• Cerner les ressources manquantes, trouver des solutions
temporaires et signaler les lacunes au sein du système
• Schématiser le continuum de soins, expliquer les
plans de traitement et de soins, réduire l’incertitude
(orientation du patient) et minimiser les obstacles à la
délité au traitement anticancéreux
• Effectuer les aiguillages vers les équipes de l’hôpital
et de la communauté et communiquer avec elles
• Assurer rapidement la liaison
• Faciliter la coordination et l’organisation des
soins médicaux et psychosociaux (en utilisant des
cheminements cliniques)
• Contribuer à l’élaboration et à l’application du plan de
soins interdisciplinaires et du plan de soins inrmiers
• Contribuer à la collaboration interprofessionnelle
(milieux hospitaliers et communautaires)
Domaine de pratique 1
Évaluation globale de la
santé
Procéder en temps opportun
à des évaluations globales
des besoins de la personne
atteinte de cancer et de ses
proches en matière de santé
et de soins de soutien dans
l’ensemble du continuum
du cancer en utilisant une
approche systématique
adaptée à la langue et à la
culture.
Promouvoir une approche coordonnée en
s’appuyant sur ses compétences en évaluation
afin de dégager et d’aborder, tout au long du
continuum de la maladie, les changements
touchant les besoins de santé et les besoins en
soins de soutien
• Réaliser, au moyen d’une approche
systématique, une évaluation initiale exhaustive
des besoins de santé et des besoins en soins
de soutien qui inclut la réponse de la personne
au cancer, ses préoccupations et objectifs
principaux ainsi que sa compréhension du
pronostic
• L’évaluation initiale considère le contexte
situationnel, les besoins et les réponses
de la personne et de ses proches lors de la
détermination de l’étendue et de la profondeur
de l’évaluation
Continuité
relationnelle
Une relation
thérapeutique entre
un patient et au
moins un fournisseur
de soins qui acquiert
une connaissance
croissante du
patient en tant que
personne et qui
établit un lien entre
les soins passés,
présents et futurs
(Haggerty et al.,
2003).
• Amorcer et maintenir une relation continue avec le
patient atteint de cancer
• Être une intervenante facile d’accès tout au long du
continuum de la maladie
• Indiquer, sur la trajectoire du cancer, les aspects de
l’implication du navigateur professionnel et quand
cette dernière prend n
• Faire partie de l’équipe d’oncologie
• Avoir la conance des prestataires de soins et des
membres de l’équipe
Domaine de pratique 2
Relation thérapeutique
basée sur le soutien
S’impliquer, avec les
personnes atteintes de
cancer et leur famille, dans
une relation thérapeutique
caractérisée par la
bienveillance/l’humanisme.
Cette relation basée sur
le soutien est sensible à
l’évolution des réponses
physiques, psychosociales
et spirituelles
Établir une relation thérapeutique avec les
patients/familles en étant le lien constant entre
le patient, l’équipe soignante, l’hôpital et les
services communautaires et ce, tout au long du
continuum du cancer
• Bâtir une relation thérapeutique en s’appuyant
sur ses compétences en communication et
en amorçant des conversations qui visent à
explorer les peurs et inquiétudes concernant la
vie avec le cancer, la progression de la maladie,
la mortalité, le mourir et les questions liées à la
santé sexuelle
• Effectuer les aiguillages nécessaires vers
d’autres professionnels de la santé
• Servir d’interlocuteur privilégié pour les patients
et leurs proches aux différentes phases de
l’expérience du cancer
suite à la page 57…
doi:10.5737/1181912x2315362

CONJ • RCSIO Winter/Hiver 2013 57
…suite de la page 56
Dimension 2 : Promotion de l’empowerment des patients et de leur famille
(Les fournisseurs de soins sont perçus par le patient comme étant des partenaires encourageants)
CONCEPTS FONCTIONS CLÉS Domaines de pratique de
l’ACIO*
Compétences associées
Coping actif
Mesures actives qui
visent à enrayer ou
à éviter les facteurs
de stress ou du
moins à en réduire
les effets (Carver et
al., 1989)
• Aider le patient et sa famille à obtenir activement
l’information, le soutien et les aiguillages dont ils
ont besoin
• Rehausser ou renforcer chez le patient et ses
proches les sentiments d’autonomie (autogestion
de la santé) et d’autodétermination en leur
fournissant éducation et soutien pour qu’ils
conservent leur sentiment de maîtrise et leur
qualité de vie
• Favoriser la reconnaissance par le patient et ses
proches de leurs propres ressources
• Renforcer le coping actif
• Faciliter la résolution de problèmes
• Faciliter la prise de décision
• Fixer les objectifs et les hiérarchiser
Domaine de pratique 4
Enseignement et
encadrement
Préparer les personnes
atteintes de cancer et
leur famille aux nombreux
et différents aspects de
l’expérience du cancer en
dispensant l’enseignement
ainsi que le counseling et
le soutien psychosocial/
spirituel tout au long du
continuum.
Domaine de pratique 6
Prise de décisions et
défense des droits du
patient
En collaboration avec
les autres membres
de l’équipe de soins
interprofessionnelle,
faciliter l’autodétermination
et la prise de décisions
éclairée chez le patient/
la famille. Jouer le rôle
de porte-parole pour le
patient/la famille en
communiquant et en
documentant leur approche
préférée en matière de
soins.
Fournir, aux patients et à leur entourage,
des informations et des enseignements
individualisés selon leurs besoins, leur niveau
d’instruction et leur situation en utilisant des
stratégies fondées sur des données probantes
afin de faciliter leur coping
• Cerner la capacité et les styles
d’apprentissage des personnes, le rôle
souhaité et la profondeur de leur implication
dans la prise de décisions
• Avoir conscience des différents aspects de
l’expérience du cancer et fournir, en juste
à temps, des enseignements pertinents
et renforcer l’enseignement dispensé par
d’autres intervenants
• Posséder des connaissances sufsantes pour
pouvoir discuter en profondeur d’aspects
des options de traitement et des effets
secondaires, du processus morbide et de
la gestion de la maladie au sein de divers
contextes cliniques et sociaux
• Posséder des compétences en négociation et
en collaboration an de faire valoir comme il
faut les droits du patient/de sa famille
• Aider le patient à mobiliser ses propres
ressources et à en explorer de nouvelles
• Mobiliser les ressources et les services
disponibles dans les organismes de lutte
contre le cancer et dans la communauté an
de répondre aux besoins
Auto-prise en
charge du cancer
Appuyer la personne
et sa famille
et renforcer sa
capacité d’accepter
la maladie et
de reprendre le
contrôle, quel que
soit le pronostic
(Bulsara et al.,
2006).
• Évaluer les symptômes et en faire le suivi
• Effectuer ou faciliter la prise en charge des
symptômes
• Aider le patient à composer avec son état de santé
altéré et ses symptômes et à les gérer—de façon
proactive et non réactive—ou renforcer ses efforts
à cet effet, en dispensant en temps opportun
de l’information et des instructions d’autosoins
personnalisées
• Renforcer les comportements d’autosoins
• Aider le client à suivre des plans de traitement et
de soins individualisés
• Soutenir le patient et ses proches dans la prise de
décisions et lors des transitions liées au cancer
(soins palliatifs)
• Soutenir le patient et ses proches sur la manière de
négocier leurs soins (rôle de défense des droits des
patients)
• Optimiser les capacités et les compétences en
autosoins
• Faire de la formation, du modelage et de
l’encadrement an de faciliter des changements
de comportement chez le patient, sa famille et
les membres de l’équipe vers l’adoption des
soins centrés sur le patient (hôpital et ressources
communautaires)
Domaine de pratique 3
Gestion des symptômes
du cancer et des
effets secondaires des
traitements
Intégrer et appliquer les
connaissances relatives
à la pathophysiologie du
cancer, à la progression
de la maladie, aux
modalités de traitement,
aux effets secondaires
et complications liés
aux traitements et aux
problèmes associés aux
symptômes pour faire
l’évaluation initiale,
planier, mettre en œuvre
et évaluer les résultats
des soins et des autres
interventions cliniques
fondés sur des pratiques
exemplaires et des
données probantes.
Œuvrer auprès du patient et de sa famille
afin de comprendre et gérer le plan de soins
et les effets secondaires, symptômes et
complications associés
• Comprendre l’expérience du cancer et
participer en toute aise à des conversations
sur divers besoins, sentiments, peurs,
inquiétudes, pertes auxquels le patient et sa
famille peuvent être confrontés tout au long de
la trajectoire du cancer
• Préparer le patient/sa famille à anticiper
et à autogérer les problèmes et questions
associés aux effets secondaires du traitement
et aux symptômes des traitements standards
• Utiliser les interventions fondées sur
les meilleures pratiques/résultats de
recherche an de prévenir ou de minimiser
les problèmes/symptômes à mesure qu’ils
surviennent
suite à la page 58…
doi:10.5737/1181912x2315362
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%