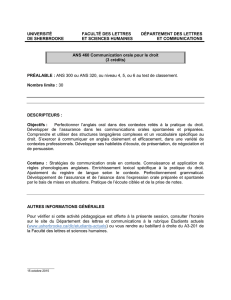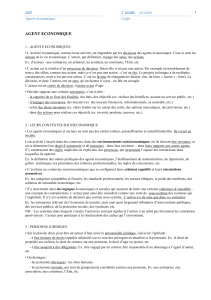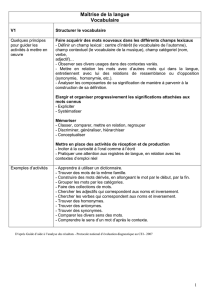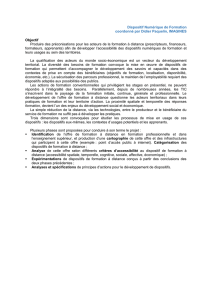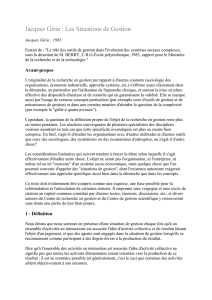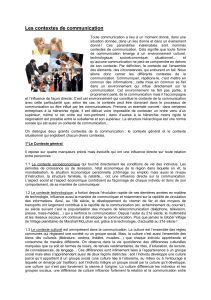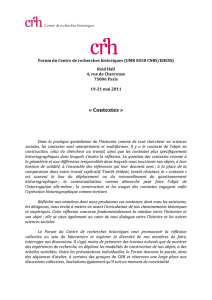Y-a-t-il un langage d`entreprise?

1/
Jacques Girin* novembre 1991
Langage et culture d’entreprise :
Y-a-t-il un langage d’entreprise?1
1- Introduction
“Les indigènes cherchent divers objets - arbres, affleurements de corail,
tas de pierres ; ils discourent sur leur véritable nom, se le montrent du doigt,
confrontent leurs opinions. Ils finissent par prendre une décision, qui est
l’aboutissement du discours, de leurs déplacements, du choix des désignations,
du maniement des ustensiles ; en effet, lorsqu’ils arrivent à un accord, ils
laissent des signes, marquent les arbres et abattent les jeunes arbres”2.
Remplaçons les “divers objets” des Trobriandais étudiés par Bronislaw
Malinowski par des usines, des marchés, des techniques financières, et nous
voilà dans un comité de direction discutant de stratégie. Remplaçons-les par des
machines, du personnel, des budgets, et nous sommes dans le cercle de qualité
d’un atelier. Lorsqu’un accord survient, on laisse des signes, par exemple un
relevé de décisions. Il arrive aussi que l’on abatte de jeunes - ou de vieux -
arbres...
Malinowski, comme tous les ethnologues de terrain, savait bien que le
langage et la culture entretenaient des liens étroits. Son mérite particulier a été
de souligner le côté actif du langage à l’intérieur d’une culture : “La principale
fonction du langage n’est pas d’exprimer la pensée ni de reproduire l’activité de
l’esprit, mais au contraire de jouer un rôle pragmatique actif dans le com-
portement humain. Ainsi conçu, il compte parmi les grandes forces culturelles et
complète les activités physiques.”3
* CNRS, Directeur du Centre de recherche en gestion de l’École polytechnique.
1 paru dans T. Globokar (Ouvrage dirigé par) : Entreprise, société, communauté, Tissages
invisibles, éditions Autrement et Ministère de la recherche, série “recherches en cours”, 1993, pp. 170-
194).
2 Bronislaw Malinowski : “Théorie ethnographique du langage”, dans Les jardins de corail, François
Maspero, 1974, page 242.
3 ibid.

2/
L’entreprise est aujourd’hui, dans nos sociétés modernes, la forme la plus
aboutie de l’action collective, laquelle est de moins en moins fondée sur des
activités physiques. Comment ne pas croire, par conséquent, que le langage y
joue au degré le plus élevé ce rôle “pragmatique actif” qui est le sien chez les
jardiniers de la Nouvelle-Guinée ? S’il existe quelque chose comme une “culture
d’entreprise”, le langage doit nécessairement y entrer au titre de composant
essentiel. Il en résulte assez naturellement que, si l’on croit important de
s’intéresser à la culture d’entreprise, il faut alors considérer comme une question
cruciale celle du langage (d’entreprise).
Comme cette dernière affirmation résume assez fidèlement la thèse que je
voudrais soutenir, ma démonstration s’arrêtera là, et le reste de ce texte ne sera
consacré qu’à examiner quelques petites difficultés qui se présentent lorsqu’on
veut faire quelque chose d’une telle proposition. En reprenant cette
démonstration dans l’ordre inverse, on peut en effet en découvrir plusieurs.
La première difficulté se trahit dans la parenthèse : “le langage
(d’entreprise)”, car on sait bien - ou on devrait savoir - qu’il ne suffit pas de
nommer une chose pour qu’elle se mette à exister. C’est précisément la raison de
cette parenthèse, que je m’efforcerai d’ôter tout au long de ce texte, en essayant
de tracer les éléments d’une problématique - une manière de poser des
problèmes pertinents et d’avancer dans leur étude - tenant compte de ce qu’il est
aujourd’hui possible d’entreprendre en matière d’études du langage dans
l’entreprise. Ici, rien ne remplace vraiment les exemples d’analyses concrètes
qui, pour peu nombreux qu’ils soient encore, occuperaient cependant plusieurs
volumes. Je ne pourrai donc qu’esquisser et suggérer, mettre en scène quelques
éléments de conceptualisation, et renvoyer, pour plus de détails, à d’autres
textes.
La deuxième difficulté réside dans la question des rapports entre langage
et culture. Dire que “le langage compte comme une grande force culturelle”,
c’est exprimer un genre de relation assez complexe à cerner. Pour mieux
approfondir cette relation, il faudra s’intéresser un peu à un problème très
fondamental, savoir comment se fabrique le sens à partir de mots et des phrases.
On ne saurait mieux faire que d’interroger, là-dessus, les spécialistes du langage,
qui répondent unanimement qu’ils n’en savent rien, et que le problème est
beaucoup plus compliqué que ne le croit le béotien. Bien que convaincants, leurs
arguments fournissent assez d’éléments pour fabriquer une petite théorie de la

3/
signification suffisante pour notre usage, mais un peu plus “sophistiquée” que
les conceptions courantes qui, elles, conduisent à des erreurs. Au milieu de cette
théorie, se rencontre une notion ordinaire et vague, celle de “contexte” : c’est
justement la discussion de cette notion qui me servira à examiner un peu plus
précisément la question des rapports entre langage et culture.
La troisième difficulté tient à la notion de culture d’entreprise, qui a fait
l’objet, dans les années récentes, de volumineux débats. Ce texte n’a pas pour
vocation d’y apporter une nouvelle contribution, n’y d’en reprendre tous les
arguments, mais il faut bien prendre position, et adopter une perspective.
J’indiquerai donc quelle sorte de réalité je veux désigner en faisant usage de
cette expression, et cela ne pourra être considéré que fortuitement comme une
contribution au débat général.
Remettant à nouveau les choses à l’endroit, on trouvera donc le plan de ce
texte : culture d’entreprise, culture et langage - qu’il faudra décomposer en deux
parties - et, en conclusion, langage d’entreprise.
2- Culture d’entreprise : position
L’idée de culture recouvre incontestablement quelque chose d’assez vaste
et de relativement confus4, et cependant nécessaire. Une position raisonnable
quant à la réalité recouverte par cette notion me semble découler des trois
remarques suivantes.
Premièrement, la culture se rapporte à la fois à des manières de sentir, de
penser et d’agir, suivant la définition durkheimienne du fait social5. La capacité
à ressentir une émotion en écoutant une musique, celle d’analyser une partition,
celle de composer ou de jouer d’un instrument, voilà ce que pourrait être, par
exemple, une culture musicale.
Deuxièmement, elle ne peut se concevoir que de manière différentielle :
ce n’est pas, par exemple, un fait de culture, que de distinguer le haut du bas, le
4 Pour un inventaire et une discussion des principales définitions qui ont été données de ce terme en
anthropologie, on peut se reporter à P. Mercier : “Anthropologie sociale et culturelle” dans J. Poirier (sous la
direction de...) : Ethnologie générale, Gallimard, Pléïade, 1968, pages 881-1036. Pour un état récent de la
question sur la culture d’entreprise, voir les différentes contributions réunies sous le titre “Vie symbolique” dans
J.-F. Chanlat (sous la direction de...) L’individu dans l’organisation, les dimensions oubliées, Presses de
l’Université Laval et Éditons Eska, Québec-Paris, 1990.
5 Voir par exemple E. Durkheim : Les règles de la méthode sociologique, PUF, 1974, page 5.

4/
passé du futur, le devant du derrière, ou encore l’homme des animaux et des
choses, car tous être humains de toutes les civilisations le font sensiblement de
la même manière. En revanche, c’est un trait de culture que de distinguer une
musique d’un bruit, une composition picturale d’un maculage, une action
intentionnelle d’un réflexe ou d’une causalité naturelle. Car ce qui est musique
ou peinture pour les uns n’est que bruit ou maculage pour d’autres, et ce qui
suppose une intention pour les uns - par exemple la maladie ou la mort imputée
à des sorts - n’est que phénomène naturel pour d’autres.
Troisièmement, elle se rapporte de manière cruciale à la question du sens.
La culture, c’est ce qui permet de donner un sens à ce qui arrive. Le sens étant
entendu comme ce que l’on sent, ce que l’on dit (l’interprétation, le com-
mentaire, la réponse verbale), mais aussi ce que l’on fait, d’un événement, d’une
action, d’un message. Ainsi, la culture fait la part entre la puanteur et l’odeur
délicieuse, s’agissant, par exemple, d’un fromage, déclenchant ainsi le haut le
coeur ou la salivation. Elle fait sentir le fumet que dégagent les femmes
sublimes du marché de Harrar - robes de soirée et cheveux enduits de beurre
rance - comme délectable ou repoussant. Elle permet de saisir un reproche là ou
d’autres entendraient une simple remarque, une menace derrière une observation
anodine, un ordre déguisé en requête, et conditionne par conséquent les réponses
pratiques que ces messages vont engager.
Quatrièmement, la culture est le fait d’un groupe, mais ne désigne en
aucun cas une réalité partagée de la même manière par tous les membre de ce
groupe. La culture d’un groupe est, bien au contraire, sa capacité à saisir de
manière différenciée la signification d’un événement, d’un message, d’une
action. Ce point est essentiel, car la notion de culture a trop souvent été com-
prise, à tort, comme renvoyant à des “évidences partagées” par tous. Une telle
conception renvoie à un type de société où le lien social se réduirait à ce que
Durkheim appelait la “solidarité mécanique”, reposant sur l’existence d’un
groupe indifférencié d’individus en tous points semblables. Cela n’est pas le cas,
on le sait bien, même dans les sociétés traditionnelles étudiées par les
anthropologues. Qui chasse, qui taille les outils, et qui fait la cuisine ? Qui
raconte les mythes fondateurs ? Qui peut donner un sens à un événement mal-
heureux ? Qui peut plaisanter avec qui ? Les générations, les genres, les liens de
parenté, le système social en général, distribuent ces éléments de culture, qui
forment système. Si l’on peut parler de la culture, c’est parce que le tout
s’articule de manière plus ou moins harmonieuse, et non pas parce qu’il y aurait
une manière d’agir, de sentir, de penser, commune à tous.

5/
La transposition de la notion de culture, issue de l’anthropologie, au cas
de l’entreprise appelle encore trois réserves très importantes, si l’on ne veut pas
risquer d’ajouter au caractère normalement confus de la notion elle-même de
pures et simples erreurs.
En premier lieu, l’anthropologie s’intéresse classiquement à rendre
compte de ce que l’on appelle des “totalités”, généralement une société tradi-
tionnelle relativement close, dans laquelle on entreprend de mettre en relation
tous les éléments de la vie sociale. L’économique, le social, le politique, le
religieux, les systèmes de parenté, les catégories du savoir, etc., ne peuvent être
séparés, et c’est ce tout, qui forme une culture. Nous ne sommes absolument pas
dans ce cas lorsqu’il est question de l’entreprise, car des pans entiers de la vie
sociale en sont absents. Au cas par cas, il peut, certes, arriver que la religion, les
liens de parenté, voire les pratiques sexuelles, doivent être considérés comme
des éléments structurants d’une culture d’entreprise, mais ce n’est pas la
configuration la plus commune. En France, par exemple, l’entreprise, à l’image
de l’État, est laïque, et l’on ne se livre pas à la prière au moment de lancer un
nouveau produit, ni à la bénédiction lorsqu’on met en service une centrale
nucléaire, ce qui, pourtant, ne saurait faire de mal. L’entreprise ne règle pas
(sauf à travers les horaires de travail et les menus des cantines) la manière dont
on prend son sommeil ou sa nourriture, pas plus que le choix du conjoint. La
culture d’entreprise n’est qu’une fraction de la culture et celle-ci, fort
heureusement lui échappe en grande partie. Lorsque des entreprises tentent
abusivement d’élargir leur emprise sur ce point, voulant par exemple imposer
leur définition de la normalité, stigmatisant tour à tour ou simultanément les
obèses, les tabagiques ou les homosexuels, il ne convient plus de parler de
culture d’entreprise, mais de totalitarisme, ce qui est une tout autre question.
Bref, autant il est relativement facile de parler de culture nationale ou
régionale, de la culture d’une classe sociale, etc., en se référant à des sortes
“totalités”, où tous les aspects de la vie sociale sont présents, autant le cas de
l’entreprise est différent. Celle-ci n’est pas la source principale, la cause pre-
mière, ni quoi que ce soit de ce genre, d’une culture, mais elle est seulement l’un
des lieux où une culture se re-crée, et où elle peut acquérir des traits spécifiques.
Par exemple, l’entreprise ne réinvente pas le rapport hommes/ femmes, mais elle
le réactive et l’actualise à sa manière, différente suivant les cas. L’entreprise est
une réalité ouverte sur l’extérieur, par lequel elle est travaillée, et qu’elle
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%