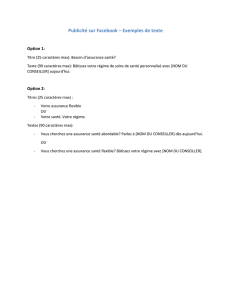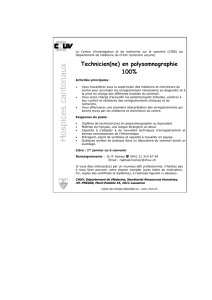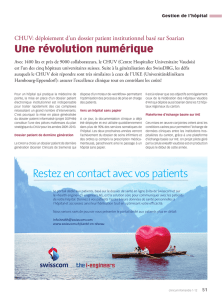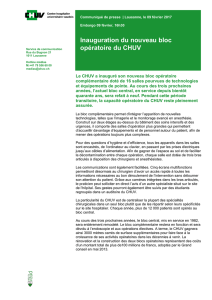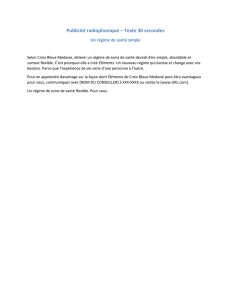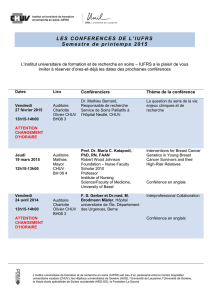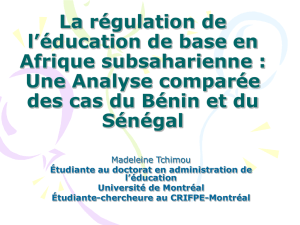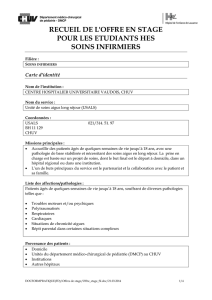Prise en charge opératoire multimodale des calculs de la voie

U. Fritschi
O. M’Baya Kabongo
T. Tawadros
P. Jichlinski
M. Valerio
introduction
La prise en charge des calculs du système urinaire supérieur re-
présente une part essentielle de l’activité d’un service d’uro-
logie. Les changements des habitudes alimentaires, du mode
de vie et la prévalence élevée de maladies associées à la for-
mation de calculs urinaires (diabète, syndrome métabolique,
obésité) ont engendré une augmentation significative de l’in-
cidence de la maladie lithiasique. Par ailleurs, le recours faci-
lité à l’imagerie abdominale dans notre société à forte médi-
calisation augmente la probabilité de découverte fortuite de
calculs asymptomatiques. La prévalence dans les pays occi-
dentaux est aujourd’hui estimée à environ 10%.1
La prise en charge thérapeutique de la maladie lithiasique, en
urologie, a subi de profondes évolutions durant les dernières
années. Dans le passé, le recours à une chirurgie invasive était
indispensable. La lithotomie ouverte était parfois l’unique so-
lution. La lithotritie extracorporelle par ondes de choc a révo-
lutionné la prise en charge des calculs du rein et de l’uretère
depuis son introduction il y a 30 ans.2 Une approche multimodale
de la maladie lithiasique intégrant l’ensemble des techniques
endoscopiques, par voie percutanée et par l’urétéroscopie rigide, s’est ensuite
peu à peu imposée. Plus récemment, l’urétérorénoscopie flexible a complété
l’arsenal thérapeutique et permis de réduire davantage le caractère invasif du
traitement des calculs.3 Elle a aussi permis d’élargir les indications cliniques à des
patients qui, par le passé, présentaient des contre-indications absolues ou rela-
tives au traitement.
Dans la première partie de cet article, nous aborderons les différentes techni-
ques opératoires ; dans la seconde, nous présenterons un résumé de notre expé-
rience récente au sein du Service d’urologie du CHUV.
plateau technique pour le traitement des calculs
de la voie urinaire supérieure
L’objectif d’une intervention en urgence doit être distingué d’un traitement à
visée définitive, soit l’extraction ou litholapaxie du calcul. En situation d’urgence
(tableau 1), le but est de drainer rapidement le haut appareil urinaire soit par
voie rétrograde au moyen d’une sonde urétérale, soit par voie percutanée au
moyen d’une néphrostomie par ponction écho-guidée.
Multimodal surgical management of
stones in the upper urinary tract
Emergency and differed urinary stone treat-
ment are basic challenges in daily urological
practice. By proposing the complete range of
treatment and by improving medical and pa-
ramedical skills, management of stone patients
can be optimized. In this article, we present the
latest developments in stone treatment as
well as our experiences with new technologies.
Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 2316-21
Le traitement de la lithiase urinaire en urgence et en électif
représente une partie importante de la pratique quotidienne
en urologie. En proposant la gamme complète du plateau tech-
nique disponible et en améliorant les compétences du person-
nel médical et paramédical, la prise en charge des patients
peut être optimisée. Dans cet article, nous présentons les dé-
veloppements dans le traitement de la lithiase ainsi que notre
expérience dans le domaine.
Prise en charge opératoire
multimodale des calculs de la
voie urinaire supérieure
perspective
2316 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
3 décembre 2014
Drs Urs Fritschi,
Olivier M’Baya Kabongo,
Thomas Tawadros et Massimo Valerio
Pr Patrice Jichlinski
Service d’urologie
CHUV, 1011 Lausanne
20_25_38256.indd 1 27.11.14 09:24

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
3 décembre 2014 2317
L’indication et le choix du traitement à visée définitive
sont adaptés à la morphologie de la voie urinaire, la forme,
le volume et la localisation de la pierre ainsi qu’aux souhaits
du patient. L’objectif reste la fragmentation du calcul et l’éva-
cuation aussi complète que possible. Le traitement d’un
calcul non obstructif, asymptomatique, sans répercussion
sur la fonction rénale, est une indication relative.
Dans le choix au recours à une technique spécifique, trois
facteurs sont considérés : la charge lithiasique (nombre et
taille des calculs), la localisation et la densité du calcul (ta-
bleau 2). Selon le tableau clinique, la lithotripsie extracor-
porelle (ESWL), la néphrolitholapaxie percutanée (NLPC),
l’urétéroscopie rigide et l’urétérorénoscopie flexible sont
utilisées. Dans les cas complexes, une approche multimo-
dale associant plusieurs techniques opératoires simultanées
et/ou consécutives est possible afin d’optimiser la prise en
charge.
Lithotripsie extracorporelle
Le procédé appelé lithotripsie extracorporelle (ESWL)
se base sur la destruction focalisée du calcul par l’action
d’on des de choc générées à distance par un lithotriteur
placé au contact du patient. Depuis l’introduction du pre-
mier lithotriteur de Dornier, en 1983, l’ESWL est considérée
comme le traitement de choix dans les situations suivan-
tes : calculs mesurant entre 5 et 20 mm et localisés dans les
cavités rénales, l’uretère proximal ou distal, les calculs de
l’uretère moyen étant d’accès difficile en raison des sur-
projections osseuses.4
La technique opératoire inclut deux étapes : 1) le repérage
par échographie et fluoroscopie et 2) la fragmentation du
calcul par des ondes de choc réglées en fonction des carac-
téristiques du ou des calculs. Les lithotriteurs de dernière
génération intègrent un système de ciblage sélectif qui cou-
ple le déclenchement des tirs au foyer de focalisation uni-
quement en présence du calcul à l’aide d’une sonde de re-
pérage échographique placée à la tête de tirs.
Le taux de succès de l’ESWL varie entre 30 et 76% en fonc-
tion du lithotriteur, de la densité du calcul, de sa localisation,
de la charge lithiasique et de l’expérience de l’opérateur. Les
effets secondaires les plus fréquents sont l’hématurie et les
douleurs consécutives à la migration des fragments. L’héma-
tome rénal ou sous-capsulaire survient très rarement, mais
peut montrer des images impressionnantes. Généralement,
il se résout spontanément. La répétition des séances d’ESWL
est considérée comme la cause de l’installation d’une hyper-
tension artérielle ou d’un diabète à long terme.5
Les contre-indications sont les troubles de la coagula-
tion, l’anti-agrégation plaquettaire, la grossesse, l’infection
urinaire, des malformations orthopédiques ou rénales, les
tumeurs rénales et l’obésité morbide qui empêche la foca-
lisation.
Malgré un rapport bénéfice/risque favorable, le rôle de
l’ESWL est mis en discussion dans certaines indications au
profit des traitements endoscopiques, minimalement inva-
sifs. Ces derniers sont en plein essor. Par la visualisation en
direct du processus de fragmentation et d’élimination des
calculs, ces instruments offrent la possibilité de déterminer
avec précision la charge lithiasique résiduelle à la fin de
l’intervention, un avantage indéniable sur l’ESWL en présen-
ce de traitements itératifs.
Néphrolitholapaxie percutanée
La néphrolitholapaxie percutanée (NLPC) est la techni-
que de choix pour les calculs de grande taille (L 20 mm)
situés dans le système pyélo-caliciel.6 D’un point de vue
technique, la mise en place d’une sonde urétérale par voie
rétrograde permet de dilater le système pyélo-caliciel, ce
qui facilite l’accès percutané du rein sous contrôle échogra-
phique et/ou fluoroscopique. Le site de ponction est choisi
non seulement en fonction de la localisation et du volume
du calcul, mais aussi de la situation anatomique. Différents
générateurs d’ondes de fragmentation sont utilisés : les gé-
nérateurs à ultrasons, le lithotripteur pneumatique (litho-
clast) ou le laser Holmium-YAG. Le choix du système dépend
de la charge lithiasique et du diamètre du néphroscope.
La NLPC classique nécessite une dilatation du trajet per-
cutané jusqu’à Charrière 30 (= 1 cm). La fragmentation et
l’extraction des calculs de gros volume en sont grandement
facilitées (figure 1).
Plus récemment, des instruments de plus petit diamètre
sont apparus sur le marché et trouvent leur place dans la
pratique quotidienne. Ceux-ci réduisent le risque de sai-
Tableau 1. Indication à un drainage en urgence et à
une fragmentation et ablation du calcul
Indications à un drainage en urgence
• Pyélonéphrite obstructive
• Obstruction d’un rein unique ou obstruction bilatérale
• Insuffisance rénale aiguë
• Oligoanurie
• Douleurs résistant aux antalgiques
Indications opératoires électives
• Taille L 6 mm
• Croissance rapide du calcul
• Calcul coralliforme
• Douleurs récidivantes
• Altération de la fonction rénale
• Pyélonéphrite obstructive
• Rein unique avec obstruction
• Infections récidivantes
• Comorbidités14 (immunosuppression)
• Situation personnelle (travail, voyage)
Taille/localisation Uretère distal Uretère moyen Uretère proximal Rénal
l 1 cm URS rigide ou ESWL URS rigide ESWL ESWL ou URS flexible
1-2 cm URS rigide URS rigide URS rigide ou ESWL ESWL ou URS flexible
L 2 cm URS rigide URS rigide URS rigide NLPC
Tableau 2. Interventions recommandées en fonction de la taille et de la localisation d’un calcul urinaire10
ESWL : lithotripsie extracorporelle ; URS : urétéroscopie ; NLPC : néphrolitholapaxie percutanée.
20_25_38256.indd 2 27.11.14 09:24

gnement et de transfusion sanguine.7 La réduction du cali-
bre des instruments peut rendre la fragmentation et l’extrac-
tion des calculs plus laborieuses. Comme pour l’ESWL, nous
retrouvons des contre-indications telles que les troubles
de la crase et l’obésité. L’expérience de l’opérateur compte
pour beaucoup en présence d’anomalies de l’anatomie ré-
nale.
Malgré les progrès technologiques, le taux de complica-
tions est sensiblement plus élevé que pour les autres tech-
niques. Des complications hémorragiques ne sont pas rares
(7% de transfusion) et 10% des patients présentent un état
fébrile en postopératoire.8 En cas de complication hémor-
ragique grave, la disponibilité des radiologues interven-
tion nels doit être garantie.
Urétéroscopie rigide
L’urétéroscopie rigide est une technique opératoire bien
établie. L’utilisation de fibres optiques dans des instruments
semi-rigides et la miniaturisation des outils de fragmenta-
tion ont grandement contribué au succès de la technique.
Celle-ci consiste à opérer par voie rétrograde dans l’uretère
sous contrôle visuel et fluoroscopique. La fragmentation du
calcul se réalise sous vision directe comme pour la NLPC.
L’extraction des fragments peut se faire en utilisant des
sondes à panier ou des pinces endoscopiques. En fin d’in-
tervention, l’urétéroscope est retiré et une sonde urétérale
est laissée en place temporairement afin de drainer correc-
tement les urines et éviter des coliques néphrétiques. Trai-
tement alternatif à l’ESWL, l’urétéroscopie rigide est indi-
quée pour tout calcul de l’uretère. Le taux de complications
est bas 9 avec des lésions de la muqueuse urétérale (1,5%),
de l’uretère (1,7%) et des coliques néphrétiques (2,2%) parmi
les plus fréquentes.
Urétérorénoscopie flexible
Avec l’urétérorénoscopie flexible, l’accès aux calculs de
la voie urinaire supérieure est quasi illimité et l’horizon des
traitements s’est élargi.3 L’angulation de l’endoscope varie
entre 270° et 360°, permettant l’inspection de toutes les ca-
vités rénales. De plus, l’urétérorénoscopie flexible permet
d’intervenir sur un groupe de patients qui, dans le passé, ne
pouvaient pas bénéficier d’un traitement des calculs uri-
naires (tableau 3).10
L’urétérorénoscopie flexible est réalisée sous contrôle
fluoroscopique. Une gaine d’accès est placée dans l’uretère
par voie rétrograde (figure 2), ce qui permet par la suite
l’accès direct au rein sans risque de lésion urétérale, tout en
évitant une surpression rénale avec des risques infectieux
et d’extravasation. Grâce à la fibre laser qui est introduite
dans le canal de travail, le calcul peut être fragmenté sous
vision directe (figure 3). Les fragments sont ensuite retirés à
travers la gaine d’accès tout en évitant des lésions de la voie
urinaire supérieure.
Les indications sont relativement larges : du simple calcul
de 6 mm dans un calice inférieur, inaccessible aux autres
traitements, jusqu’à l’incision du parenchyme pour évacuer
un calcul de plusieurs centimètres dans un diverticule rénal.
L’urétérorénoscopie flexible peut être utilisée également
pour le traitement des calculs coralliformes, bien que plu-
sieurs séances soient souvent requises afin de fragmenter
et d’évacuer tout le calcul (figure 2).
Le taux de réussite dépend de l’expérience de l’opéra-
teur ainsi que de la configuration et surtout la composition
du calcul.11 Des calculs de 1 cm peuvent être évacués dans
80% des cas en une séance, les calculs entre 1 et 2 cm dans
72%.12 Rares sont les complications, dont la plus fréquente
est l’apparition d’état fébrile.13
2318 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
3 décembre 2014
Figure 1. Fluoroscopie montrant un accès percutané
dans le calice moyen du rein gauche ainsi qu’une
sonde autostatique posée par voie rétrograde
Des résidus lithiasiques sont visibles dans le calice inférieur.
Tableau 3. Groupes de patients ayant des contre-
indications relatives ou strictes à d’autres traitements
de la lithiase, mais accès à l’urétérorénoscopie
flexible
• Traitement anticoagulant
• Traitement antiagrégant plaquettaire
• Calculs dans un diverticule rénal
• Sténose de la jonction pyélo-urétérale
• Femmes enceintes
• Patients obèses (IMC L 30)
• Anomalies orthopédiques ou anatomiques
• Echec de traitement par lithotripsie extracorporelle ou urétéroscopie
rigide
• Patient avec dérivation urinaire (accès antégrade)
20_25_38256.indd 3 27.11.14 09:24

activités au sein du chuv
L’analyse des activités dans notre service se focalise sur
la période allant de mai 2013 à octobre 2014, suite à l’adop-
tion de l’urétérorénoscopie flexible. Nous avons réalisé 223
interventions endoscopiques à but thérapeutique, dont 9
NLPC, 64 urétéroscopies rigides et 150 urétérorénoscopies
flexibles (tableau 4). Dans cette analyse, nous nous sommes
limités à l’analyse des taux de succès ainsi que des compli-
cations de l’urétérorénoscopie flexible (tableaux 4 et 5). Le
taux sans fragment en une séance d’urétérorénoscopie
flexi ble s’approche des chiffres de la littérature avec des
calculs de moins de 1 cm, évacués dans 74% des cas. Lors
des 150 urétérorénoscopies flexibles, qui incluent les pre-
mières réalisées dans le cadre de la courbe d’apprentissa ge,
peu de complications significatives sont survenues. On re-
trouve, en peropératoire, des lésions iatrogènes des voies
urinaires et des saignements, en postopératoire des sai-
gne ments et des états fébriles (tableau 5) comme compli-
cations les plus fréquentes. En aucun cas, une intervention
chirurgicale ouverte n’a été nécessaire.
conclusions
La lithiase urinaire représente une grande partie de l’ac-
tivité endoscopique au CHUV. Le plateau technique pour
2320 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
3 décembre 2014
L’image à gauche montre la complexité ainsi que la taille du calcul avant traitement. A droite, un petit fragment résiduel dans le calice inférieur est visualisé
après une séance d’urétérorénoscopie flexible.
Figure 2. Traitement par urétérorénoscopie flexible d’un calcul coralliforme chez un patient anticoagulé
Figure 3. Fragmentation du calcul au laser Holmium-
YAG dans un calice moyen
Patients traités au CHUV de 05/2013 à 10/2014 Taux sans
fragment
(1 séance)
Nombre 223
Hommes 68% (n = 151)
Femmes 32% (n = 72)
Age moyen 54 ans (21-90)
Néphrolitholapaxie 9 78% (7/9)
percutanée
Urétéroscopie rigide 64 73% (47/64)
Urétéroscopie flexible 150
0-1 cm 97 74% (72/97)
1-2 cm 39 58% (23/39)
L 2 cm 14 26% (4/14)
Tableau 4. Interventions endoscopiques sur lithiase
urinaire depuis l’introduction de l’urétérorénoscopie
flexible dans le Service d’urologie du CHUV
Lésion iatrogène de l’uretère 3/150 (2%)
Lésion iatrogène de l’urètre 1/150 (0,04%)
Hémorragie nécessitant l’interruption du geste 5/150 (3,3%)
Etat fébrile postopératoire 14/150 (9,3%)
Hématurie prolongée (L 24 h) 5/150 (3,3%)
Réhospitalisation 13/150 (8,6%)
Tableau 5. Morbidité de l’urétérorénoscopie flexible
depuis l’adoption de l’intervention au sein du CHUV
20_25_38256.indd 4 27.11.14 09:24

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
3 décembre 2014 2321
une prise en charge optimale des patients atteints d’un
calcul de la voie urinaire supérieure semble être complet
avec le développement des différentes technologies et l’in-
tégration de l’urétérorénoscopie flexible. Dans notre expé-
rience, nous avons constaté des taux de succès compara bles
à ceux des centres de référence tout en gardant une faible
morbidité. Nous espérons que la formation du personnel
soignant ainsi que l’expertise médicale vont améliorer da-
vantage nos résultats futurs.
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.
Implications pratiques
La prise en charge de la maladie lithiasique est multimodale
et à adapter au patient
La lithotripsie extracorporelle (ESWL) reste la méthode de
choix pour les calculs de petite taille. Elle est sûre et pré-
sente des taux sans fragment très satisfaisants
La place de la chirurgie percutanée du rein concerne les cal-
culs rénaux de plus de 2 cm
L’urétérorénoscopie flexible est une technique révolution-
naire puisqu’elle permet le traitement par voie rétrograde
des calculs rénaux, avec peu de contre-indications
>
>
>
>
1 Romero V, Akpinar H, Assimos DG. Kidney stones :
A global picture of prevalence, incidence, and associa-
ted risk factors. Rev Urol 2010;12:e86-96.
2 Chaussy C, Brendel W, Schmiedt E. Extracorpo-
really induced destruction of kidney stones by shock
waves. Lancet 1980;2:1265-8.
3 Traxer O, Dubosq F, Jamali K, et al. New-genera-
tion flexible ureterorenoscopes are more durable than
previous ones. Urology 2006;68:276-9 ; discussion 280-1.
4 Tiselius HG. Removal of ureteral stones with extra-
corporeal shock wave lithotripsy and ureteroscopic
procedures. What can we learn from the literature in
terms of results and treatment efforts ? Urol Res 2005;
33:185-90.
5 * Skolarikos A, Alivizatos G, de la Rosette J. Extra-
corporeal shock wave lithotripsy 25 years later : Com-
plications and their prevention. Eur Urol 2006;50:981-
90 ; discussion 990.
6 Miller NL, Lingeman JE. Management of kidney
stones. BMJ 2007;334:468-72.
7 Yamaguchi A, Skolarikos A, Buchholz NP, et al.
Operating times and bleeding complications in percu-
taneous nephrolithotomy : A comparison of tract dila-
tion methods in 5,537 patients in the Clinical Research
Office of the Endourological Society Percutaneous Ne-
phrolithotomy Global Study. J Endourol 2011;25:933-9.
8 Jessen JP, Honeck P, Knoll T, et al. Percutaneous
nephrolithotomy under combined sonographic/radio-
logic guided puncture : Results of a learning curve using
the modified Clavien grading system. World J Urol
2013;31:1599-603.
9 Perez Castro E, Osther P, Jinga V, et al. Differen-
ces in ureteroscopic stone treatment an outcomes for
distal, mid-, proximal, or multiple ureteral locations :
The clinical research Office of the Endourological So-
ciety Ureteroscopy Global Study. Eur Urol 2014;66:
102-9.
10 ** Türk C, Knoll T, Petrik A, et al. Guidelines on
urolithiasis, EAU Guidelines 2014.
11 De la Rosette J, Traxer O, et al. The clinical re-
search office of the endourological society of urete-
roscopy global study : Indications, complications and
outcomes in 11,885 patients. J Endourology 2014;28:
131-9.
12 Grasso M, Bagely D. Small diameter, actively de-
flectable, flexible ureteropyeloscopy. J Urol 1998;160:
1648-53.
13 Geavlete P, Georgescu D, Nita G, et al. Complica-
tions of 2735 retrograde semirigid ureteroscopy pro-
cedures : A single-center experience. J Endourol 2006;
20:179-85.
14 Goldsmith ZG, Lipkin ME. When (and how) to
surgically treat asymptomatic renal stones. Nat Rev
Urol 2012; 9: 315-20.
* à lire
** à lire absolument
Bibliographie
20_25_38256.indd 5 27.11.14 09:24
1
/
5
100%