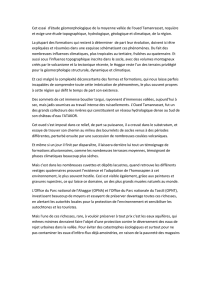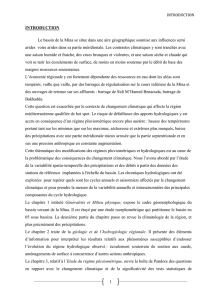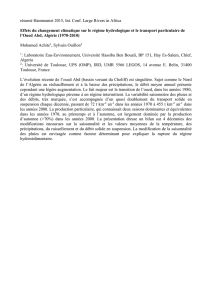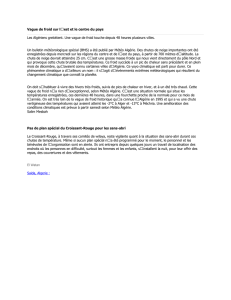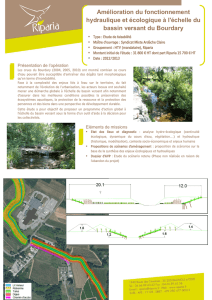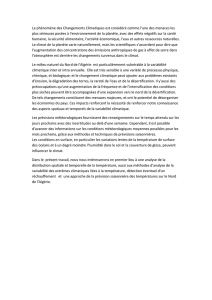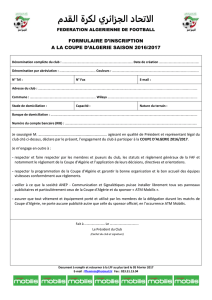Abondante ou rare, l`eau disait Léonard de Vinci, "est la force

INTRODUCTION
Générale

1
Introduction générale
Abondante ou rare, l’eau disait Léonard de Vinci, "est la force conductrice de
la nature". La santé et le bien être de l’humanité, tout comme la survie des
écosystèmes de la planète, reposent sur l’eau. Et pourtant, la rareté et le mauvais
emploi des réserves d’eau douce mettent notre avenir en péril. L’eau n’a-t-elle pas
été considérée comme un don du ciel inépuisable et gratuit ? L’humanité pourrait
manquer d’eau durant ce siècle ou du moins la ressource risque de devenir
inaccessible dans certaines zones de la planète. L’Algérie en est un, Elle est
confrontée à un manque d’eau important dû à la semi-aridité de son territoire, aux
faibles précipitations, et à la sécheresse qui sévit d’année en année face à des besoins
qui ne cessent d’augmenter. L’eau devra être mobilisée et préservée, à défaut tous
les efforts de développement seront stoppés.(Khaldi,2005).
Au cours de la dernière décennie, la problématique des changements climatiques a
été reconnue comme l’un des problèmes majeurs du développement à l’échelle
locale et régionale voire même à l’échelle internationale, aux côtés du
développement durable, de la préservation et de la protection de l’environnement. La
plupart des sujets de préoccupation recouvrent ou convergent vers le domaine de la
gestion des ressources en eau. De fait, la tendance actuelle est de considérer que les
réponses au changement climatique font partie intégrante de la prise de décision sur
la gestion durable des ressources en eau (par. ex. concernant les interactions terre –
eau - environnement). Ces réponses devraient aussi être intégrées dans la
planification nationale du développement économique, social et régional, et
harmonisées avec d’autres activités de gestion des ressources et de l’environnement,
tant en pratique qu’au niveau de la prise de décision.(Khaldi, 2005).
En Algérie, il est admis que des mesures sont nécessaires pour améliorer la capacité
à s’adapter à la variabilité hydrologique et aux phénomènes extrêmes (inondations et
sécheresses) observés aujourd’hui dans des circonstances dynamiques (notamment
les pressions actuelles dues à la démographie, à l’économie, à l’utilisation des terres
et au développement régional), de même que pour réduire les vulnérabilités
significatives de la société, de l’économie et de l’environnement aux impacts futurs.
La question de l’eau constitue un défi permanent pour les pays de l’Afrique du Nord
en général et l’Algérie en particulier. La demande est en constante augmentation,
notamment pour le secteur de l’agriculture qui absorbe plus de 87 % du potentiel
disponible. Par ailleurs, et à l’instar des pays riverains de la Méditerranée, le
développement socio-économique des pays de cette région s’est accompagné d’une
profonde modification des rapports que l’homme entretient avec la ressource en eau.
La dépendance par rapport aux eaux de surfaces et souterraines est extrêmement
variable d’un pays à l’autre.
La question de l’eau ne peut être réduite à un simple aspect d’insuffisance des
réserves disponibles. Dans les zones semi arides du Sud de la méditerranée, la

2
faiblesse des précipitations et leurs distributions aléatoires se traduisent souvent par
une situation de contrainte hydrique. Il est donc important de connaître la relation
qui relie les deux paramètres pluie - débit pour pouvoir mettre à la disposition des
planificateurs un outil «simple» permettant l’estimation ou la prévision des débits
pour les études d’aménagement futures de la région.
En effet, les modèles hydrologiques qui ont vu le jour au cours de ces vingt
dernières années, constituent des outils incontournables en regard de la relation pluie
– débit, qui essaye de simuler la transformation de la pluie en débit par des modèles
mathématiques devenus très répandus grâce à l’accroissement des capacités de
calcul et l’amélioration de l’outil informatique.
Dans cette étude, nous allons appliquer les modèles du Génie rural « GR » du
CEMAGREF (GR1A, GR2M, GR4J) sur le bassin versant d’Oued Sebdou (Tafna-
NW Algérie). L’objectif est de trouver les paramètres optimaux de chaque modèle
qui permettent une meilleure simulation afin d’apprécier les débits simulés pour la
prévision et ou la prédétermination.
Le mémoire est structuré en quatre chapitres :
Le premier chapitre, donne une présentation du site d’étude, ainsi qu’un aperçu
géologique et morphologique sur le bassin versant.
Le second chapitre, traitera l’étude climatique et hydrologique du bassin versant
d’Oued Sebdou dans laquelle nous allons essayer de mettre en évidence la variabilité
climatique de la région
Dans le troisième chapitre, nous présentons l’état de l’art de la modélisation
pluie-débit.
Le quatrième chapitre porte sur l’application du modèle GR1A, GR2M et GR4J
sur les données relatives au bassin versant d’Oued Sebdou, où, nous essayerons dans
cette partie d’évaluer les performances de ce modèle pour simuler les débits.
Enfin, une conclusion générale où sera présentée une synthèse des résultats de
cette étude.
1
/
3
100%