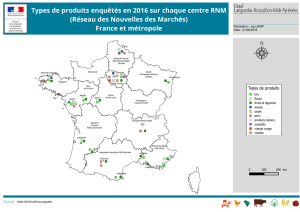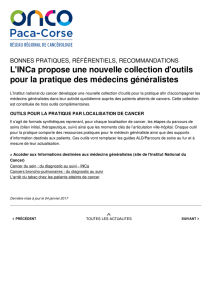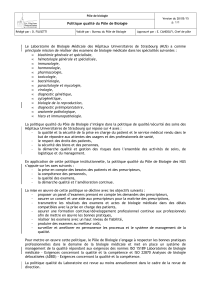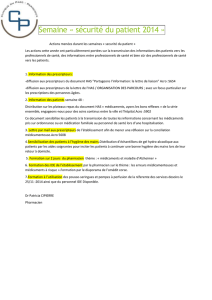Le partage des responsabilités en médecine Une

Anne Vega, août 2011
Le partage des responsabilités en médecine
Une approche socio-anthropologique des pratiques soignantes
Rapport final
Cuisine et dépendance : les usages socioculturels du médicament chez les
médecins généralistes français
Sous la responsabilité scientifique de Sylvie Fainzang, directrice de recherche
INSERM au CERMES CNRS-Inserm-EHESS (laboratoire d'accueil du post-
doctorat).
Thème 1 : Les déterminants du jugement et de la décision médicale

Résumés
L’objectif de cette étude qualitative est de « tenter de comprendre les multiples
influences autres que les seules connaissances médicales qui pèsent sur les orientations des
pratiques et des décisions médicales ». En effet, en France les connaissances restent sur ce
sujet « éparses et de portées peu opérationnelles » (Bungener 20071). Ceci concerne en
particulier les études sur les facteurs non cliniques intervenants dans les motivations de
prescriptions médicamenteuses : la plupart sont Anglo-saxonnes et sont publiées dans les
revues médicales. Pourtant, parmi les pays européens, la France se distingue par des
consommations et des prescriptions élevées de médicaments, dont l’efficacité n’a pas été
démontrée (Rosman 2009/1).
Afin de combler ce retard dans les recherches dans l’Hexagone, cette étude s’est
fondée sur une analyse de la littérature internationale, d’entretiens et d’observations du travail
de médecins généralistes français, aux profils variés (dont des praticiens salariés). Les
résultats permettent de remettre en cause un certain nombre d’idées reçues. Les patients
observés participent peu aux logiques de sur prescription (dans cette étude, ils modèrent plutôt
l’ensemble des ordonnances). Les médecins observés sont souvent à l’initiative des
prescriptions de médicaments, qu’ils soient libéraux ou salariés. En effet, le système de
paiement à l’acte ne fait que renforcer plusieurs tendances culturelles (dont les formations
médicales et l’organisation des soins en France ne sont que le reflet). Ces tendances sont
favorables à des cumuls de médicaments dans les ordonnances. Car la plupart des médecins
français sont porteurs de croyances concernant l’efficacité et les effets bénéfiques des produits
en général. Les firmes pharmaceutiques s’appuient sur ces croyances pour influencer les
prescriptions grâce à leur présence auprès des étudiants en facultés et à tous les niveaux du
système de santé. De plus, il n’existe pas de réelle coordination dans les soins entre les
praticiens (suite à la hiérarchisation des soins et à la valorisation de l’autonomie dans le
travail). On observe alors des logiques de prescription d’un produit par pathologie, d’où des
abus notoires chez les personnes souffrant de polypathologies. Ces abus sont renforcés par le
fait que les médecins spécialistes délèguent le suivi de traitements aux médecins généralistes
sans toujours les tenir informés. De leur côté, les médecins généralistes ajoutent des produits
palliatifs contre les effets secondaires des traitements spécialisés, en sous estimant d’autres
effets iatrogènes rapportés par les patients. In fine, des produits dont les causes initiales de
prescription ont été oubliées sont maintenus dans les ordonnances.
Autrement dit, les médecins généralistes ne sont pas les seuls acteurs impliqués et
responsables de surcoût dans les ordonnances. Cette étude souligne plutôt un paradoxe : les
généralistes sont censés être l’un des « pivots » du système de santé français, mais sans en
avoir ou s’en donner les moyens. D’une part, leurs compétences pharmacologiques sont
limitées et ils sous estiment les effets délétères de médicaments (comme leur « pairs »).
D’autre part, ils partagent peu leurs décisions. Ainsi, la plupart des enquêtés ont peu ou pas
d’échanges directs avec d’autres médecins, et jugent inutiles les avis de professionnels non
médicaux. Ils jugent également souvent problématique l’écoute des patients et/ou de leurs
proches.
La plupart des enquêtés reproduisent en médecine générale des traditions culturelles
dominantes (nationales, médicales et familiales). Ils utilisent le médicament de façon assez
homogène : psychotropes ou pas, il s’agit de réduire rapidement tous les symptômes et de
prévenir des risques organiques. Plus précisément, les prescriptions de médicament les plus
« abusives » recensées concernent la médication des épidémies saisonnières bénignes (types
1 Lettre de recommandation de la directrice du CERMES pour la Cnamts, en vue du financement de ce post-
doctorat.

rhumes, grippes, gastro-entérites). Elles sont liées principalement à des sensibilités et à de
peurs culturelles importantes concernant les infections respiratoires et à des logiques de
prescription d’un médicament par symptôme perçu ou redouté (avec des passages directs des
produits aux symptômes). Une majorité des médecins est convaincue de la nécessité de
médicamenter les maux courants, dont « la dépression », qu’ils pensent maîtriser par des
associations de produits psychotropes. Les « abus » sont également liés au renouvellement
sans critique de produits initiés par d’autres médecins, et en particulier d’ordonnances déjà
longues : comprenant des produits psychotropes, mais aussi d’autres produits dangereux, ou
ayant des interactions entre eux (notamment chez des personnes âgées). Cependant, cette
tendance à utiliser des produits inutiles, coûteux (« me too »2), ou toxiques s’explique surtout
par le fait qu’au sortir des facultés, les médecins généralistes n’ont pas d’autres outils et pas
de références adaptées à leur futur exercice (caractérisé par l’incertitude diagnostique,
l’écoute répétitive de plaintes et la gestion du retour de patients dont les maux sont
fréquemment liés à leurs conditions de vie). Faute de références en médecine générale, la
plupart des enquêtés ont alors des recours privilégiés, voire exclusifs aux avis et aux
médicaments spécialisés – ou vantés comme tels par les représentants des firmes que la
plupart côtoient (ces derniers comme les médecins spécialistes font sinon « autorité », du
moins ils restent les principales aides au travail). En l’absence de formation au doute et à sa
gestion, des enquêtés ont également recours à l’ordonnance pour se rassurer et sont
constamment à le recherche de « recettes ».
Cette étude montre encore d’autres usages socioculturels du médicament chez les
médecins les plus prescripteurs. Ces derniers ont souvent des rapports problématiques à
l’altérité et aux patients jugés négativement. En conséquence, ils imposent leurs prescriptions
et médicalisent des différences et des problèmes sociaux. Ils utilisent également des
médicaments pour pallier leurs limites relationnelles (pour ne pas revoir de suite des patients),
et/ou pour maintenir ou élever leurs revenus. Dans ce sens, des sur prescriptions font suite à
des fatigues professionnelles (de nombreux médecins travaillent trop, et trop vite). Or, elles
restent tabous, comme des surconsommations médicales de produits psychotropes et d’alcool
« pour tenir », qui participeraient également à leur banalisation. Cette étude montre in fine
l’existence d’autres non-dits : des « abus » de prescription sont liés à des « accidents »
professionnels traumatisants. (Or, ni les initiateurs ni les médecins qui travaillent avec ces
derniers ne remettent en cause ces abus a priori répandus3). Autrement dit, les motivations à
prescrire « hors des bonnes pratiques » des médecins les plus prescripteurs de cette étude ne
sont pas ou pas uniquement financières.
Sur tous ces points, les pratiques des « petits » prescripteurs de médicaments sont
« l’exception qui confirme la règle ». En effet, ces médecins ne sont dégagés d’une double
dépendance aux avis de médecins spécialités et de laboratoires pharmaceutiques. Plus
précisément, leurs motivations soignantes (leurs cultures familiales) les ont poussé à se
resocialiser auprès de patients variés avant de s’installer et/ou à se reformer. Ils ont alors pris
conscience de la limite du « réflexe » médicament-ordonnance, et sont parvenus à pallier les
problèmes d’assurance au travail : en partageant leurs décisions et leurs responsabilités, en
développant des compétences et/ou des alternatives thérapeutiques. Cette recherche permet
alors de soulever une problématique déterminante (qui seraient également à l’origine de la
plupart des sur prescriptions dans l’Hexagone) : le recrutement de praticiens ayant peu de
motivation soignante. En effet, c’est le cas des médecins les plus prescripteurs de cette étude,
2 Médicament qu’une firme développe uniquement pour prendre une part de marché, sans prétendre innover sur
le plan thérapeutique : il s’agit de produits presque identiques aux précédents, mais plus coûteux.
3 Cette étude souligne alors les limites des « tris » des produits dans les ordonnances effectués par les médecins
urgentistes suite à des hospitalisations de patients et dans une moindre mesure par des gériatres et les psychiatres
(davantage sensibilisés aux effets délétère des médicaments, mais moins confrontés aux retours de patients).

qui cherchent avant tout le confort dans leur travail, c’est-à-dire à ne pas endosser certaines
responsabilités dans les soins, à ne pas s’investir auprès des patients, et à ne prendre aucun
risque : à se surprotéger via le recours aux médicaments.
***
Les niveaux de prescription dépendent des rapports des prescripteurs aux produits (et à
l’ordonnance), de leur fréquentation des représentants des laboratoires. En France, ils sont
également en lien direct avec une survalorisation des savoirs spécialisés et des expertises.
Cependant, l’usage social des médicaments condense aussi le rapport à la maladie, au corps et
surtout aux patients4. La mise à jour des profils des « petits », des « moyens » et des « gros »
prescripteurs de médicaments permet donc de nuancer l’influence de l’âge, du genre, voire
des strates religieuses des médecins prescripteurs : les résultats de cette étude soulignent
plutôt les liens existant entre les motivations initiales, les orientations dans les soins, et les
niveaux de prescription des médecins.
Les principaux résultats de cette étude montrent qu’il existe chez les médecins français une
forte tradition positiviste et des visions « optimistes » des médicaments, confortées par les
stratégies des firmes pharmaceutiques : la plupart des médecins sont persuadés des progrès
constants des thérapeutiques et sous estiment les effets négatifs de produits qu’ils prescrivent.
De plus, des ordonnances abusives sont renouvelées faute de relations équilibrées et directes
entre les différents prescripteurs. Enfin, dans l’Hexagone, il n’existe ni culture de soins
communautaires incluant le point de vue des usagers, ni références proprement
« généralistes », d’où un recours privilégié voire exclusif aux savoirs et aux produits
spécialisés en médecine générale. A cet égard les médecins peu prescripteurs de médicaments
de cette étude font figure d’exception : ils ont créé des pratiques et des repères généralistes
pour mieux prendre en charge leurs patients. Cette motivation soignante est un facteur
déterminant pour expliquer les différents niveaux de prescriptions. En effet, les médecins dont
les désirs initiaux n’étaient pas d’emblée tournés vers les patients ont plutôt des usages non
strictement pharmacologiques des médicaments. A ce sujet, ce rapport permet notamment de
généraliser les résultats des études menées sur les usages des produits psychotropes.
4 De même que du côté des soignés « l’usage social des médicaments condense à la fois le rapport à la maladie,
au corps et à l’autorité médicale » (Fainzang, 2007, p. 571).

PLAN
PRESENTATION GENERALE DU RAPPORT
Cadre théorique et méthode : des pratiques de prescription socialement et
culturellement construites
Une approche critique de la médecine
L’apport des ethnographies du travail
PREMIERE PARTIE
Des psychotropes aux autres médicaments :
des médecins français plutôt initiateurs des traitements
Le rapport à l’ordonnance : les conséquences de représentations positives des médicaments
La mise à l’écart des effets iatrogènes des produits
La médicalisation de maux bénins
Des sur interprétation médicales : les lacunes des formations initiales
Des décisions médicales peu partagées : des prescriptions peu contrôlées en France
Des accumulations de produits spécialisés dans les ordonnances
Un pouvoir médical peu partagé : la reproduction des hiérarchies dominantes en médecine
générale
Des perceptions des risques prononcées en médecine générale
Les laboratoires pharmaceutiques : une présence constante et peu « chronophage »
La valeur heuristique des recherches sur les produits psychotropes
Une omniprésence des commerciaux sur le terrain
Des logiques de don et de contre don
SECONDE PARTIE
Des analyses macro sociales aux approches micro sociales :
les déclinaisons du « réflexe » médicament
L’influence des caractéristiques socioculturelles des prescripteurs sur l’ordonnance : des
facteurs intriqués
L’impact des traditions religieuses et du genre du médecin à préciser
L’impact de l’âge du médecin : des confirmations
Des instrumentalisation des médicaments aux instrumentalisations de patients chez les
médecins les plus prescripteurs
Des gros aux petits prescripteurs : une médecine adaptée au médecin/aux patients
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
1
/
200
100%