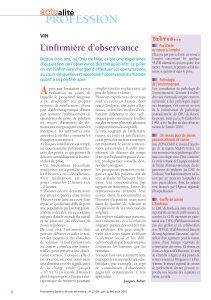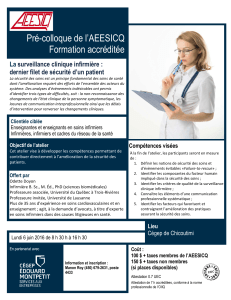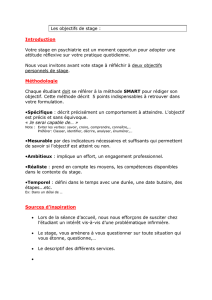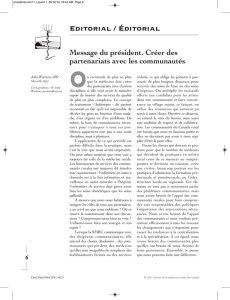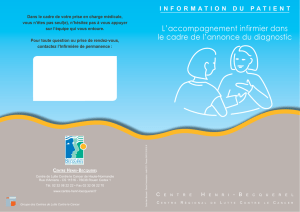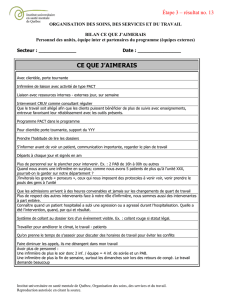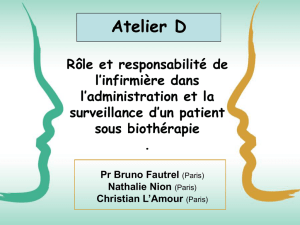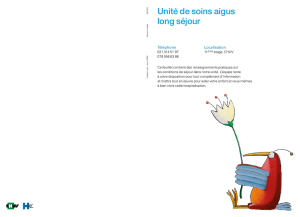895-30 - politique et procédure relatives au recours à la

DATE D’APPROBATION
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
NOUVELLE POLITIQUE
DATE DE LA MISE À JOUR
Page 1 de 11
10 février 2014
10 février 2014
Oui Non
s. o.
DIC : 1-2-1
RECUEIL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES
OBJET :
POLITIQUE ET PROCÉDURE RELATIVES AU RECOURS À
LA SURVEILLANCE DES PATIENTS DU CHU DE QUÉBEC
POLITIQUE NO
895-30
DESTINATAIRES :
Les unités de soins et les services des directions clientèle
ÉMISE PAR :
Direction des soins infirmiers
Direction des services multidisciplinaires
Direction des services professionnels
Directions clientèle
APPROUVÉE PAR :
Le conseil d’administration
Original signé par Gertrude Bourdon, secrétaire du conseil
Références :
Loi médicale (RLRQ, c. M-9, art. 31)
Loi sur les infirmières et infirmiers (RLRQ, c. l-8, art. 36)
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2, art. 118.1)
1. OBJET
La présente politique établit les règles visant à encadrer le recours à la surveillance instaurée pour assurer la
sécurité des patients du CHU de Québec ou celle d’autrui. Elle vise plus précisément à s’assurer de la
nécessité de cette mesure avant son application, mais également à en évaluer régulièrement la pertinence
en cours d’utilisation.
2. CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Les médecins et les infirmières ont des responsabilités au regard de la surveillance clinique à accorder aux
personnes présentant des risques. Ces responsabilités sont notamment définies par la Loi médicale et par la
Loi sur les infirmières et les infirmiers qui précisent les activités réservées à chacune de ces professions.
Selon cette législation :
Le médecin est responsable « […] d’exercer une surveillance clinique de la condition des personnes
malades dont l’état de santé présente des risques
1
»;
L’infirmière est responsable « […] d’exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont
l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique
infirmier
2
».
Compte tenu du cadre législatif, le médecin et l’infirmière sont deux professionnels qui peuvent décider du
niveau de surveillance d’un patient. Donc, l’ordonnance médicale n’est pas nécessaire pour instaurer un
niveau de surveillance spécifique.
Même si l’ordonnance médicale n’est pas requise pour instaurer ou augmenter un niveau de surveillance,
il est de la responsabilité de l’infirmière d’aviser le médecin au moment du changement de l’état clinique du
patient.
1
Loi médicale (RLRQ, c. M-9), article 31, 8e alinéa.
2
Loi sur les infirmières et infirmiers (RLRQ, c. I-8), article 36, 2e alinéa.

RECUEIL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES
OBJET :
POLITIQUE ET PROCÉDURE RELATIVES AU RECOURS À
LA SURVEILLANCE DES PATIENTS DU CHU DE QUÉBEC
POLITIQUE NO
895-30
DATE D’APPROBATION
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
NOUVELLE POLITIQUE
DATE DE LA MISE À JOUR
Page 2 de 11
10 février 2014
10 février 2014
Oui Non
s. o.
DIC : 1-2-1
3. CHAMP D’APPLICATION
La présente politique s’applique aux médecins, au personnel infirmier, aux professionnels et aux chefs des
unités de soins et des services du CHU de Québec.
4. DÉFINITIONS
4.1. SURVEILLANCE USUELLE
Mesure qui consiste à observer le patient minimalement dans le cadre des tournées habituelles de
l’équipe de soins et dont la fréquence est établie en fonction des caractéristiques de la clientèle de
l’unité de soins.
4.2. SURVEILLANCE ACCRUE
Mesure qui consiste à effectuer une surveillance supplémentaire à la surveillance usuelle. Il existe trois
niveaux de surveillance accrue : discrète, étroite ou constante. Ces niveaux de surveillance peuvent
être réalisés par l’ensemble des membres du personnel infirmier dans l’objectif d’engagement
thérapeutique.
4.2.1. Surveillance discrète
Mesure requise lorsque le patient présente un niveau léger de dangerosité pour lui-même ou
pour autrui. Cette mesure consiste à accorder une surveillance aux 30 minutes ou plus
souvent, si requis. Elle implique que les intervenants connaissent les déplacements du patient.
Ce niveau de surveillance se distingue de la tournée générale effectuée régulièrement sur les
unités, dans la mesure où le patient visé doit être localisé de façon spécifique. Ce niveau de
surveillance doit être intégré dans la planification du travail de l’équipe de soins et peut être
instauré en tout temps.
4.2.2. Surveillance étroite
Mesure requise lorsque le patient présente un niveau modéré de dangerosité pour lui-même
ou pour autrui. Cette mesure consiste à accorder une surveillance aux 15 minutes ou plus
souvent, si requis. Elle implique que les intervenants sachent en tout temps où se trouve le
patient et ce qu’il fait. Ce niveau de surveillance doit être intégré dans la planification du travail
de l’équipe de soins et peut être instauré en tout temps.
4.2.3. Surveillance constante
Mesure requise lorsque le patient présente un niveau élevé de dangerosité pour lui-même ou
pour autrui. Cette mesure consiste à accorder une présence continue auprès du patient par un
membre du personnel désigné ou par les membres de l’équipe de soins. En aucun temps le
patient ne peut être laissé seul. Ce niveau de surveillance peut être mis en place sans
prescription médicale.

RECUEIL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES
OBJET :
POLITIQUE ET PROCÉDURE RELATIVES AU RECOURS À
LA SURVEILLANCE DES PATIENTS DU CHU DE QUÉBEC
POLITIQUE NO
895-30
DATE D’APPROBATION
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
NOUVELLE POLITIQUE
DATE DE LA MISE À JOUR
Page 3 de 11
10 février 2014
10 février 2014
Oui Non
s. o.
DIC : 1-2-1
L’Annexe 1 fait état des particularités des niveaux de surveillance accrue d’un patient
présentant un problème de santé mentale. Le « Guide pour déterminer la fréquence de la
surveillance », présenté à l’Annexe 2, sert à déterminer la fréquence de la surveillance.
5. PRINCIPES DIRECTEURS
La présente politique repose sur les principes directeurs suivants.
La mise en place d’une surveillance accrue exige dans un premier temps une évaluation rigoureuse par
l’infirmière. Les professionnels et l’équipe médicale concernés se joindront rapidement à elle afin
d’évaluer les risques compromettant la sécurité du patient ou celle d’autrui.
Le niveau de surveillance choisi vise à assurer un environnement qui impose le moins de contraintes
possible au patient et qui ne lui cause aucun préjudice.
Selon le Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles d’application des mesures de contrôle
du gouvernement du Québec, « […] lorsqu’un dispositif ou une intervention est appliqué dans le but de
confiner une personne dans un lieu d’où elle ne peut sortir librement, on doit considérer qu’il s’agit d’une
mesure de contrôle. Il est donc nécessaire d’en déclarer l’utilisation et d’en faire le suivi. » On peut donc
considérer qu’une surveillance étant effectuée sans engagement thérapeutique est une mesure de
contrôle.
Une surveillance constante est appliquée lorsque l’état clinique du patient le requiert et qu’aucune autre
mesure ne permet de diminuer les risques.
L’infirmière responsable du patient assure la supervision du personnel effectuant la surveillance et lui
faire part des directives du plan thérapeutique infirmier (PTI) relatives aux activités qui doivent être
réalisées.
Un plan d’intervention interdisciplinaire (PII) (cf. Annexe 3) est rédigé à l’instauration d’une surveillance
constante lorsque la décision est prise en équipe interdisciplinaire et un PII est nécessairement rédigé
si la surveillance constante est d’une durée supérieure à 24 heures.
Le patient ou son représentant ainsi que sa famille et ses proches sont parties prenantes de la
démarche et mis à contribution afin de participer à la recherche de solutions en respect des objectifs
du PII, sauf pour une personne en âge légal de décider qui demande de ne pas aviser sa famille. Selon
le risque pour le patient et pour les autres, leur implication est incontournable, sauf dans les situations où
le personnel de soins ayant évalué la condition du patient juge la mesure applicable de façon urgente.
Au moment de l’instauration d’une surveillance constante, la famille en est avisée dans les plus brefs
délais afin d’obtenir son consentement.
Toute surveillance accrue est minimalement évaluée et documentée au dossier du patient à chaque
quart de travail.

RECUEIL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES
OBJET :
POLITIQUE ET PROCÉDURE RELATIVES AU RECOURS À
LA SURVEILLANCE DES PATIENTS DU CHU DE QUÉBEC
POLITIQUE NO
895-30
DATE D’APPROBATION
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
NOUVELLE POLITIQUE
DATE DE LA MISE À JOUR
Page 4 de 11
10 février 2014
10 février 2014
Oui Non
s. o.
DIC : 1-2-1
6. OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis par la Direction des soins infirmiers, la Direction des services multidisciplinaires, la
Direction des services professionnels et les directions clientèle en élaborant la présente politique sont les
suivants :
Assurer la sécurité du patient ou celle d’autrui en ayant recours au moyen le plus approprié, en tenant
compte des particularités de chaque situation;
Mettre en place des mesures encadrant l’utilisation de la surveillance des patients;
S’assurer que le personnel bénéficie d’une formation adéquate et du soutien requis dans le
développement de ses compétences;
S’assurer que le personnel de soins applique la démarche requise selon l’« Algorithme décisionnel sur la
pertinence d’une surveillance » (cf. Annexe 4) et utilise l’« Aide-mémoire » (cf. Annexe 5), avant
d’instaurer une surveillance constante;
Assurer l’utilisation adéquate des ressources humaines et financières reliées à la surveillance des
patients;
Mettre en place un registre en temps réel, afin d’assurer le suivi du recours à la surveillance constante
des patients du CHU de Québec.
7. ÉNONCÉ DE POLITIQUE
L’évaluation du risque doit se faire à l’admission et de façon continue. Au moment de l’évaluation de la
condition clinique du patient, l’infirmière, le médecin et les membres de l’équipe interdisciplinaire ainsi que le
chef d’unité évaluent les causes expliquant les comportements pouvant mettre en danger la propre sécurité
du patient ou celle d’autrui (fugue, chute, interférence au traitement, risque suicidaire, risque d’agressivité ou
autres situations dangereuses) et tentent d’y remédier.
L’évaluation de la condition clinique du patient et de ses comportements se fait régulièrement (à chaque
quart de travail), de façon à instaurer le bon niveau de surveillance et afin de rechercher des mesures de
remplacement. De plus, il faut analyser la possibilité de jumelage avec un autre patient sous surveillance et
retirer la mesure, si celle-ci ne s’avère plus nécessaire.
8. RESPONSABILITÉS D’APPLICATION
Les rôles, responsabilités et obligations des divers intervenants dans l’application de la présente politique et
procédure sont répartis de la façon suivante.
8.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Adopte la présente politique et procédure, de même que ses mises à jour.

RECUEIL DES POLITIQUES ET PROCÉDURES
OBJET :
POLITIQUE ET PROCÉDURE RELATIVES AU RECOURS À
LA SURVEILLANCE DES PATIENTS DU CHU DE QUÉBEC
POLITIQUE NO
895-30
DATE D’APPROBATION
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
NOUVELLE POLITIQUE
DATE DE LA MISE À JOUR
Page 5 de 11
10 février 2014
10 février 2014
Oui Non
s. o.
DIC : 1-2-1
8.2. LE COMITÉ DE DIRECTION
Approuve la présente politique et procédure et en recommande l’adoption au conseil
d’administration.
8.3. LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS, LA DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES, LA DIRECTION DES
SERVICES PROFESSIONNELS ET LES DIRECTIONS CLIENTÈLE
Fournissent les ressources nécessaires à l’application de cette politique;
Sont responsables de la diffusion de la politique auprès de leurs équipes respectives;
Assurent le suivi de l’application de cette politique au sein de leur direction respective et sont
responsables de ses mises à jour.
La Direction des soins infirmiers assure la transmission des résultats (mécanismes de suivi) aux
rencontres du comité clinique stratégique (CCS) et ultimement au comité de direction.
8.4. LES CHEFS D’UNITÉ OU DE SERVICE
S’assurent du respect de l’application de cette politique (selon les bonnes pratiques reconnues)
par tout le personnel sous leur responsabilité;
S’assurent de l’évaluation régulière (à chaque quart de travail) de la pertinence des surveillances
instaurées;
S’assurent de l’inscription au registre des heures de surveillance constante de leur unité de soins
ou de leur service.
8.5. L’ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE
Est proactive afin de proposer la mise en place des mesures de remplacement adaptées à la
condition du patient;
Intervient en procédant de façon précoce à leur évaluation spécifique et implique les familles au
regard des décisions à prendre (gestion des risques).
8.6. LES COORDONNATEURS D’ACTIVITÉ
S’assurent du respect de l’application de cette politique en l’absence du chef d’unité de soins ou de
service.
9. PROCÉDURES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE POLITIQUE
Les modalités d’application suivantes découlent de la présente politique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%