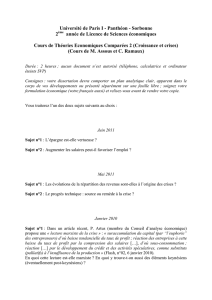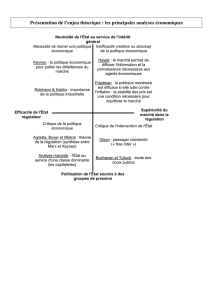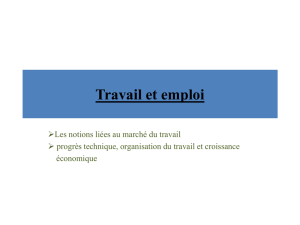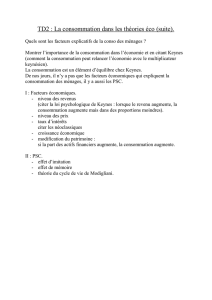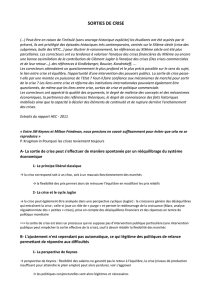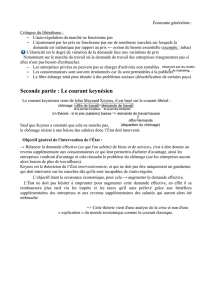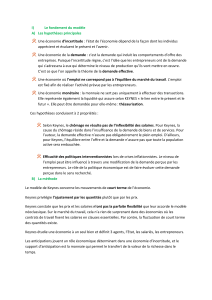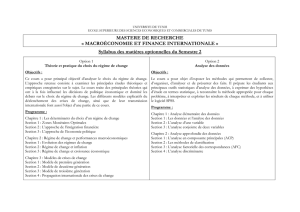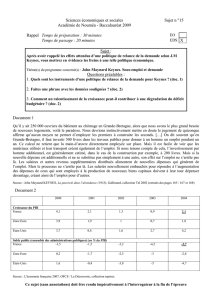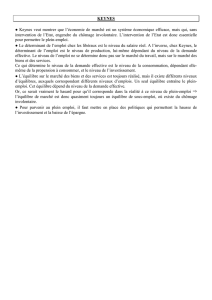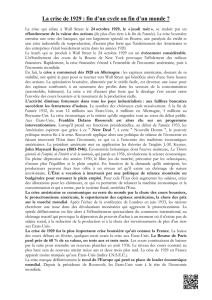Télécharger l`analyse - Présence et Action Culturelles

LEMODELEKEYNESIENPOUR
DOMPTERLESCRISESDE
L’ECONOMIQUE
Par Marc Sinnaeve
L’Etatsocialseconstruitd’unpointdevueéconomiquesurunmodèlekeynésiend’économiemixte
quiprévoit,àcôtédumarché,uneinterventiondel’Etatentantquerégulateuretacteur
importantdudéveloppementéconomique.De1950à1975,leschémakeynésienarendupossible
lespolitiquesderépartitionplusharmonieusedesrichessesproduitesentreprofits,salaireset
dépensespubliques.
Lespouvoirspublicsd’après‐guerre,quionttirélesleçonsdelacrisede1929,n’hésitentplusà
intervenirdansl’économiedemanièrestructurelle(etpasseulementconjoncturelle,entempsde
crise).
L’économiesemi‐dirigéequisemetalorsenplacesetraduitnotammentparlamiseenœuvredes
précepteskeynésiens:l’investissementpublic,lacréationd’emploispublicsetlastimulationdela
consommationvialeshaussessalarialesnégociéesetlesdifférentsleviersderedistribution(fiscalité,
Sécu,servicespublics…)1.
JohnMaynardKeynes,reconnucommeleplusimportantdeséconomistesdu20èmesiècle2,
préconise,danslesannées1920déjà,uneremiseenquestiondulaisser‐fairelibéraletdudogmede
l’équilibredesmarchésparl’ajustementautomatiquedesprix.
Lesinégalitésàl’originedescrises
Keynesnoteàcesujetquelasommedesintérêtsetdesdécisionsséparéesdesagentsprivésdu
marchén’aboutitpasrationnellement3àunéquilibrespontanéentreoffreglobaleetdemande
globale,pasdavantagequ’àunesituationdeplein‐emploietd’allocationoptimaledesressources
dansl’intérêtdechacun.Ceci,contrairementàcequeprofesseladoctrinedela«maininvisible»4
dumarchéformuléeparl’économisteAdamSmith5:«Iln’estnullementcorrectdedéduiredes
1Enpériodedecriseéconomique,cesdifférentsoutilsfonctionnentcommeautantdestabilisateurs
automatiquesdel’économie:l’emploipublicestmoinsviteetmoinsdirectementtouché;lesrevenusde
complémentouderemplacementdelasécuritésocialepermettentdesoutenirlademande.
2 Lacrisede1929etl’analysequ’ilenfaitdanssonouvragemajeurThéoriegénéraledel’emploi,del’intérêtet
delamonnaie,sortien1936,ferontsaréputationinternationale…aprèssamort(en1946)
3 Il pense au contraire que c’est l’incertitude qui domine le fonctionnement de l’économie.
4Silamaindumarchéestinvisible,aditleprixNobeld’EconomieJosephStieglitz,c’estpeut‐êtreparcequ’elle
n’existepas…
5 Diteaussithéoriepuredel’équilibregénéraldeconcurrenceparfaite.

principesdel’économiepolitique,expliqueraKeynes,quel’intérêtpersonneldûmentéclairéœuvre
toujoursenfaveurdel’intérêtgénéral.»
Aucontraire,ajoute‐t‐il,lapersistanced’écartsinacceptablesdanslesrevenusetlesfortunessont
descaractéristiquesstructurellesdeséconomiescapitalistesnonrégulées:ildénonceàcetégardles
politiquesinéquitablesdesannées1920‐30,fondéessurlesbaissesdesalaire,lessacrificesimposés
auxplusfaiblesetlaréductiondesservicesdel’Etat,enparticulierpourlesplusdémunis.
Tantlacrisede1929quelaplupartdesgrandescrisesquisuivront,avecleurcortègededrames
sociauxethumains,proviennenteffectivement,selonleséconomisteshétérodoxes,nonpasd’un
problèmedeproduction,demarchéouderareté,maisd’unetropgrandeinégalitédansla
répartitiondesrevenusetdesrichesses.Autrementdit,ils’agitmoinsdecriseséconomiquesquede
crisesdel’économique…laissésanscontrôleàsonproprefonctionnementetauxintérêtsquile
dominent.
C’est,donc,surladéconstructionduconceptlibérald’autorégulationdel’économieparlemarché
queKeynesvafondersathéoriedel’interventionnismeétatique,etc’estàpartirdelà,qu’ilva
fournir,sansenavoirpourautantl’intention,unerationalisationéconomiqueàl’Etatsocialàvenir.
Comme«onnepeutsansinconvénientabandonneràl’initiativeprivéelesoinderéglerleflux
courantd’investissement»,c’est,donc,àl’Etat,soutientKeynes,d’«instaurerdelaprévisibilitédans
cetuniversincertain,enassurantquesi,demain,lemarchéseretourne,ladépensepubliqueprendra
lerelaispourassurerdesdébouchésconstants».
Unecircularitévertueuse
AprèslaSecondeGuerremondiale,cettearticulationdeslogiquesdemarchéetd’économiedirigée
quisedouble,onl’adit,d’unetransactionpolitiqueconstituelecadrepropulseurdurenouveau
économique:entrel’Etatetlemarché,etentrelecapitaletletravail(Cf.notrecontribution
précédente«LePactesocialde1944:legrandcompromisCapital‐Travail»).
Lecompromispasséentreemployeursetsyndicatsest,ausenspropre,unnewdeal.Ilnemarque
paslafindesconditionsdetravailéprouvantes,oudel’existencedesous‐catégoriesdesalariés,
maiscesréalitésdutravailsontenquelquesortecompenséesparlarépartitionsocialeplusjustedes
gainsdeproductivité.Acetitre,lenouveaurapportdeforcespermetd’envisagerlesalaire,
désormais,nonpluscommeuncoûtdeproductionqu’ilfautcomprimeraumaximum,maiscomme
unlevierdelacroissanceéconomique.Apartirdecemoment,eneffet,lesalairecessed’êtreunprix
«pur»fixéparlemarché;ildevientunprix«négocié»,fixéautermed’accordscollectifsdansun
systèmeinstitutionnaliséetrééquilibréderelationscollectivesdutravail…
S’ensuituncycleàl’intérieurduquellanécessitédelarelanceéconomiquefaitdel’augmentation
dessalaires,précisément,undesmoteursintégrésdelacroissance.Démonstration…
Grâceauxhaussesmodestesmaisrégulièresdeleurpouvoirsalarial,lestravailleursontlapossibilité
d’améliorerleurbien‐être,desatisfairedesnouveauxbesoinsenachetantdesbiens(voitures,

télévisions,réfrigérateurs,cuisinières…)rendusaccessiblesgrâceauxprogrèstechnologiquesetàla
productionindustrielledemasse.Enclair,tantl’offrequelademandesonttiréesverslehaut.Les
pratiquesdeconsommationquivonts’instaureralimentent,àleurtour,lesbénéficesdes
entreprises,etdonc,également,toutàlafoislesinvestissementsprivéspourproduiredavantageou
mieux,lamargedenégociationsalariale,etlacroissanceéconomique.Augmentent,aussi,par
conséquent,lesrecettesfiscalesdel’Etat(dégagéesparlacroissancedesrichesses)etlescotisations
sociales(proportionnellesàlamasseetauxmontantsdessalairesdutravail).Unepartiedeces
revenuspublicsestalorsréinjectéedansl’économie(travauxetinvestissementspublics,création
d’emploispublics…),ainsiquedanslesmécanismesredistributifs(prestationsdelaSécu,services
publics)quiviennentnourrir,àleurtour,lepouvoird’achatdesménages.
L’emploicommepromessedupactepolitique
Danscettedynamique,l’objectifduplein‐emploi(dontlestravauxdeKeynesavaientmontréqu’ilne
découlaitpasmécaniquementdesauto‐ajustementsdumarché)estérigéenresponsabilité
collective,assuméeaussibienparlesentreprisesprivéesqueparlespolitiquespubliques
keynésiennes.Plusmêmequ’unobjectif,ils’agitdanslaperceptioncommunequ’enontlesgens
d’unepromessequiestalorsaucœurdupactepolitique,implicitemaisnéanmoinsdéterminant,qui
agouvernélessociétésindustriellesde1945à1975.Aujourd’hui,d’ailleurs,biendesannéesplus
tard,toutsepasseencore,notelesociologueMichelMolitor,«commesilesgenssesentaientles
victimesd’unesortederuptureunilatéraled’uncontratsocialmajeur»6.
Lechômageaucoursdecettepériodeestextrêmementbas.Danslespayseuropéens,iloscilleentre
2et3%delapopulationactive(chômeurscompletsindemnisés).Ils’agitalorsd’unchômage
frictionnel(tempsnécessaireaprèsunlicenciementpourretrouverunnouvelemploi),d’unchômage
saisonnieretd’unepartdechômagestructurel.
Unedesconditionsdufonctionnement«autoalimenté»delacircularitékeynésienneentre
productionetconsommation,c’estquel’équilibrequis’instaureconcerneuneoffreetune
demande,alors,encoreessentiellementnationales.
Ontouchelààunedesdifférencesessentiellesaveclecapitalismedelafindu20èmeetdudébutdu
21èmesiècle:lacroissancedelaconsommationpermeteneffetàuneproduction,alors
majoritairementnationale,detrouverdesdébouchéseuxaussinationaux,mêmedansunpaysaussi
ouvertcommercialementsurl’extérieurquelaBelgique:«EnBelgique,l’économiedemarché
découvrel’existenced’unimportantmarchéintérieur,àcôtédumarchéextérieurqui,depuisles
originesducapitalismebelge,constituelevéritablemoteurdelacroissance.»7Lelibre‐échange,qui
triompheraàpartirdesannées1990,ilestvrai,nes’estpasencoreimposéauxfrontières
économiquesdouanières.
6InLaRevuenouvelle,juin2006.
7GuyVANTHEMSCHE,Lesparadoxesdel’Etat.L’Etatfaceàl’économiedemarché.XIXèetXXèsiècles,Labor,
1997.

Undemi‐siècleàl’abridescrisesfinancières
Autredifférence«motrice»:lafortecroissancedel’activitééconomiquequirésultedespolitiques
keynésiennesvafavoriser,àsontour,unemontéecontinuedesinvestissementsprivésdansl’activité
productive.Lapartdesbénéficesquirevientauxactionnaires(encontrepartieducapitalinvestidans
l’entreprise),esteneffet,alors,leplussouventréinvestiedansl’entreprise,plutôtquedansles
circuitspurementfinanciersouspéculatifs.Carilexistejusqu’àlafindesannées1970uncadre
réglementairestrictrelatifàlacirculationdescapitaux,quifavorisel’investissementindustrieldans
lepays,etdécouragelesopérationsspéculativessurlesmarchésfinanciersinternationaux.
Desmesures,inspiréesdelapolitiquemiseenœuvre,dès1933,parleprésidentdesEtats‐Unis
FranklinRooseveltrégulenteneffetlesecteurbancaireetfinancier.Faceàl’impéritiedespolitiques
libéralesdesonprédécesseurHooveretduBigBusinessàenrayerlacrisebancaire,économiqueet
socialequiremonteaukrachboursierdeWallStreeten1929,leprésidentdémocrateFranklin
DelanoRoosevelt,éluen1932,vaagiravecunedéterminationetunerapidité8quivisent,nonpasà
«rassurerlesmarchés»,maisàlesdompter.Danslescentpremiersjoursdesonmandat,pressépar
unvastecourantpopulairedefonddanslepays,ildécided’unesériederéformesfondamentaleset
demesuresfortespourencadrerstrictementlesystèmebancaireetmettrefinàlaspéculation;vote
ducélèbreGlass‐SteagallAct9quiséparelesbanquesdedépôtdesbanquesd’investissementou
d’affaires10;instaurationd’unsystèmedeprotectiondesdéposants;créationdelaSEC(Securities
ExchangeCommission),l’autoritédecontrôledesmarchés…
Lesréformesimposéesenmatièrebancaireatteignentd’embléeleursobjectifs…Cemalgré
l’oppositionvirulentedesactionnairesetautresacteursduBigBusiness:furieux,soutenusparle
partirépublicain,ilsfontbarrageauxréformesde«FDR»,enagitantlespectredelafuitedes
capitauxetdel’asphyxiedel’économie…LesjugesdelaCoursuprêmeprennentunmalinplaisirà
déclarerinconstitutionnellesnombrederéformesengagées.MaisRoosevelttientbon.Les
catastrophespréditesparlesfinanciersnesesontpasproduites:iln’yaeuniexilfiscal,nifuitedes
entrepreneursoudesinvestisseurs.
Mieuxmême,l’économieaméricaineatrèsbienvécuaveccesrèglespendantundemi‐siècle,
constatel’économiste«rooseveltien»11PierreLarrouturou,etlemondeavécuàl’abridescrises
financières…C’estqu’iln’yaalorsaucunedépendancedespouvoirspublicsetdesménagesvis‐à‐vis
del’endettement,desbanquesetdesmarchésfinanciers.
8Certainesloissontprésentées,discutées,votéesetpromulguéesdanslamêmejournée!
9Ensupprimantcetteloialorsqu’ilétaitsecrétaireauTrésor(ministredesFinances)desEtats‐Unisde1995à
1999,RobertRubin,anciendelabanqueGoldmanSachs,permettraauxbanquesdetransformerdescrédits
immobiliersenactifsliquidessusceptiblesd’êtrerevendus,facteurdéclencheurdelacrisedessubprimesen
2007‐08.
10Voiraussilachroniquerécentedel’économistePaulDeGrauwesurlesfaux‐vraisobstaclesàunenouvelle
scissiondesactivitésbancaires:http://www.lesoir.be/debats/chroniques/2012‐09‐05/scinder‐les‐banques‐
courage‐monsieur‐le‐premier‐ministre‐936062.php
11IlafondéetanimelecollectifRosoevelt2012,avec,notamment,EdgarMorin,MichelRocard,Stéphane
Hessel…www.roosevelt2012.fr.

Laraisonestsimpleàcomprendreetrenvoie,acontrario,auxcausesprofondesdelacrisemondiale
quiaéclatéen2008.Jusqu’en1980etladéclarationdela(contre‐)«révolutionconservatrice»par
l’AmériquedeRonaldReaganetlaGrande‐BretagnedeMargaretThatcher,lerapportentreladette
etlePIBétaitstable;l’économien’a,alors,pasbesoindedette.Lecompromissocial‐démocrateou
fordisteassure,vialesmécanismescollectifsmisneplace,uneprogressionrégulièredessalaireset
unpartageéquilibré,oudumoinséquitable,delarichesseentresalariésetactionnaires.Dans
l’ensembledespaysOCDE,pointePierreLarrouturou12,lapartdessalairesreprésente67%duPIB
en1982,soitaumomentdutournantnéolibéral.
Trenteansplustard,suiteauxpolitiquesd’austéritébudgétaire,demodérationetdeprécarisation
salariale,cetauxestde57%,soitunebaisse«colossale»dupouvoird’achatdessalariés
qu’accompagneuntassementdesbudgetspublicsgénéré,lui,engrandepartieparlespolitiquesde
concurrencefiscaleentreEtatsetlesréductionsd’impôtsconcédéesauxplushautsrevenusafinde
nepasles«fairefuir».Cedoublemanqueàgagnersera«compensé»parl’incitationà
l’endettementdesménagesetdesEtats.Toutprofitpourlesmarchésfinanciers,dérégulés,qui,en
troisdécennies,calculeLarrouturou,ontabsorbé150%dePIB.
ANALYSE2012–23/PrésenceetActionCulturelles
12InLeSoir,1eret2septembre2012.
1
/
5
100%