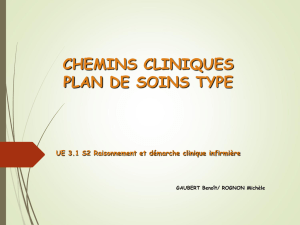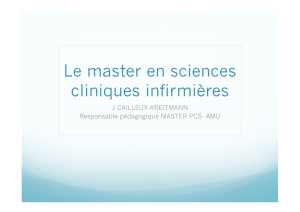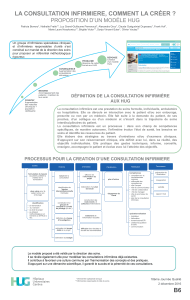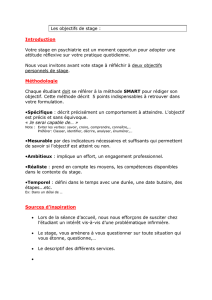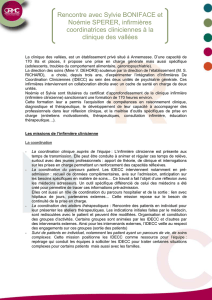Les jugements en matière de responsabilité civile, les

Annexe
Les jugements en matière
de responsabilité civile,
les décisions disciplinaires
et les rapports de coroners
La vision contemporaine
de l’exercice infirmier
au Québec
81

NOTE 14 DU CHAPITRE 1
L’infirmière doit évaluer l’état de santé des personnes, identifier les situations
d’urgence et y répondre de façon efficace, ce qui implique l’obligation de dépister les
situations de santé à risques et les complications, afin d’assurer le suivi et d’orienter les
soins infirmiers ou médicaux que le patient doit recevoir.
Jugements en matière de responsabilité civile
Lorsque les infirmières constatent que l’état de santé d’une personne peut être compromis,
elles doivent alors, en cas de besoin, faire appel au médecin. Par conséquent, il leur
appartient donc de déterminer au regard de la situation et selon leur propre évaluation de
l’état de santé du patient, s’il est nécessaire ou non de faire appel au médecin. Plusieurs
décisions illustrent ce principe.
La Cour d’appel dans Hôpital général de la région de l’Amiante inc. c. Perron1reprocha en effet
à l’infirmière chargée du transport du patient de la salle d’opération à la salle de réveil et aux
infirmières en poste à la salle de réveil de ne pas avoir constaté les difficultés respiratoires,
la faiblesse du pouls et la pâleur d’un jeune patient qui venait de subir une chirurgie mineure
et qui était encore sous l’effet de l’anesthésie. Selon la Cour, les fautes des infirmières
consistaient dans ce cas à ne pas avoir constaté ce qui était visible et apparent, et ce, par
manque de vigilance, et de ne pas avoir appelé immédiatement l’anesthésiste lorsque leur
évaluation de l’état du jeune patient indiquait qu’il y avait une situation d’urgence. La Cour
affirme que les infirmières devaient savoir que les signes constatés étaient annonciateurs
d’une défaillance cardiaque et qu’elles devaient dans ce cas recourir immédiatement aux soins
de l’anesthésiste.
Dans Hôtel-Dieu d’Amos c. Gravel2, la Cour d’appel rappela qu’une mauvaise évaluation par les
infirmières de l’état critique de santé d’une mère enceinte dont les membranes avaient été
prématurément rompues constitue une faute lorsque les événements périnatals exigeaient
une surveillance accrue et démontraient que le médecin traitant devait être rejoint pour
intervenir immédiatement. Par contre, dans l’affaire Claveau c. Guimond3, la Cour écrit que,
malgré l’état de santé de la femme enceinte et du fœtus, il n’y avait aucune preuve qui
démontrait qu’en raison de l’urgence de la situation, l’infirmière présente auprès de la mère
devait appeler le médecin. La Cour écrit à cet effet qu’«on ne peut prétendre que l’infirmière
a mal évalué la situation». L’infirmière n’a donc commis aucune faute lors du monitorage
82
Les jugements en matière
de responsabilité civile,
les décisions disciplinaires
et les rapports de coroners
1. [1979] C.A. 567.
2. [1989] R.J.Q. 64 (C.A.); [1984] C.S. 792.
3. [1998] R.R.A. 616 (C.S.).

électronique du cœur fœtal et des contractions pendant l’accouchement ni lors de
l’interprétation qu’elle pouvait faire des graphiques.
L’affaire Bordeleau c. Hôpital St-Luc4est un autre exemple où la Cour décida que l’évaluation
de l’état de santé d’un patient par une infirmière avait été faite selon les normes de
l’infirmière prudente et diligente. Selon la Cour, la preuve de l’évaluation faite du patient par
l’infirmière démontrait que ce patient, alors à l’unité des soins intensifs du département de
psychiatrie en raison d’idées suicidaires, était revenu dans le même état stable que lors de
son évaluation par le psychiatre et que, par conséquent, il n’était donc pas nécessaire de faire
appel au médecin spécialiste afin de réévaluer ce patient. L’infirmière n’avait donc commis
aucune faute en évaluant elle-même le patient et en jugeant qu’il n’était pas nécessaire de
faire appel au médecin spécialiste. Le geste suicidaire commis par le patient ne pouvait être
empêché et ce geste n’était pas imputable à une faute commise par l’infirmière.
Cette même règle a également été exprimée par la Cour d’appel dans De Bogyay c. Royal
Victoria Hospital5où une patiente, atteinte d’une psychose maniaco-dépressive, s’est suicidée
alors qu’elle était hospitalisée. Dans cette affaire, la Cour d’appel jugea que l’infirmière-chef
n’avait commis aucune faute en ne faisant pas appel au psychiatre le lendemain d’une nuit
agitée, puisque sa propre évaluation de la patiente le matin même démontrait que cette
dernière s’était normalisée et stabilisée et que rien ne laissait présager un danger immédiat
pour cette patiente. Aucun reproche ne pouvait donc être adressé à l’infirmière-chef à ce
sujet.
Dans l’affaire Bérubé c. Cloutier6, la Cour supérieure rappela le devoir qu’ont les infirmières
d’évaluer l’état de santé des patients afin de déterminer si l’urgence de la situation
nécessitait l’appel d’un médecin. Afin de déterminer l’urgence réelle de la situation, la Cour
précise que les infirmières devaient assurer, notamment, la vigilance requise et la prise de
signes vitaux selon les standards et les normes que commande l’état général du patient et que
celles-ci ne doivent alors commettre aucune omission, manquement ou négligence à cet
égard. Ainsi, et dans le cas en espèce, une patiente opérée pour subir une réduction
mammaire et qui, lors des soins postopératoires, démontrait une évolution anormale et un
état qui se dégradait exigeait de la part des infirmières une surveillance accrue, une prise plus
fréquente des signes vitaux et un appel au médecin. Il ressort des propos de la Cour qu’il
s’agit là de règles connues et qu’il appartient à l’infirmière d’exercer «son jugement
clinique».
83
4. [2000] R.R.A. 181 (C.S.).
5. [1987] R.R.A. 613 (C.A.).
6. [2000] R.R.A. 484 (C.S.).

De la même manière, la Cour d’appel reproche aux infirmières de la salle de réveil dans
l’affaire Tabah c. Liberman7de ne pas avoir agi correctement en appliquant un pansement
supplémentaire sur la plaie d’un patient qui venait de subir une hémithyroïdectomie. Comme
le signale la Cour, en raison des effets dramatiques que peut provoquer un léger saignement
suite à une hémithyroïdectomie, les infirmières devaient éviter de poser un pansement
additionnel qui aurait pour effet de cacher davantage le saignement de la plaie. Par
conséquent, la faute des infirmières a donc contribué au décès du patient dans les jours
suivants.
Dans l’affaire St-Jean c. Mercier8, la Cour signale qu’un orthopédiste a commis une faute en
n’ordonnant pas l’immobilisation de la colonne vertébrale d’un patient polytraumatisé
hospitalisé à la suite d’un accident où ce dernier s’est fait heurter par une voiture alors qu’il
faisait de l’autostop. Selon la Cour, le médecin spécialiste aurait commis une faute en ne
prenant pas connaissance des notes des infirmières qui l’informaient de la présence d’un
déficit neurologique du patient. Les infirmières ont donc évalué correctement l’état de santé
du patient au cours de son hospitalisation et ont agi adéquatement en notant plusieurs fois
au dossier de ce dernier, et ce, au cours des jours suivant l’accident, que celui-ci était
incapable de faire une mobilisation de ses pieds ou de ses orteils. Les infirmières n’ont donc
commis aucune faute puisqu’elles ont noté au dossier les signes ou symptômes qu’elles
devaient remarquer et qui devaient guider le médecin.
En situation d’urgence, l’évaluation initiale de l’infirmière peut comporter l’initiation de
mesures diagnostiques lorsqu’une telle intervention est requise par l’état de la patiente. Dans
l’affaire Claveau c. Guimond9, la Cour note que l’infirmière n’avait commis aucune faute en
procédant à un test à la nitrazine lorsque la femme enceinte se présenta à l’hôpital. L’examen
pratiqué par l’infirmière avait été fait suivant l’usage et les règles de l’art et n’était pas fautif.
La Cour note également que les infirmières avaient correctement pris les signes vitaux de la
mère et du fœtus.
Rapports de coroners
Deux rapports de coroners portant sur les causes et circonstances de décès impliquant la
pratique d’infirmières à l’urgence de centres hospitaliers illustrent l’importance du jugement
clinique que l’infirmière est en situation d’exercer quant à l’évaluation initiale et à la
surveillance de l’état physique de patients sous observation, ainsi que la gravité des
conséquences pouvant résulter d’une mauvaise évaluation.
84
7. [1990] R.J.Q. 1230 (C.A.).
8. [1999] R.J.Q. 1658 (C.A.).
9. [1998] R.R.A. 616 (C.S.).

Le premier rapport10 porte sur le décès d’un enfant de huit mois survenu par arrêt cardiaque,
en salle d’observation à l’urgence d’un centre hospitalier.À son arrivée à l’urgence, l’enfant
est évalué au triage puis codé urgent. L’infirmière du triage avise le médecin de garde et lui
fait rapport de ses observations. Si cette infirmière n’avait pas insisté sur le cas de l’enfant
auprès du médecin, ce dernier aurait couché l’enfant au cube (en attente d’une salle) alors
que les symptômes cliniques observés par l’infirmière démontraient un état de santé précaire
et nécessitaient un suivi rigoureux de l’évolution de l’état de santé de l’enfant en salle
d’observation (salle trauma).
Toutefois, en salle d’observation, l’enfant est décédé par arrêt cardiaque à la suite d’un choc
hypovolémique consécutif à une rupture de la rate. L’infirmière de la salle d’observation et le
médecin de garde ont concentré leurs observations sur les signes neurologiques. L’enquête
faisant ressortir des lacunes dans les notes d’observations en ce qui concerne les signes
vitaux. Dans ses conclusions, le coroner souligne l’importance d’une bonne compréhension
entre les intervenants quant à leurs responsabilités respectives en vue d’assurer la continuité
des soins et traitements, et d’une «confiance mutuelle éprouvée, propre à laisser beaucoup
de place au jugement de l’infirmière»11.
L’autre rapport12 comporte un constat du coroner relativement au rôle que l’infirmière doit
être en mesure d’assumer quant à l’évaluation de l’état de santé (triage) des patients qui se
présentent à l’urgence. Ce rapport a trait au décès d’une personne âgée, à la suite de son
admission à l’urgence, dû à un problème cardiaque sévère et à une insuffisance respiratoire.
Dans ses conclusions, le coroner souligne que, malgré que le triage ait bien fonctionné, la
situation prévalant à l’urgence était dangereuse en raison de la présence d’un seul médecin,
jugée insuffisante pour répondre à l’achalandage et à la gravité des cas référés. Dans les
circonstances, il n’est pas acceptable qu’une évaluation effectuée en quelques minutes par
l’infirmière puisse entraîner des attentes prolongées de l’ordre de 12 heures. Le coroner
recommande qu’à chaque fois qu’il y a attente de plus de 2 ou 3 heures, le système de triage
devrait pouvoir être suffisamment souple pour permettre de disposer du personnel infirmier
supplémentaire afin de faire une évaluation clinique plus complète, incluant la révision du
dossier antérieur et une anamnèse complète. Cela pourrait permettre d’adresser ou de
soumettre plus rapidement aux médecins de garde les cas plus lourds de polypathologies qui
ont davantage de risque de présenter une détérioration rapide, sans se fier uniquement aux
symptômes présentés à l’admission de ces patients.
Deux autres rapports illustrent que, dans certains milieux où il n’y a pas de médecin sur place,
c’est l’infirmière qui est en situation de déceler les cas problématiques nécessitant un suivi
médical. C’est à la suite de ses observations cliniques que le médecin interviendra ou non en
temps utile auprès du patient.
85
10. Rapport A-122858, 24 février 1999, coroner Gilles Perron.
11. Ibid., p. 41-42.
12. Rapport A-128256, 21 mars 1999, coroner Raynald Gauthier.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%