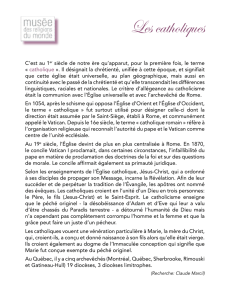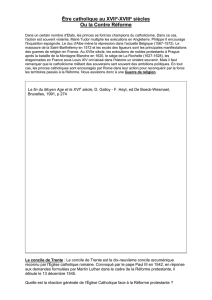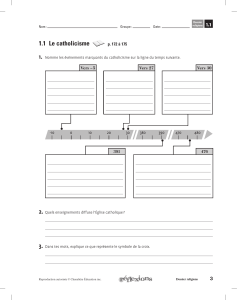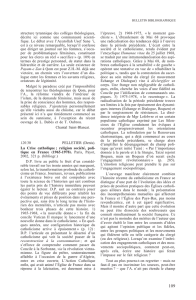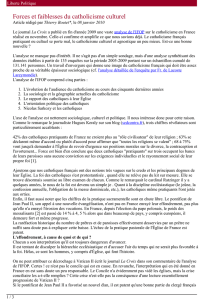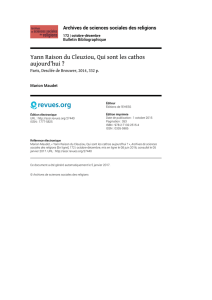catholicisme libèral et catholicisme social

CATHOLICISME LIBÈRAL ET CATHOLICISME SOCIAL
Article écrit par René RÈMOND
I. Prise de vue
II. Catholicisme libéral
• Catholicisme et libéralisme, dogmatisme et irréligion
• La liberté, fille du christianisme
• Le pari des catholiques libéraux
III. Catholicisme social
• Un double refus
Refus du libéralisme
Refus du socialisme
• De l’initiative spontanée…
à la doctrine de l’Église
• Les institutions
Prise de vue 1.
Catholicisme libéral, catholicisme social, démocratie chrétienne : trois courants de pensée qu’il serait déraisonnable de traiter comme s’ils n’avaient entretenu
aucune sorte de relation réciproque. Assurément, ce qui les différencie est souvent essentiel entre catholiques libéraux et démocrates chrétiens, il y a toute la distance
qui sépare au XIXe siècle le libéralisme de la démocratie, et, d’autre part, le catholicisme social réprouve le libéralisme qu’il tient pour responsable des maux qui
affligent la société.
Plusieurs traits apparentent néanmoins ces écoles et autorisent à les considérer, dans une certaine mesure, comme autant de manifestations d’une même tentative
pour assurer la présence active du christianisme dans la société contemporaine. C’est, en premier lieu, la référence explicite et délibérée au catholicisme. La fidélité
avouée à l’Église est au principe de ces trois écoles. Catholiques libéraux, catholiques sociaux, démocrates chrétiens acceptent dans son intégralité le dogme défini par
l’Église : ils reçoivent son enseignement, sans restrictions ni aménagements. Limitant leur ambition au domaine des applications à la société, ils se défendent de vouloir
prendre position dans l’ordre de la foi. Cette précision prévient l’équivoque que l’analogie des appellations risque de provoquer entre catholicisme libéral et
protestantisme libéral : ce dernier exprime une tendance à interpréter les dogmes à la lumière du rationalisme moderne, et va parfois jusqu’à remettre en question la foi
même en la divinité du Christ. Rien de tel dans le catholicisme libéral. Cependant, l’adhésion à la cause de la liberté ou la sympathie pour la démocratie colorent
inévitablement l’appartenance à l’Église et affectent le jugement sur son organisation interne. Les catholiques libéraux s’accommoderont plus difficilement que les
intransigeants de l’autorité souveraine du pape, surtout si celle-ci s’exerce pour condamner l’usage des libertés ; des démocrates chrétiens seront tentés de souhaiter
que la coercition cède le pas à la discussion dans l’Église. De la constitution interne et de la discipline, leurs préférences gagneront-elles le contenu dogmatique de la
foi ? C’est la thèse des adversaires : acharnés à les perdre, ils s’évertueront à prouver qu’un catholique libéral ou social ne peut être un bon catholique puisqu’il éprouve
le besoin d’ajouter une nuance propre à l’enseignement commun. C’est par réaction contre ces appellations distinctives que les catholiques attachés à une tradition
immuable se sont baptisés « intégraux » : procès de tendance contre lequel s’élève la fidélité indéfectible à l’Église de tant d’adeptes de ces trois familles.

Elles sont si loin de se détacher de l’Église que c’est le souci de défendre ses libertés, de préserver son influence ou d’accroître son rôle qui inspire toutes leurs
entreprises. La deuxième caractéristique qui les rapproche, en les singularisant par rapport à l’ensemble de leurs coreligionnaires, est en effet la conviction partagée
que le catholicisme n’est pas une affaire privée : il implique des conséquences pour l’ordre social. Elles se refusent donc à entériner une séparation radicale entre
l’ordre social et la religion. Les chrétiens doivent emprunter à l’Évangile les normes et les lumières de leur pensée et de leur action. Les différences entre ces trois
courants naissent au-delà de ce point commun : leurs analyses de la société divergent et ils n’accordent pas leur sympathie aux mêmes valeurs.
Leur nature mixte constitue le troisième trait de parenté de ces mouvements. Ils intéressent à la fois la réflexion théorique et l’activité pratique. Ce sont des écoles
de pensée : elles sont contraintes de se définir tant par rapport à l’Église que par rapport aux autres courants : l’effort doctrinal pour légitimer leur existence même et
dessiner les linéaments de l’ordre idéal est un aspect essentiel de leur histoire. Mais parce que leur raison d’être est aussi d’insérer le christianisme dans l’organisation
de la société, ces familles d’esprit — les deux dernières surtout — se manifestent par une efflorescence d’initiatives et d’institutions de toute sorte, associations, partis,
syndicats.
On mentionnera encore, au titre des analogies, la courbe générale qui figure leur position à l’intérieur du catholicisme. Ce furent longtemps des minorités contestées,
désavouées par l’autorité, suspectes à l’ensemble. L’acceptation de la liberté, l’affirmation d’une morale sociale, le ralliement à la démocratie parurent, en leur temps,
autant de provocations : elles isolèrent longtemps leurs adeptes et tracèrent dans l’Église des lignes de clivage décisives. L’évidence des faits, le caractère
manifestement irréversible de certaines évolutions, le progrès de la réflexion, la diffusion des idées de ces minorités, l’intervention du magistère, l’apaisement des
passions eurent pour résultat le renversement des tendances. D’une certaine façon, il n’est pas excessif de dire que les positions de ces écoles sont devenues dans la
seconde moitié du XXe siècle celles de l’Église tout entière. Les enseignements de Vatican II présentent, dans un contexte différent, une incontestable parenté avec telle
ou telle des thèses défendues jadis par ces trois écoles de pensée.
Les unes et les autres ont eu enfin une dimension internationale. Si elles ont pu trouver un milieu d’élection dans tel ou tel pays, aucune ne s’est enfermée dans un
cadre strictement national ; l’universalité de l’Église catholique l’interdisait : partout où elle était présente, il était naturel que certains de ses fidèles fussent tentés par
ces orientations ; d’autre part, l’analogie des problèmes posés à l’Église par une évolution parallèle à travers l’Europe et le monde des sociétés politiques, provoquée
par la Révolution française, le progrès de la liberté et de la démocratie, l’industrialisation et l’apparition du socialisme, appelait l’analogie des réponses. Catholiques
libéraux ou catholiques sociaux de plusieurs pays devaient sentir le besoin de se concerter et de confronter le fruit de leurs réflexions comme les résultats de leurs
initiatives.
Catholicisme libéral 1.
De ces trois courants, le catholicisme libéral est le plus ancien encore qu’on ait pu discerner du catholicisme social des origines qui remontent aux années 1820-1830,
contemporaines par conséquent des débuts de l’école catholique libérale. C’est aussi que la société a institué la liberté bien avant d’instaurer la démocratie politique et
que la révolution politique a précédé la révolution sociale née de la révolution industrielle.
Catholicisme et libéralisme, dogmatisme et irréligion
En Europe occidentale, le libéralisme tend alors à s’imposer comme la philosophie dominante : les institutions politiques, l’économie, les relations sociales s’en
inspirent. Il imprègne les codes et les mentalités. Le libéralisme catholique est une variante de ce grand courant dominateur. À essayer de jeter un trait d’union entre
catholicisme et libéralisme, il rencontre de grandes difficultés : la philosophie libérale est en effet liée au rationalisme moderne et semble inséparable de la critique de
tout enseignement dogmatique. L’effort des catholiques libéraux implique un pari sur la nature du mouvement : ils ne pensent pas que son association avec
l’anticléricalisme ou même l’irréligion soit indissoluble ; elle est, à leurs yeux, le fruit contingent des circonstances et ils ne désespèrent pas de la rompre en rendant la
liberté à ses véritables origines, qui sont chrétiennes.

Des considérations diverses les inspirent. Ce peut être une vue simplement réaliste : la société moderne est fondée sur l’affirmation de la liberté. À refuser de la
reconnaître, l’Église s’exclut du monde, alors qu’elle peut trouver des avantages à un ordre qui repose sur la liberté de tous : elle n’a rien à perdre au droit commun et
tout à gagner à échapper à la tutelle régalienne de l’État. A-t-elle eu à se louer de la protection intéressée du pouvoir monarchique ? Tel est le point de vue que
Lamennais, dont le nom s’inscrit aux origines du catholicisme libéral comme au principe de plusieurs des courants modernes du catholicisme, exprime en 1829 dans
l’ouvrage qu’il intitule Des progrès de la Révolution et de la guerre contre l’Église. La bataille contre le monopole universitaire, les luttes pour la liberté de
l’enseignement, les disputes autour du droit d’association et sur le statut des congrégations fournissent autant d’arguments aux thèses libérales et actualisent leur
programme. Certains bornent leurs aspirations à réclamer pour l’Église le droit de se gouverner elle-même ; d’autres vont jusqu’à appeler de leurs vœux une séparation
radicale entre société religieuse et société civile. Le mot d’ordre « l’Église libre dans l’État libre » associe dans son ambiguïté libéraux et catholiques libéraux : c’est à la
fois la formule énoncée par Cavour pour régler la question romaine (1860) et le mot d’ordre proposé par Montalembert au congrès de Malines (1863). Mais dans tous
les pays où le catholicisme, se confondant avec le passé national, était la religion d’État et où l’Église jouissait d’un statut privilégié, comme en Autriche ou en Espagne,
les vues des catholiques libéraux heurtaient trop profondément les habitudes de pensée et la sensibilité pour pouvoir atteindre autre chose que de faibles minorités,
convaincues par avance de la bienfaisance de la liberté et de sa grandeur.
Il en allait tout autrement dans les pays où les catholiques ne formaient qu’une minorité perdue dans une masse : ils avaient tout à redouter de l’application stricte du
principe de l’unité de foi. La liberté possède pour eux un mérite essentiel, qu’elle soit à conserver ou à conquérir : elle est la condition de leur existence. Dans certains
de ces pays, la liberté religieuse existait de longue date et ne leur avait jamais été contestée : c’était le cas aux États-Unis. Les prêtres français qui ont émigré pendant
la Révolution y ont découvert le bienfait de la séparation et en ont rapporté une sympathie durable pour la liberté religieuse. Ailleurs, les catholiques ont dû s’unir,
combattre, parfois s’allier à d’autres, pour obtenir la liberté. En 1828, les catholiques belges s’associent à leurs compatriotes libéraux contre la domination des
Hollandais protestants ; la révolution de 1830 et l’indépendance belge seront le fruit de cette alliance. 1829 : l’action du grand tribun irlandais O’Connel arrache
l’émancipation des catholiques d’Angleterre. 1837 : l’« incident de Cologne » marque le point de départ d’une évolution qui fera du catholicisme allemand une force
politique de premier plan. Dans tous ces pays, les catholiques ont découvert expérimentalement les avantages de la liberté pour tous ; rattachement à la liberté et la
défense des libertés catholiques se confondaient dans une même cause, où les catholiques intransigeants et ceux qui étaient convaincus de la supériorité intrinsèque
de la liberté pouvaient mêler sans problèmes leurs efforts.
La liberté, fille du christianisme
Il existe en effet une famille de catholiques qui croient à la liberté pour elle-même : ce sont eux les catholiques libéraux authentiques. À leurs yeux, la liberté se
justifie pour elle-même, indépendamment des avantages qui peuvent en résulter pour l’Église. Elle est au reste fille du christianisme : c’est l’Évangile qui en a inculqué
la notion aux hommes, c’est l’Église qui, au cours des siècles, en a enseigné les principes. C’est un faux dilemme que celui qui les contraindrait à choisir entre la fidélité
à leur foi et leur attachement à la liberté. Un Montalembert, un Lacordaire, pour s’en tenir à des exemples français, ne mettent pas, à servir la liberté, moins de ferveur
ou de conviction que les libéraux non catholiques, tels un Benjamin Constant ou un La Fayette. Ils constituent, à l’intérieur de la grande famille libérale, une branche
originale qui se propose, selon la devise du journal de Lamennais, L’Avenir (1830-1831), de réconcilier « Dieu et la liberté ». Ils sont favorables à la reconnaissance
de toutes les libertés qui symbolisent l’accomplissement de la liberté : libertés de conscience et d’expression, institutions représentatives, contrôle du pouvoir par les
assemblées délibérantes. Leur défiance de l’État les rapproche des autres libéraux. Elle n’est pas étrangère à leur indifférence à l’égard de la question sociale qui
commence à tourmenter les catholiques sociaux : ils ne partagent pas nécessairement les thèses économiques du libéralisme, mais redoutent que l’intervention de l’État
dans les rapports sociaux ait pour contrepartie le renforcement de l’autorité aux dépens, une fois de plus, de la liberté des individus.
Dans les pays traditionnellement catholiques, cette famille de catholiques libéraux a toujours été au XIXe siècle une minorité ; son importance a en partie dépendu de
ses antécédents intellectuels et religieux. Elle n’existe guère qu’en Italie et en France. Une certaine forme de religion austère, raisonnante, telle que le jansénisme
l’avait un temps exprimée, semble bien lui avoir préparé le terrain. À première vue, la filiation a de quoi surprendre : comment une théologie qui se caractérisait
essentiellement par l’affirmation de la toute-puissance divine, la gratuité absolue de l’intervention de la grâce et la misère impuissante de l’homme a-t-elle pu frayer la
voie à une philosophie qui met l’accent sur la grandeur de la liberté ? La réponse tient en partie dans les avatars du jansénisme qui, au XVIIIe siècle, s’est lié étroitement
au gallicanisme et à toutes les formes parentes de résistance à l’ultramontanisme, ainsi qu’à une volonté de réforme intérieure dans le sens d’une interprétation
rationnelle. Au Piémont, en Lombardie, on peut suivre le cheminement qui conduit d’un clergé janséniste et gagné aux thèses gallicanes et richéristes du XVIIIe siècle au
catholicisme libéral et patriote qui est, avant 1848, une composante du Risorgimento et qu’illustrent les noms de Pellico, de Manzoni, de Rosmini. L’Italie est un cas où
les circonstances politiques ont renforcé l’attraction du courant libéral : l’amour de la patrie opprimée par l’Autriche de Metternich fortifie le courant néo-guelfe qui rêve
de voir l’Église prendre la tête du renouveau national et le pape unir dans sa personne la religion et la liberté. À ce grand rêve, le début du pontificat de Pie IX (1846) a
apporté un commencement d’accomplissement, vite compromis par les événements de 1848. De même en France, la famille d’esprits qui se caractérise à partir de la fin
de la Restauration, par son attachement aux valeurs de liberté et sa volonté de les concilier avec l’Église, trouve des prédispositions dans une certaine tradition
intellectuelle qui affirmait les droits de l’intelligence et répugnait autant aux excès de l’autorité dans le gouvernement de l’Église qu’aux égarements d’une piété trop
sensible. De Royer-Collard à Imbart de La Tour, une lignée d’universitaires ne juge pas que la foi doive s’établir sur la défaite de la raison. Ce libéralisme est souvent
associé aux vestiges du gallicanisme et aux survivances d’un type de catholicisme antérieur à la Révolution. D’où sa faible audience dans le jeune clergé dont la ferveur
va à un catholicisme ultramontain dévot et militant, lié à l’intransigeance dogmatique et au culte de l’autorité. Les catholiques libéraux se défendent de vouloir
infléchir la vie interne de l’Église, ils n’en sont pas moins en désaccord avec les orientations qui y prédominent. Leur sympathie va naturellement à plus de liberté dans
l’Église : or les progrès de l’ultramontanisme ne font qu’y renforcer l’autorité et la centralisation. La plupart d’entre eux ont désapprouvé la tendance qui dispose de la
majorité au concile du Vatican. En retour, ils apparaissent suspects et font l’objet de mises en garde : leurs positions, avouées ou supposées, motivent des condamnations
doctrinales. L’encyclique Mirari vos (1832), l’encyclique Quanta cura (1864) et le catalogue des erreurs contemporaines qui l’accompagne, connu sous le nom de
Syllabus, les définitions conciliaires de 1870 anéantissent les efforts des catholiques libéraux, dispersent leurs groupes, désavouent leurs entreprises et condamnent les
postulats mêmes de leur action. Contrairement à leurs espérances, le magistère romain et l’épiscopat semblent s’acharner à affirmer l’incompatibilité de la foi

catholique et de la liberté.
Le pari des catholiques libéraux
À vrai dire, c’était plutôt la contradiction du dogme tel qu’il était conçu avec le libéralisme tel qu’il se formulait alors. C’était en effet une gageure en 1830, et encore
en 1870, de prétendre unir catholicisme et libéralisme. Le libéralisme paraissait trop lié à l’anticléricalisme : le postulat suivant lequel la religion n’était qu’une affaire
privée dont la société n’avait pas à connaître était difficilement acceptable pour un catholicisme convaincu que la religion devait inspirer tous les actes publics, et que
l’Église était la garante du droit naturel et de la morale publique. La politique anticléricale de tous les gouvernements libéraux, le programme menaçant pour les droits
acquis de l’Église proposé par les partis libéraux, la réalisation de l’unité italienne au détriment de la souveraineté pontificale par un gouvernement dont l’inspiration
était autant libérale que nationale rendaient illusoire toute tentative de conciliation. L’évolution interne du catholicisme ne suscitait pas de moindres obstacles : le
mouvement théologique tend alors à affirmer les droits de la vérité sans contrepartie. En face d’elle, l’erreur ne saurait en avoir. Or n’est-ce pas la logique du
libéralisme que d’affirmer le droit pour toute opinion sincère de s’exprimer et de tenter de faire des adeptes ? Entre ces deux systèmes, la position des catholiques
libéraux est difficile et précaire : leur foi les rend suspects aux yeux des libéraux, et leurs adversaires intransigeants ont beau jeu à les présenter comme des
catholiques inconséquents dont la foi est douteuse ; ils reculent devant les conséquences logiques d’une conviction sincère et entière. Leur argumentation même prête
le flanc à la critique doctrinale quand elle se fonde sur la distinction, énoncée par Mgr Dupanloup à propos de l’interprétation du Syllabus, entre la thèse et l’hypothèse.
C’est accorder à l’intransigeance qu’elle a raison sur le terrain des principes : seule la considération du possible contraindrait à suspendre, ou à différer, l’application
de la thèse. Elle ne rassure pas les libéraux qui se souviennent du passé.
Isolé, le catholicisme libéral s’amenuise. D’autres familles s’affirment qui l’éclipsent. Sa trace se perd presque complètement et il semble disparaître sans postérité.
Et pourtant la suite a donné raison à cette minorité suspectée et dénoncée. Un siècle plus tard, ses positions sont devenues celles du catholicisme tout entier. La
déclaration adoptée par le deuxième concile du Vatican sur la liberté religieuse (1965) consacre la recherche et les efforts des catholiques libéraux du XIXe siècle.
L’Église y reconnaît la valeur éminente de la liberté : elle renonce pour elle-même à un régime de privilège ; elle s’accommode du droit commun et ne demande que la
liberté de s’administrer elle-même et de prêcher l’Évangile. Du premier concile du Vatican au deuxième et du Syllabus à cette déclaration, le renversement est
complet. C’est aussi que, dans l’intervalle, la perspective d’ensemble s’est profondément modifiée. D’une part, le libéralisme s’est éloigné de ses sources anticléricales :
il a admis la liberté religieuse et ses prolongements au même titre que les autres libertés. D’autre part, la pratique a généralisé les conclusions que les catholiques
libéraux avaient au XIXe siècle tirées de quelques expériences positives aux États-Unis ou en Belgique. Surtout, l’approfondissement de la réflexion théologique, une
perception plus aigue et plus juste de la mission de l’Église ont révélé que la foi était inséparable de la liberté de la conscience. Aussi n’est-ce plus par une concession à
la nécessité des circonstances — l’hypothèse —, mais bien par une conformité fondamentale à une exigence intrinsèque de la vérité que la liberté est acceptée par le
catholicisme. Jean-Paul II souligne la convergence entre la conception chrétienne de l’homme et la défense des droits de l’homme. Ces deux causes qui ont longtemps
pu paraître adverses se sont aujourd’hui réconciliées.
Ainsi l’histoire du catholicisme libéral est-elle celle d’une poignée de précurseurs dont l’intuition, longtemps combattue comme prématurée, a obtenu la consécration
de l’universalité. C’est aussi l’extension d’une expérience d’abord limitée à des situations d’exception et devenue avec le temps la règle de nos sociétés.
Catholicisme social 1.
L’expression « catholicisme social » est relativement récente : elle n’a été reçue couramment en France que dans la dernière décennie du XIXe siècle. La réalité est
notablement plus ancienne : l’un de ses historiens, J. B. Duroselle, en fait remonter la première apparition en France à un article de Lamennais sur la démoralisation
ouvrière, paru en 1822 dans Le Drapeau blanc. Le retard du vocabulaire sur la réflexion et les tâtonnements entre plusieurs appellations, « économie chrétienne (ou
charitable) », « socialisme chrétien », illustrent les incertitudes d’une école qui a hésité avant de prendre conscience d’elle-même, ainsi que les résistances qu’elle a dû
vaincre avant d’imposer ses convictions et ses vues à l’ensemble des catholiques.
Si l’on enjambe la longue période des préparations pour aller d’emblée aux conclusions et si l’on fait — provisoirement — abstraction des nuances de pensée pour
dégager les composantes fondamentales de l’attitude des catholiques sociaux, on retiendra quelques orientations maîtresses.

Le catholicisme social se définit d’abord, logiquement et chronologiquement, par référence à ce qu’on appelle, au XIXe siècle, la question sociale, c’est-à-dire les
conséquences sociales de la révolution industrielle, le paupérisme, l’existence d’un prolétariat ouvrier misérable et livré sans défense aux rigueurs de la loi de l’offre et
de la demande. Cette condition préalable implique elle-même un commencement d’industrialisation ; elle requiert que des catholiques aient su reconnaître la nouveauté
du phénomène. La corrélation entre l’essor de l’industrie et l’apparition d’une école catholique sociale rend compte de la localisation territoriale de celle-ci : sa
géographie est circonscrite aux pays déjà touchés par le progrès technologique. Elle explique aussi, d’une certaine façon, la lenteur à prendre conscience de la
nouveauté et de l’ampleur du phénomène. Le catholicisme social est d’abord un sursaut de la conscience morale provoqué par la révélation de la misère ouvrière. Cette
relation avec le monde de l’industrie n’a pas empêché les catholiques sociaux de s’intéresser aussi à la condition paysanne ; leurs efforts se sont largement orientés vers
l’organisation de l’agriculture, le syndicalisme agricole ; certains d’entre eux ont même pensé trouver la solution de la question ouvrière dans le retour à la terre.
Un double refus
Refus du libéralisme
Après la reconnaissance de l’existence d’une question sociale vient la volonté d’y remédier. Le catholicisme social ne prend pas son parti de la situation : il ne la croit
pas irrémédiable ; la misère de la condition ouvrière n’est pas une fatalité. Il ne la justifie pas non plus, comme une transition nécessaire, par les résultats ultérieurs. Il
ne souscrit pas à la thèse libérale qui y voit la conséquence normale du libre jeu des mécanismes économiques. Il refuse d’incliner les exigences de la moralité, les droits
de la personne devant les nécessités de l’économie ou les impératifs du rendement. Il est donc revendication de la conscience morale, protestation volontariste au nom
de la liberté de l’homme de façonner son destin. Le catholicisme social — ce trait est particulièrement accusé à ses origines — se présente doublement comme
l’adversaire du libéralisme ; non seulement il en récuse les thèses et les maximes, mais il lui impute la responsabilité des maux qui affligent la condition ouvrière : la
libre concurrence érigée en règle, l’intérêt particulier élevé à la hauteur d’un principe, le culte du progrès ont engendré cette société inhumaine. Le catholicisme social
prend le contre-pied de l’individualisme qui inspire la pensée, l’économie et la société libérales. C’est au reste l’un des sens de l’épithète qui le qualifie que d’opposer
la préoccupation altruiste du groupe à l’égoïsme de l’individualisme libéral.
Refus du socialisme
Le refus de se résigner au désordre social et le procès du libéralisme ont engendré diverses orientations. À la même époque, le socialisme aussi procède de ces
mêmes refus. L’opposition aux écoles socialistes n’a pas moins contribué à constituer le catholicisme social que sa critique du libéralisme. Il ne pouvait évidemment que
rejeter le marxisme du fait de son postulat matérialiste, de son acceptation de la lutte de classes et de l’utilisation délibérée de la violence pour substituer à l’ordre
capitaliste une société présumée plus juste. Mais il ne s’oppose guère moins aux autres écoles socialistes, même celles qui se défendaient d’être matérialistes. Il refuse
de souscrire au procès qu’elles intentent au droit de propriété. À quelques exceptions près et qui relèveraient davantage du socialisme chrétien que du catholicisme
social — encore qu’au départ pareille distinction ne soit pas aisée à établir —, les catholiques sociaux sont profondément attachés à la défense de la propriété
individuelle : ils y voient le prolongement matériel de la personne et cherchent la solution de plusieurs des problèmes de la société moderne dans sa diffusion
généralisée et une transmission facilitée.
Devant la gravité et l’urgence de la question sociale qu’atteste au XIXe siècle l’universalité du péril révolutionnaire — le spectacle de la Commune a été décisif pour la
naissance de la vocation sociale d’un Albert de Mun et d’un La Tour du Pin —, les catholiques ont le devoir d’intervenir. Leur religion leur en fait une obligation de
conscience : « sociaux parce que catholiques », selon le mot d’ordre proposé à l’Association catholique de la jeunesse française par l’un de ses premiers présidents, Henri
Bazire. Ce faisant, le catholicisme social répudie à la fois la thèse libérale, qui réduit le fait religieux à la vie privée, et l’orientation théologique, qui déduit de
l’attachement exclusif au seul nécessaire une attitude d’indifférence à l’égard du monde et de ses problèmes. L’action des chrétiens doit prendre une forme nouvelle. La
charité traditionnelle est impuissante à résoudre la question que pose l’industrialisation : elle peut atténuer des souffrances, éveiller des dévouements, mais non
atteindre le mal à sa racine même.
Si les catholiques puisent dans leur foi le ressort de leur action, elle leur apporte aussi la réponse aux questions. L’Église détient en effet le secret d’un ordre social
juste et harmonieux. Le principe des solutions réside dans l’Évangile bien compris, interprété par le magistère et appliqué à la société. La conviction que le catholicisme
possède la clé de l’organisation de la société, que l’Église a compétence pour définir l’ordre idéal, qu’elle est qualifiée pour enseigner aux hommes les moyens de le
réaliser, est une des composantes du catholicisme social. Aussi va-t-il s’employer concurremment à élaborer une doctrine sociale inspirée des maximes de l’Évangile, à
obtenir du magistère sa reconnaissance et à en amorcer l’application.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%